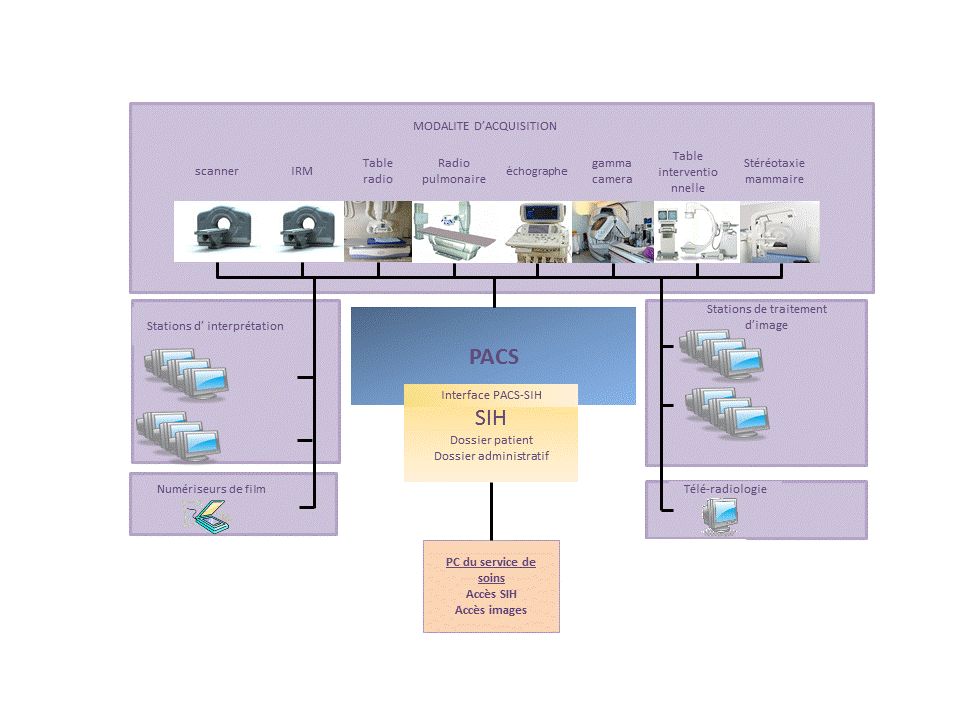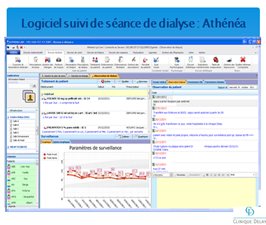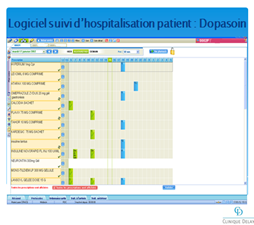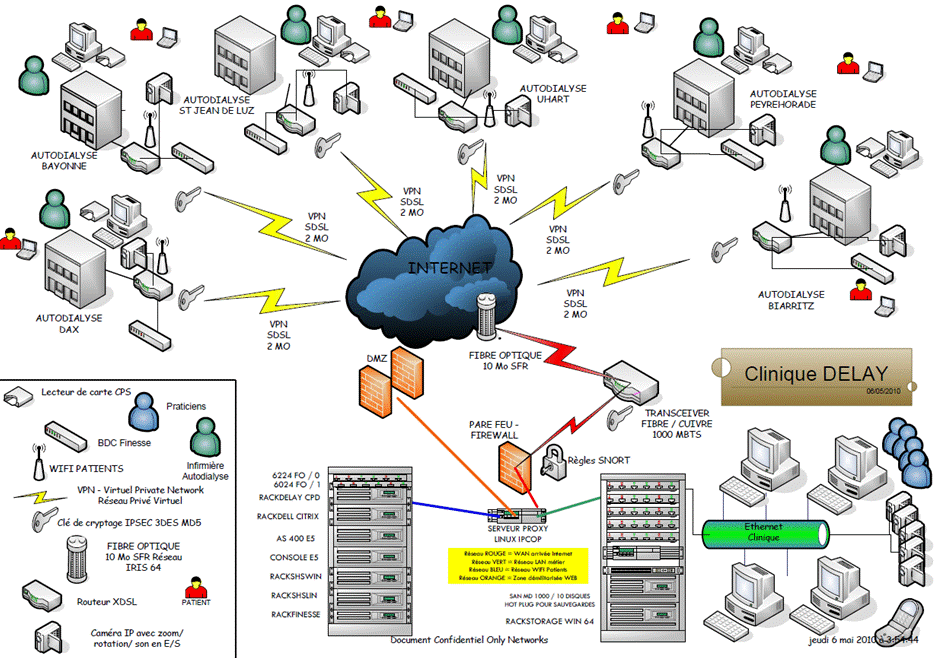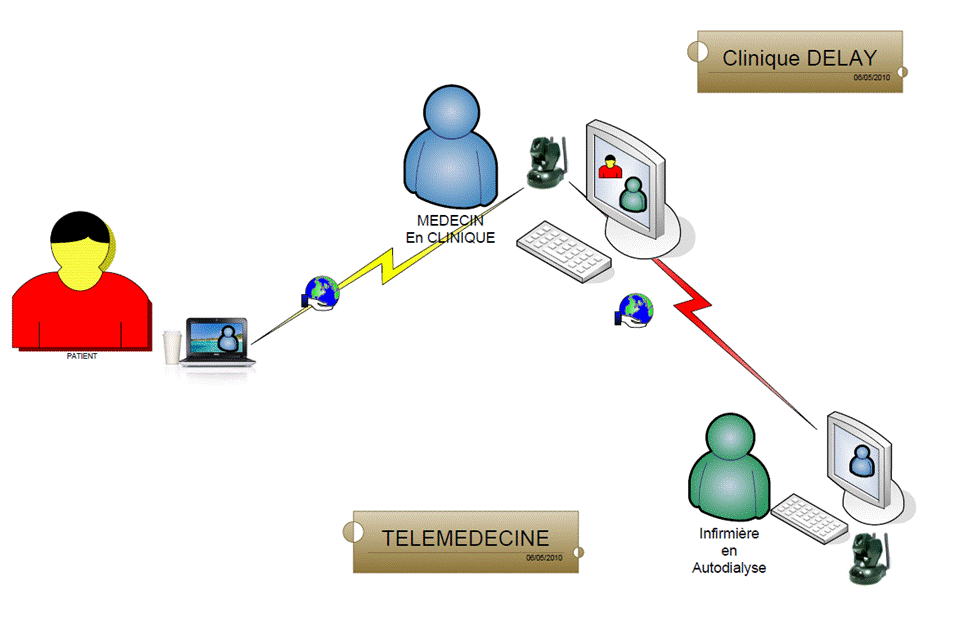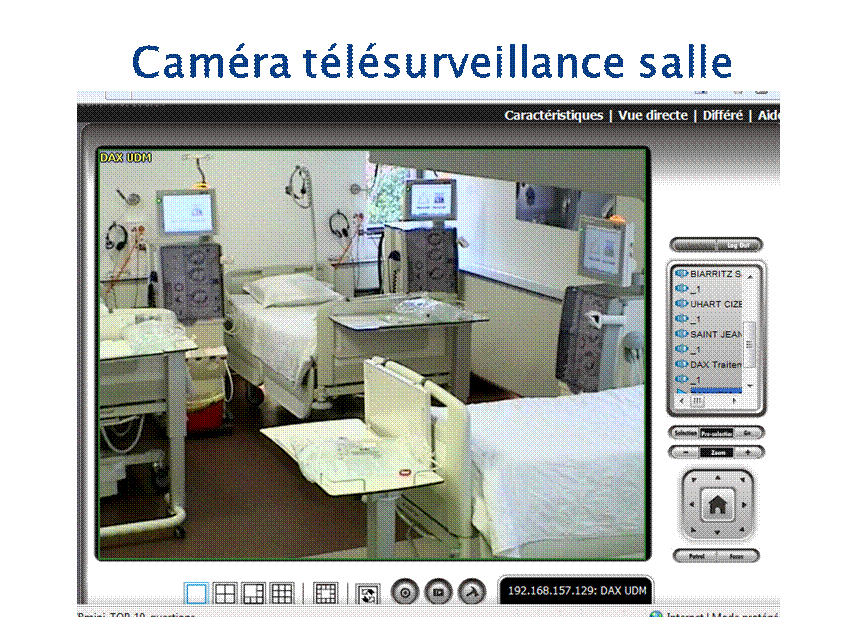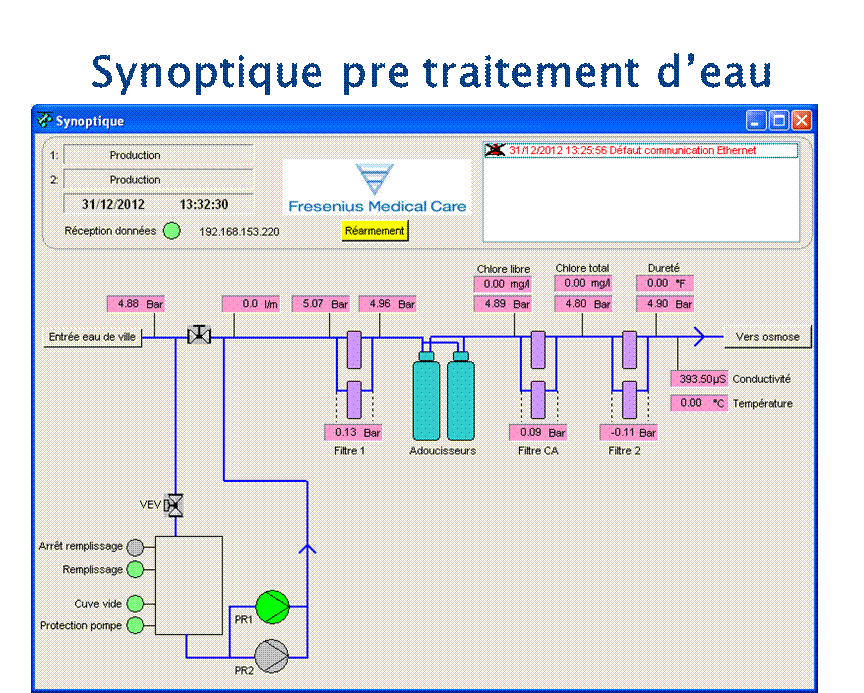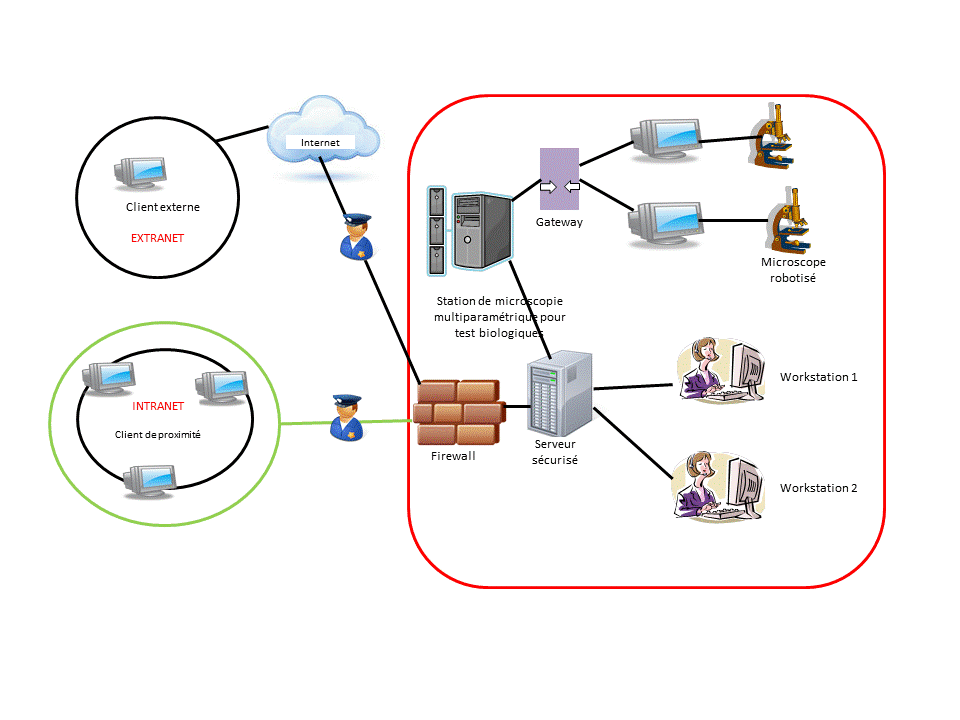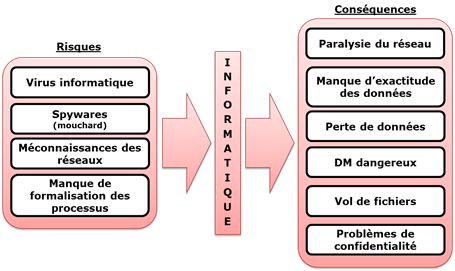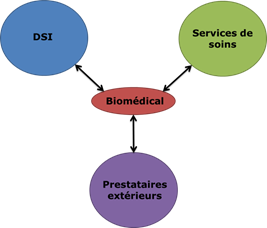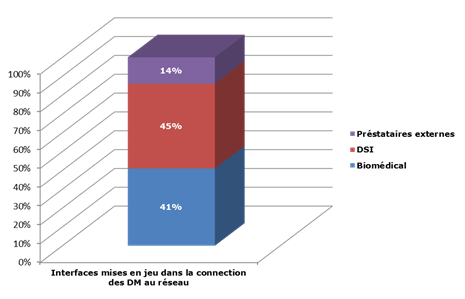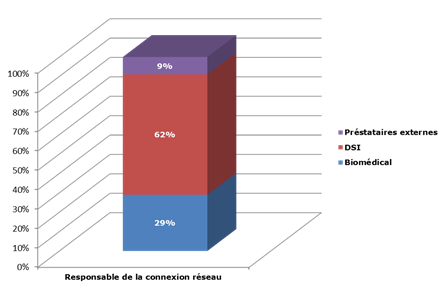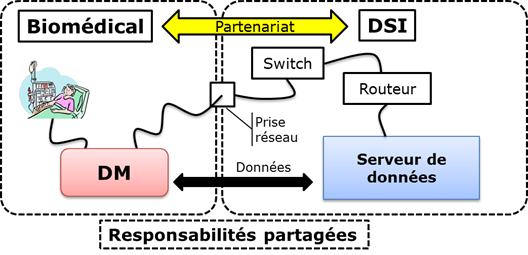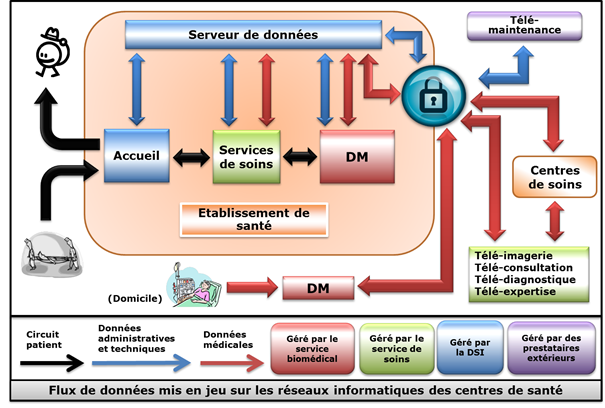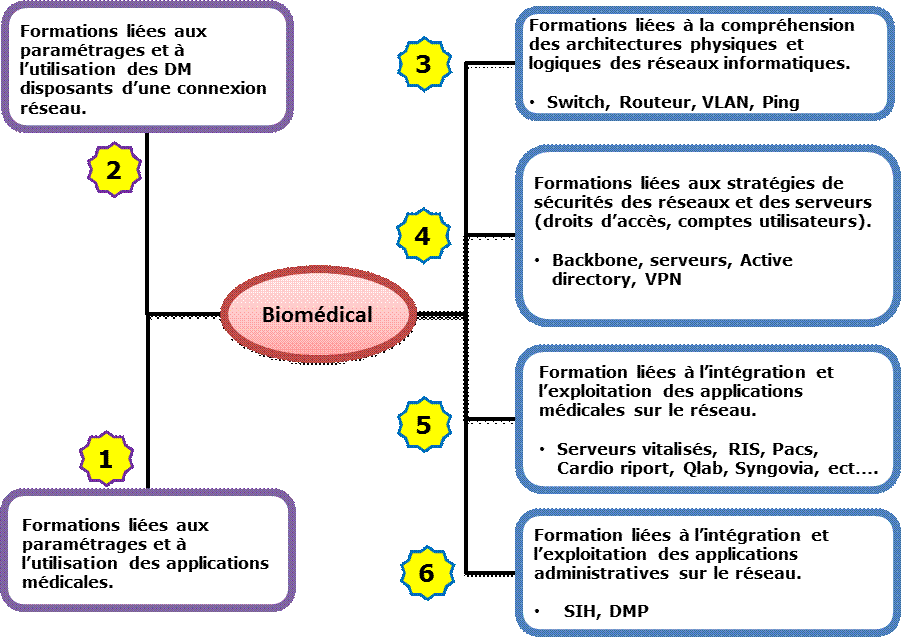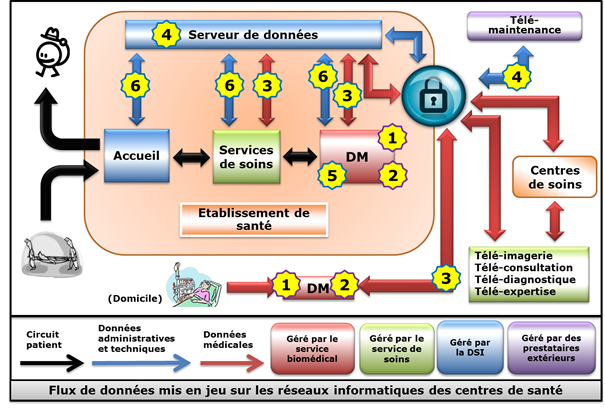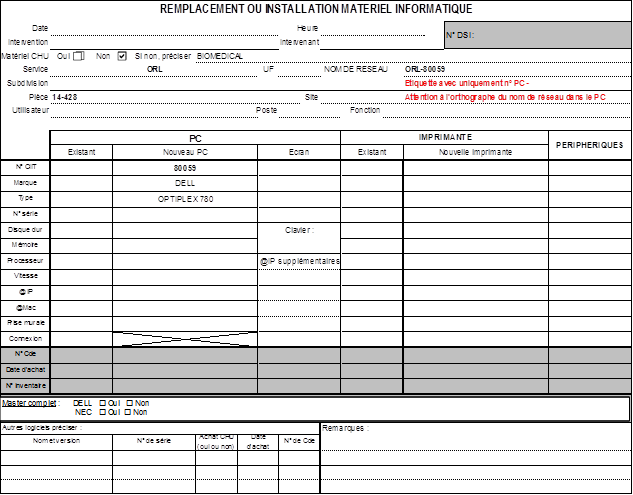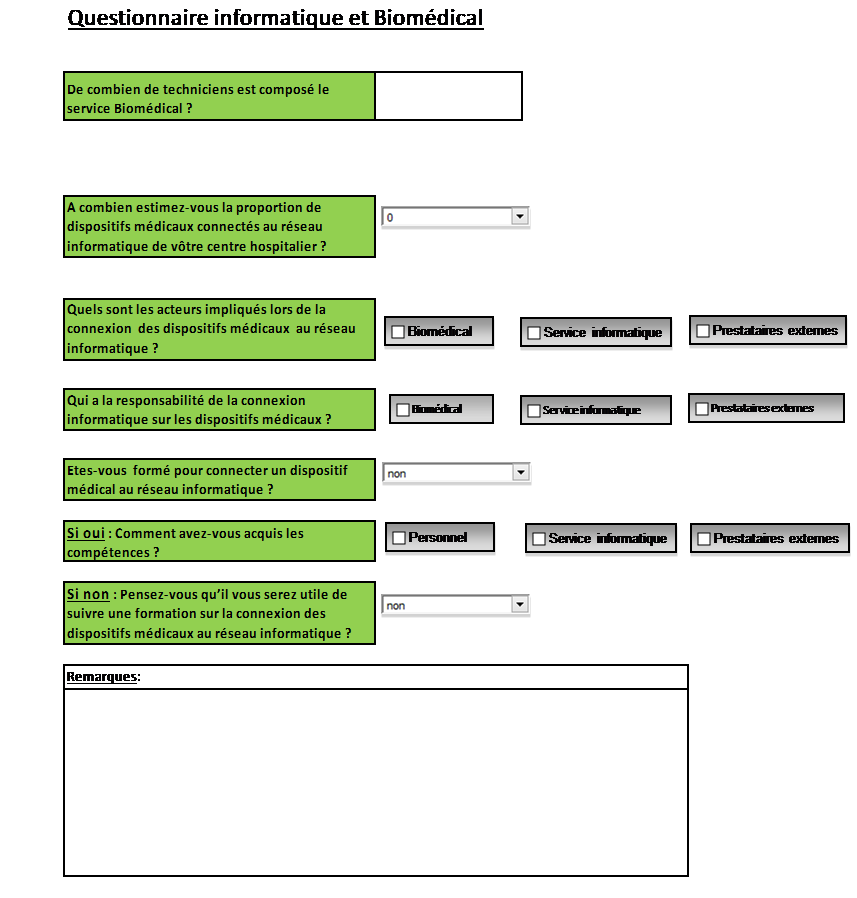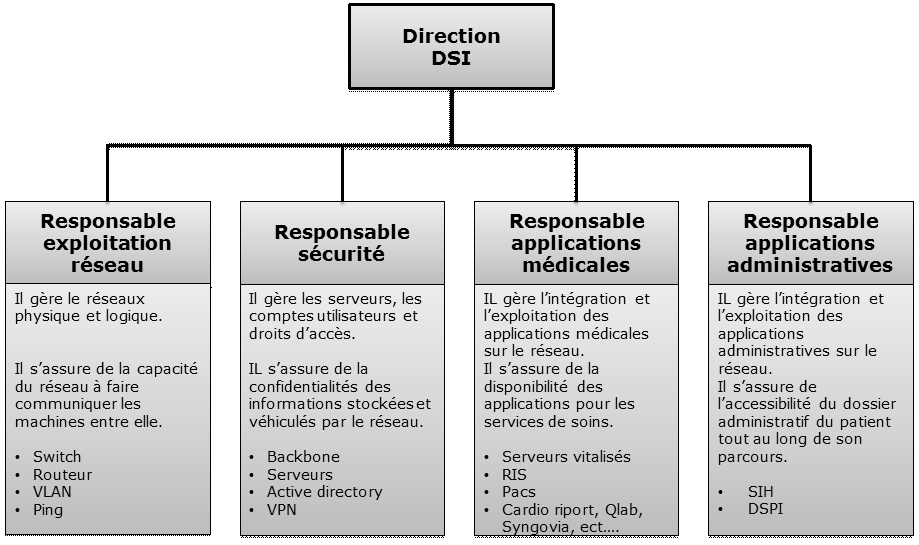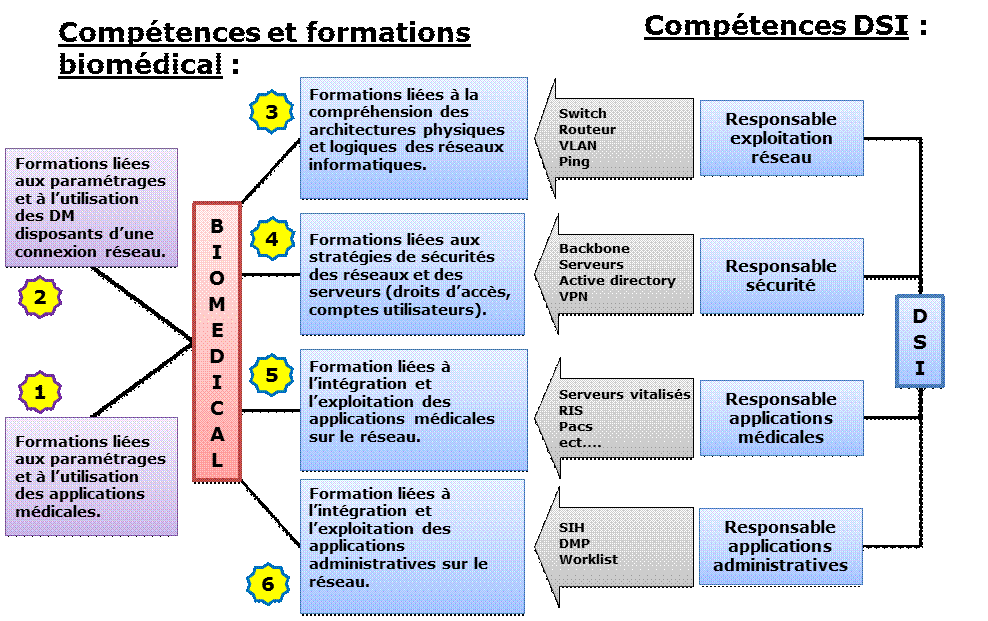|
Avertissement
|
Si vous arrivez
directement sur cette page, sachez que ce travail est
un rapport d'étudiants et doit être pris
comme tel. Il peut donc comporter des imperfections ou
des imprécisions que le lecteur doit admettre
et donc supporter. Il a été
réalisé pendant la période de
formation et constitue avant-tout un travail de
compilation bibliographique, d'initiation et d'analyse
sur des thématiques associées aux
technologies biomédicales. Nous ne
faisons aucun usage commercial et la duplication est
libre. Si vous avez des raisons de contester ce
droit d'usage, merci de nous en
faire part . L'objectif de la
présentation sur le Web est de permettre
l'accès à l'information et d'augmenter
ainsi les échanges professionnels. En cas
d'usage du document, n'oubliez pas de le citer comme
source bibliographique. Bonne lecture...
|
|
Information, informatique et dispositifs
médicaux, compétences et
formations pour les techniciens
biomédicaux
|
|

Sébastien
DEBRAY |
|
|
Référence
à rappeler : Information, informatique et
dispositifs médicaux,compétences et
formations pour les techniciens biomédicaux.
Sébastien DEBRAY, Flavien ZINGARETTI, Projet
d'intégration, Certification Professionnelle
ABIH, UTC, 2013
URL : http://www.utc.fr/abih
; Université
de Technologie de Compiègne
|
RESUME
L’évolution
des
technologies dans le domaine de la santé
améliore la prise en charge du patient et
contribue très largement au diagnostic des
pathologies.
Aujourd’hui,
de
plus en plus de dispositifs médicaux sont
connectés aux réseaux informatiques de
santé.Toutes
ces évolutions obligent le technicien
biomédical à faire évoluer ses
compétences pour maitriser la gestion des
dispositifs médicaux connectés au
réseau.
L’objet de notre projet est de déterminer les
compétences et les formations
nécessaires et de proposer des actions
à mener pour permettre de garantir la
sécurité et la qualité de soins
délivrés aux patients.
Mots clés : biomédical,
information, informatique, formation, réseau de
santé.
|
|
ABSTRACT
The evolution of
technologies in network of health improves patient and
contributes greatly to the pathologies diagnostic.
Today, increasingly of medical devices are connected to
computer networks health.All these changes require the
biomedical technician to evolve knowledge to master
management of medical devices connected to the network.
The project is to evaluate the competence and training
needed and propose actions to help ensure the safety and
quality of patient care.
Key words : Biomedical, communication, software
, networks health.
|
Remerciements
Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour nous
avoir accompagnées tout au long de notre projet:
M. Gilbert FARGES, enseignant chercheur, responsable de la
formation Assistant Biomédical en Ingénierie
Hospitalière (ABIH) à l’Université
Technologique de Compiègne.
M. Pol Manoël FELAN, responsable pédagogique de la
formation Assistant Biomédical en Ingénierie
Hospitalière (ABIH) à l’Université
Technologique de Compiègne pour sa présence
quotidienne et son aide.
M. Alain DONADEY, ingénieur, chef de projet à
l’Université Technologique de Compiègne et tuteur de
ce projet.
M. KIRCH Stéphane, ingénieur biomédical au
Centre Hospitalier W. MOREY (Chalon-sur-Saône), M. Eric
LAMBURE, technicien biomédical à la clinique DELAY
(BAYONNE), M. François BODECOT, technicien
Biomédical au centre hospitalier de BEAUVAIS pour nous
avoir fait bénéficier de leurs travaux et de leurs
expériences.
L’ensemble des intervenants.
L’ensemble de la promotion ABIH 2013 pour la bonne humeur
quotidienne au sein du groupe.
Sommaire
Retour
sommaire
Introduction
De nos jours, les technologies
pour la santé sont de plus en plus présentes dans le
milieu médical et singulièrement dans le milieu
hospitalier. Leur importance est souvent sous-estimée alors
que l’imagerie, l’anesthésie, la chirurgie et la biologie
leur doivent leur efficacité actuelle. L’objet de notre
projet est de présenter une vision des évolutions
dans le domaine de l’informatique médicale et des
réseaux afin de faire apparaitre les nouvelles
compétences aux quelles le technicien biomédical
devra faire face pour garantir la maitrise et la
sécurité des dispositifs médicaux et ainsi
assurer des soins de qualités aux patients.
Glossaire
BACKBONE : Une dorsale Internet est un réseau
informatique faisant partie des réseaux longue distance de
plus haut débit d'Internet (grosse architecture)
CNIL : Commission nationale de l'informatique et des
libertés
DM : Dispositif médical
DMP : Dossier Médical Personnel
DSI : Direction des systèmes d’informations
FIRMWARES : micro-logiciel ou microcode, c’est un ensemble
d'instructions et de structures de données qui sont
intégrées dans du matériel informatique
HACKER : Pirate informatique
HAD : Hospitalisation à domicile
IP : Protocole Internet
LAN : Local Area Network, en français réseau
local
MALWARES : Englobe les virus, les vers, les chevaux de
Troie
PACS : Picture archiving communication system
PING : Outil informatique permettant de tester
l'accessibilité d'une autre machine à travers un
réseau IP
ROUTEUR : Elément intermédiaire dans un
réseau informatique assurant le routage des paquets.
RIS : Radiology information system
RSSI : Responsable de la sécurité des
systèmes d'information.
SIH : Système d’information hospitalier
SIR : Système d'information radiologique
SPYWARES : Logiciel espion
SWITCH : Commutateur réseau
VIRUS : Logiciel malveillant
VLAN : Virtuel LAN, réseau local (sous-partie d’un
LAN)
VPN : Virtual Private Network, réseau privé
virtuel
I.
Description de la situation
A.
Contexte
Actuellement de plus en plus de dispositifs médicaux sont
connectés aux réseaux informatiques hospitaliers.
Leurs avantages sont multiples et leurs domaines d’applications ne
cessent d’augmenter, que ce soit en intranet ou en extranet. On
les retrouve tout au long de la chaine de soins du patient et ils
mettent en jeu de multiples acteurs.
Tous utilisent le même réseau informatique mais avec
des attentes et des outils différents.
On dissociera deux aspects sur le réseau :
- Les aspects techniques et logistiques
Pour ce qui est de l’informatique de gestion, de nombreuses
solutions existent et sont déjà bien ancrées
au sein des établissements de santé. Ce qui est plus
récent, c’est l’interconnexion de ces applications avec
l’informatique dite médicale.
Définition : L'informatique
médicale est l'application des techniques issues de
l'informatique au domaine médical.
L’informatique médicale permet le
traitement et le stockage de l'information médicale.
« La pratique d'une médecine
moderne et de qualité ne peut être dissociée
d'un traitement rationnel de l'information médicale. En
effet, la complexité croissante de la médecine
occidentale actuelle (spécialisation des médecins,
quantité d'informations à traiter, optimisation de
la posologie des médicaments, guides de bonnes pratiques,
etc.) pousse de manière naturelle à la mise en
place de systèmes d'informations robustes étant
capables d'aider le praticien dans ses tâches quotidiennes
» (source Wikipédia).[1]
On remarque que certaines
spécialités ont été précurseurs
dans l’utilisation de ces nouvelles technologies. La
majorité des dispositifs médicaux connectés
au réseau se situe dans l’imagerie médicale et les
laboratoires. Mais de plus en plus de services de dialyse
connectent leurs dispositifs médicaux (DM)
ainsi que depuis peu les blocs opératoires et services de
réanimation. On les retrouve également au domicile
des patients pour les hospitalisations à domicile (HAD).
L’augmentation de la capacité d’échange sur les
réseaux informatiques (débit) a permis de modifier
la pratique de la médecine et a ouvert de nouvelles
perspectives en s’affranchissant des distances. On parle
aujourd’hui de télé-imagerie, de
téléconsultation, de télédiagnostic,
de télé-expertise et de
télé-chirurgie.
Au cours de nos recherches nous n’avons trouvé que peu
d’informations pour établir une réelle cartographie
de la situation. Il n’existe pas d’études
quantifiées déterminant le nombre de DM connectés aux réseaux
informatique. Nous nous sommes donc principalement basés
sur nos expériences et nos échanges avec la
communauté Biomédicale pour établir cet
état des lieux.
Les modes d’organisations des services biomédicaux pour la
gestion de ses DM connectés au
réseau sont très disparates suivant les
établissements de santé. Ils sont fonction de la
taille de l’établissement, du nombre de DM connectés et surtout du niveau
de formation des techniciens biomédicaux.
B. Problématique
et enjeux
1)
Evolution des
compétences du technicien biomédical
Le profil et les compétences du technicien
biomédical ont considérablement évolué
depuis sa création. En 50 ans, ils ont connus plusieurs
avancées technologiques majeures.
Avec l’arrivée des premiers composants électroniques
dans les DM, il fallait être
capable de diagnostiquer les composants défaillants sur les
cartes électroniques et les remplacer.
Puis sont arrivés les composants multicouches avec
l’impossibilité de dépanner au composant et
nécessitant le remplacement de la carte défaillante.
Aujourd’hui, on considère comme dispositif médical
tous les logiciels et applications utilisées à des
fins médicales (Article L5211-1 du code de la santé
publique).[2]
L’omniprésence de l’informatique et l’utilisation des
réseaux informatiques pour le transfert des données
amènent à se poser la question des nouvelles
compétences que le technicien biomédical doit
acquérir pour mener à bien les missions qui lui sont
confiées.
La formation des techniciens biomédicaux tout au long de
leur carrière (en tenant compte des avancées
technologiques) est un enjeu majeur pour garantir la maitrise et
la sécurité des DM.
2)
Dispositifs
médicaux et informatiques
On trouve des dispositifs médicaux connectées au
réseau l’informatique dans des services tel que :
- L’Imagerie Médicale
- La suppléance fonctionnelle
- Les laboratoires
- Les blocs opératoires
- Les services de soins critiques et
généraux
L’imagerie Médicale
L’imagerie médicale a profondément
modifié la prise en charge des patients et des maladies.
Depuis les années 1970, Scanner, Médecine
Nucléaire, Ultra-Sons, IRM, TEP, imagerie fonctionnelle et
aujourd’hui imagerie moléculaire ont transformé la
sémiologie et ont contribués à la
connaissance des pathologies.
Tous ces dispositifs sont connectés au réseau
informatique de santé.
Les réseaux d’imagerie ont plusieurs objectifs :
- Interconnecter les différents
équipements d’imagerie médicale
- Communiquer rapidement les images
à l’intérieur et à l’extérieur des
établissements de santé
- Partager l’imagerie avec les
différents médecins en charge du patient
Deux éléments interviennent pour structurer un
réseau d’imagerie :
Radiology Information System ou Système
d’Information en Radiologie est un système
réseautique de gestion des documents et des
activités du service de radiologie.
Le PACS (Picture Archiving and Communication
System) est un système de gestion électronique des
images médicales avec des fonctions d'archivage, de
stockage et de communication rapide. Il offre une perspective de
développement des réseaux d’imagerie à grande
échelle et sur le long terme.
Les principales fonctions du PACS sont de centraliser et de
gérer :
- L’acquisition numérique
de tous les examens radiologiques
- La consultation d’examens radiologiques
sur des stations ou consoles de
visualisation
- Le diagnostic sur des consoles
dédiées
- Le partage et l’envoi d’images dans et
en dehors du service ou de l’hôpital
- L’échange d’informations
administratives avec les systèmes informatiques
radiologiques (RIS) et hospitaliers (SIH)
- Le système RIS/PACS,
intégré au SIH
(Système Informatique Hospitalier)
Cela permet de constituer le dossier d’imagerie médicale,
outil structurant pour le dossier patient. En favorisant la
communication entre les praticiens autour de l’imagerie et plus
généralement du dossier patient auquel l’image doit
être intégrée, il améliore ainsi la
qualité des soins.
Suppléance fonctionnelle
L’application de l’informatique dans les services de soins tels
que la dialyse a permis d’améliorer la prise en charge
thérapeutique mais également la surveillance des
patients qu’ils soient dans le service de dialyse de
l’établissement ou dans un centre distant ou
même au domicile du patient dans le cas de dialyse à
domicile (HAD).
L’informatique permet de limiter les déplacements des
médecins, du personnel de soin et des techniciens
biomédicaux. Il donne un accès immédiat
à différentes informations nécessaires au bon
déroulement et à la surveillance des séances.
Prenons l’exemple de la clinique DELAY, un centre de
néphrologie et d’hémodialyse que nous avons pu
découvrir grâce à Mr LAMBURE Eric
étudiant en DUT Dialyse à l’UTC de Compiègne.
Dans cet établissement, les générateurs
de dialyse sont connectés au réseau informatique.
Cette connexion leur permet de centraliser les différentes
données de chacun des générateurs sur un
poste déporté. Sur ce poste sont installés
des logiciels d’applications médicales qui permettent :
- le suivi et l’archivage des
séances de dialyse (logiciel athénéa).
- Le suivi des hospitalisations des
patients (logiciel Dopasoin).
- Le suivi des résultats de
laboratoire (logiciel Solenis).
- Le suivi des résultats d’examens
de radiologie (logiciel Paxradio).
- De plus avec ces nouvelles technologies,
ils ont également pu développer :
- la télémédecine
- la téléconsultation
- la téléassistance
- la supervision des installations des
différents établissements.
La
télémédecine :
Elle permet au personnel soignant de gérer le suivi et la
surveillance des séances de dialyse de 6 autres centres
d’auto dialyse de proximité.
Avec cette technologie, il assure les soins et le suivi
médical de 225 patients dans les mêmes conditions que
dans leur centre.
L’équipe biomédicale centralise et gère un
parc de 102 générateurs.
La
téléconsultation :
Elle assure aux patients en séance la possibilité de
consulter le médecin par le biais d’un ordinateur
équipé d’une caméra et d’un casque.
Le médecin peut répondre aux besoins du patient
même si il ne se trouve pas à proximité de
celui-ci.
La
téléassistance :
Les techniciens de dialyse peuvent garantir la
sécurité, la traçabilité et le bon
fonctionnement des équipements, via la
téléassistance et la supervision.
La téléassistance est composée de cameras :
- dans les salles de dialyse
- dans les locaux techniques
Cela leur permet une visualisation de
l’état des différents dispositifs médicaux,
et ainsi de pouvoir renseigner le personnel soignant des
éventuelles manipulations à effectuer en cas de
dysfonctionnement mineur. Mais également d’optimiser le
diagnostic des dysfonctionnements éventuels et d’assurer
une intervention rapide et de minimiser l’indisponibilité
du DM.
La supervision
technique :
La supervision des équipements des
installations est aussi assurée par des logiciels qui
permettent de centraliser les différentes données de
fonctionnement et de rendre optimale la traçabilité
et le suivi des équipements de tous les centres
connectés.
Le technicien biomédical supervise :
- les unités de traitement d’eau
- les groupes électrogènes
- les onduleurs informatiques
- les climatiseurs
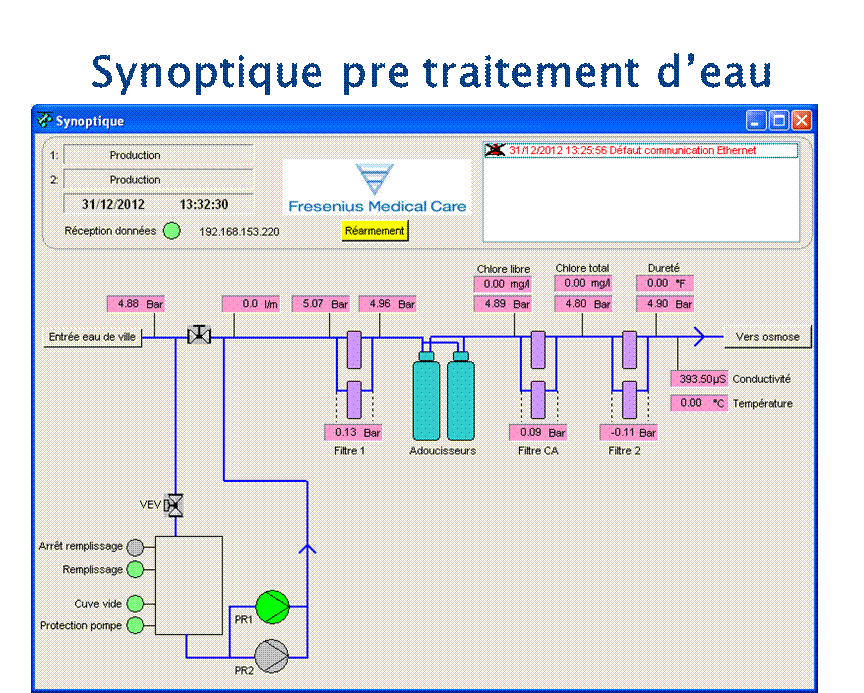
|
| Figure 18: supervision
prétraitement d'eau (Clinique DELAY) |
L’informatique a permis une optimisation des soins et de la prise
en charge apportés au patient.
Elle améliore les conditions de travail des praticiens et
du personnel soignant.
Elle permet une surveillance et une gestion efficiente des
installations et des dispositifs médicaux.
Les laboratoires
L’augmentation des demandes de diagnostic
biologique favorise l’apparition d’automates de plus en plus
rapides et fiables au sein des laboratoires d’analyses
médicales.
Dans les laboratoires d’analyses médicales, l’informatique
intervient sous deux aspects :
L’informatique technique qui permet la communication des automates
d’analyses entre eux et tout au long de la chaine d’analyse.
L’informatique de gestion qui intervient dès la demande de
l’examen, jusqu’à la mise à disposition du
résultat dans le cadre d’un dossier patient
informatisé.
L’informatique assure la gestion des échantillons, des
résultats ainsi que des instruments.
- Gestion des échantillons sur une
chaine d’automate en fonction des données de
l'informatique centrale (liste de travail)
- Transfert des données vers
l'informatique centrale ou les appareils d'analyse
- Transfert des résultats d'analyse
vers l'outil de gestion
- Transfert des résultats
directement au service de soin
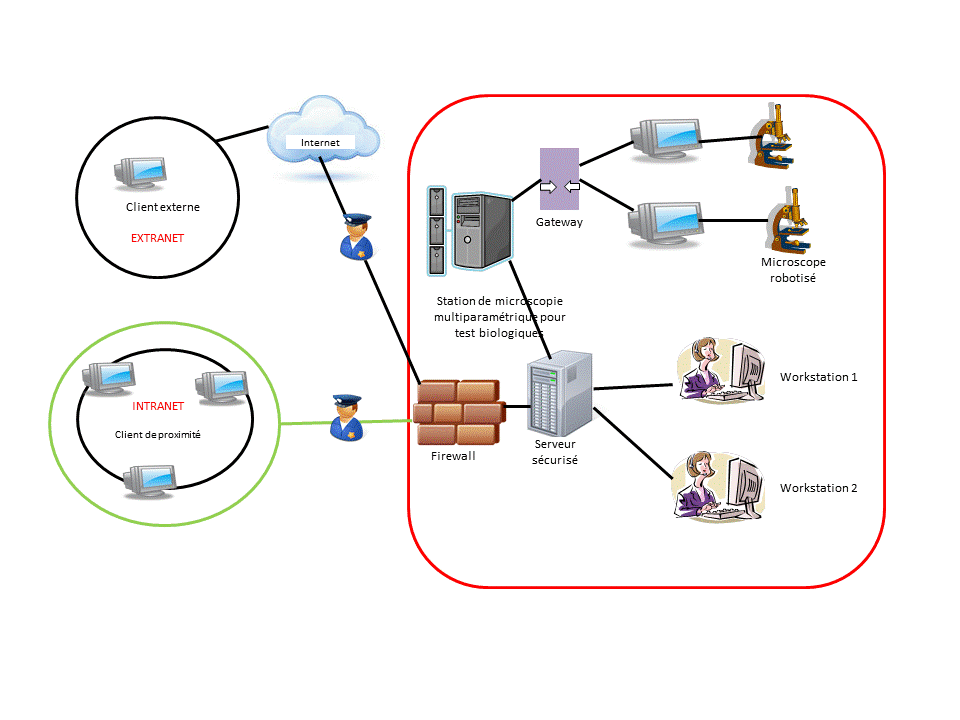
|
| Figure 7: Exemple d’architecture réseau d’un
laboratoire d’analyse |
Les blocs opératoires
L’informatisation des blocs opératoires est une
évolution récente, elle améliore les
pratiques chirurgicales, en aménageant de façon
optimale les salles d'opérations pour la réalisation
d'interventions invasives ou conventionnelles.
Elle s’adapte de manière individuelle aux besoins
spécialisés ou interdisciplinaires. Ce concept de
salle d'opération intégrée propose des
solutions pour chaque exigence liées à
l'activité grâce à un aménagement du
poste de travail de la salle d’opération.
Prenons l’exemple du centre hospitalier W.MOREY de
Chalon-sur-Saône qui a profité d’un changement de
site pour intégrer l’informatique médical dans ses
blocs opératoires.
Une réflexion commune a commencé en 2009 avec la
constitution d’un groupe projet piloté par le service
biomédical et incluant la DSI,
les soignants, les prestataires externes et les services
généraux. Ils ont ainsi pu constituer un cahier des
charges répondant fidèlement à toutes leurs
attentes en plaçant le patient au centre de la
réflexion.
Le concept de blocs opératoires intégré
équipé de stations numériques
multimédia permet d’afficher, de distribuer, d’enregistrer,
de diffuser et d’archiver les vidéos, les images et les
données médicales.
- Système vidéo qui permet
d’acquérir des vidéos de différentes
natures
•
radiologiques
• ultrasonores
• caméras
vidéo
• caméras
endoscopiques
• baie
d’électrophysiologie
• pc de diverses
origines
- Système de commande des appareils
et des systèmes périphériques issus
d'autres fabricants
- Système Intégration des
appareils d'endoscopie
- Système d’applications
multimédia pour la communication audio et vidéo
(médecine télé-assistée)
- Système d’enregistrement
numérique de photo ou de vidéo en continu
- Système de
visioconférences ou de la vision de vidéo en
streaming.
Ces interfaces interagissent avec le SIH et le PACS
L’ensemble des fonctions est géré à partir
d’un écran tactile grâce à une interface
très simple et intuitive. De cet écran de commande
chaque source vidéo est distribuée sur un ou
plusieurs écrans présents en salle
d’opération.
Les avantages procurés par le bloc intégré
vont permettre :
- De simplifier les tâches
grâce à la commande intuitive des appareils
- De réduire le temps
d'équipement de la salle et le changement des
instruments
- D’optimiser la restitution des images
grâce aux différents systèmes de
caméras et d’autres sources de signaux
- De réduire les coûts
grâce à des interventions optimisées
- D’améliorer les soins
délivrés aux patients
Services de soins critiques
Dans les services de soins critiques où le monitorage des
patients est une nécessité, les dispositifs de
monitorage sont reliés au réseau informatique.
Cette interconnexion permet de centraliser l’ensemble des
données des patients sur une centrale de surveillance, et
ainsi d’optimiser la surveillance des patients. Les données
du DM sont consultables sur n’importe
quels postes déportés ou dans le poste de soin.
Grace à son interconnexion au réseau informatique,
la centrale de surveillance renseigne le dossier patient des
données recueillies. Ces systèmes sont
recensés dans les services où une surveillance des
patients est essentielle.
On les retrouve :
- en cardiologie
- en réanimation
- en néonatologie
- en salles de naissance
Chacune des salles d’accouchement et de pré-travail du
centre hospitalier de Beauvais sont équipées de
système de monitoring relié au réseau
informatique hospitalier. Cette interconnexion permet de
centraliser les informations des patients du service et ainsi
d’optimiser leur surveillance. Les données de chaque
patient sont archivées et incrémentent le dossier
patient, pour assurer un suivi optimisé.

|
| Figure 8: Centrale de surveillance (CH BEAUVAIS) |
Les services de médecine générale
Dans les services de médecine générale,
l’informatique a permis d’optimiser le renseignement du dossier
patient, grâce à des équipements
connectés directement sur le DM
mobile.
Cette interface permet de recueillir et de transmettre
automatiquement les constantes, du chevet du patient vers le SIH.
Reprenons l’exemple du centre Hospitalier de Beauvais où ce
système est en cours de développement dans le
service de cardiologie. Ce dispositif est connecté à
un tensiomètre électronique via une connexion RS
232.
Ce système s’appelle capsule neuron, il est
paramétré avec la workliste du service, ainsi le
personnel soignant sélectionne le nom du patient dans cette
liste et effectue la prise des constantes. A la fin du soin, le
personnel soignant envoie les données recueillies au SIH par une simple commande sur le
dispositif.
Les données sont transmises par wifi au réseau
hospitalier.
Cette évolution technique a permis de rendre efficiente la
transmission des informations sur le dossier patient, mais
également d’éviter les erreurs de saisie
éventuelles et d’optimiser les pratiques du personnel
soignant en simplifiant la retranscription des
données.

|

|
3) Les avantages liés
à l’informatique
L’informatique contribue à l’efficience des soins
délivrés au patient tout au long de la chaine de
soins.
Les aspects médicaux :
- l’optimisation du diagnostic du
praticien par l’utilisation de logiciels
d’interprétations poussés dans le domaine de
l’imagerie par exemple.
- la surveillance à distance des
paramètres médicaux dans l’hôpital et au
domicile du patient (HAD).
- l’optimisation des moyens de
communications facilitent les échanges entre les
personnels soignants. Ils peuvent solliciter l’avis d’un
spécialiste en cas de doutes sur un diagnostic
(télé-expertise).
Les aspects techniques et
logistiques :
- le suivi administratif du patient (SIH).
- la virtualisation des applications
médicales
- la diminution du support papier
- le stockage des données
médicales
- l’accessibilité rapide aux
données médicales
Les aspects formations et
recherches :
- Mutualisation des ressources pour la
recherche
- Augmentation des capacités de
formation (téléconférence)
4)
Les risques liés
à l’informatique
L’informatique contribue à l’efficience des soins mais peut
aussi être générateur de risques.
La sécurité est un enjeu stratégique majeur
pour l’hôpital. Le réseau informatique doit garantir
l’accès et l’échange de toutes données
médicales utiles au personnel soignant pour assurer sa
mission de soin tout en garantissant la sécurité et
la confidentialité des données médicales.
Risques liés
à la cybercriminalité :
Les tentatives d’intrusion des hackers sur les réseaux
informatiques de santé sont une réalité.
Pour exemple le virus Conficker a
paralysé plusieurs hôpitaux français entre
Janvier et Juillet 2009 et plus récemment les laboratoires
de Bitdefender indiquent que le risque d’attaques contre des
appareils médicaux tels que les défibrillateurs, les
pacemakers, les pompes à insuline et autres
équipements commandés par des logiciels est en
hausse en raison de l’évolution «
cybercriminelle » des techniques de piratage. [9]
En septembre 2012, The Government Accountability Office (GAO),
l'équivalent américain de la Cour des Comptes
française, signalait des vulnérabilités au
sein des appareils médicaux informatisés en raison
de logiciels et de firmwares non mis à jour. Sans parler
des attaques ciblant l’équipement médical et les
hôpitaux, qui elles, représentent un risque encore
plus grand, puisque la sécurité sur place est
toujours insuffisante face à ce type d’attaques.
Comptent parmi les cyber-attaques médicales les plus
courantes, le piratage Wifi, les spywares
installés via des prises réseau dans les
hôpitaux ainsi que les malwares
pouvant écraser ou endommager des données. [10]
Risques liés aux
méconnaissances :
Les problèmes de confidentialité ne sont pas
uniquement liés à la cybercriminalité.
Ils peuvent également provenir d’une absence de
formalisation des processus liés à la
sécurité ou d’une méconnaissance du
fonctionnement des réseaux informatiques.
Un article du journal « Le monde »du 5
février 2013 explique comment au hasard de ses recherches
le site Actu soins a découvert que de
nombreuses données médicales confidentielles
étaient en ligne, accessibles par une simple recherche dans
Google. [11]
Il y a également des risques liés au stockage et
à l’inexactitude des informations transmises :
La vie d’un patient peut dépendre de la
disponibilité immédiate et de l’exactitude des
informations transmises.
Tous ces exemples montrent l’importance d’être vigilant et
de clairement formaliser les stratégies de
sécurité.
C. Aspects
réglementaires et normatifs
1) Législation
Selon
l’article 1 de la Directive 93/42/CEE
modifiée par la Directive 2007/47/CE du Parlement
européen : [4]
Est défini comme dispositif médicale tout
instrument, appareil, équipement, logiciel,
matière ou autre article,
utilisé seul ou en
association, y compris le logiciel destiné par le
fabricant à être utilisé spécifiquement
à des fins diagnostique et/ou thérapeutique, et
nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci,
destiné par le fabricant à être utilisé
chez l'homme à des fins:
- de diagnostic, de prévention, de
contrôle, de traitement ou atténuation d'une
maladie
- de diagnostic, de
contrôle, de traitement,
d'atténuation ou de compensation d'une
blessure ou d'un handicap.
- d'étude ou de
remplacement ou modification de
l'anatomie ou d'un processus physiologique
- de maîtrise de la conception
Et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain
n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou
immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction
peut être assistée par de tels moyens.
Pour les dispositifs incorporant des logiciels ou qui sont eux
même des logiciels médicaux, la validation du
dispositif médical devra prendre en compte le cycle de
développement, de gestion, de validation et de
vérification du logiciel. La validation et la
vérification du logiciel devront se faire en fonction des
risques associés au dispositif médical.
Dans le cas d’un système d’information fonctionnant en
réseau, les différents dispositifs médicaux
constitutifs de ce réseau devront être validés
séparément et non ensemble. Chacun des composants du
réseau devra être marqué CE
indépendamment des autres éléments avec
lesquels il peut être connecté.
Le logiciel informatique commandant un dispositif médical
ou agissant sur son utilisation relève automatiquement de
la même classe.
Concernant les logiciels autonomes, il n’existe pas de
mécanisme obligatoire qui rattacherait tous les logiciels
à une même classe. Il faut vérifier au cas par
cas.
Tout logiciel autonome est considéré comme un
dispositif médical actif.
Cette directive vise à harmoniser les
caractéristiques de sécurité, de protection
de la santé ainsi que les performances des dispositifs
médicaux et les procédures de certification et de
contrôle relatifs à ces dispositifs car ils
diffèrent d'un État membre à l'autre; ces
disparités constituent des entraves aux échanges
à l'intérieur de la Communauté.
La loi 78-17 du code de la santé public : [5]
Elle a été modifiée par la loi3 du 6
août 2004 afin de transposer en droit français les
dispositions de la directive 93/42/CE
Elle a défini les obligations en terme de protection des
données personnelles et à la libre circulation des
données.
Cette loi est relative à l’information, aux fichiers et aux
libertés. Elle régit le type d’information
exploité dans les dossiers.
Elle protège les personnes des éventuels risques
liés à la publication volontaire ou involontaire
des données, mais également des recours
liés a ses fichiers ainsi que de l’archivage des
données collectées. Cette loi a été
modifiée par des directives européennes qui a :
- défini les obligations en terme
de protection des personnes, des données.
- défini les recommandations
liée à l’archivage.
Article L5211-1 du code de la santé publique,
relatif aux dispositifs médicaux [2]
On entend par dispositif médical tout instrument,
appareil, équipement, matière, produit, à
l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article
utilisé seul ou en association, y compris les accessoires
et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci,
destiné par le fabricant à être utilisé
chez l'homme à des fins médicales et dont l'action
principale voulue n'est pas obtenue par des moyens
pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais
dont la fonction peut être assistée par de tels
moyens.
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) [6]
Elle est chargée de veiller à ce que l’informatique
soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni
à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni
à la vie privée, ni aux libertés
individuelles ou publiques.
La CNIL est une institution
indépendante chargée de veiller au respect de
l'identité humaine, de la vie privée et des
libertés dans un monde numérique.
2)
Normes
La norme ISO/CEI/27799
[7]
Elle fournit des lignes directrices permettant
d'interpréter et de mettre en œuvre l'ISO/CEI 27002 dans le
domaine de l'informatique de santé et constitue un
complément à cette dernière.
Elle spécifie une série de contrôles
détaillés en vue de la gestion de la
sécurité des informations de santé et apporte
des indications de bonne pratique en matière de
sécurité des informations de santé. La mise
en œuvre de la présente norme internationale permettra aux
organismes de santé et aux autres dépositaires
d'informations de santé de garantir le niveau minimal
requis en termes de sécurité propre aux dispositifs
de leur organisme et de garantir la confidentialité,
l'intégrité et la disponibilité des
informations personnelles de santé.
Elle s'applique à tous les aspects de l'information de
santé, quelle que soit la forme (mots, chiffres,
enregistrements sonores, dessins, vidéos et images
médicales), le support utilisé pour les stocker
(imprimés, écrits papier, stockage
électronique) ou les moyens mis en œuvre pour leur
transmission (en main propre, par fax, par réseau
informatique ou par la poste), car l'information doit toujours
être protégée efficacement.
La norme NF Z 42-013 [8]
Elle fournit un ensemble de
spécifications concernant les mesures techniques et
organisationnelles à mettre en œuvre pour l'enregistrement,
le stockage et la restitution de documents électroniques
afin d'assurer la conservation et l’intégrité de
ceux-ci.
D.
Objectifs du projet
Il faudra clairement identifier le rôle,
les attentes et les responsabilités des différentes
interfaces.
- Déterminer les interfaces mises
en jeux
- Déterminer les
responsabilités de chacun des acteurs
- Déterminer l’évolution des
compétences du technicien biomédical
- Améliorer la compréhension
des attentes de chacune des parties
II. Démarche du
projet
A.
Enquête
Nous avons sollicité la communauté
biomédicale au travers d’un questionnaire afin de
déterminer l’implication et les responsabilités des
différents acteurs, ainsi que le niveau de formation des
techniciens biomédicaux vis-à-vis de l’informatique.
- Enquête
réalisée du 15 février au 31 mars 2013
- 60 envois de
questionnaires par mail
- 20% de retour (12)
Questions posées:
- A combien estimez-vous la proportion de
dispositifs médicaux connectés au réseau
informatique de vôtre centre hospitalier ?
- Quels sont les acteurs impliqués
lors de la connexion des dispositifs
médicaux au réseau informatique ?
- Qui a la responsabilité de la
connexion informatique sur les dispositifs
médicaux ?
- Etes-vous formé pour
connecter un dispositif médical au réseau
informatique ?
Nous avons déterminés que 34% des DM sont
connectés au réseau, mais cela ne nous semble pas
représentatif car les proportions proposés dans le
questionnaire ne sont pas suffisamment précises (0-25%,
26-50%,51-75%,76-100%).
Peut-être aurait-il fallu le laisser en champ libre
pour avoir un résultat plus représentatif.
B. Interfaces mises en
jeu
On peut identifier 4 implications majeures :
- Le biomédical
- Les services de soins
- La DSI
- Les prestataires extérieurs
Jusque-là, le biomédical assurait l’interface entre
les services de soins et les prestataires extérieurs.
L’arrivée de l’informatique et des réseaux fait
apparaitre un nouvel acteur qui est la DSI.
Le biomédical se trouve au centre du processus de
communication et de pilotage pour la gestion des DM informatisés.
L’enquête nous a permis d’évaluer le niveau
d’implication de chacune des parties lors de la connexion d’un DM au réseau informatique de
santé.
Le graphique ci-dessous montre une implication quasi égale
du biomédical et de la DSI.
L’une des clés de réussite de cette collaboration
repose sur la compréhension des attentes et contraintes de
chacune des parties, pour cela ils devront être capables de
se comprendre en parlant un même langage.
C. Responsabilités
Le biomédical a la responsabilité de tous les
dispositifs médicaux défini par
l’article L5211-1 du code de la santé publique.
L’attribution de la responsabilité de la connexion au
réseau est très variable d’un établissement
à l’autre, on retrouve 3 cas possibles :
- responsabilité à la charge
de la DSI
- responsabilité à la charge
du biomédical
- responsabilité partagée
entre la DSI et le biomédical
Le résultat de l’enquête montre majoritairement que
c’est la DSI qui a la
responsabilité de la connexion informatique sur les
dispositifs médicaux (69%).
C’est le cas le plus fréquent et cela s’explique par le
fait que la DSI est propriétaire
du réseau et a déjà la responsabilité
des données administratives véhiculées sur le
réseau.
Dans de rares cas (moins de 1% de l’enquête) le
biomédical a la responsabilité exclusive de la
connexion et gère son propre réseau local (VLAN).
Les 29% pour le biomédical correspondent à une
responsabilité partagée avec la DSI. Dans ce cas, la limite de
responsabilité sur le réseau physique est le plus
souvent clairement définie.
Le biomédical a la responsabilité du DM jusqu’à la prise qui permet
l’interconnexion avec le réseau du centre de santé
ensuite la responsabilité revient à la DSI.
Pour ce qui est des données transmises sur le
réseau logique on ne peut établir de réelle
frontière de responsabilités dans la mesure
où les données ne s’arrêtent pas à la
prise, la responsabilité partagée n’est possible
qu’avec une étroite collaboration entre le
biomédical et la DSI.
En résumé
:
- Si la DSI a la
responsabilité exclusive de la connexion elle fera
appel au fournisseur du DM pour le
paramétrage de celui-ci et se chargera de
l’intégration sur le réseau, le tout
supervisé par le biomédical.
- Si le biomédical a la
responsabilité exclusive de la connexion, il devra
gérer son propre réseau, voir même
créer son propre réseau physique. Dans ce cas le
biomédical devra disposer de connaissances très
poussées en informatique réseau.
- Si la responsabilité est
partagée entre le biomédical et la DSI, le biomédical assurera le
paramétrage du DM en
collaboration avec le fournisseur du DM
et déclarera auprès de la DSI
toutes les informations utiles à l’intégration
du DM sur le réseau.
D.
Flux de données mis
en jeu sur les réseaux informatiques
Le schéma
ci-dessus illustre les différents types de flux de
données mis en jeu lors du circuit d’un patient dans un
établissement de santé.
On constate que plusieurs types de données circulent sur le
réseau.
- Données administratives
- Données techniques
- Données médicales
Les données
administratives du patient vont être renseignées
dès son arrivée à l’accueil et elles vont
le suivre tout au long de son parcours.
Les données techniques vont permettre
d’agir sur le paramétrage des DM
à distance (télémaintenance).
Les données médicales vont
augmenter l’efficience de la qualité des soins pour le
patient. Elles pourront être consultées dans
l’établissement ou en dehors de l’établissement et
permettront :
- De solliciter l’avis d’un
spécialiste à distance (télé
expertise, télé diagnostique,
téléconsultation…)
- De suivre en temps réel les
constantes du patient dans les services de réanimation
ou même au domicile dans le cas HAD
- D’être envoyées vers un
autre centre de santé en cas de transfert du patient
L’ensemble de ces données va interagir avec les
données administratives en incrémentant le
Dossier Médical Personnel (DPM)
par l’intermédiaire du système d’information
hospitalier (SIH).
E. Formation pour les Techniciens
biomédicaux
Aujourd’hui les nouvelles compétences nécessaires
aux techniciens biomédicaux sont principalement
liées à la compréhension de l’architecture
réseau mise en place par la DSI
ainsi qu’à l’évolution technologique des dispositifs
médicaux.
Le technicien biomédical n’a pas vocation à devenir
informaticien, tout comme l’informaticien n’a pas vocation
à devenir technicien biomédical mais ils doivent
être capables de se comprendre en parlant un même
langage et identifier leurs attentes et contraintes
réciproques.
Le biomédical doit comprendre le fonctionnement global des
réseaux informatiques et respecter les procédures
mises en place par la DSI pour garantir
la sécurité et la confidentialité des
données.
Nous avons identifié
6 domaines de formations liés à l’informatique
:
- Formations liées à la
compréhension des architectures physiques et logiques
des réseaux informatiques.
- Formations liées aux
stratégies de sécurité des réseaux
et des serveurs (droits d’accès, comptes utilisateurs).
- Formations liées à
l’intégration et l’exploitation des applications
médicales sur le réseau.
- Formations liées à
l’intégration et l’exploitation des applications
administratives sur le réseau.
- Formations liées aux
paramétrages et à l’utilisation des DM disposants d’une connexion
réseau.
- Formations liées aux
paramétrages et à l’utilisation des applications
médicales.
Le niveau de formation nécessaire au technicien
biomédical dans les 6 domaines précédemment
cités sera fonction de la politique de
responsabilité mise en place dans l’établissement.
- responsabilité exclusive à
la charge de la DSI
- responsabilité exclusive à
la charge du biomédical
- responsabilité partagée
entre la DSI et le biomédical
Le schéma ci-dessus permet de localiser les
compétences nécessaires à la bonne prise en
charge du patient tout au long de son circuit.
Si la responsabilité est partagée et que le
biomédical assure la connexion du DM
à la prise réseau, les compétences seront
fonctions du type de DM.
- Dans le cas d’un DM
sans PC, il faudra maitriser les formations n°2 et
3.
La formation liée à
l’utilisation et au paramétrage du DM
(n°2) sera nécessaire pour localiser les chants
de paramétrages dans les différents menus du DM et la formation sur les réseaux
physiques et logiques (n°3) pour identifier les plages IP disponibles, masque de réseau et
sous réseau…
- Dans le cas de DM
avec PC, il faudra maitriser les formations n°1et 5 en
plus des deux précédentes.
La formation liée à
l’utilisation et aux paramétrages des applications
médicales (n°1) sera nécessaire pour localiser
les chants de paramétrages dans les différents menus
de l’application médicale et la formation liée aux
stratégies de sécurités des réseaux et
serveurs (n°3). L’application médicale se trouvant le
plus souvent sur un PC, il faudra se conformer aux
modalités de déclarations d’un PC sur le
réseau défini par la DSI
(choix d’antivirus, type d’accès VPN,
types de logiciels autorisés…). Il faudra également
remplir une fiche de description détaillant l’ensemble des
informations techniques relatives au PC et aux applications
installées (annexe 1).
III. Conclusion
Les nouvelles technologies informatiques améliorent la
qualité des soins et la prise en charge du patient.
Le technicien biomédical n’a pas vocation à devenir
informaticien mais l’étroite collaboration entre le
technicien biomédical et la DSI
lors de la gestion des DM
connectés au réseau l’oblige à
acquérir un minimum de notions sur la façon dont les
informations sont véhiculées sur le réseau.
IL lui faudra clairement identifier les niveaux de
responsabilités de chacun des acteurs et être capable
de se comprendre en parlant un même langage.
Propositions d’actions
à mettre en place :
- Clairement identifier les interfaces
• Mettre en
place des groupes participatifs impliquant toutes les
interfaces mises en jeu (Biomédical, DSI, Prestataires externes, services
de soins…).
- Définir les
responsabilisées
• Les
responsabilités peuvent être établies sous
la forme d’un contrat entre la DSI
et le biomédical.
- Etroite collaboration avec la DSI
• Nous
proposons que la DSI passe 3 jours
avec les techniciens biomédicaux et que les techniciens
biomédicaux passent 3 jours avec la DSI. Cela permettra une parfaite
compréhension des attentes et contraintes de chacune
des parties.
• Les connaissances
nécessaires aussi bien à la DSI qu’au biomédical pour la
bonne prise en charge des DM
connectés au réseau pourront
s’acquérir sous forme de fertilisation croisée
entre les 2 partenaires. [annexe
4]
- Prioriser les formations :
1. Formations
liées aux architectures physiques et logiques
2. Formations
liées aux paramétrages des DM
3. Formations
liées à la sécurité
4. Formations
liées aux applications médicales
5. Formations
liées aux applications administratives
Le niveau de formation dans
chacun des domaines dépendra de la politique de
responsabilité mise en place dans
l’établissement.
Aujourd’hui, l’omniprésence de l’informatique
médicale dans la médecine moderne montre la
nécessité de faire évoluer la
formation du technicien biomédical pour pouvoir garantir
la maitrise et la sécurité des dispositifs
médicaux.
[1] Informatique
médicale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_m%C3%A9dicale
(Consulté en février 2013)
[2] Article
L5211-1 du code de la santé publique
http://www.legifrance.gouv.fr (Consulté le 02
/03 /2013)
[3] Système pacs (consulté
le 30/03/2013)
http://www.caducee.net/DossierSpecialises/imagerie-medicale/pacs.asp
[4] Directives
Européennes 93/46/CE modifié par la directive
2007/47/CE
http://www.europa.eu
(Consulté le 03 /03 /2013)
[5]
Loi 78-17 du code de la santé publique
modifié par la loi 3 du 6 aout 2004:
http://www.legifrance.gouv.fr
(Consulté le 03 /03 /2013)
[6] La CNIL
http://www.cnil.fr/la-cnil/
[7] La norme NF EN ISO 27799 -
Informatique de santé - Gestion de la
sécurité de l’information relative
à la santé en utilisant l’ISO/CEI27002 Ed
Afnor, septembre 2008
http://www.afnor.org
consulte (Consulté le 29/02/2013)
[8] La norme NF
Z 42-013
http://www.afnor.org
(Consulté le 29/02/2013)
[9]
Risques d’attaques contre des appareils
médicaux
http://www.bitdefender.fr/blog/Des-patients-cardiaques-et-diabetiques-menaces-par-des-malwares-ciblant-les-appareils-medicaux-013.html
[10] Informatique hospitalière,
sécurité et confidentialité
http://siteinfosecusante.free.fr/spip.php?article34
[11] Le Monde-Comment des données
médicales confidentielles se retrouvent en ligne
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/02/05/malaise-comment-des-donnees-medicales-confidentielles-se-retrouvent-en-ligne/#xtor=AL-32280270
Loi hôpital patients sante et territoires
http://www.sante.gouv.fr/la-loi-hopital-patients-sante-et-territoires.html
(Consulté le 03 /03 /2013)
Sécurité de
l’information en santé : grille d’autodiagnostic
d’après l’ISO 27799
http://www.utc.fr/master-qualite/
(consulté le 29/02/2013)
Télématique médicale
(consulte le 25/03/2013)
http://www.awt.be/web/dem/index.aspx?page=dem,fr,040,040,001
Enquête sur la sécurité informatique
http://www.clusif.asso.fr/fr/production/ouvrages/pdf/CLUSIF-MIPS2010-Hopitaux.pdf
Exemple d’installation d’un laboratoire d’analyse
http://imagerie-puces-a-cellules.univ-rennes1.fr/index_htm_files/77.png
Exemple pacs-e santé de la Loire
http://dsi.silicon.fr/wp-content/uploads/2012/04/programme-pacs-e-sante-de-la-loire.jpg
Télémédecine
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANAP_Telemedecine_en_action_tome1.pdf
La télémaintenance et le biomédical
http://www.utc.fr/~farges/master_mts/2004-2005/projets/fdili_kichenassamy/fdili_kichenassamy.htm
Le système capsule neuron
http://www.capsuletech.fr/Collateral/Documents/France/Technical%20Data%20Sheet%20-%20Capsule%20Neuron%20FR.pdf
Menaces informatiques et pratiques de
sécurité en France, Ed Club de la
Sécurité de l’Information Français (CLUSIF),
17 juin 2010, [site consulté le 03/03/13].
http://www.clusif.asso.fr/fr/production/ouvrages/pdf/CLUSIF-MIPS2010-Hopitaux.pdf
Article de Marie-Françoise DE PANGE, publié le 13
novembre 2009 dans Le Quotidien du Médecin
http://siteinfosecusante.free.fr/spip.php?article34
(consulte le 1/03/201)
Figure 1 : architecture du PACS
http://www.caducee.net/DossierSpecialises/imagerie-medicale/pacs.asp
Figure 2 : logiciel de suivi de dialyse
Athénéa fournie par Mr Lambure (Clinique
DELAY)
Figure 3 : logiciel suivi d’hospitalisation
patient Dopasoin fournie par Mr Lambure (Clinique DELAY)
Figure 4 : réseau de la clinique
DELAY fournie par Mr Lambure (Clinique DELAY)
Figure 5 : télémédecine
et équipement cote patient fournie par Mr Lambure (Clinique
DELAY)
Figure 6 : télésurveillance
fournie par Mr Lambure (Clinique
DELAY)
Figure 7 : architecture réseau d’un
laboratoire d’analyse
http://imagerie-puces-a-cellules.univ-rennes1.fr/index_htm_files/77.png
Figure 8 : Centrale de surveillance fournie
par Mr Bodecot (CH Beauvais)
Figure 9 : Capsule Neurone fournie par Mr
Bodecot (CH Beauvais)
Figure 10 : risques et conséquences
(auteurs FZ.SD)
Figure 11 : Interface mises en jeu (auteurs
FZ.SD)
Figure 12 : graphique 1 interfaces mises en
jeu dans la connexion des dm au réseau (auteurs FZ.SD)
Figure 13 : graphique 2 responsable de la
connexion réseau (auteurs FZ.SD)
Figure 14 : Responsabilités
partagées (auteurs FZ.SD)
Figure 15 : Flux de données mis en
jeu sur les réseaux informatiques des centres de
santé (auteurs FZ.SD)
Figure 16 : Formations (auteurs FZ.SD)
Figure 17 : Localisations des
compétences (auteurs FZ.SD)
Figure 18
: supervision pré-traitement d’eau fournie par
Mr Lambure (Clinique DELAY)
Annexes
Annexe 1
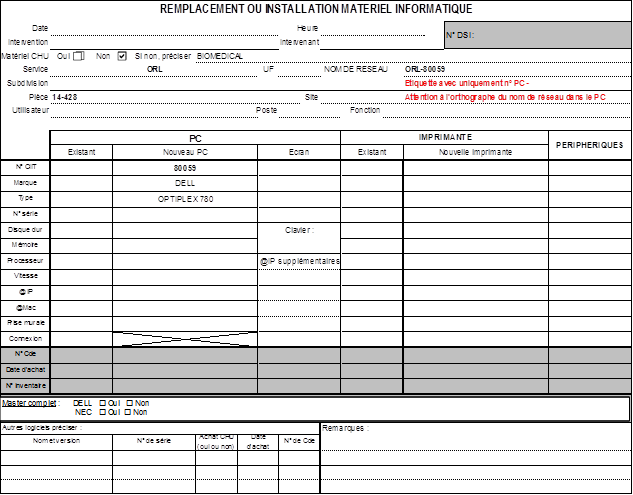
Retour sommaire
Annexe
2
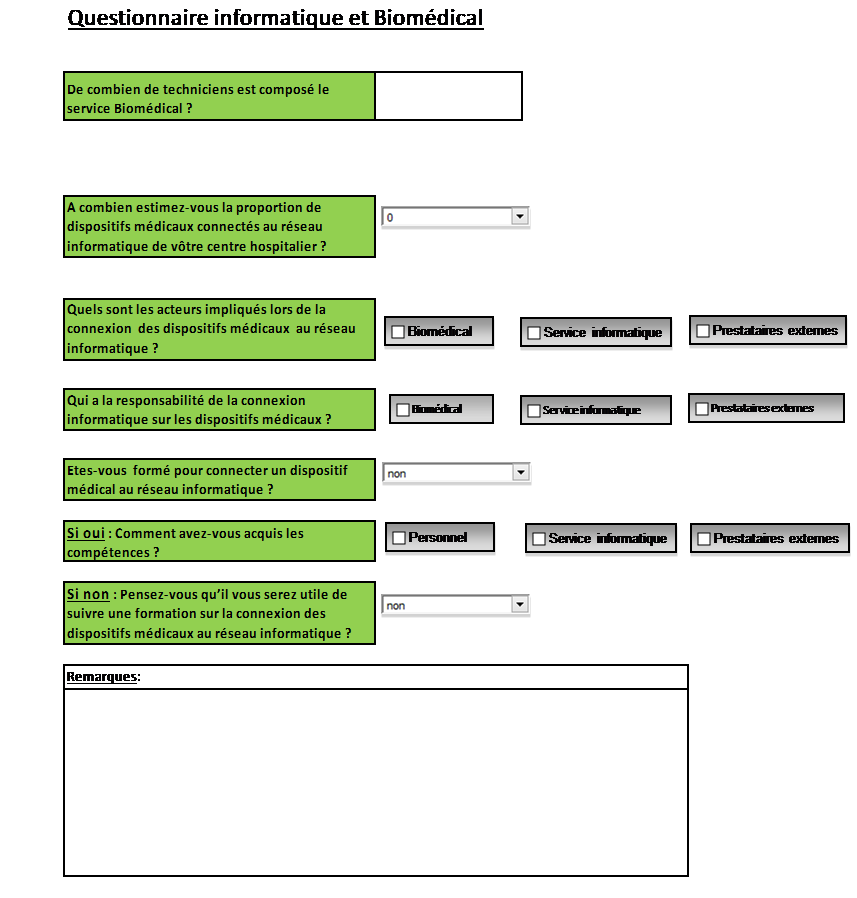
Retour sommaire
Annexe 4