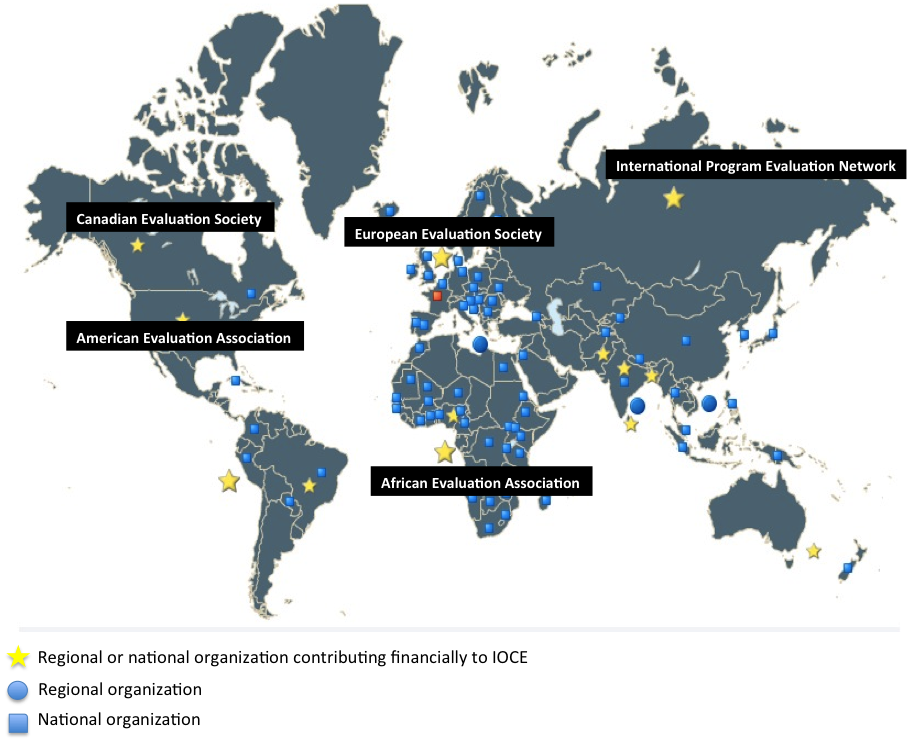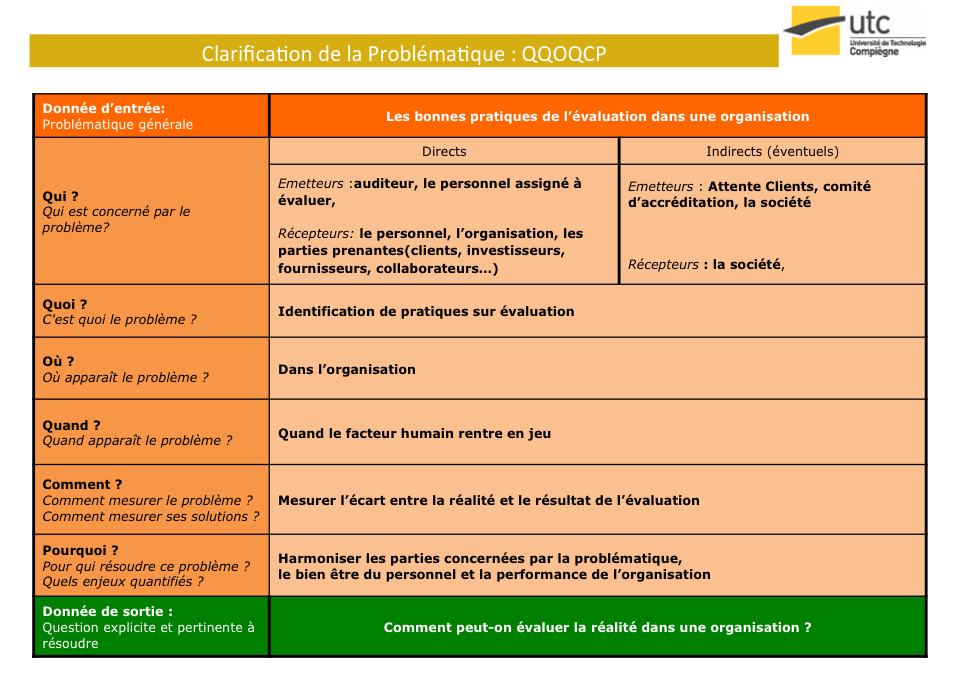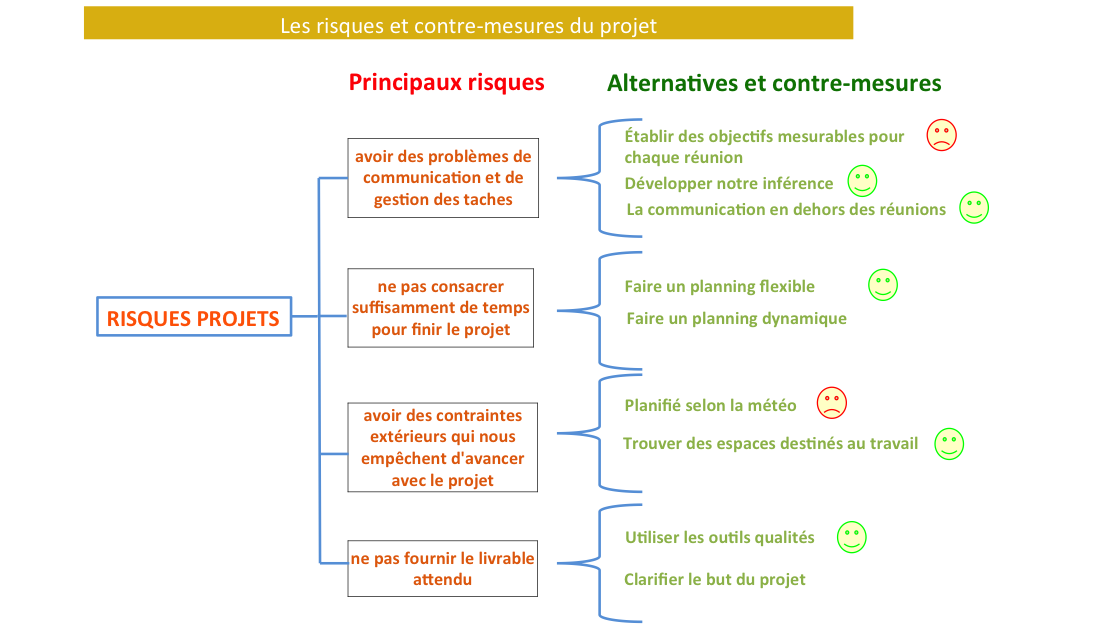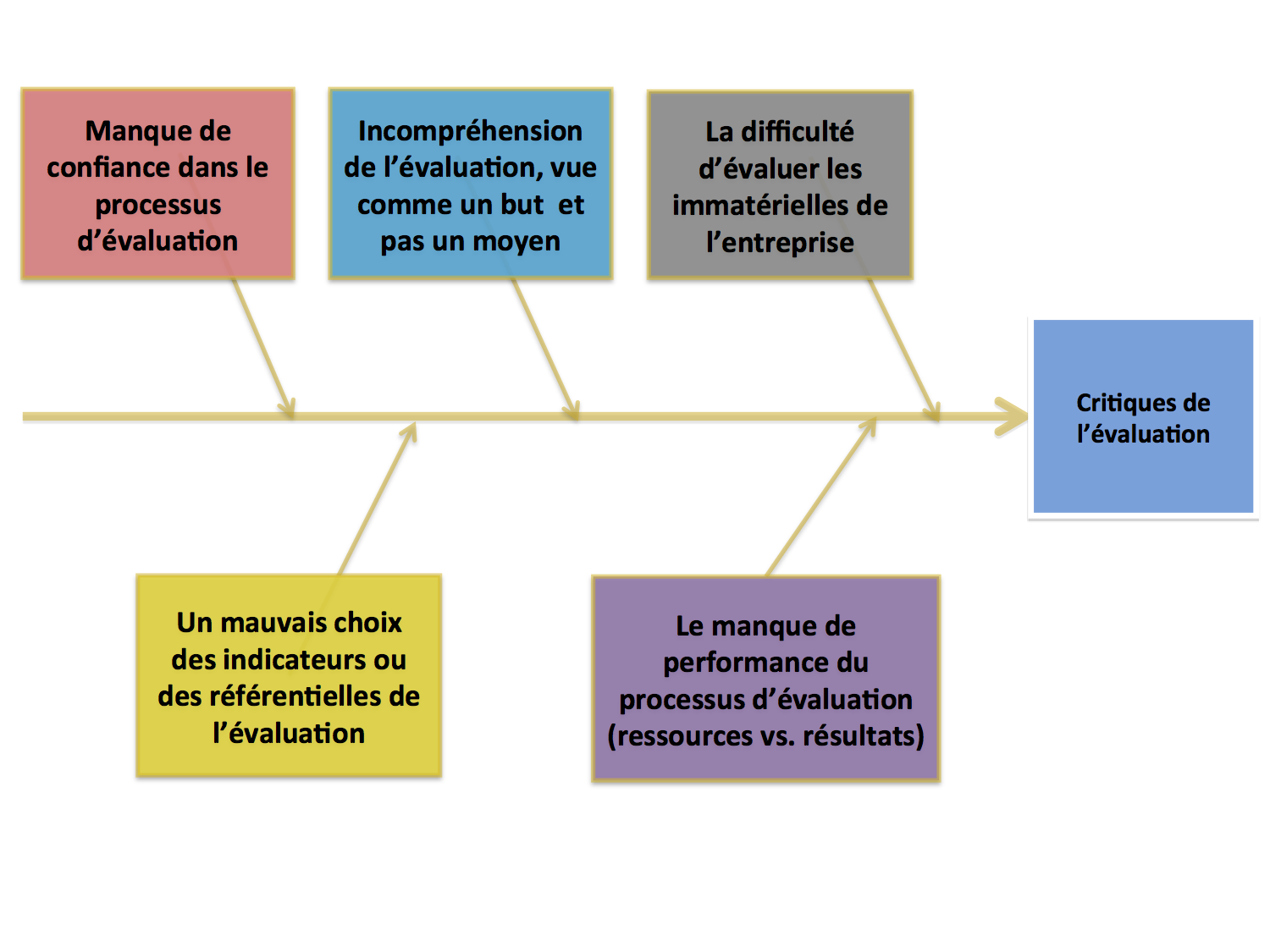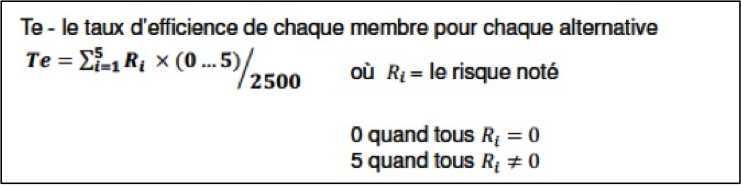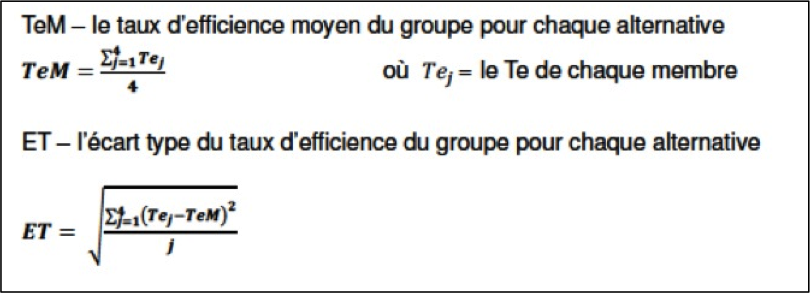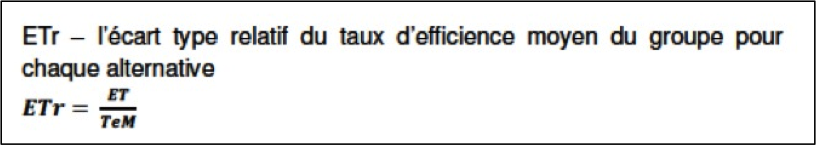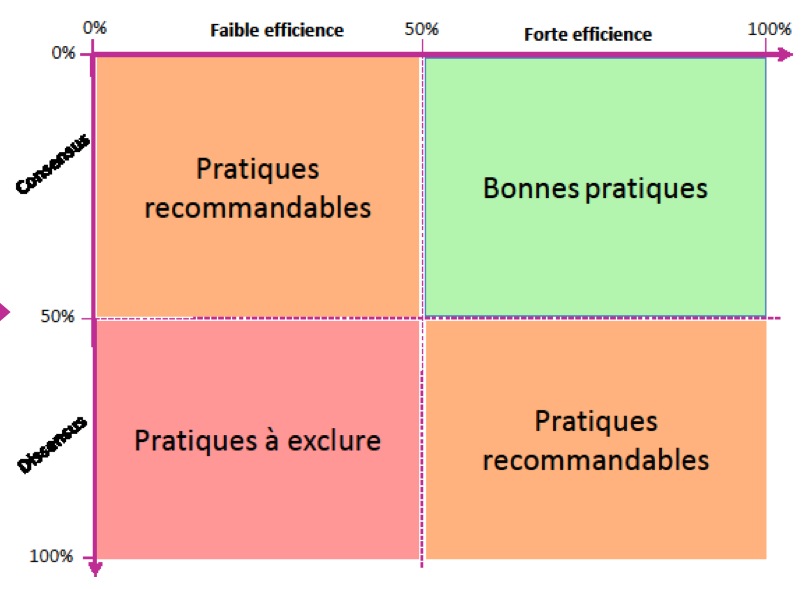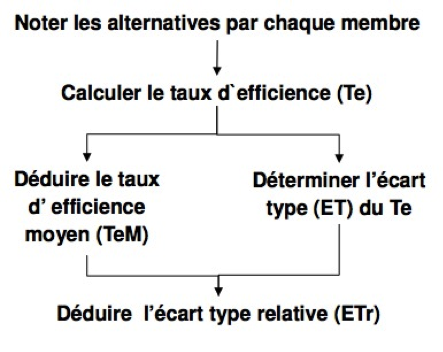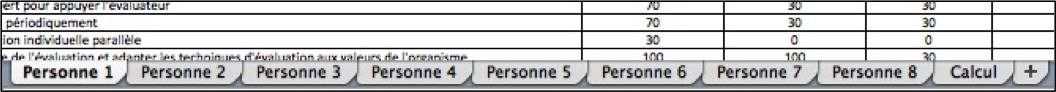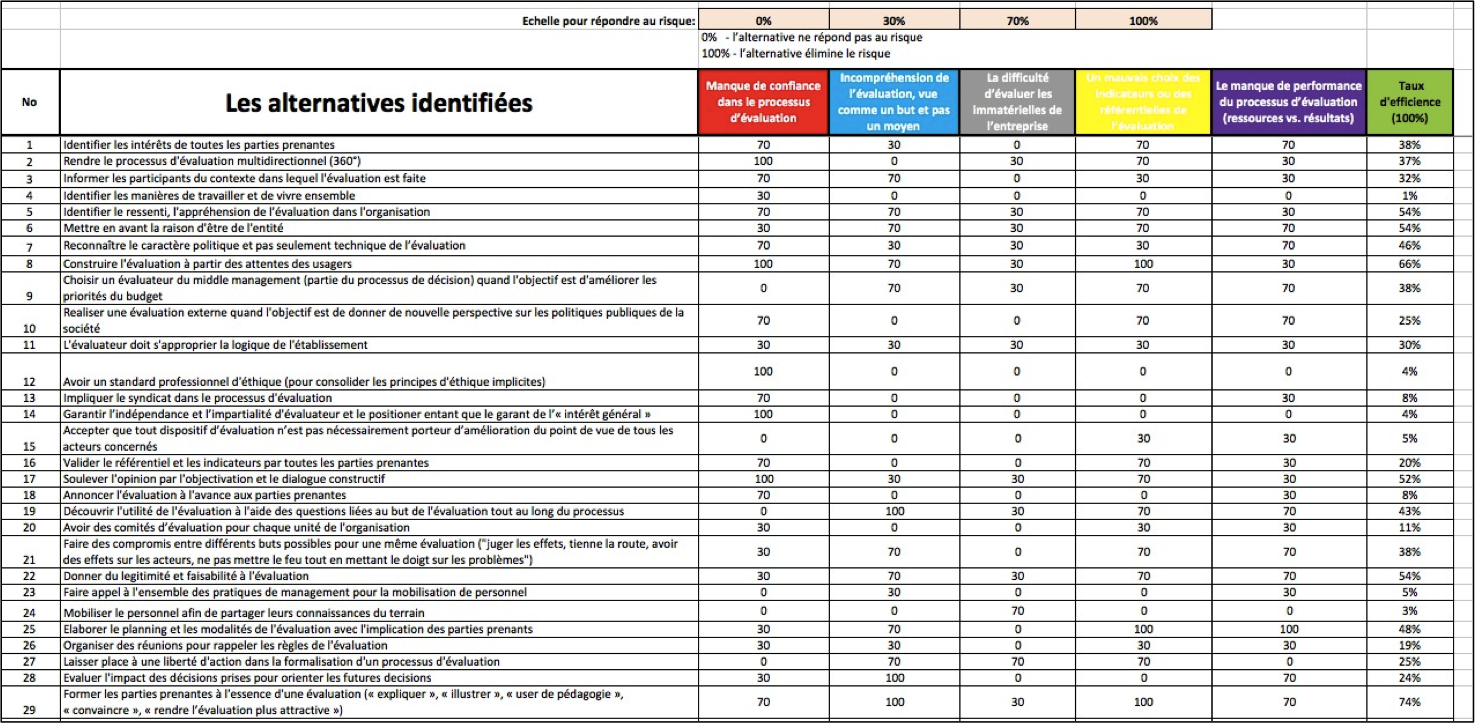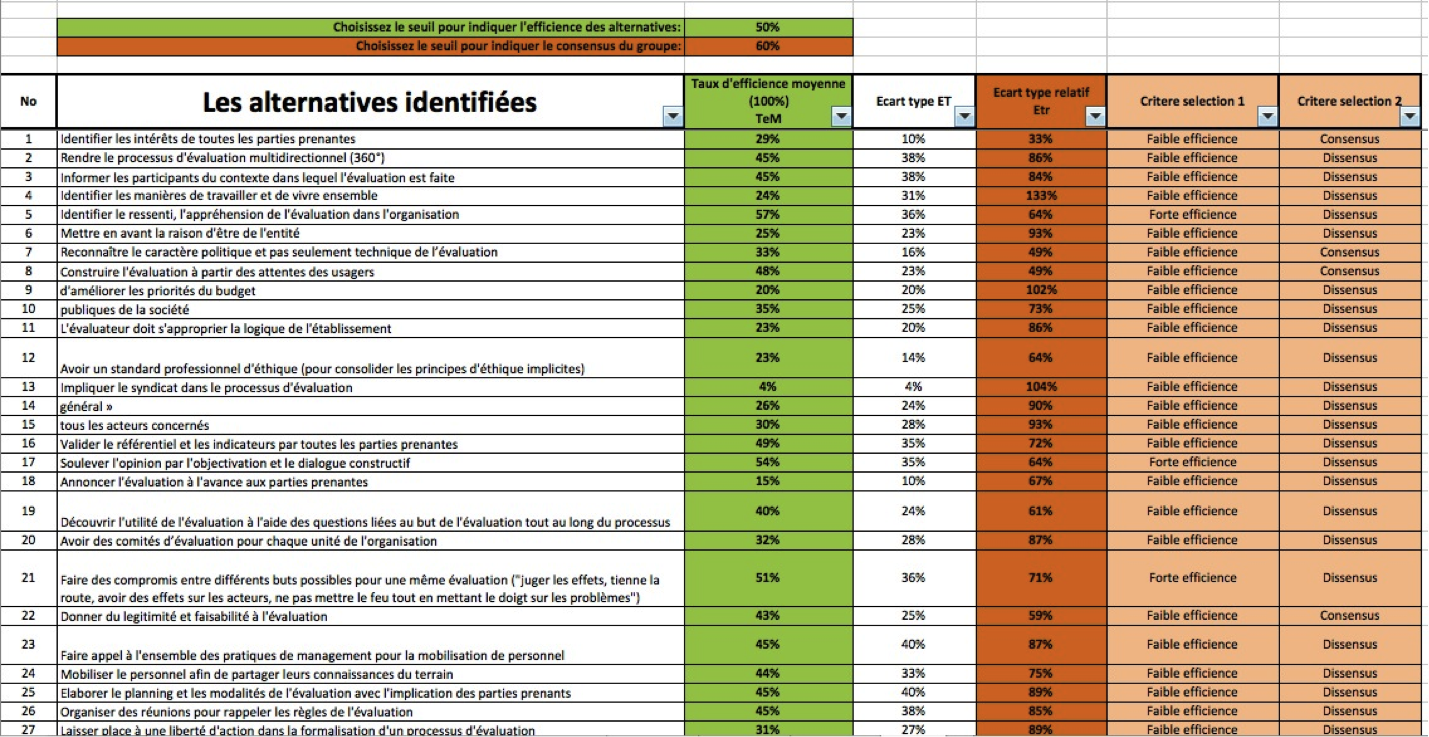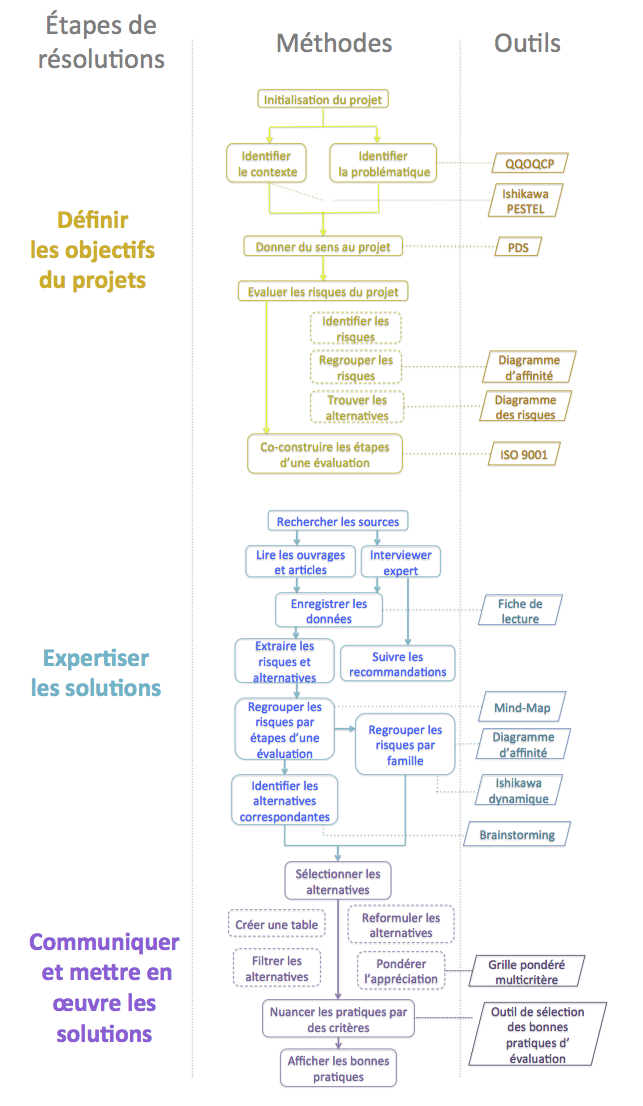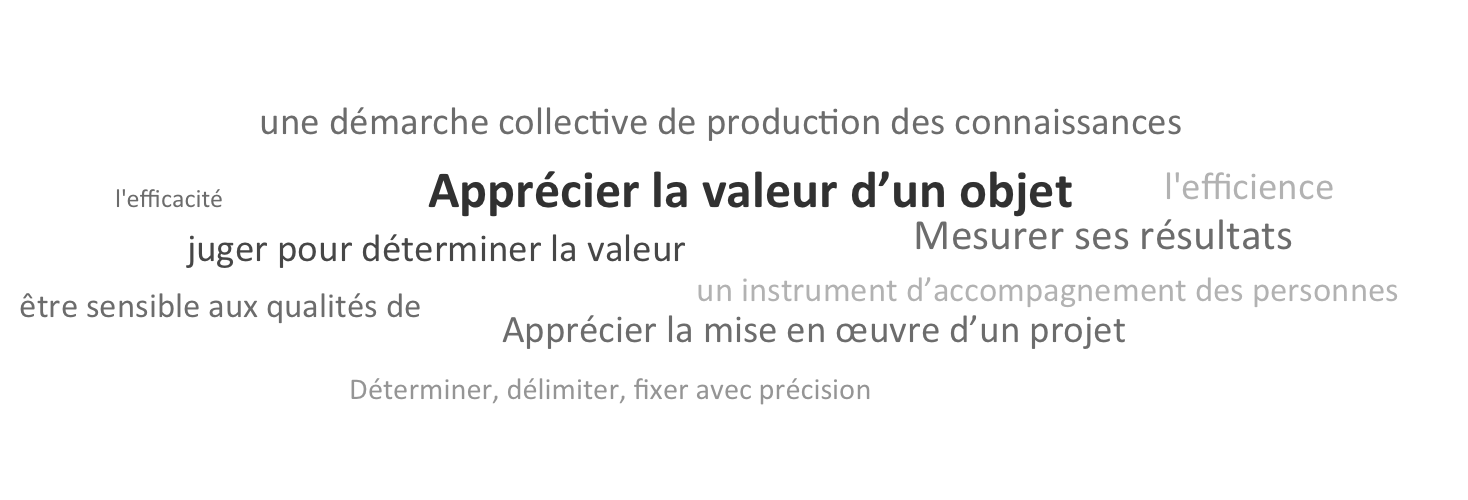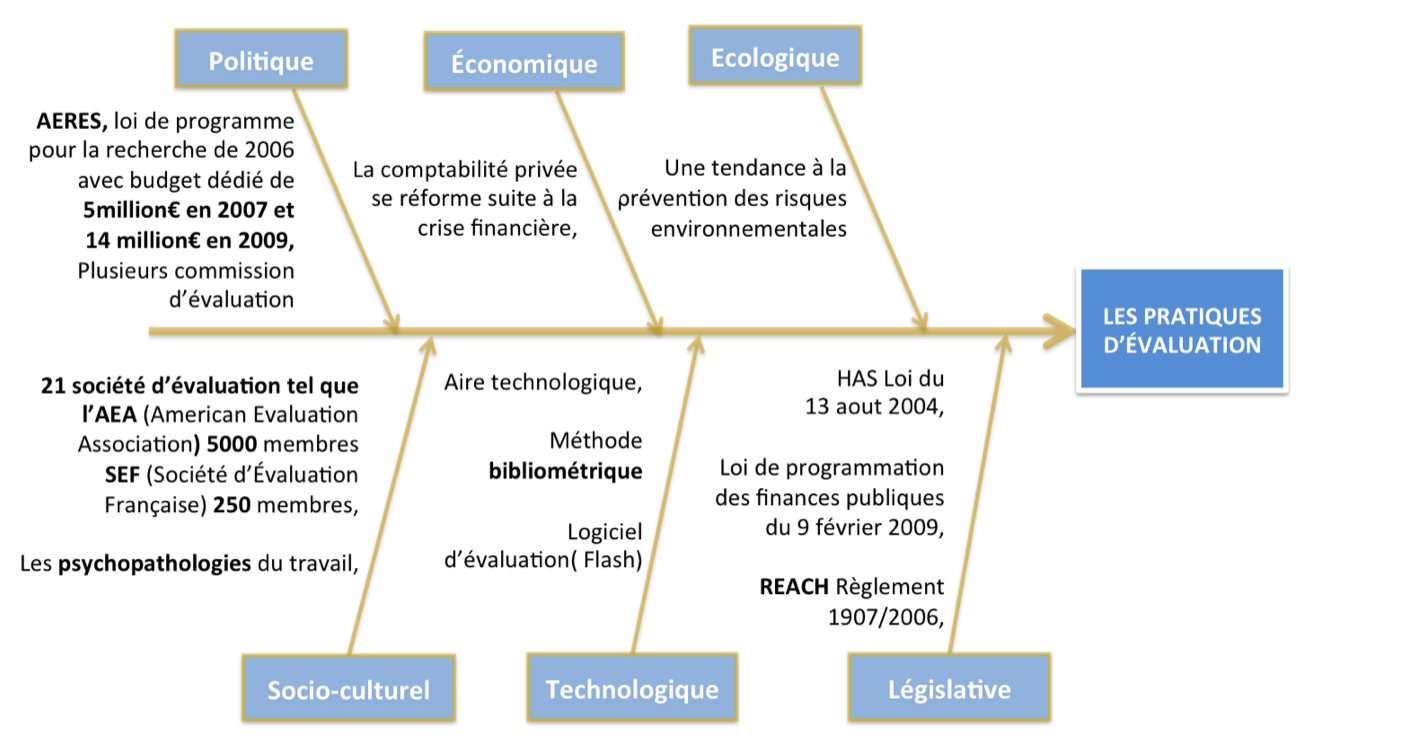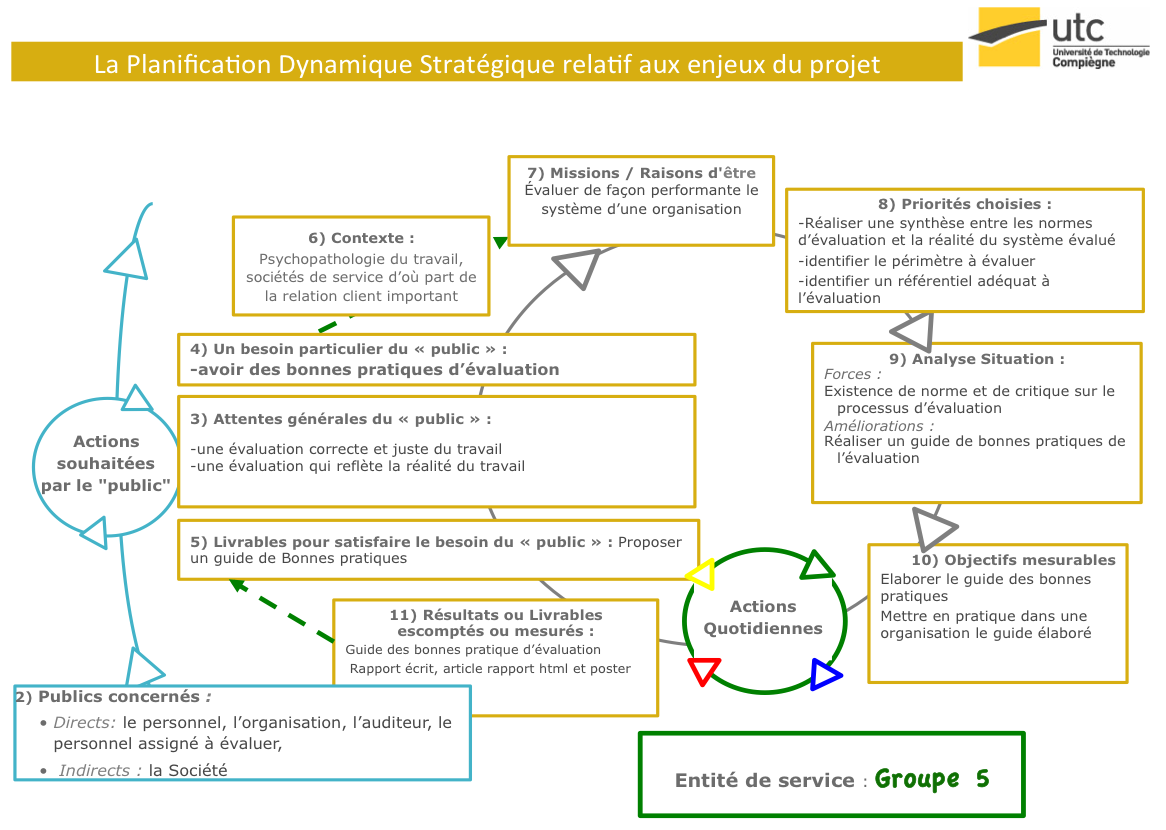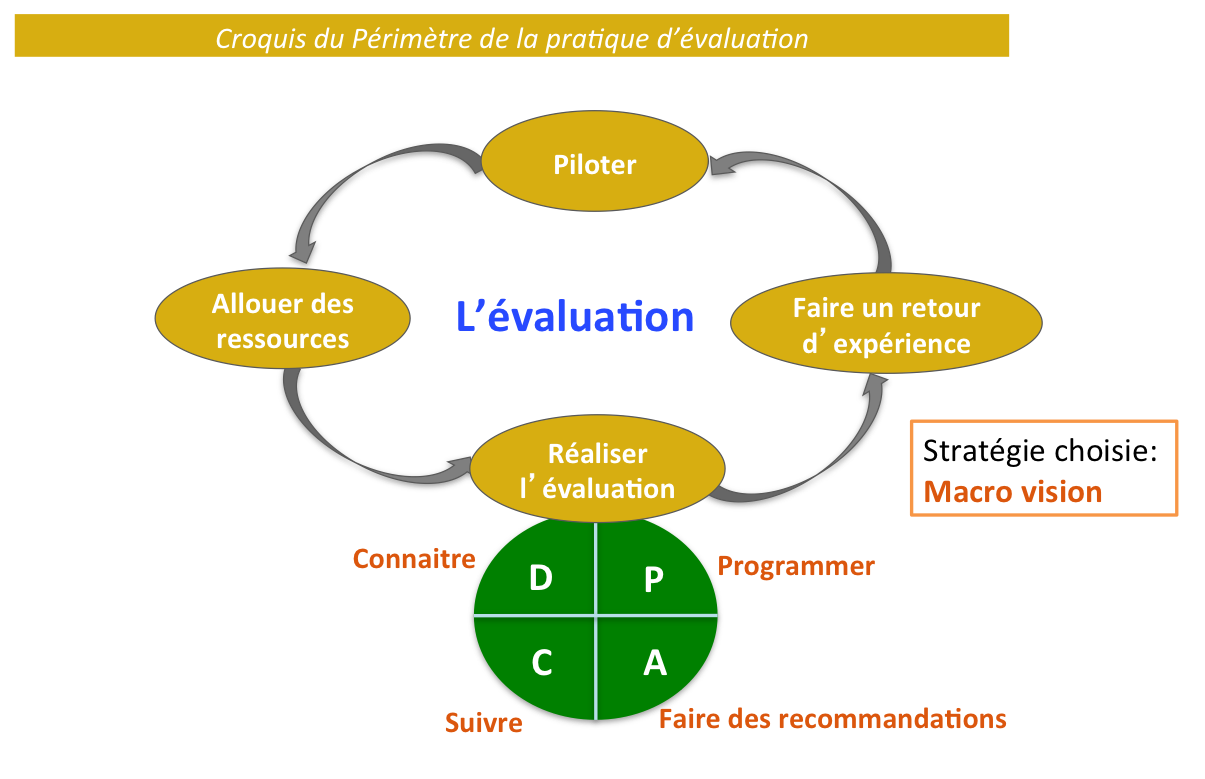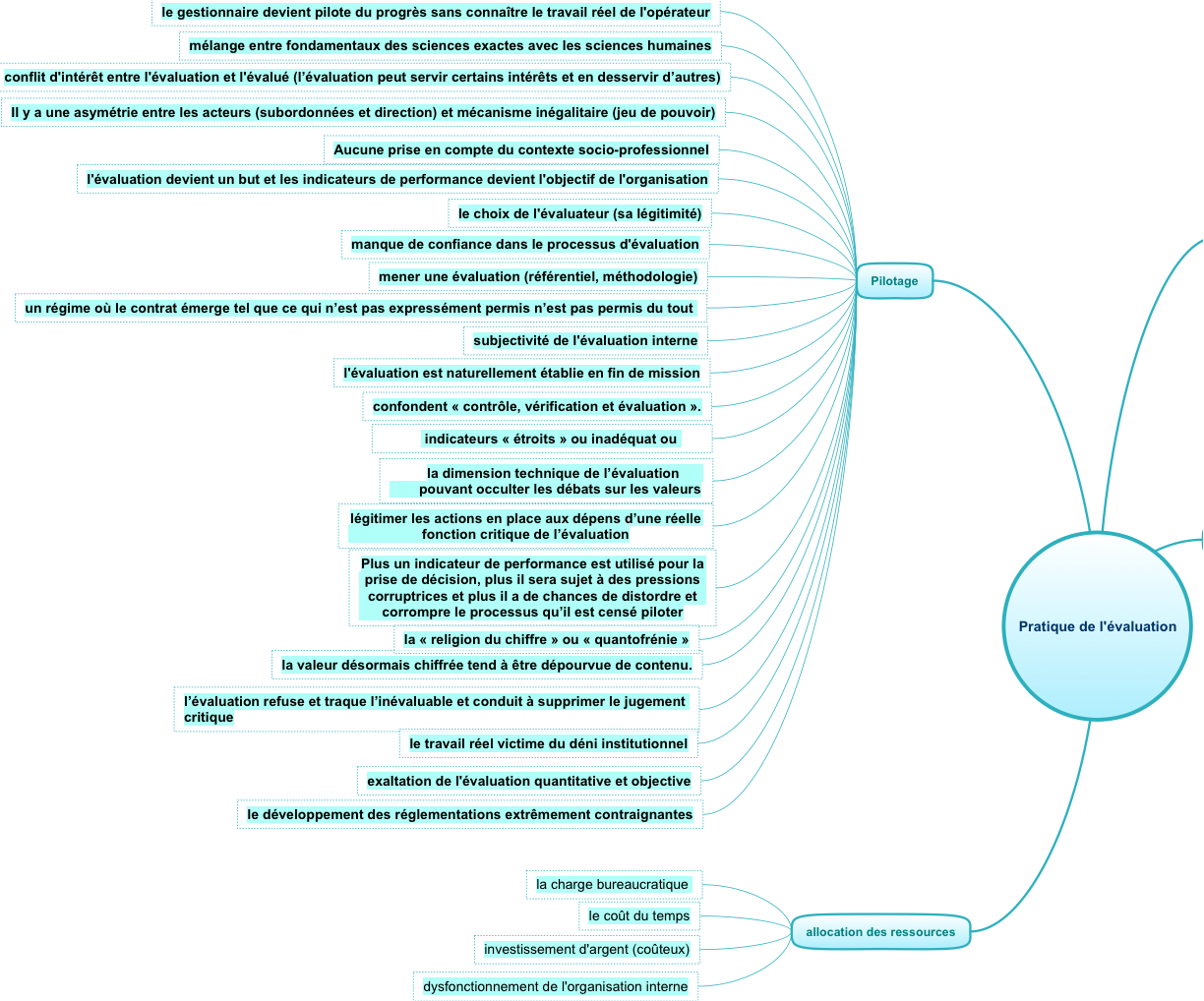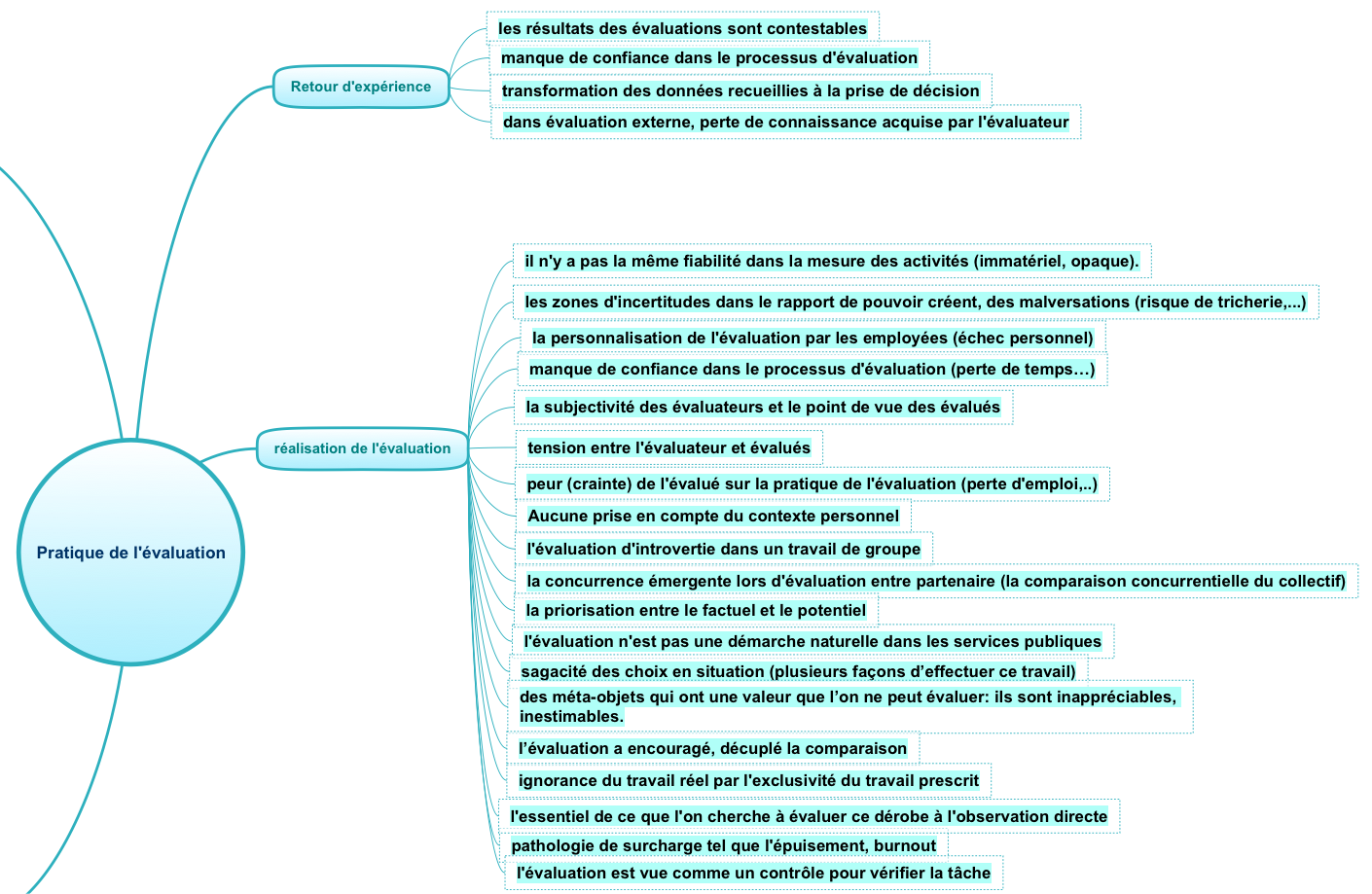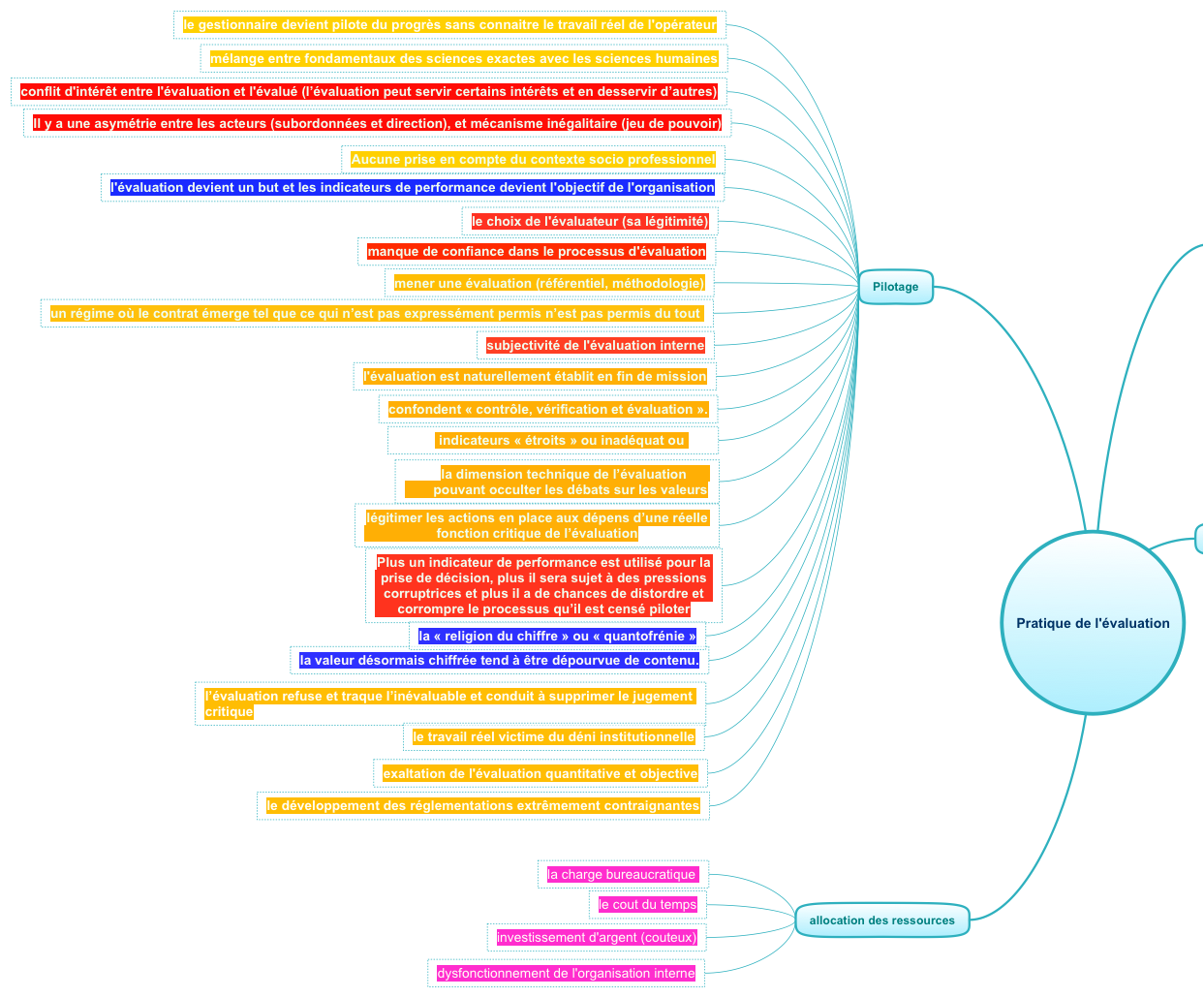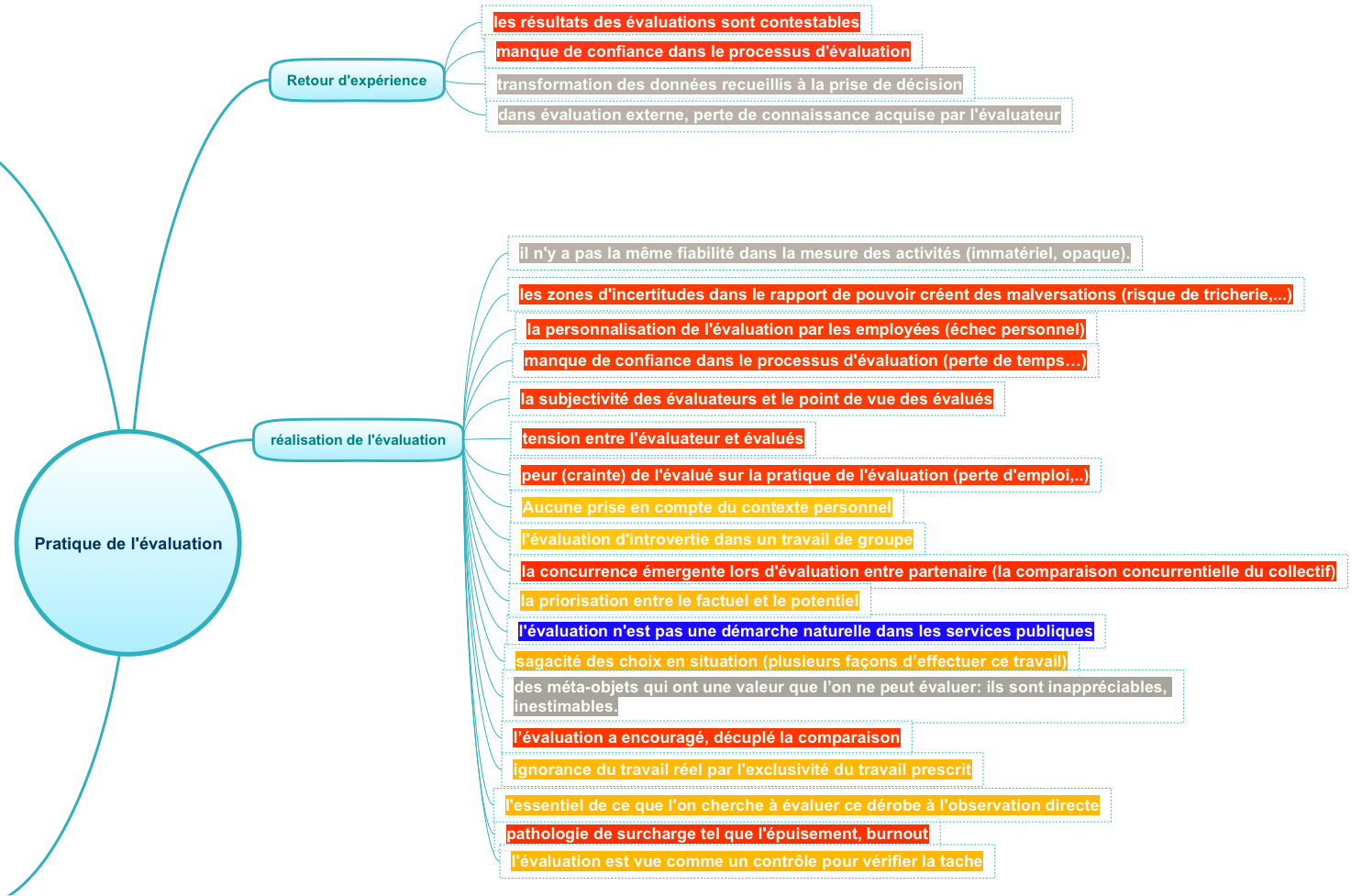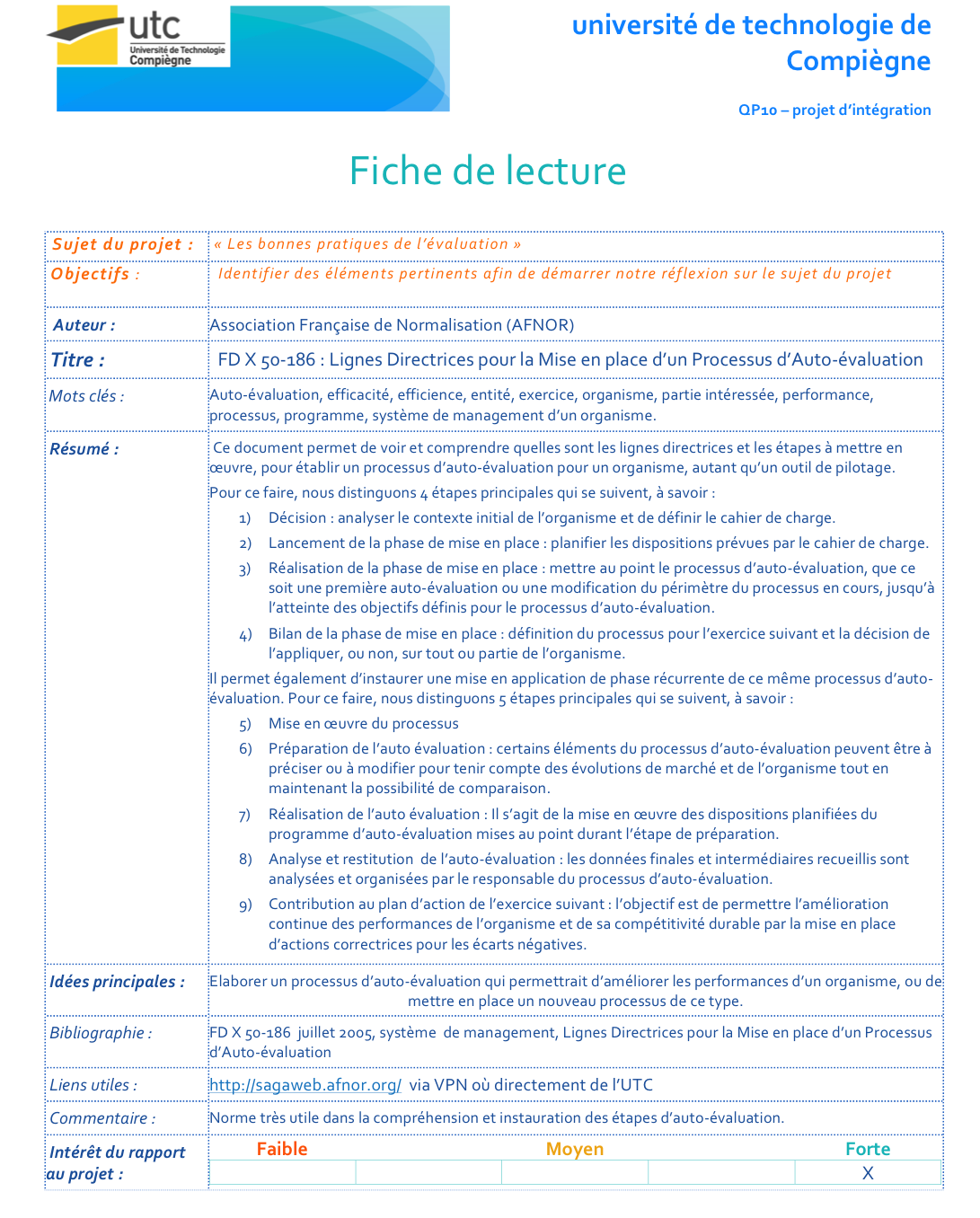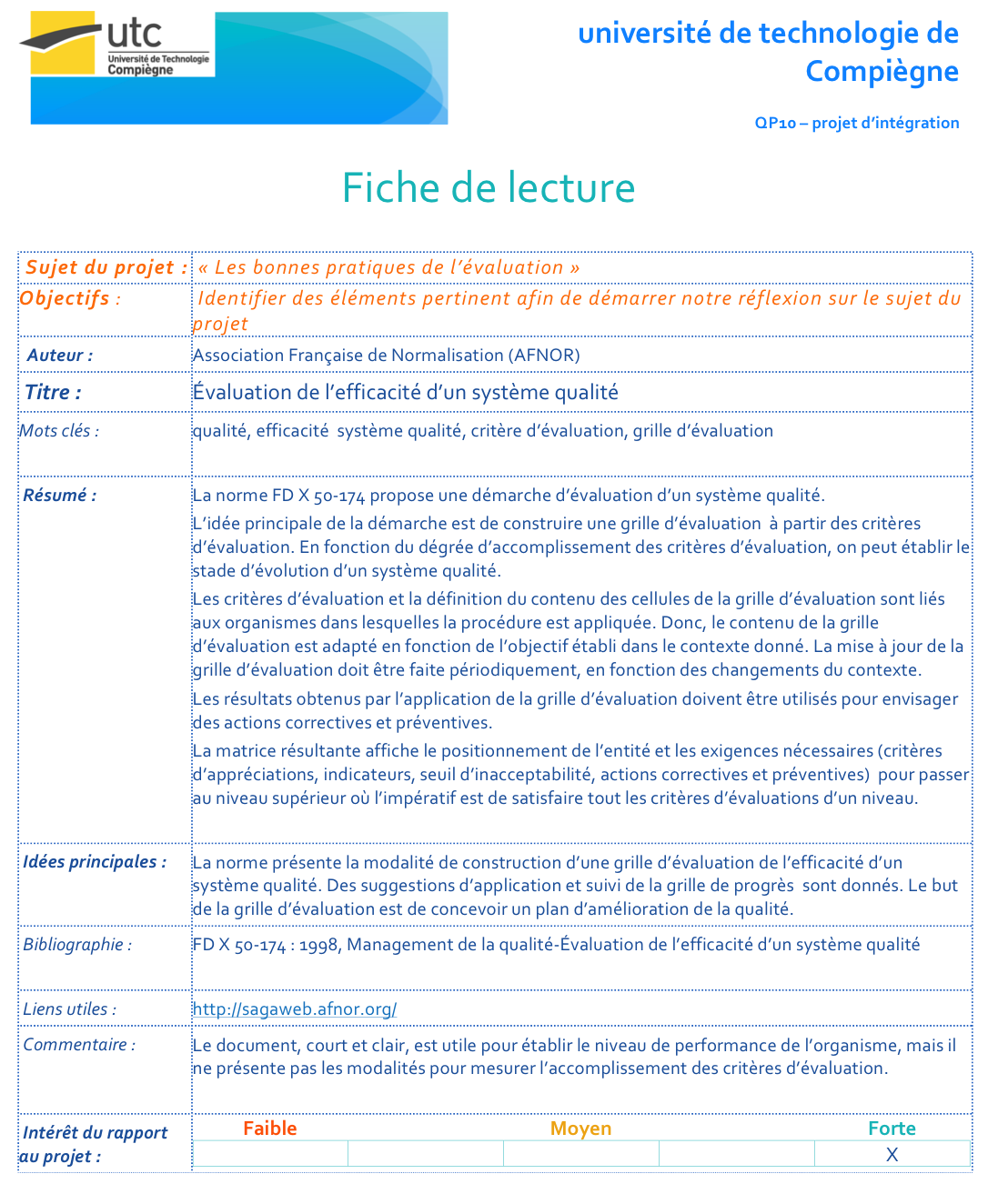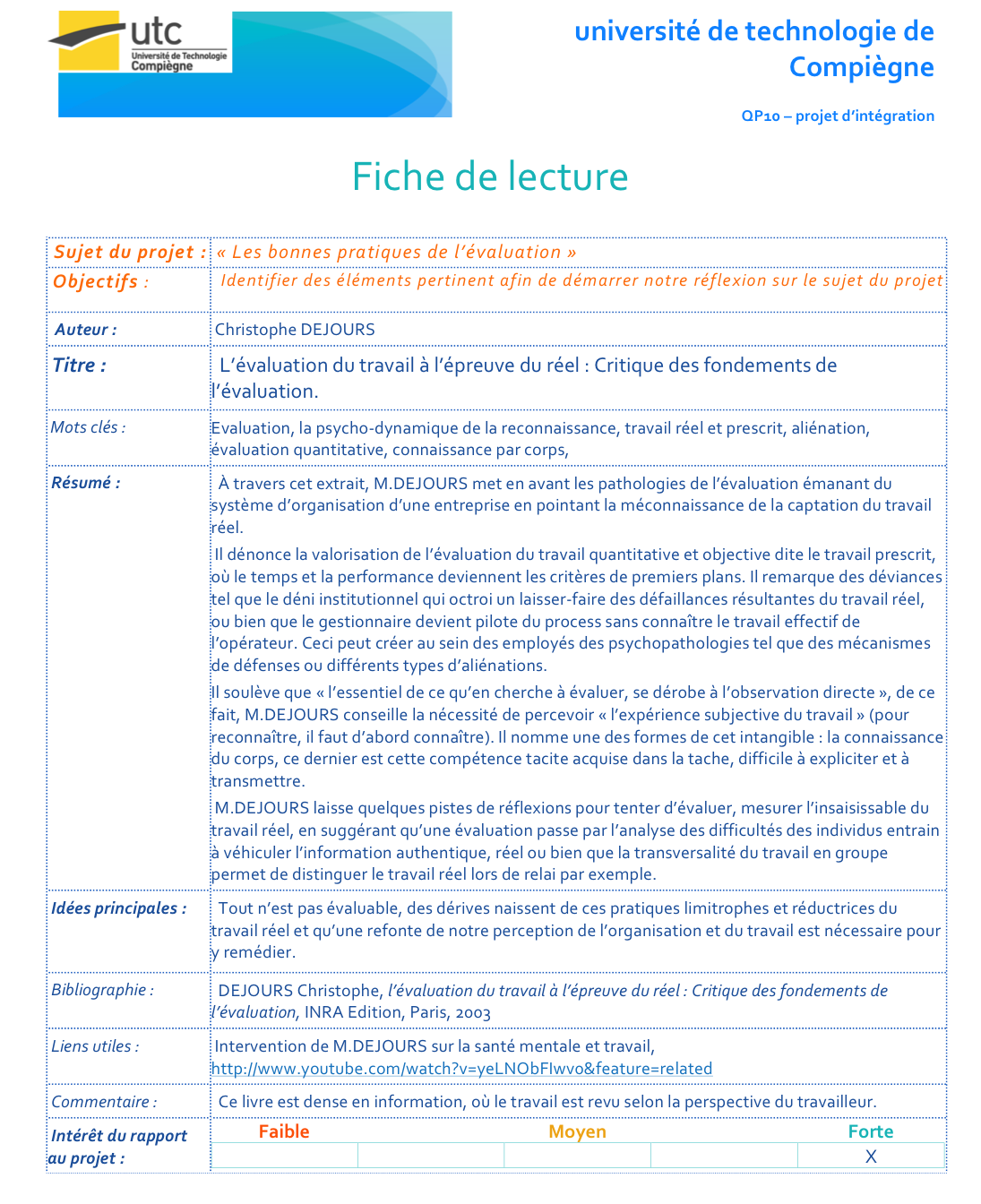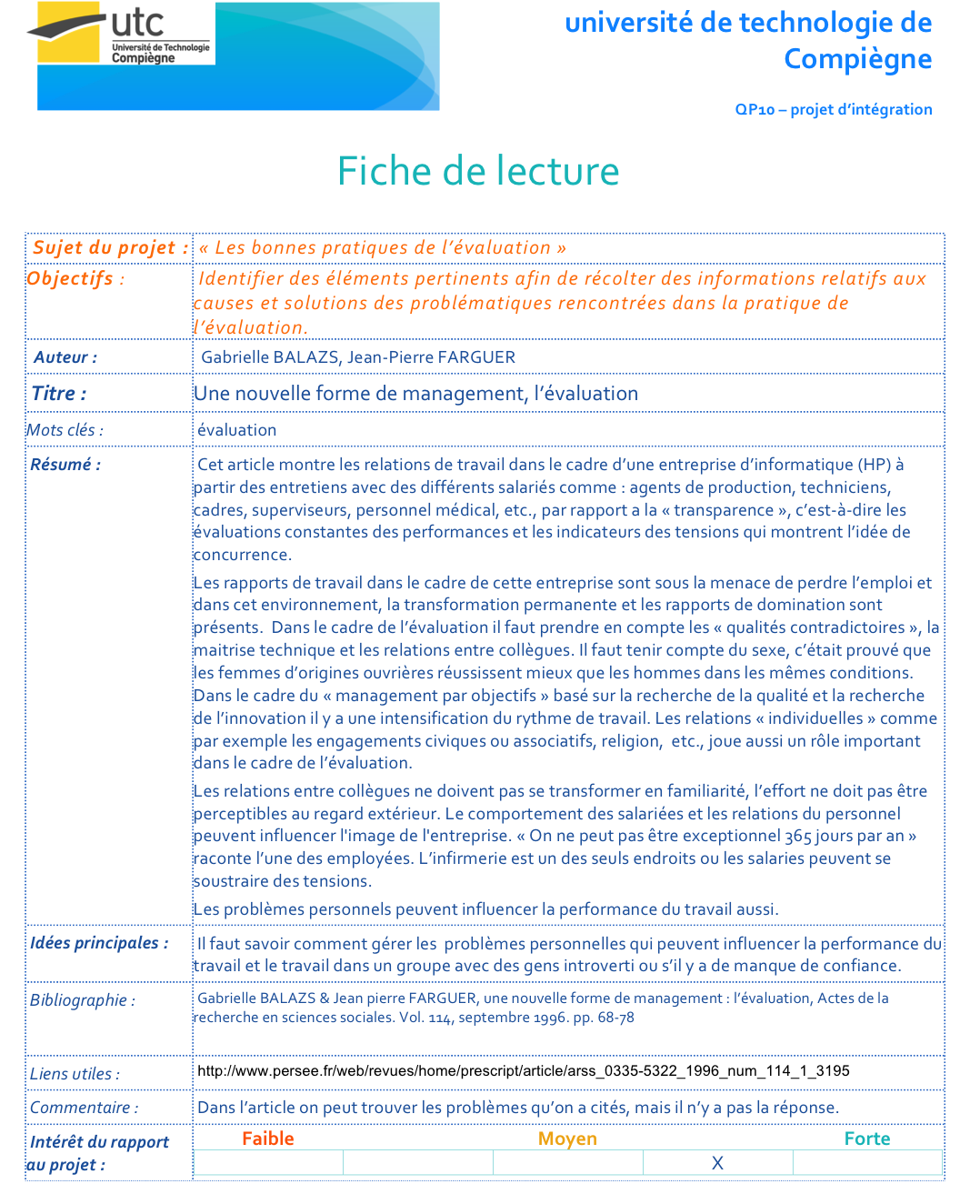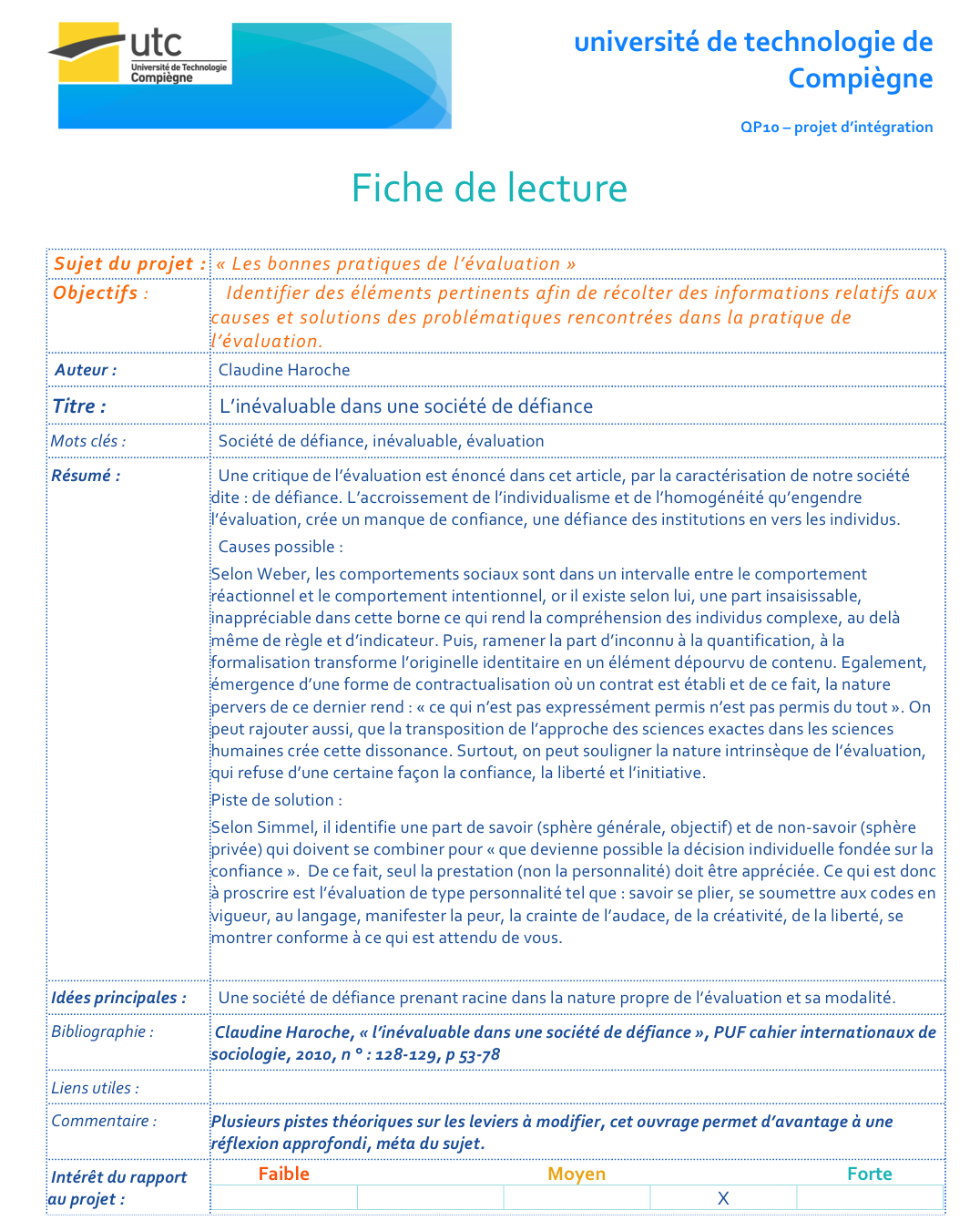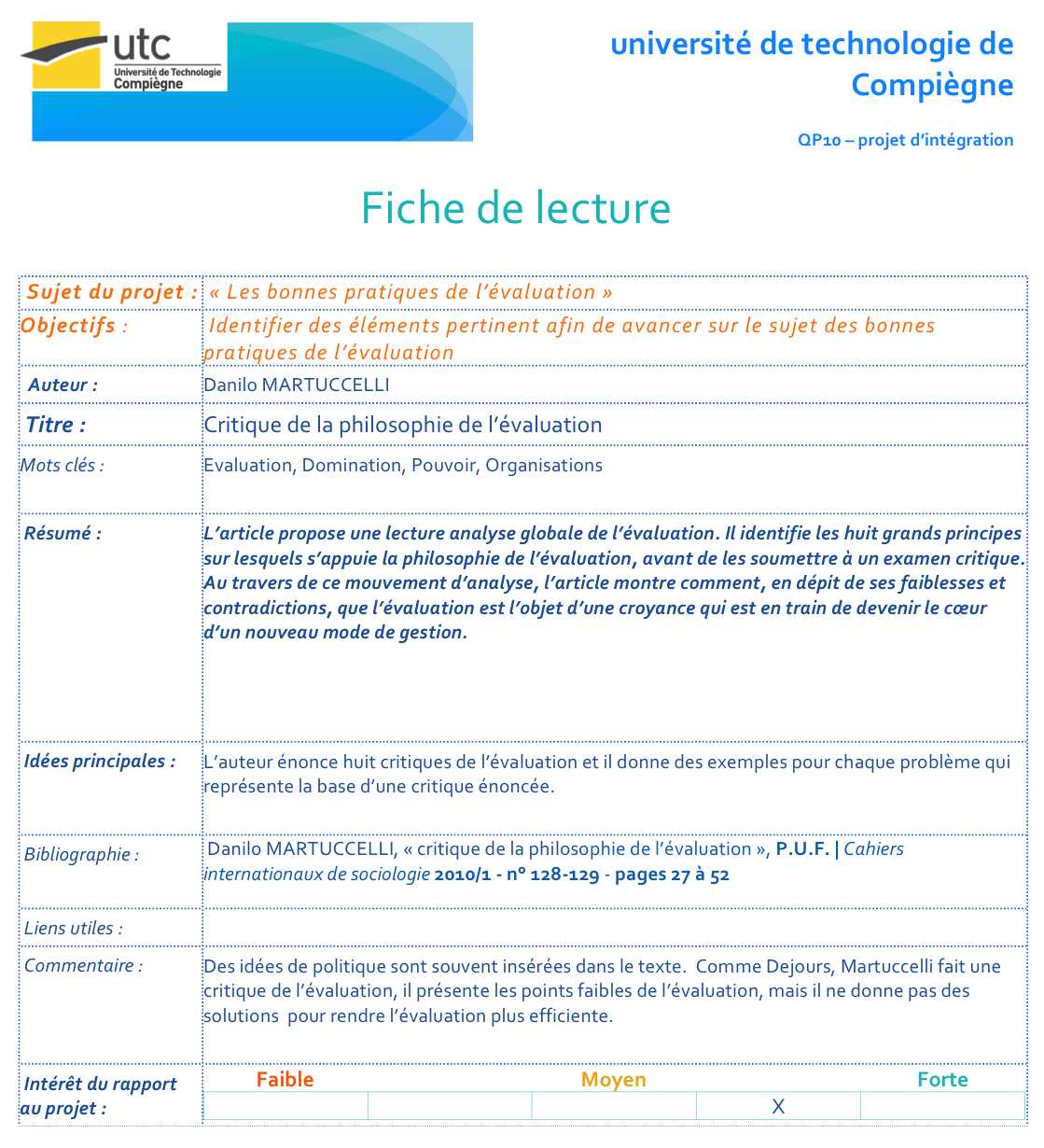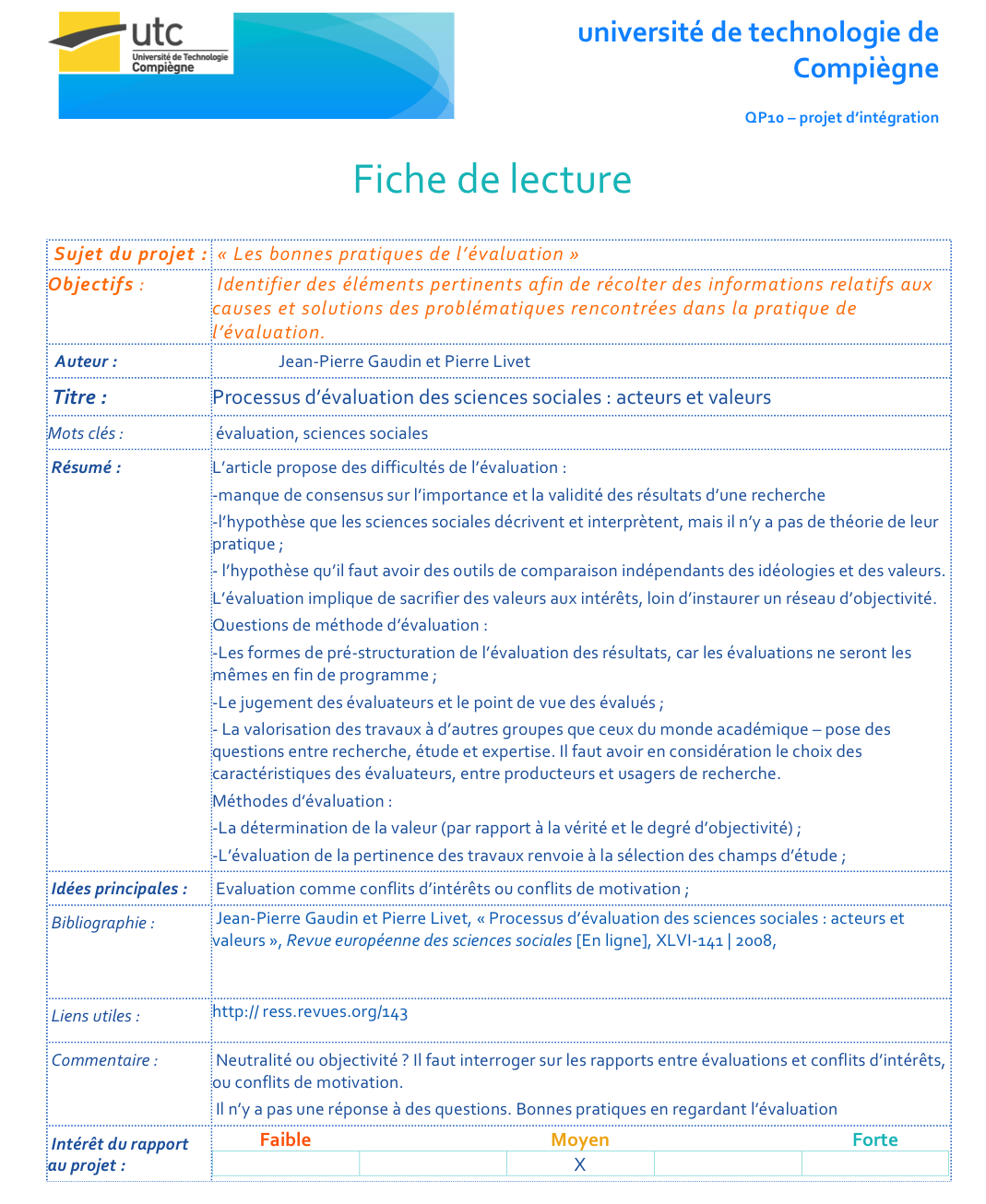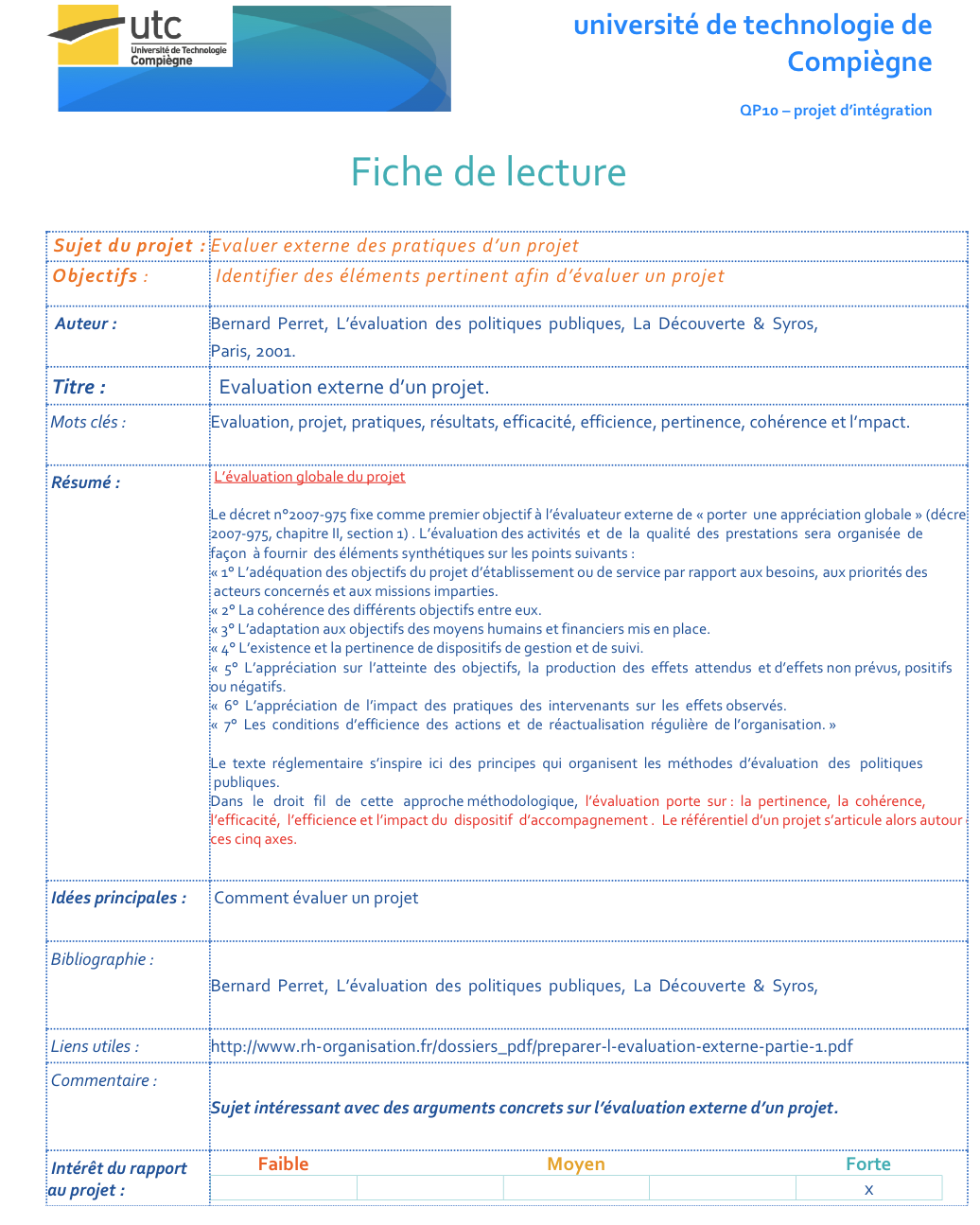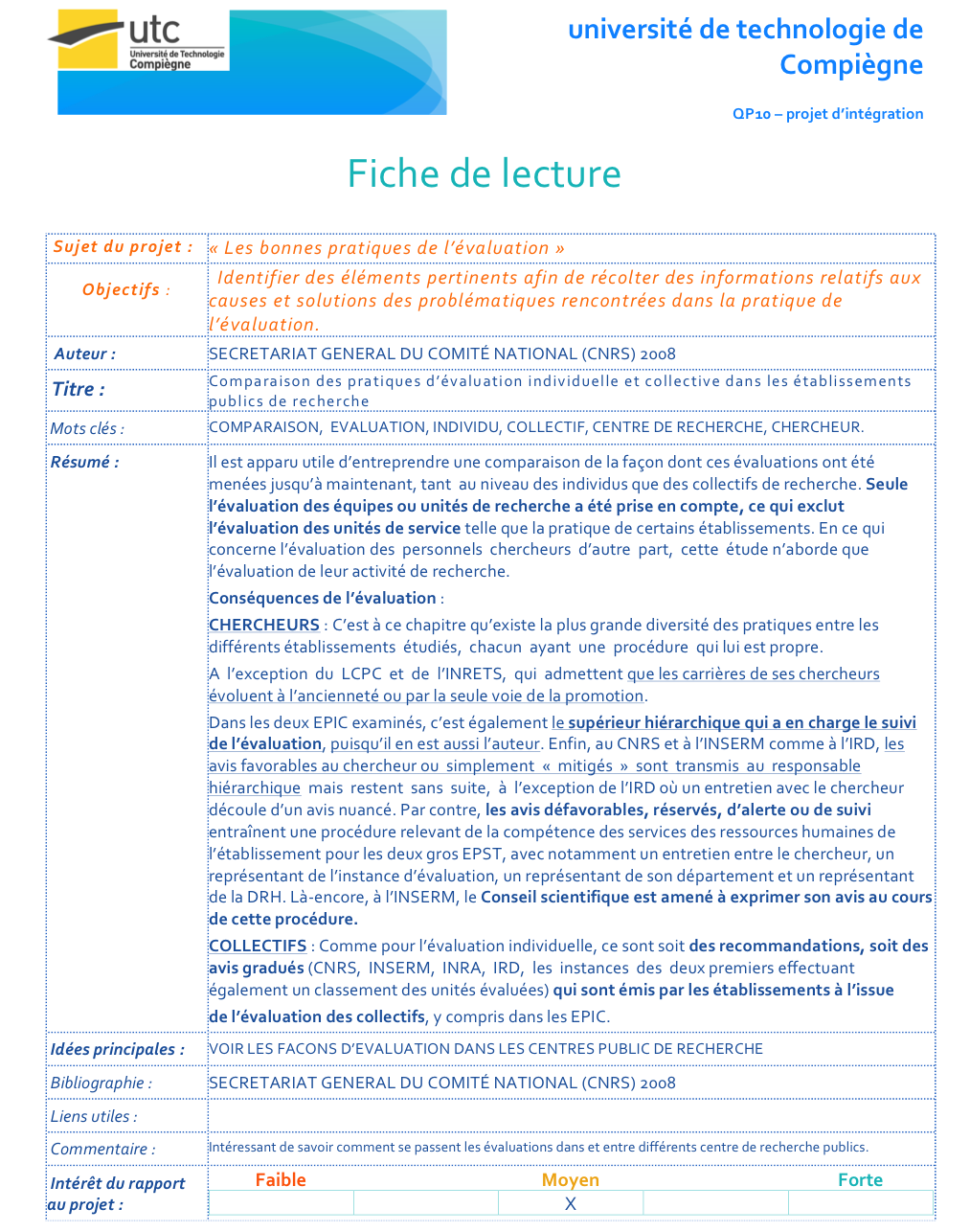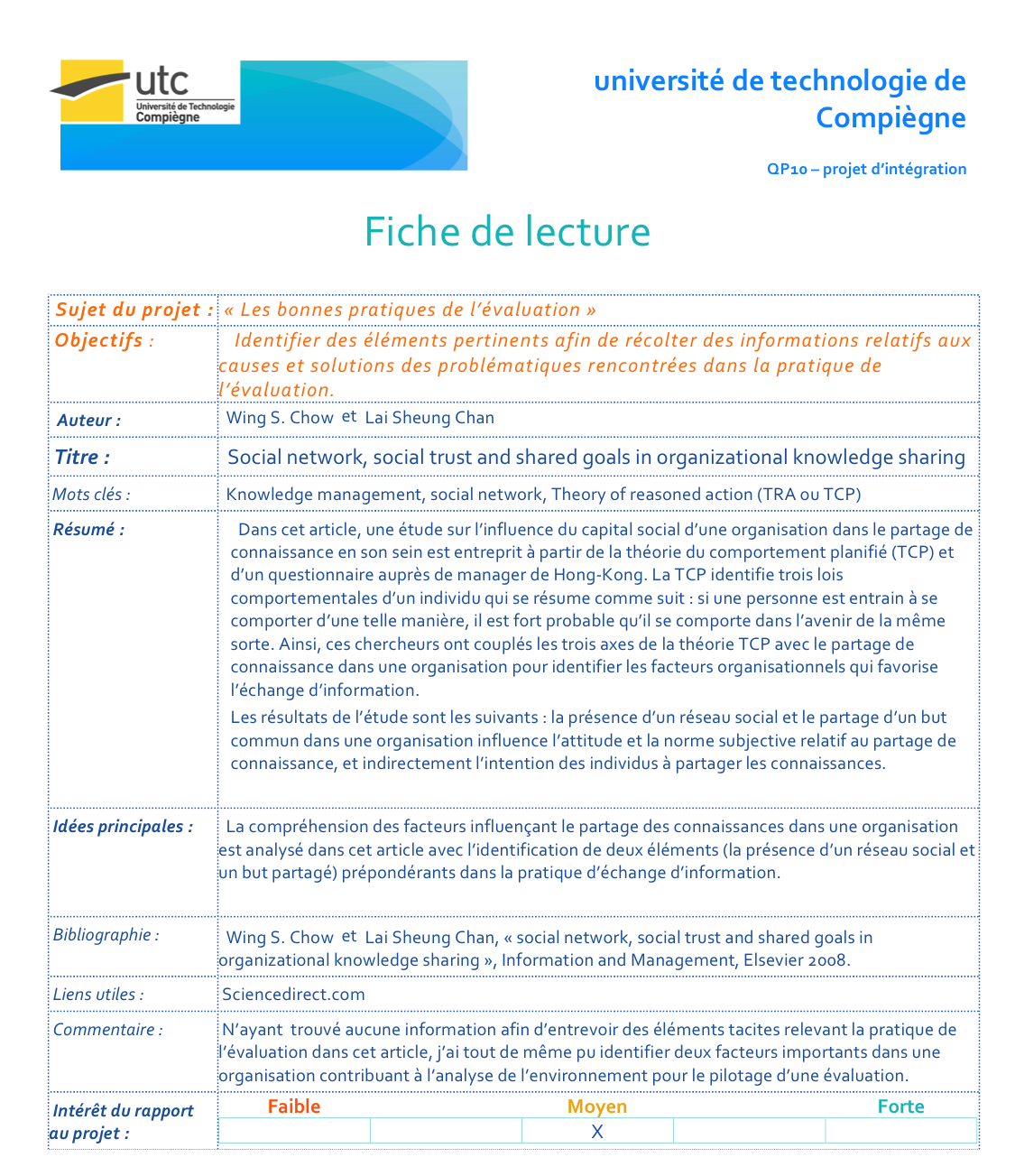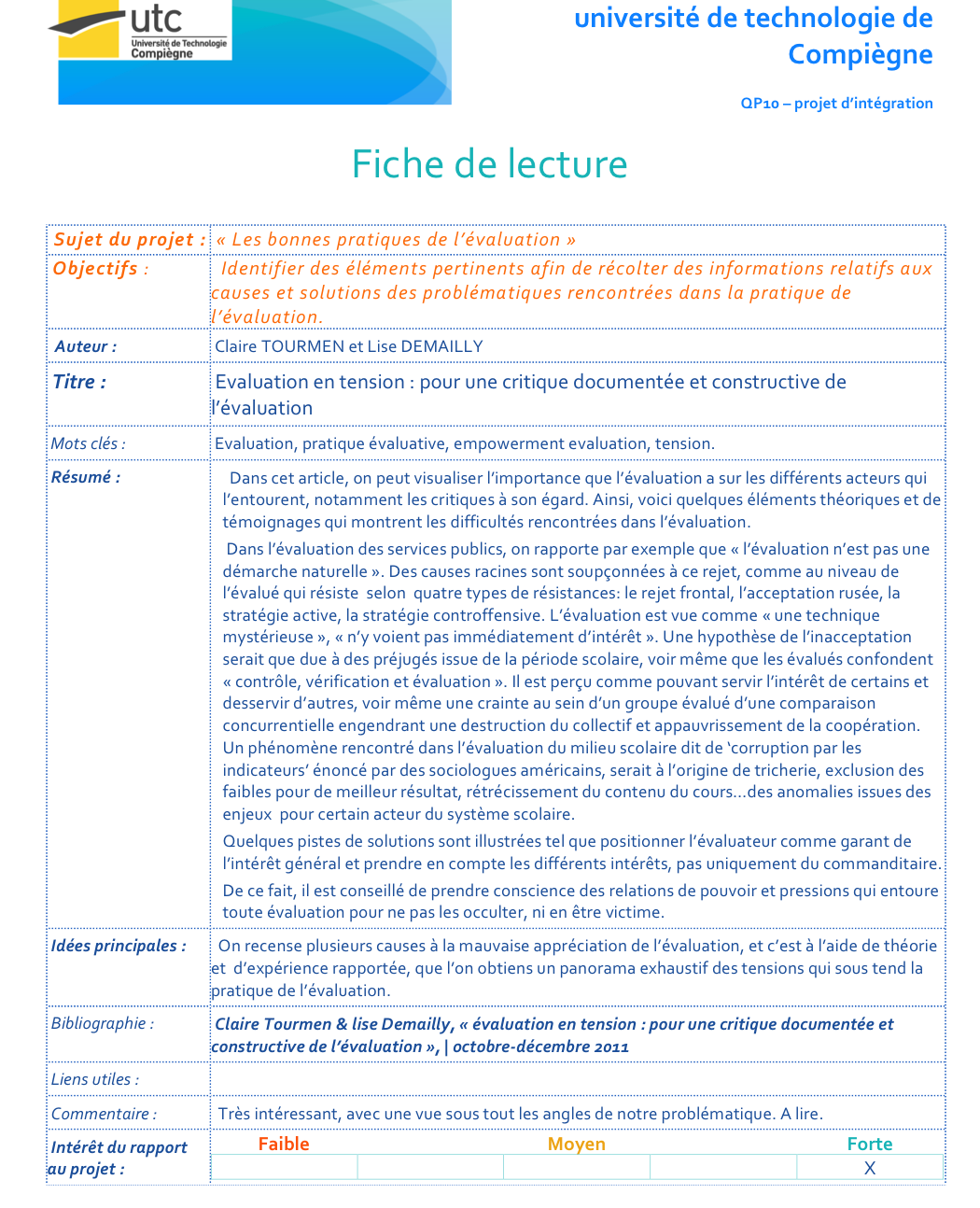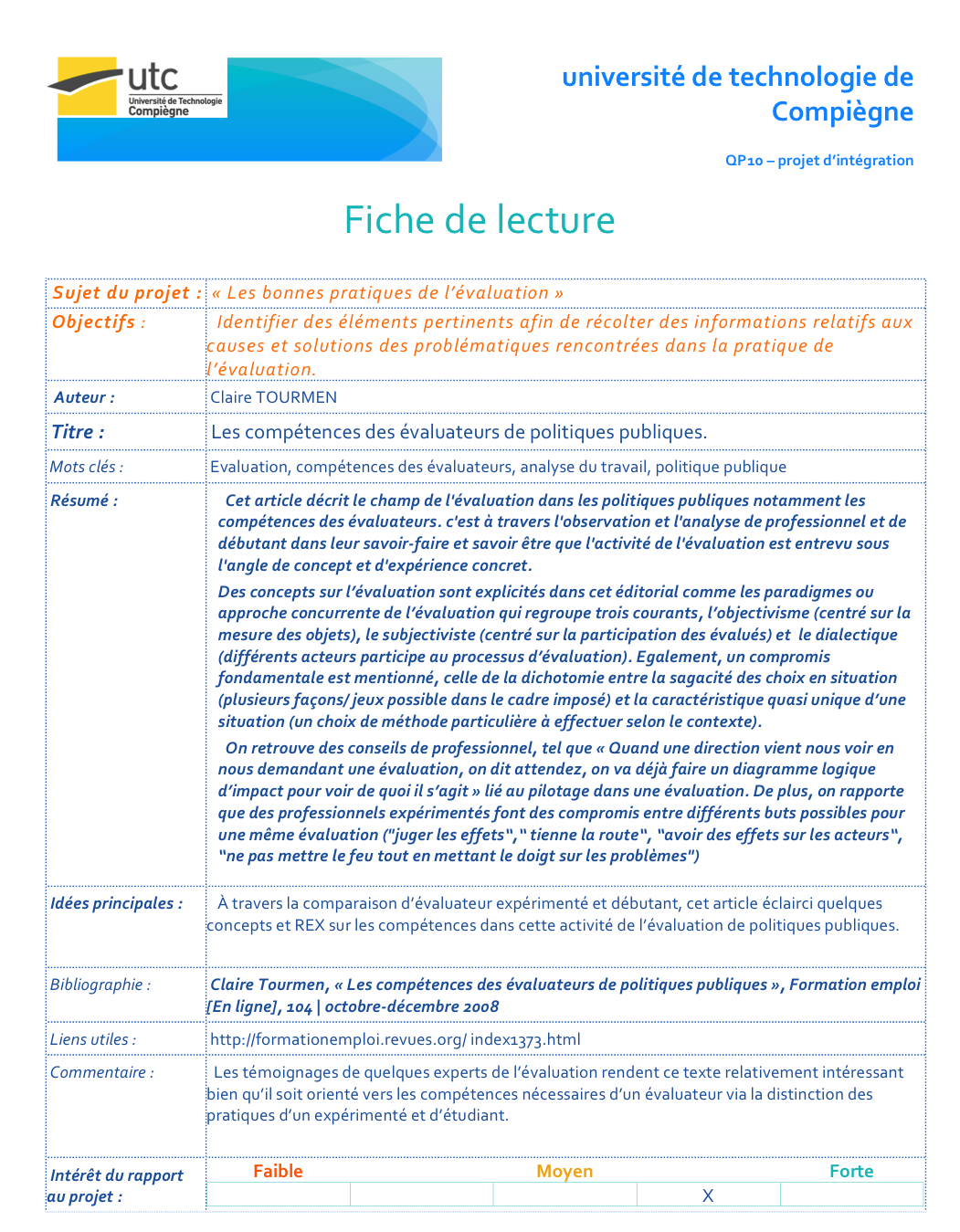La pratique de l’évaluation est l’un des
mécanismes
prépondérant au sein des gouvernements et des organisations
contemporaines, qu’elles soient à but lucratif ou non lucratif,
où toute entités se doivent d’assurer leurs pérennités.
C’est
ainsi que deux modes de gouvernance, la compétition marchande et
le rôle étatique ont guidés ce principe omniprésent vers des
courants multiples qui se reflète de part les déviances
montantes et la pluralité de ces formes.
Le dispositif
d’évaluation s’appui sur des instruments de mesure à l’aide
d’indicateur censé être applicable pour tout type de structure
(hôpital, entreprise, association, tribunal…) ce qui contribue à
un suivi pertinent et objectif de l’évolution du processus
opérationnel et stratégique.
Or cette approche
pragmatique est fortement reprochéeselon
les
spécialistes et concernés provocant malheureusement des
symptômes organisationnels tel que les psychopathologies et
autres méfaits sociétales comme l’effet « prix
Goncourt ».
Historiquement, la rationalisation
du travail par Taylor
lors de la généralisation industrialo-capitalisme
en 1890 créa le besoin d’évaluer ce qui devint ainsi,
l’opérateur essentiel de la naissance du capitalisme. Elle prend
son essor au XIXème siècles, principalement aux Etats-Unis, pour
mesurer d’abord l’efficacité des étudiants puis du système
éducatif et de santé. L'évaluation
a fait l'objet depuis deux siècles de multiples théories qui se
confrontent, donnant lieu notamment à une bataille idéologique
entre adeptes du quantitatif et ceux du qualitatif.
Depuis quelques
années, un courant participative de l’évaluation entre en jeu,
grâce à la sociologie des organisations et des retours d’experts
tel que E.Monier,
précisant que « Le chargé d'évaluation devient un
maïeuticien, un méthodologue et un médiateur », réfutant
l’évaluateur traditionnel, également de critique
fondé, « l’essentiel de ce qu’en cherche à évaluer, se
dérobe à l’observation directe » selon C.Dejours qui
propose de « percevoir l’expérience subjective du
travail ».
C’est dans un souci
d’équité des deux visions de la pratique d’évaluation, celle de
l’objectivisme tangible traditionnel et du subjectivisme tacite
précurseur que nous souhaitons entamer une analyse préliminaire
des pratiques de l’évaluation au niveau normative et au niveau
de l’état de l’art.
Il s’agit
donc par la suite, de clarifier le sujet sur les bonnes
pratiques de l’évaluation à l’aide d’objectifs identifiés et
mesurables puis de l’expertise et la mise en œuvre du plan
d’action défini avec comme idéal de contribuer et rendre plus
performant tout organisme en possession de ce rapport afin
d’améliorer l’efficacité, l’efficience du processus
d’évaluation et de ce fait, la performance de ces entités.
Evaluer c'est d'abord
mesurer,
mais aussi apprécier la valeur d’un projet ou d’une action, sa
mise en œuvre, ses résultats au regard des missions des
objectifs initialement prévus. Il faut donc commencer à
travailler l'évaluation dès le début de l'élaboration du projet.
L’évaluation peut s’appliquer dans n’importe quel domaine de
travail.
L'évaluation permet de
mesurer divers aspects d’un projet ou d’une action dans un
organisme: l'efficience, l'efficacité, l'impact, la cohérence et
la cohésion des gens d’une équipe. Ainsi cette technique
dite de gestion possède une polysémie
qui se diversifie sous l’expertise académique d’un article et un
contrôle de normes de qualité dans un processus productif ; ou
bien dans le suivi du chiffre d’affaire d’une organisation ;
comme dans un indice de satisfaction des usagers d’un service
social; également dans une épreuve standardisée pour comparer
les compétences scolaires des élèves, etc.
L’évaluation est aussi
pour l’équipe un processus permanent, qui doit être utilisé
comme un instrument d’accompagnement des personnes, une démarche
collective de production de connaissances.
Le mot « évaluation » peut avoir plusieurs
connotations en fonction de la perception des acteurs concernés.
Il existe de nombreuses définitions pour cette notion et c’est
dans ce cadre, que l’on entreprend de clarifier le concept
d’évaluation. Voici quelques exemples des définitions:
« Porter un
jugement sur la
valeur. Estimer,
apprécier, juger. » (Le nouveau petit Robert 1994)
« Déterminer plus
ou moins approximativement la valeur de quelque chose »
(Lexis)
« La rétroaction
planifiée et systématique d’informations nécessaires pour guider
l’action future. » (Arnold 1971)
« La collecte et
l’interprétation systématique d’évidence (données probantes)
menant, de façon inhérente au processus, à un jugement sur la
valeur (d’un programme) dans une perspective d’action. »
(Beeby 1977)
« L’analyse d’une
action raisonnée en termes de sa pertinence, son implantation et
ses résultats. » (SCE 1985)
« Le processus de
détermination de la valeur des choses. » (Scriven 1991)
Les définitions
présentées ci-dessus contiennent des mots qui montrent la
subjectivité et l’incertitude de l’évaluation, comme estimer, apprécier,
approximativement, jugement, pertinence. La subjectivité
d’un évaluateur intervient dans l’analyse des données, étant le
principal motif du
manque de confiance dans le processus d’évaluation. Comme on
sait que la rationalité de l’homme est limitée, on s’attend que
l’interprétation de la réalité diffère en fonction de
l’évaluateur. L’effet est la méfiance des acteurs concernés
regardant la mauvaise interprétation des données, donc d’une
évaluation qui ne reflète pas la réalité.
L’évaluation est
souvent perçue par les évalués comme une vérification de leur
activité et ils ont peur d’une mauvaise perception de leurs
actions. Dans la relation évaluateur-évalué intervient la notion
de confiance, qui n’est pas toujours présente.
Une seconde raison du
manque de confiance dans l’évaluation, autre que la
subjectivité, est l’incompréhension de l’activité par
l’évaluateur. Donc il n’a pas la capacité de construire un
référentiel robuste et il ne peut pas comprendre l’essentiel de l’objet analysé. La
pertinence de l’évaluation est mise en cause par les acteurs qui
ne comprennent pas toujours la nécessité de cette démarche. Il
n’est pas toujours évident d’assimiler que l’évaluation n’est
pas le but, mais uniquement un moyen d’analyser la réalité pour
la prise de décision.
La perception de l’évaluation comme un contrôle emmène à avoir
une vision binaire des choses (conforme/ non conforme). Le
processus d’évaluation donne une gradualité à chaque objet
analysé et mets en avant l’inexistence de mauvaise pratique,
mais seulement des pratiques qui peuvent être amélioré. Donc
l’appréciation des évaluateurs a un rôle informatif pour des
futures décisions.
Le
contexte actuel qui entoure la
pratique de l’évaluation est très vaste, allant de la dynamique
sociétale contemporaine au fonctionnement propre des entités
étatiques mondiales, au niveau national et international, voire
d’organisme responsable de l’évaluation aux organismes qui se
font évaluer.
Par conséquent, nous allons
prospecter selon une méthode empruntée au terrain du marketing
de diagnostic de l’environnement externe. C’est à l’aide du PESTEL, étant
l’acronyme de Politique, Économique, Socio-culturel,
Technologique, Écologique et Législative qu’une description
succincte du contexte est proposée pour entrevoir en sous
parties la situation actuelle.
La
stratégie des états tend vers le contrôle, la maitrise de
fonctionnement du système et ceci passe par la mise en place de
démarche pour s’assurer que la concordance entre les objectifs
et les résultats escomptés sont le plus proche possible.
Comme en France, où en
2006, une loi de programme pour la recherchea
été mise en place ce qui a conduit à la création de l’AERES
ayant pour rôle de suivre et accompagner l’évaluation des
institutions éducatives françaises.
Dans ce climat, la progression du budget affilié à l’AERES a
triplé
en 2 ans de 2006 à 2009, ce qui connote des pistes sur
l’importance prise par les entités étatiques dans la pratique
d’évaluation.
Toujours
en France, on remarque un nombre conséquent d’organismes
nationaux d’évaluation pour des domaines spécifiques comme dans le domaine social
et socio-médical.
Au niveau législatif, en Europe
sous la gouvernance de l’U.E, on peut identifier des décrets
et lois relatifs à la pratique d’évaluation. Par exemple,
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation
des substances chimiques (dite règlement REACH) afin de
cadrer et maitriser dans l’union européenne la prévention des
risques environnementales. Le gouvernement Français a montré
récemment un intérêt à l’évaluation d’une partie de ces
institutions, selon l'article 12 de la loi de programmation
des finances publiques du 9 février
2009, l’ensemble des dépenses fiscales et niches sociales
existantes à cette date, à savoir 538 mesures dérogatoires
fiscales et sociales, ont fait l'objet d'une évaluation de
leur bilan coût/efficacité.
C’est
à la suite de la crise économique mondiale de 2008, que l’on
dénonça fortement le problème d’évaluation
des actifs financiers.
Cette
crise a pour origine l’évaluation financière douteuse des
risques de crédit, forte de ce constat, on remet en cause
actuellement le système de titrisation
étant l’instrument financier regretté des banques
d’investissements et des agences de notation qui déclencha à son
insu l’aide massive des états, l’argent du contribuable.
Dans
le cadre socioculturel, les répercutions de l’évaluation au sein
de la société actuel montre des symptômes de pathologie mais
aussi des fondements bienfaiteurs de l’approche de
l’appréciation de la valeur.
On
peut citer la démarche du gouvernement américain à la pratique
de l’évaluation au sein de ses institutions ce qui a conduit à
l’émergence d’une association dans la pratique de l’évaluation,
l’AEA.
Cette
dernière a pour
missiond’améliorer
les
méthodes et la pratique d’évaluation, promouvoir l’utilisation
et la perspective de profession de l’évaluation, contribuer à
l’apport de théorie et connaissances dans ce domaine.
Un
équivalent européen existe, l’European Evaluation Society,
qui a le but de stimuler, promouvoir la théorie et l’utilisation
de l’évaluation en Europe.
Bien
que des organismes participent à la promotion de l’appréciation
et de la mesure, au niveau des faits, des signes de déviance
datant de l’époque industrielle stagnent de nos jours et
s’accompagne de nouvelle psychopathologie qui s’accroit au fur à
mesure que la complexité des organisations s’établisse et que la
compétitivité féroce et déloyale fait jurisprudence, subis par
la mondialisation. On peut recenser que la quête de performancedans
une
entreprise par exemple, est source de déni institutionnel qui
octroie un laisser-faire des défaillances résultantes du travail
réel, ou bien que le gestionnaire devient pilote du processus
sans connaître le travail effectif de l’opérateur. Et ceci peut
engendrer des mécanismes de défenses ou différents types
d’aliénations de la part des opérateurs.
Voici un
récapitulatif des principales organisations présentent dans le
monde participant
à l’édifice de la pratique de l’évaluation :
Figure n°: 1
- les différentes organisations sur la pratique de
l'évaluation dans le monde
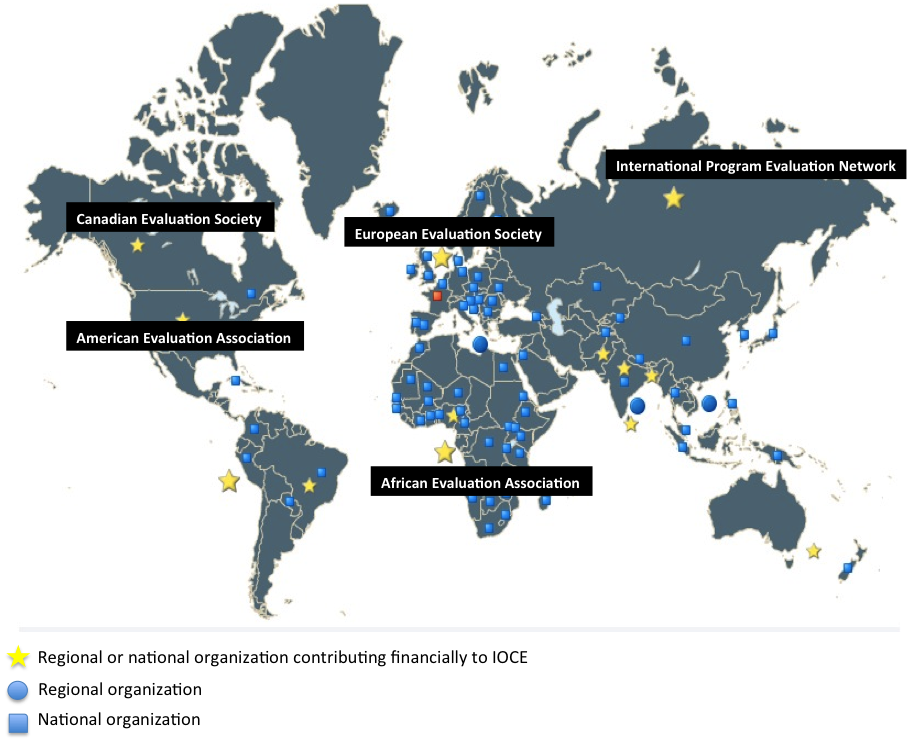
|
L’avancée
technologique remarquable qui se symbolise sous plusieurs traits
dans la société actuelle, connote une variété et multiplicité
des disciplines résultantes, avec des spécialisations abouties
ou en construction.
Pour ces derniers,
on peut noter que l’évaluation prend une ampleur prépondérante
et obligatoire, surtout lorsque le facteur humain et
environnemental entre en jeu. Notamment pour les nouvelles
technologies, tel que les problématiques d’éthique que pose
certaine approche, tel un commentaire émis par M. LARRÈRE :
« Est-ce
que les biotechnologies, les nanotechnologies et la biologie
synthétique relèvent d'artefacts ou de processus naturels ?
Cette question est cruciale car le sens donné à ces techniques
influera sur les dispositions éthiques et métaphysiques ».
C’est ainsi,
qu’un panorama du contexte permet de se situer par rapport à
l’état de l’évaluation dans notre époque. Ceci afin de
comprendre le périmètre du projet relatif à la pratique de
l’évaluation.
C’est à
l’aide du formalisme et du cigle QQOQCP pour Qui ? ,
Quoi ? Ou ? Quand ? Comment ? et
Pourquoi ? que nous proposons d’éclaircir le sujet
traité. Le schéma ci dessous synthétise et nous permet de
formuler la problématique que nous proposons de
résoudre :
La problématique identifiée
‘comment peut-on évaluer la réalité dans une
organisation ? ‘ nous ouvre une voix vers une démarche
d’appropriation des critiques et bienfaits de l’évaluation
afin d’identifier des bonnes pratiques de l’appréciation de la
valeur dans la réalité.
Afin
de visualiser en un coup d’œil les enjeux relatifs au projet, la
représentation graphique de la planification stratégique dynamique
nous permet de situer les acteurs environnants, la mission et
les objectifs du projet par rapport à l’équipe qui agisse à sa
réalisation.
Le
public concerné et impliqué par rapport aux pratiques de
l’évaluation est avant tout le personnel d’une organisation mais
aussi l’organisation elle-même mais aussi l’auditeur et le
public assigné à être évalué. Le public indirectement impliqué
est la société.
Les
attentes générales du public sont une évaluation juste et
correcte du travail et une évaluation qui reflète la réalité du
travail. Le besoin et le livrable particulier c’est d’avoir les
bonnes pratiques de l’évaluation.
C’est
pour cette raison que le contexte de notre travail est orienté
vers les soucis de cette réalité qui se reflète de par les
psychopathologies du travail, puis en prenant en compte la part
importante des organismes tertiaire d’où la prépondérance des
relations avec le client et le personnel dans la co-production
des services.
La mission de notre travail est
donc d’évaluer de
façon performante le système d’une organisation selon les
critères et indices spécifiés.
Les
priorités choisies à travailler sont la réalisation
d’une synthèse entre les normes d’évaluation et la réalité du
système évalué.
L’existence de normes et de
critiques sur le processus d’évaluation est notre support
ainsi que notre force mais la réalisation d’un guide des
bonnes pratiques reste notre domaine à développer et
élaborer et de le mettre en pratique dans une organisation.
Ceci constitue notre objectif mesurable.
Dans l’optique de repérer
les contraintes potentielles qui risque de perturber le bon
déroulement du projet, une analyse des risques fut menée dans
le but de déceler les risques et les contre-mesures pour y
remédier.
Après un brainstorming et un
diagramme d’affinité, le tableau ci-dessous fut établi
regroupant les risques perçus par les membres du projet et la
famille de risques corresponde.
|
Famille de risques
|
Risques perçus
|
|
avoir des problèmes
de communication
et de gestion des taches
|
se perdre dans des détails
|
|
ne pas écouter les autres
|
|
ne pas clarifier la
thématique
|
|
avoir des problèmes de
gestion de tâche
|
|
de ne pas arriver à un
consensus
|
|
avoir des conflits dans
l'équipe de projet qui empêchent l'avancement
|
|
Ne pas consacrer
suffisamment de temps pour finir le projet
|
de ne pas avoir le temps pour
finir le projet
|
|
ne pas respecter les dates
limites
|
|
risque de ne pas mener le
projet avec des jalons prévus
|
|
avoir des
contraintes extérieures qui nous empêchent d’avancer
avec le projet
|
la météo nous empêche de nous
voir
|
|
de ne pas avoir d'internet
chez nous
|
|
ne pas disposer des
ressources pour réaliser notre projet (panne
ordinateur)
|
|
ne pas fournir le
livrable attendu
|
aller en cercle sans trouver
des bonnes pratiques
|
|
la peur de ne pas livrer
exactement ce que M.FARGE demande
|
|
risque que notre projet ne
serve à rien (aucune utilité)
|
|
risque de ne pas trouver une
solution concrète
|
|
de ne pas avoir des sources
d'inspirations
|
|
risques de faire hors sujet
|
|
d'aller sur la direction
erronée
|
|
avoir une mauvaise
compréhension du sujet
|
Ensuite les
alternatives pour chaque famille de risques (intrinsèquement
pour chaque risque perçu) fut identifié et représenté sous la
représentation ici-bas :
Maintenant que les
objectifs à atteindre et les risques sont identifiés, l’axe sur
lequel il est nécessaire d’entreprendre pour caractériser la pratique de l’évaluation se
schématise à partir du schéma dynamique du progrès selon l’ISO
9001. En effet, ce dernier récapitule selon un graphe la
coordination synthétique au sein d’une entité et il semble être
adéquat pour représenter les pratiques d’une évaluation sans
omettre les exigences essentielles de l’ISO 9001, telle
qu’une direction de pilotage de l’entité, puis un management des
ressources allouées pour la réalisation des objectifs fixés,
ensuite la réalisation de l’activité propre à l’entité selon un
cycle DCAP pour notre cas et une capitalisation par le retour
d’expérience. Ainsi, on peut visualiser le déroulement global
d’une évaluation. L’identification des pratiques est limité à
une vision macro pour une compréhension holistique de
l’évaluation.
De même, il
faut savoir que la pratique de l’évaluation peut se diviser en
deux sous ensembles, l’évaluation externe qui est une
appréciation d’une entité par un groupe d’évaluateur externe
avec la complicité de la direction alors que l’évaluation
interne est réalisé par les membres de l’entité, que se soit
les employés voir des partenaires.
Dans l’optique de
recadrer les pratiques d’évaluation actuelles, nous nous sommes
inspirées d’articles et d’ouvrages qui remettent en cause
l’évaluation de nos jours et présentent des pistes
d’améliorations dans le but d’identifier les raisons du
dysfonctionnement et y pallier. De ce fait, les membres du
groupe ont enregistré toutes les critiques d’une part et les points d’amélioration
d’autre part issus de ces différents textes. L’enregistrement
du tout fut procédé sur post-it pour les supports
bibliographiques physiques, tandis que les supports numériques
furent enregistrés directement via l’ordinateur.
Ainsi, voici la liste
des appuis bibliographiques qui nous ont permis d’extraire les
éléments problématiques de la critique de l’évaluation et ces
solutions :
-
FD X 50-186 juillet
2005, système de
management, Lignes Directrices pour la Mise en place d’un
Processus d’Auto-évaluation
-
FD X 50-174 : 1998,
Management de la qualité - Évaluation de l’efficacité d’un
système qualité
-
Christophe DEJOURS , « l’évaluation du travail à l’épreuve du réel :
Critique des fondements de l’évaluation », INRA Edition,
Paris, 2003
- Christian
MARÉCHAL, « Comprendre
l'évaluation dans le secteur social et médico-social »,
lexitis Edition, 2011
-
Gabrielle BALAZS & Jean
pierre FARGUER, une
nouvelle forme de management : l’évaluation, Actes de
la recherche en sciences sociales. Vol. 114,
septembre 1996. pp. 68-78
- Claudine HAROCHE, « l’inévaluable
dans une société de défiance », PUF cahier
internationaux de sociologie, 2010, n ° : 128-129,
p 53-78
-
Danilo
MARTUCCELLI, « critique
de la philosophie de l’évaluation », P.U.F. | Cahiers
internationaux de sociologie 2010/1 - n° 128-129 -
pages 27 à 52
- Jean-Pierre GAUDIN et Pierre
LIVET, « Processus
d’évaluation des sciences sociales : acteurs et valeurs
», Revue européenne des sciences sociales [En ligne],
XLVI-141 | 2008,
-
Bernard PERRET, « L’évaluation des politiques
publiques »,
La Découverte & Syros, Paris, 2001.
- CNRS, « Comparaison des pratiques
d’évaluation individuelle et collective dans les
établissements publics de recherche », SECRETARIAT
GENERAL DU COMITÉ NATIONAL, 2008
-
Wing
S. CHOW et Lai Sheung CHAN,
« social network,
social trust and shared goals in organizational knowledge
sharing », Information and
Management, Elsevier 2008
-
Claire TOURMEN & lise
DEMAILLY, « évaluation en
tension : pour une critique documentée et constructive
de l’évaluation », | octobre-décembre 2011
-
Claire
TOURMEN, « Les compétences
des évaluateurs de politiques publiques », Formation
emploi [En
ligne], 104 | octobre-décembre 2008
De
surcroit, un interview avec une spécialiste de l’évaluation, Mde
TOURMEN fut effectué. Voici l’extrait de notre échange. Lors
de l’entretient avec Claire TOURMEN, elle a évoqué les causes de
la non évaluation ainsi que les solutions applicables pour
résoudre ce problème.
En
effet, dans un premier temps les causes principales du non
évaluation sont : la méfiance du contexte de l’évaluation,
manque de temps et des moyens ainsi que les compétences des
évaluateurs.
Dans un deuxième temps, nous distinguons :
l’environnement hostile, le scepticisme dans les résultats de
l'évaluation, différence entre la pratique et la théorie,
financement de l’évaluation et le manque du temps pour évaluer.
Les
solutions possibles et envisageables sont d’avoir les moyens
financiers puis de connaitre les finalités d’évaluation. Mais
aussi avoir le temps pour évaluer et prendre de bonnes décisions
de pratique selon le contexte. Par la suite, il faut connaitre
les finalités d’évaluation mais aussi avoir les référentiels
d’évaluation.
Souvent, ce qui est recherché à
évaluer sont le climat de travail, la souffrance, la
spécificité des locaux tout en demandant les avis des gens qui
y travaillent sur le bien-être des locaux, la gestion et
l’organisation du travail. Pour cela il faut construire un
référentiel d’évaluation avec les indicateurs adéquats comme
celui d’absentéisme. Notamment il existe une différence
d’évaluation entre les pays. Aux Etats-Unis, la méthodologie
d’évaluation est différente de celle élaborée en France car
elle s’adapte selon le contexte précis d’utilisation.
Afin de
discerner les pratiques dans chaque phase du déroulement d’une évaluation, les causes
furent regroupées selon la phase correspondante à l’aide d’un
MINDMAP. Puis les
solutions associées
issues des ouvrages et d’un brainstorming ont été
retranscrites dans cette représentation synthétique. Les
détails sont visibles en annexes
5, 6 et
dans un document complémentaire où tout les risques et
alternative sont explicités.
Une attention
particulière a été portée pour les causes (ou risques), où ces
dernières ont été classées dans des familles de risque
potentiellement responsables de la mauvaise appréciation de la
pratique de l’évaluation. En effet, un Ishikawa dynamique fut
opéré en prenant un par un tel risque repéré lors des lectures
et le classant dans les familles qui se créaient au fur et à
mesure. La technique employée fut de colorer sur la MINDMAP
chaque risque qui se ressemble en ayant l’objectif de
restreindre à 4,
voir 6 sous ensembles.
De ce fait,
on obtient l’Ishikawa ci-dessous :
Figure n° 4 :
Grandes familles des risques relatifs aux pratiques de
l’évaluation.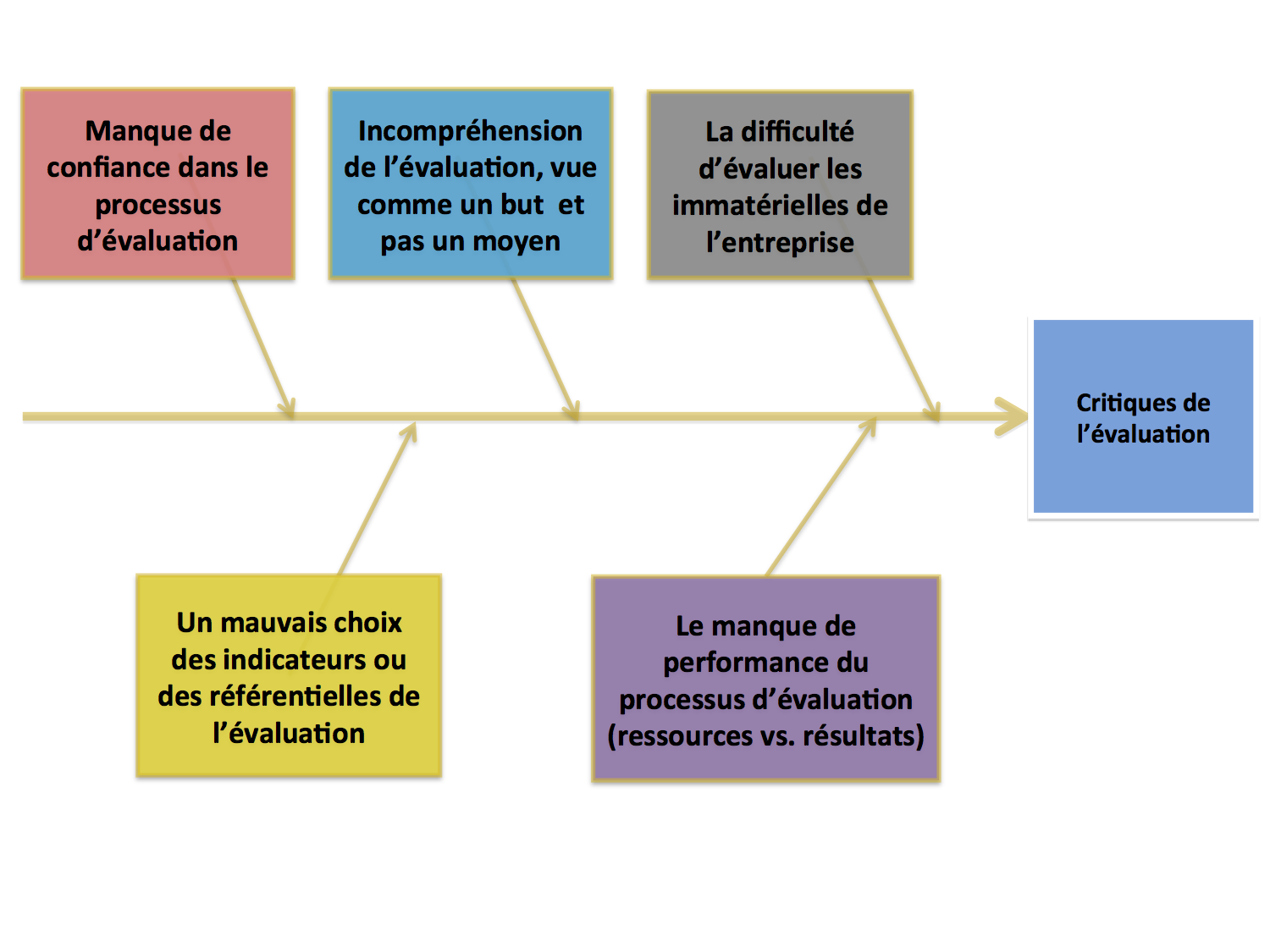
|
Maintenant que les
alternatives de chaque risque sont identifiées, il est
nécessaire de les sélectionner pour identifier les bonnes
pratiques de l’évaluation. Pour cela, une grille d’appréciation
des alternatives a été créée. Cette grille de sélection se base
sur les familles de risques discernées afin que chaque
alternative soit confrontée à chaque famille. Le principe réside
sur l’énonciation suivante : « l’alternative peut
répondre plus ou moins à une famille de risque ».
En se basant sur ce
principe, on peut pondérer notre appréciation d’une alternative
pour chaque famille de risque lié au critique de l’évaluation.
Dans notre situation, chaque membre du groupe va répondre à la
grille, et de ce
fait, va déterminer une valeur comprise parmi 0%, 30%, 70% et
100% (étant une suite de valeurs distinctes et sans valeur
médiane).
Ci-dessous, vous
avez l’échelle de notation de la grille :
|
Notation
|
Signification
|
|
0%
|
l’alternative
ne répond pas au risque
|
|
30%
|
l’alternative
élimine en partie le risque
|
|
70%
|
l’alternative
élimine en grande partie le risque
|
|
100%
|
l’alternative
élimine le risque
|
Ainsi, nous obtenons un jugement de valeur
d’une alternative de chaque membre pour chaque famille de
risque. Alors, une note moyenne est identifiée pour chaque
alternative déterminée par chaque membre. Cette note est issue
du calcul pondéré suivant:
Ri est le risque noté, c’est à dire la
valeur attribuée par chaque membre pour la correspondance entre
une alternative et une famille de risque selon l’intervalle
définie. La somme des valeurs est ensuite pondéré selon qu’une
alternative répond (soit 30%, 70%, 100% d’où une valeur égale à
1) ou ne répond pas (soit 0% d’où une valeur de 0) à une famille
de risque (Ri). C’est donc la somme des réponses logiques qui
est multiplié par la somme des notations des risques et qui est
divisé par 2500 pour ramener à un Taux d’efficience (Te) compris
entre 0% et 100%.
Ensuite, le Taux
d’efficience Moyen (TeM) qui correspond à la moyenne des Te de
tous les membres est déduit. (Rappelant la nature subjective et
personnel de la détermination des valeurs par chaque membre,
rendant le TeM contextuel et propre).
Le Taux d’efficience
Moyen (TeM) est un critère de sélection des alternatives.
De même,
l’écart type (ET) du Te entre les membres par rapport à la TeM
est envisagé dans notre analyse, ainsi, on peut visualiser
l’écart des notations pour une alternative. Voici les calculs
correspondants :
Du fait de la
nature épistémologique distinct des alternatives (fait
référence à une action particulière, des qualificatifs
orientant l’appréciation,…), il est préférable de relativiser
chaque écart type de chaque TeM dans le but d’obtenir un
second critère de sélection : l’Ecart Type relative (ETr)
de formule suivante :
Donc, il est possible
de filtrer les alternatives selon deux critères précédemment
définis :
-
le TeM, le Taux
d’Efficience Moyen du groupe pour chaque alternative, qui permet
de distinguer les alternatives répondant plus ou moins aux
différentes familles de risques.
-
Le ETr, l’Ecart Type
relatif du TeM pour chaque alternative, qui permet de montrer
les écarts d’appréciations du groupe par rapport à une
alternative.
Afin de nuancer notre
approche sur les pratiques dans le processus de l’évaluation,
une qualification graduée du TeM
et du ETr fut nécessaire. Le TeM est divisé en deux sous
ensemble :
- faible efficience
quand le TeM est compris entre 0% et 50% et
- forte efficience
quand le TeM est compris entre 50% et 100%
Tandis que l’ETr, ce
critère est séparé de la manière suivante :
- dissensus quand l’ETr
est compris entre 0% et 50% et
- consensus quand
l’ETr est compris entre 50% et 100%
Ainsi, on
obtient une matrice qui se schématise comme suit :
Voici le
processus récapitulatif de sélection des alternatives :
La
totalité de la démarche statistique effectuée est regroupé dans
un fichier EXCEL personnalisable et adaptable selon le contexte.
D’où l’obtention d’un outil de sélection des bonnes pratiques de
l’évaluation. Cet outil présente les caractéristiques
suivantes :
Fonctionnelle
-
Contextuel
-
personnalisable
-
robuste
-
nuancé
Technique
-
Possibilité d’ajouter des
alternatives dans la colonne correspondante
-
Possibilité d’émettre de
nouveau critère de sélection des alternatives
-
Le choix du seuil de la
limite de l’efficience du TeM et du consensus selon l’ETr
-
Paramétrage du tri des
colonnes
Ci-dessous,
on peut visualiser un extrait de l’outil de sélection des bonnes
pratiques de l’évaluation :
Les onglets visibles dans le schéma ci-dessus montre
les personnes participant à la notation de la grille et avec un
onglet dit ‘calcul’ qui regroupe les critères et TeM des
alternatives.