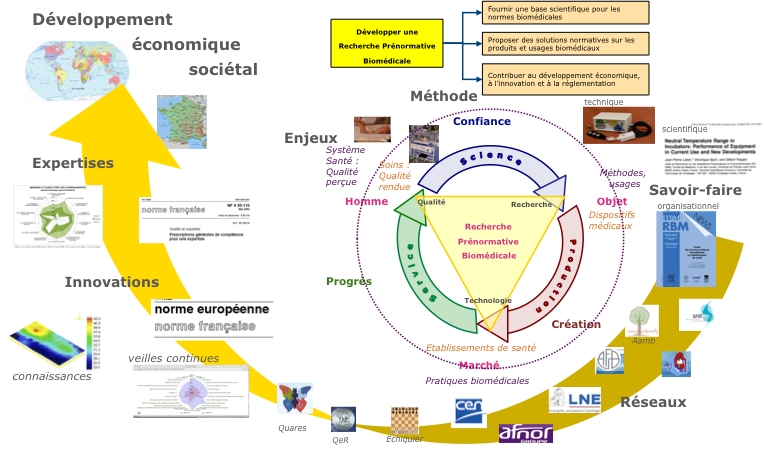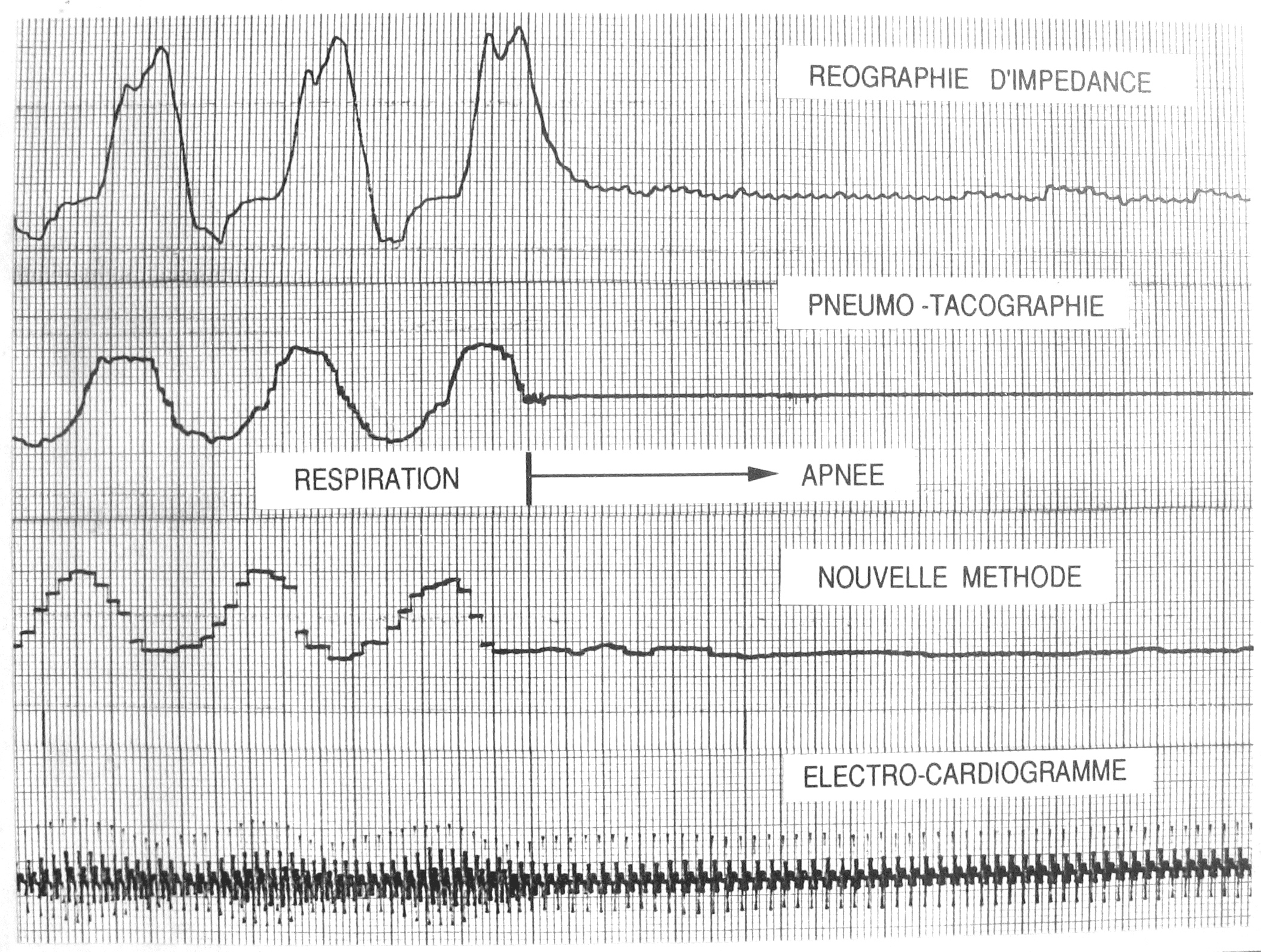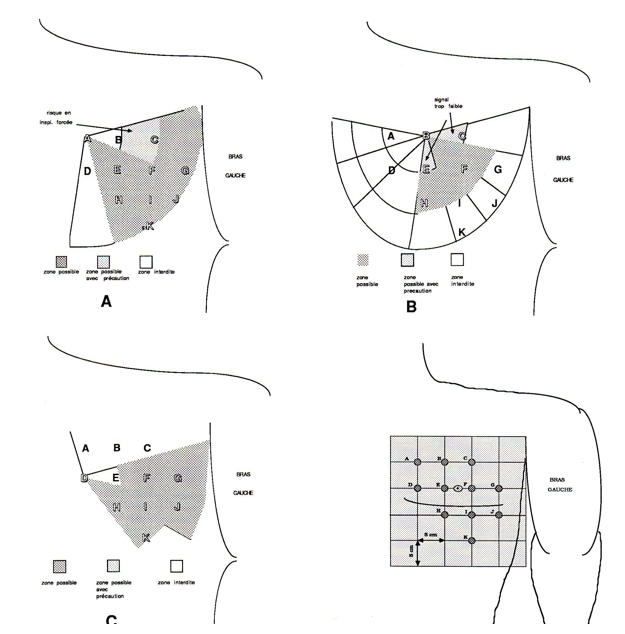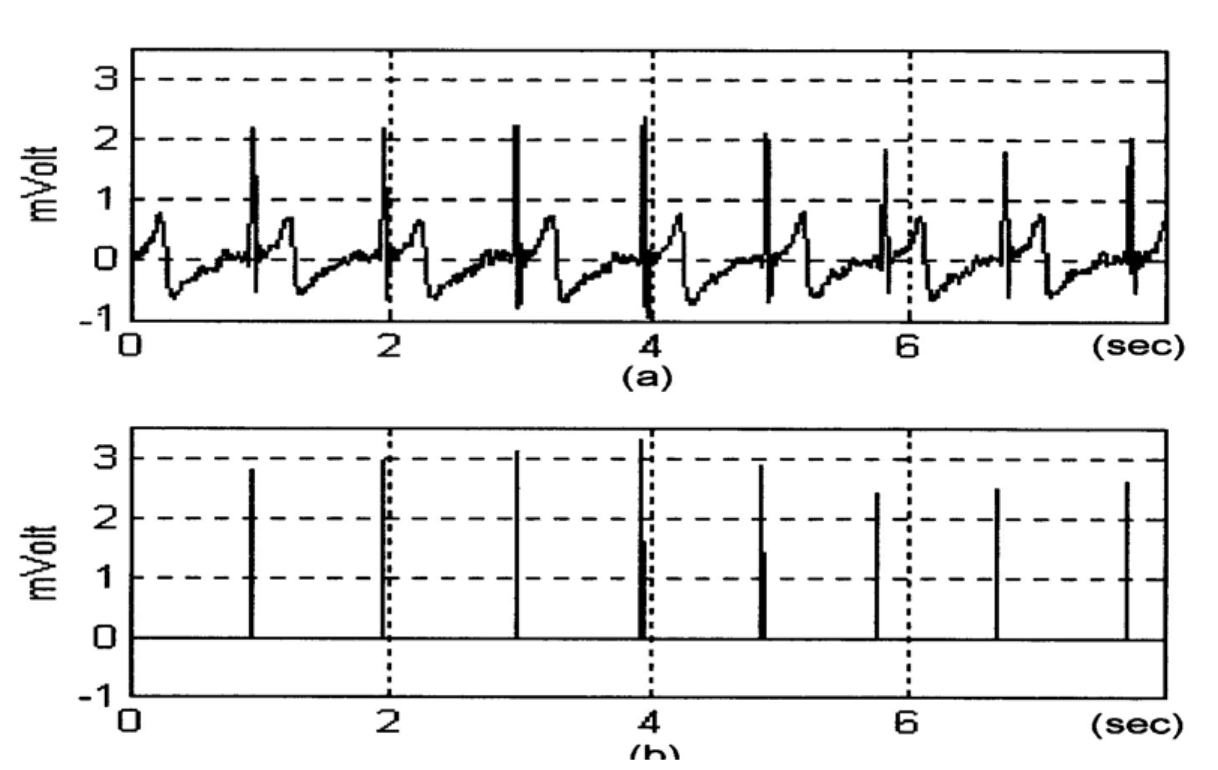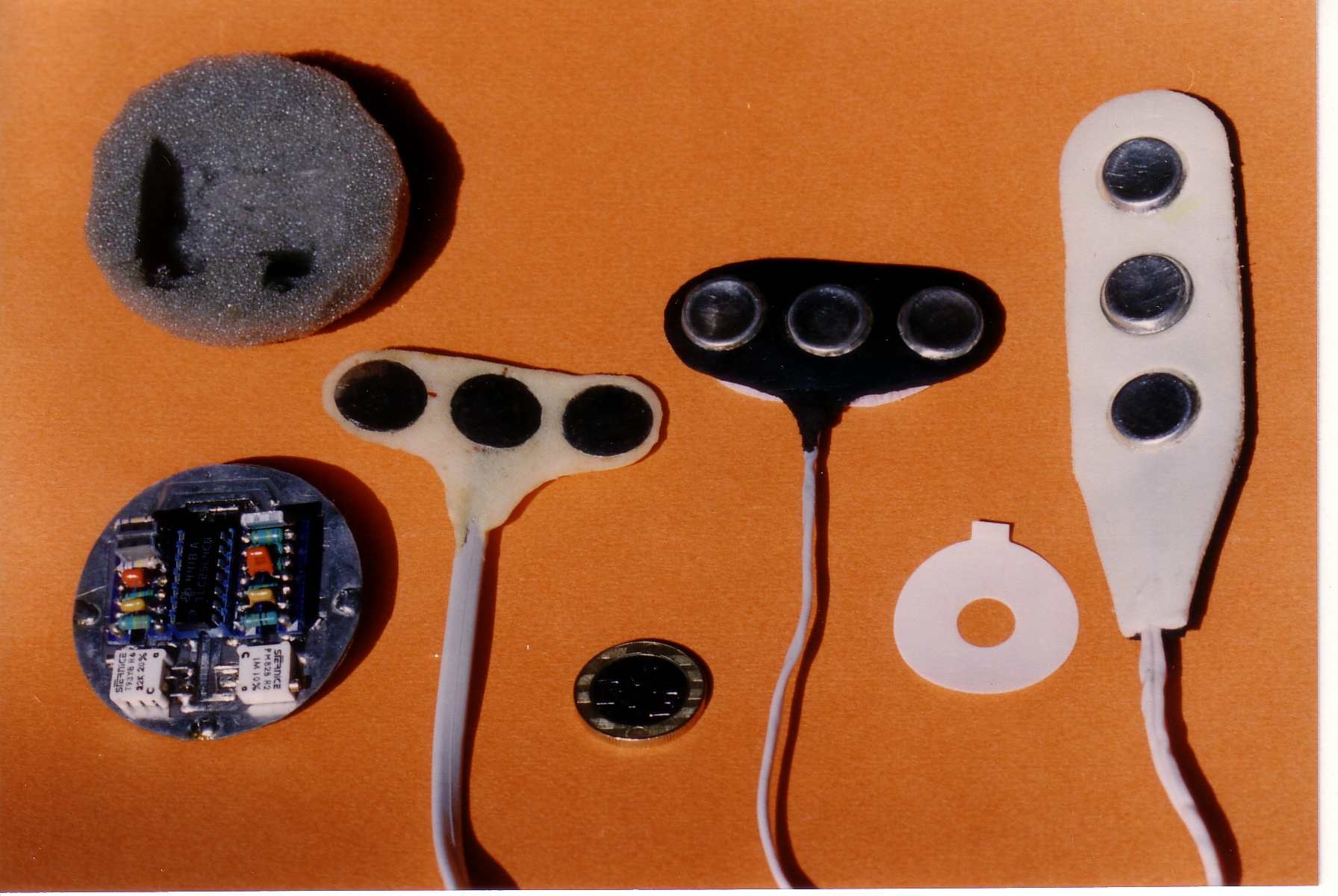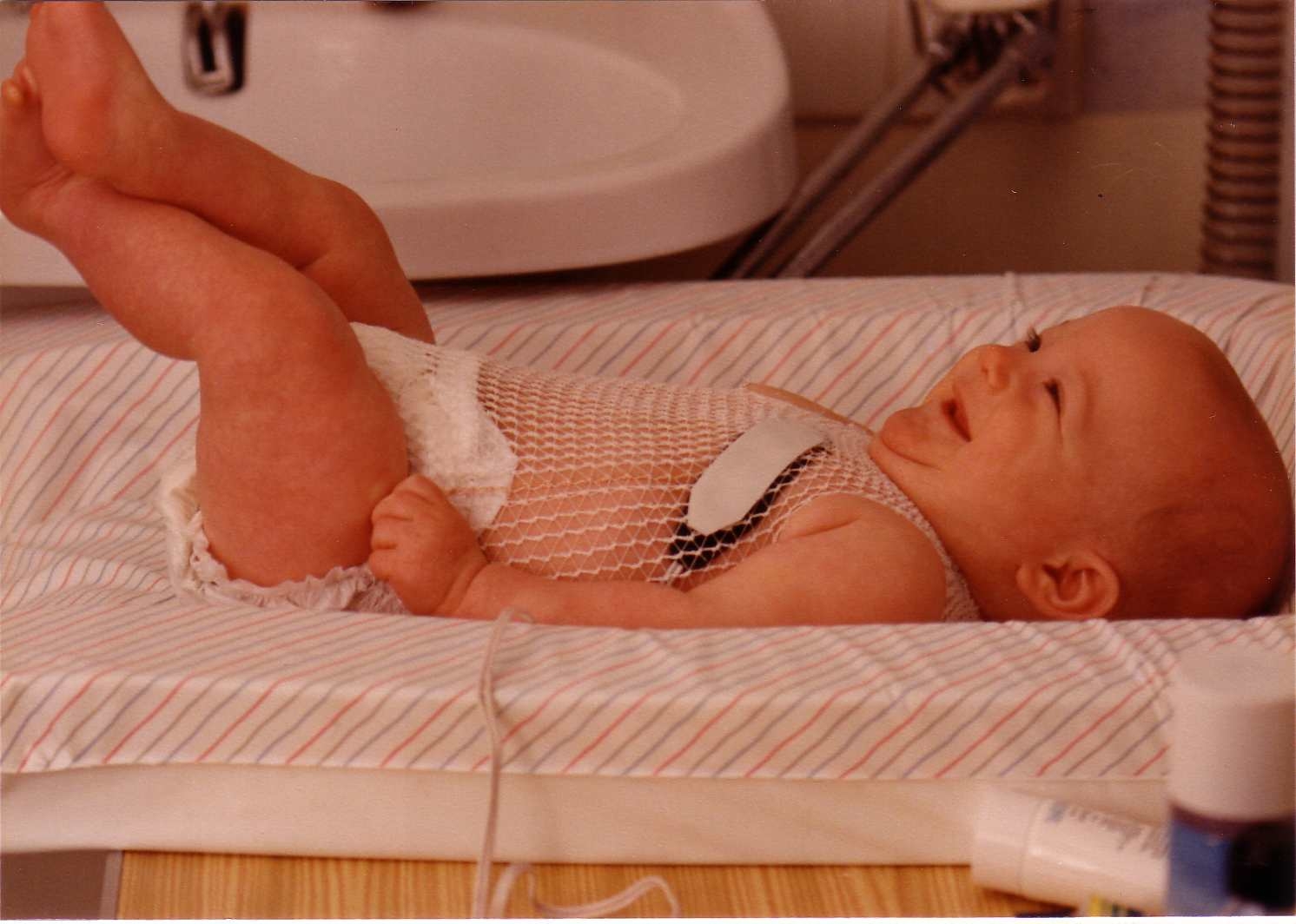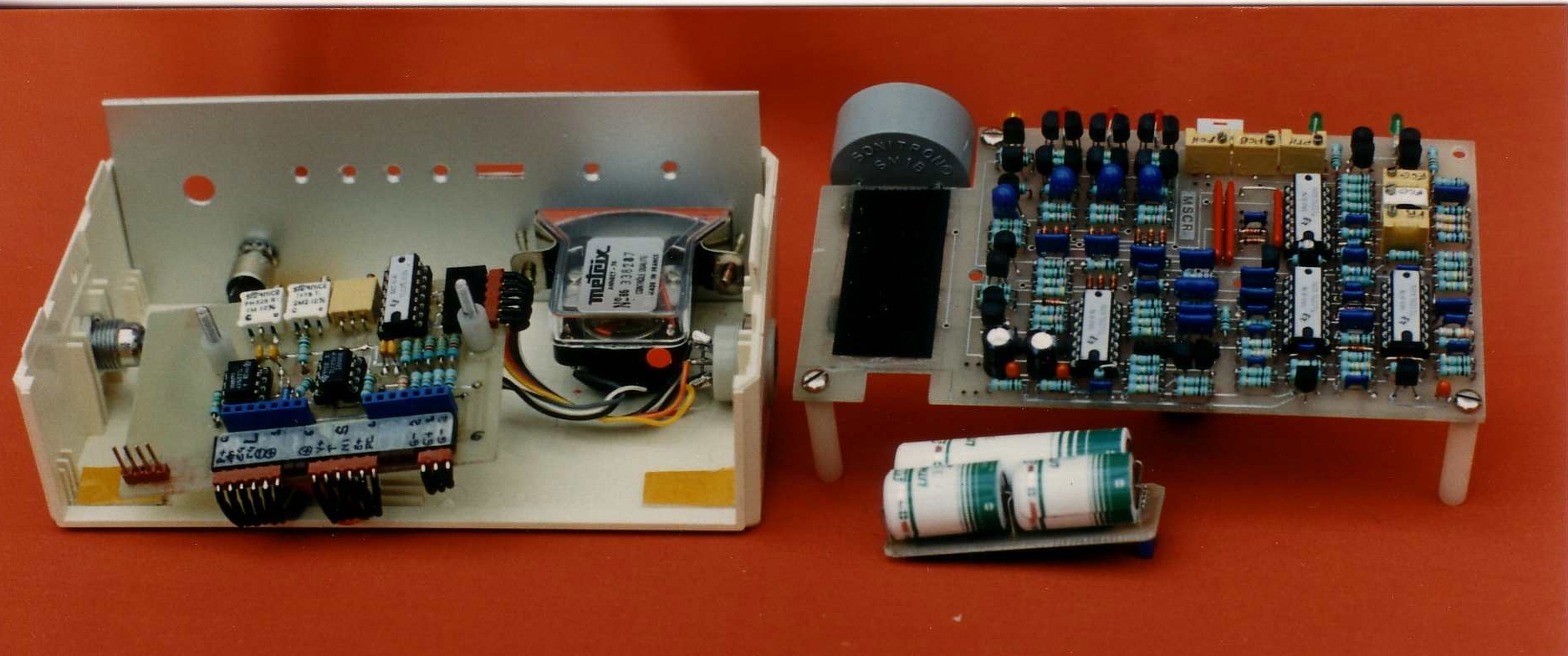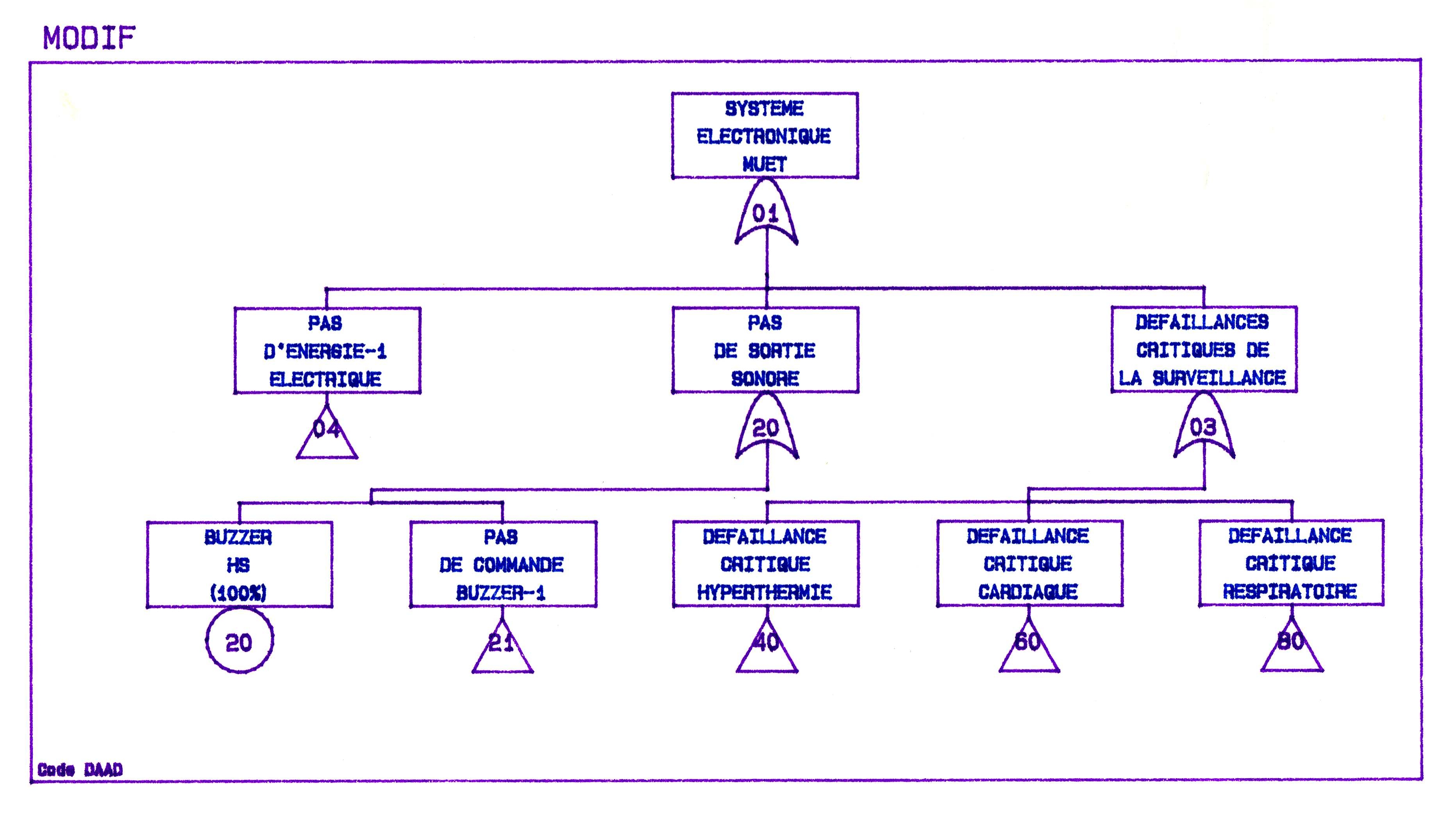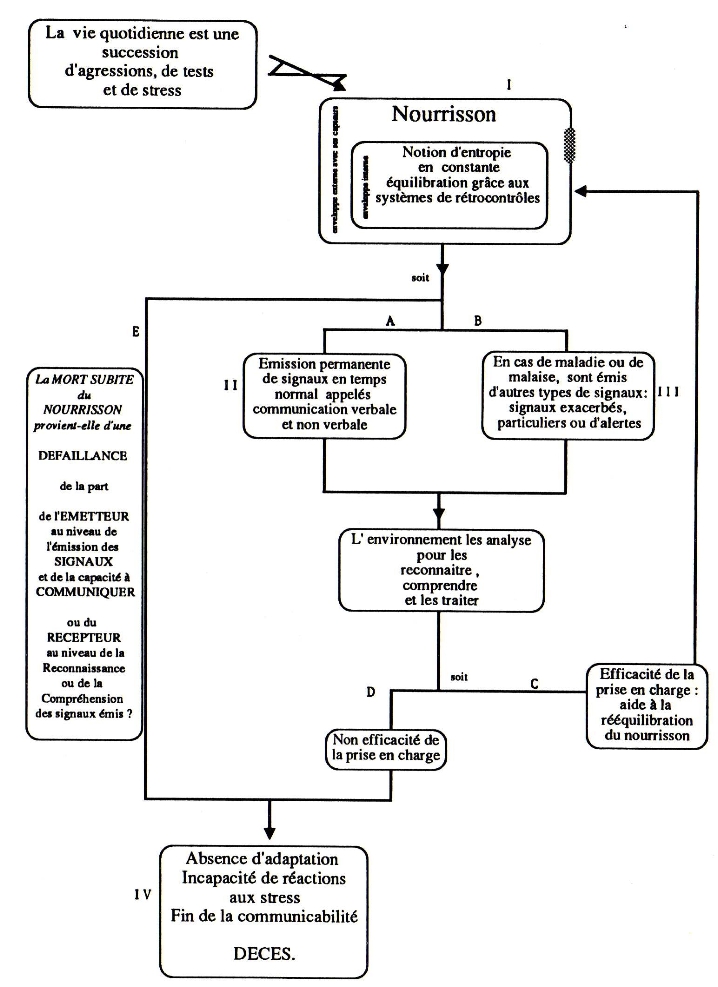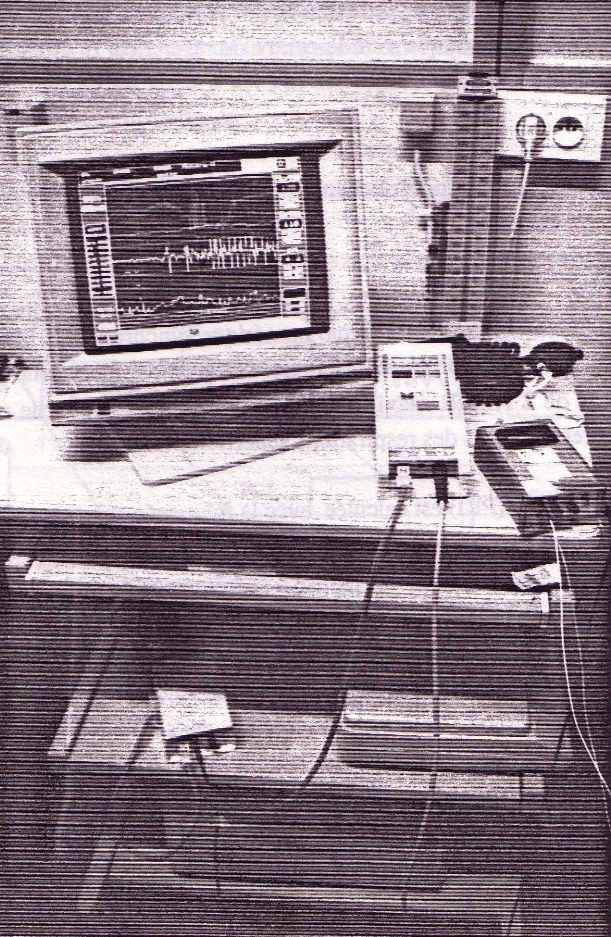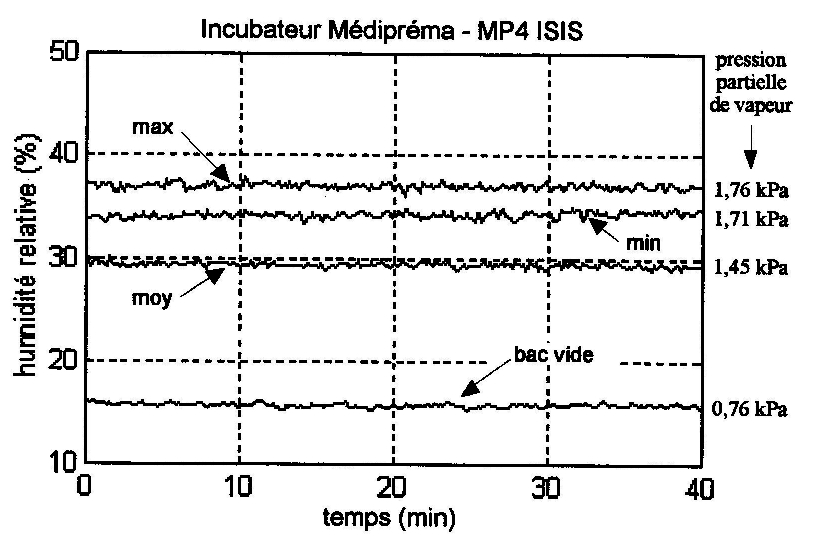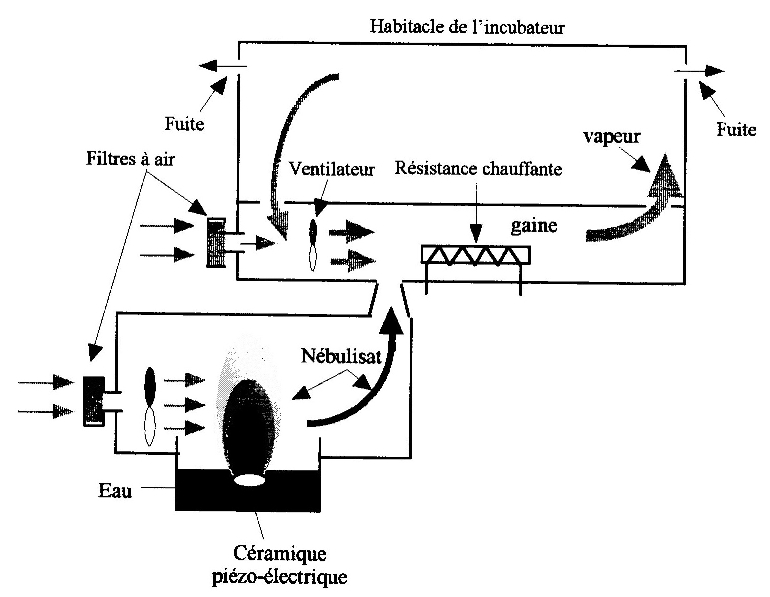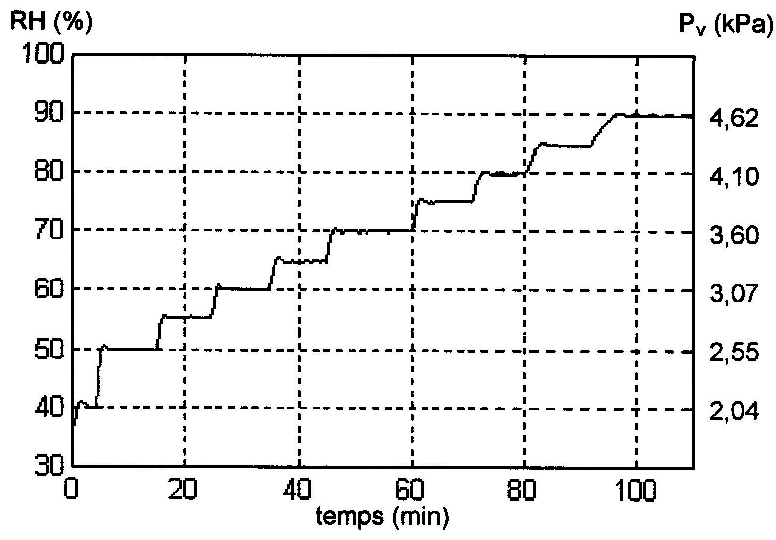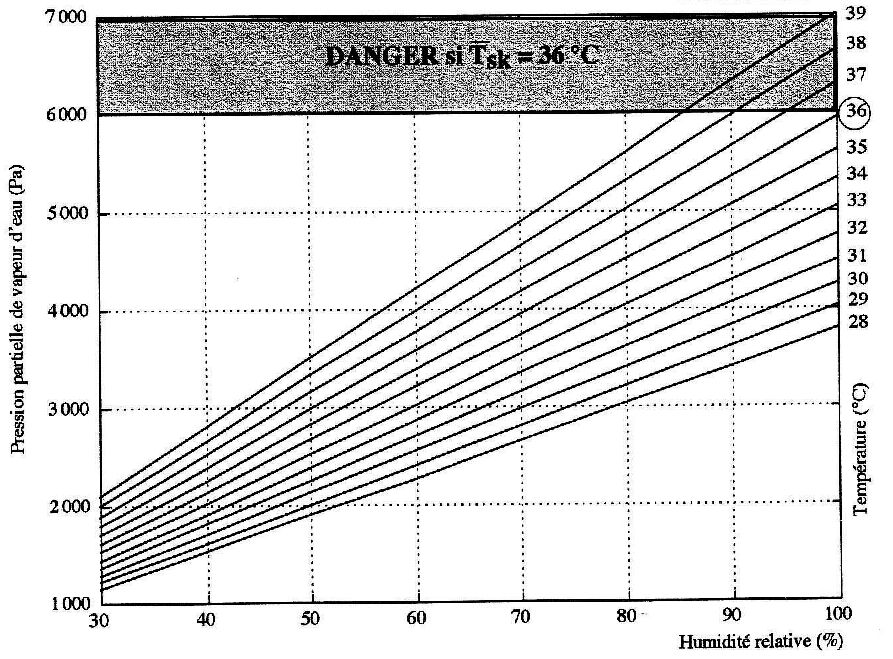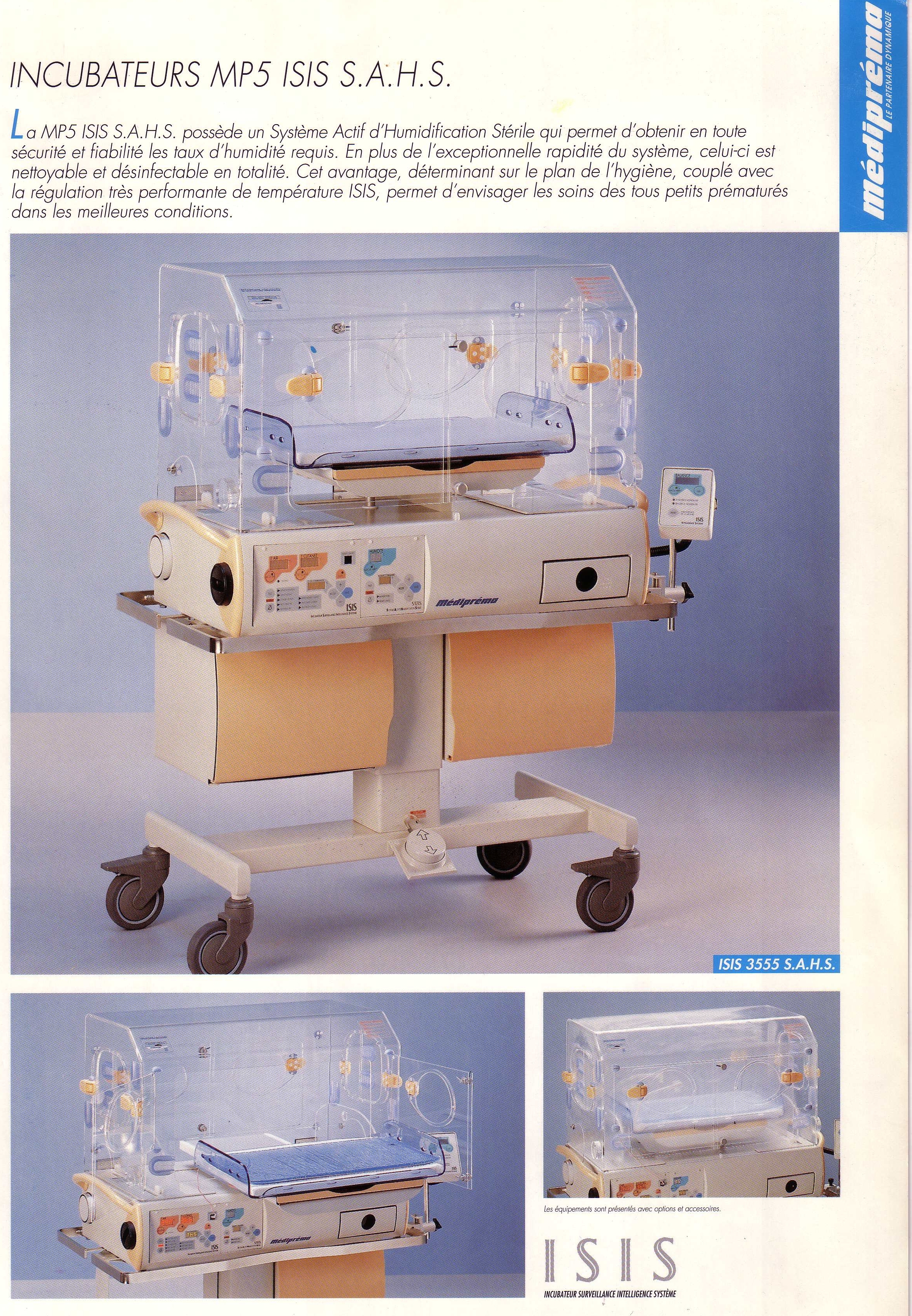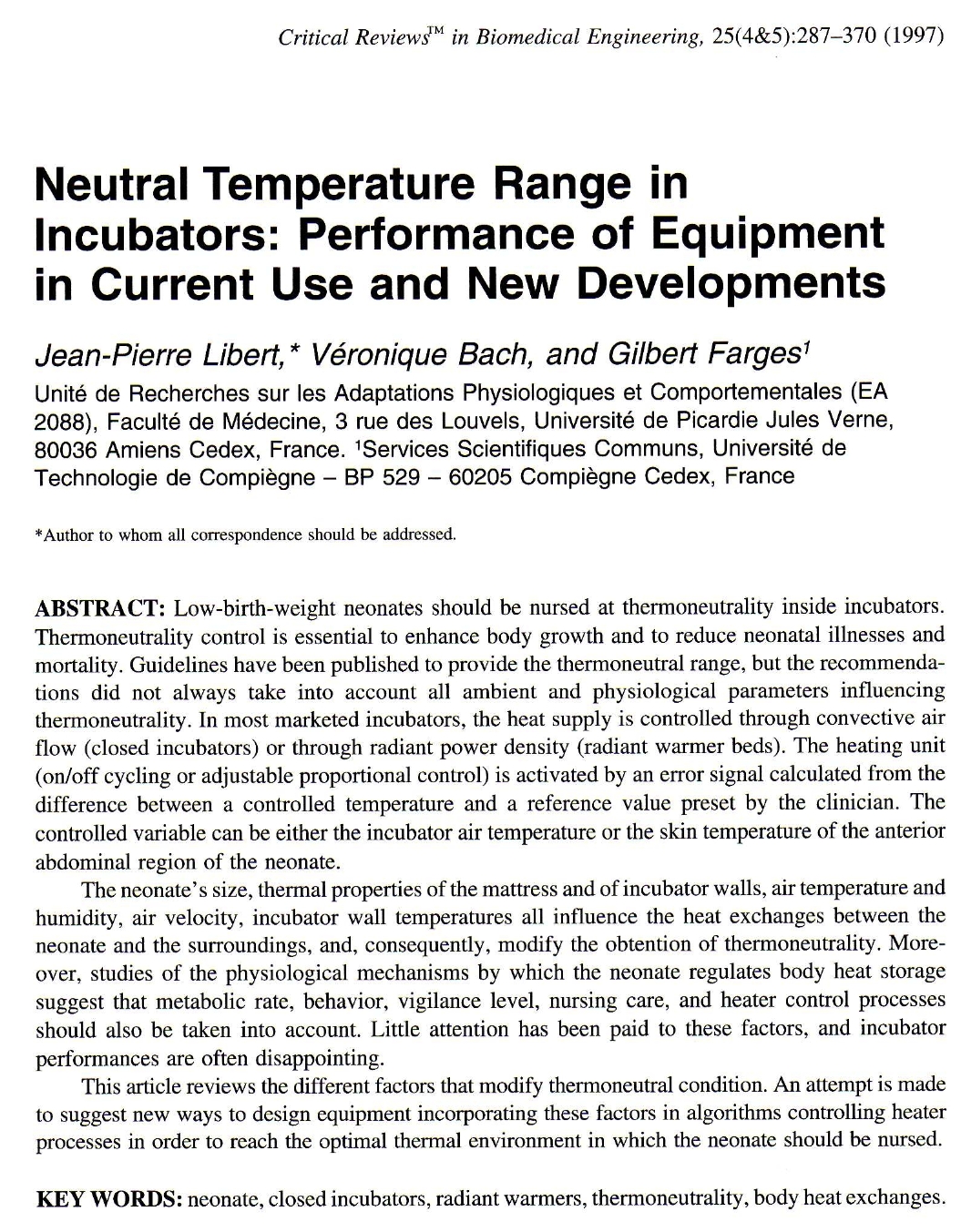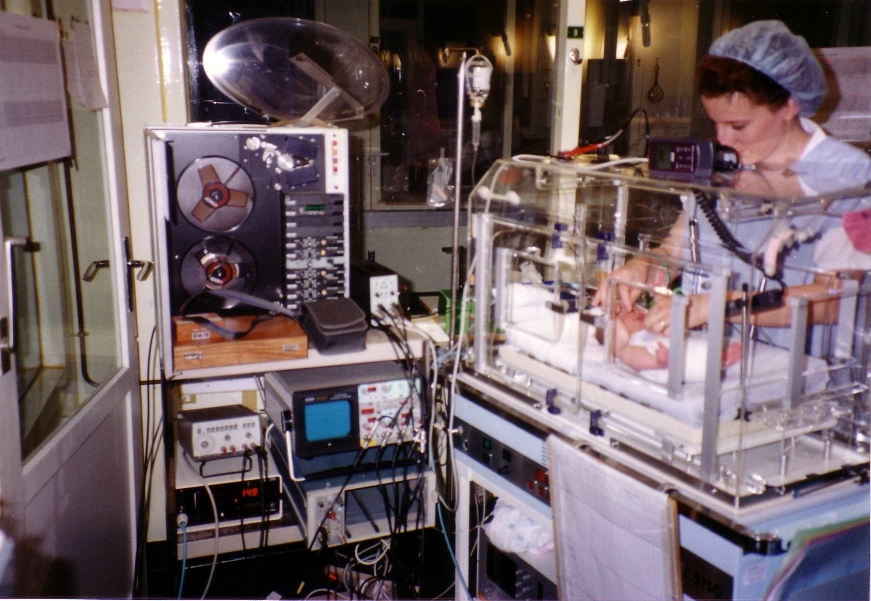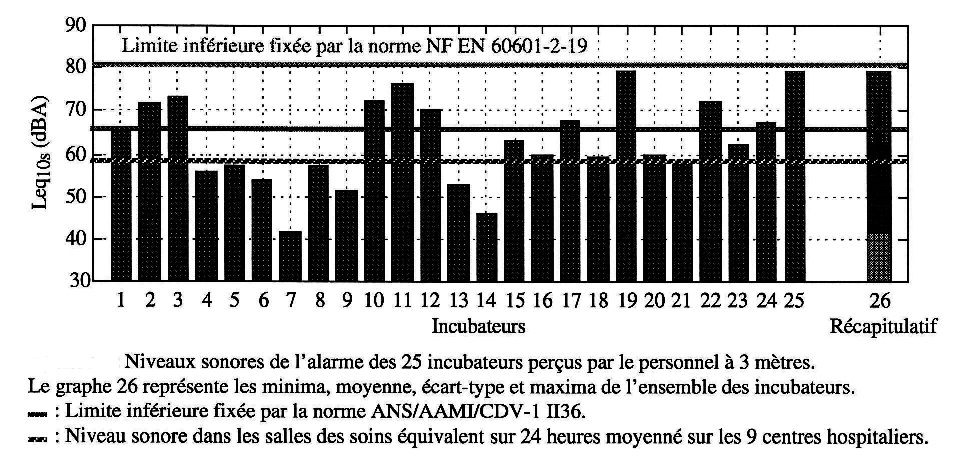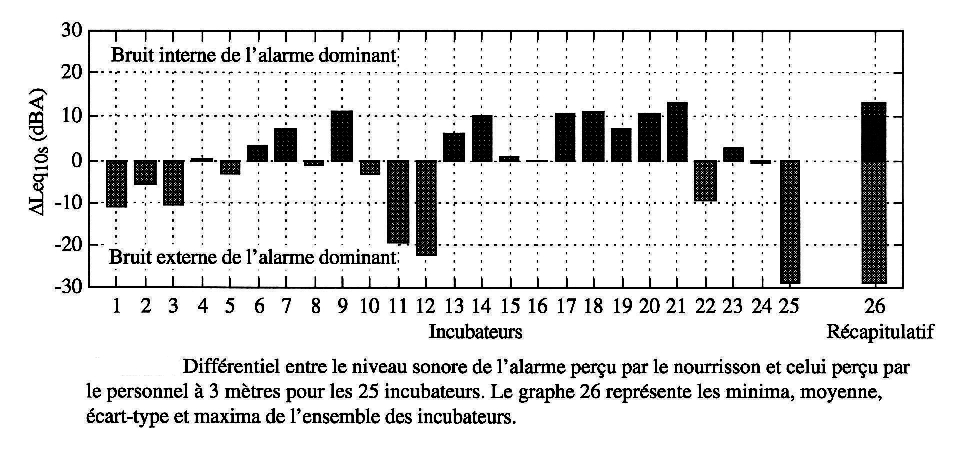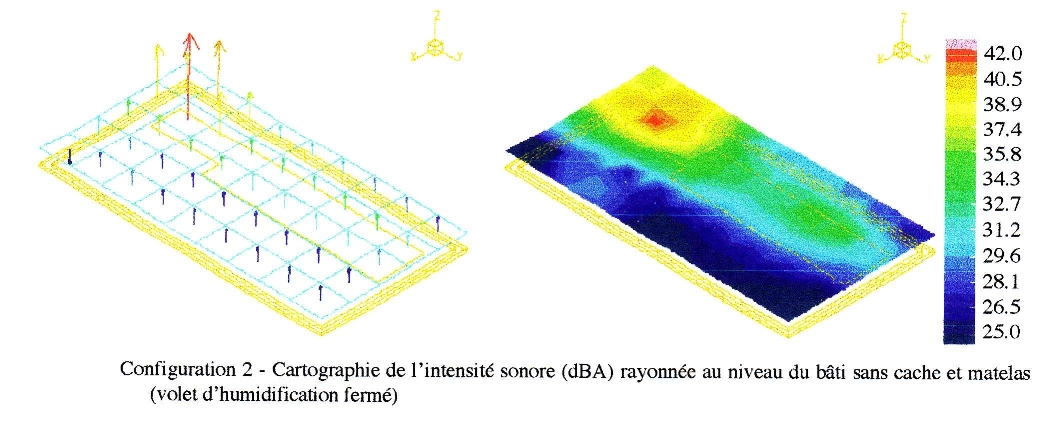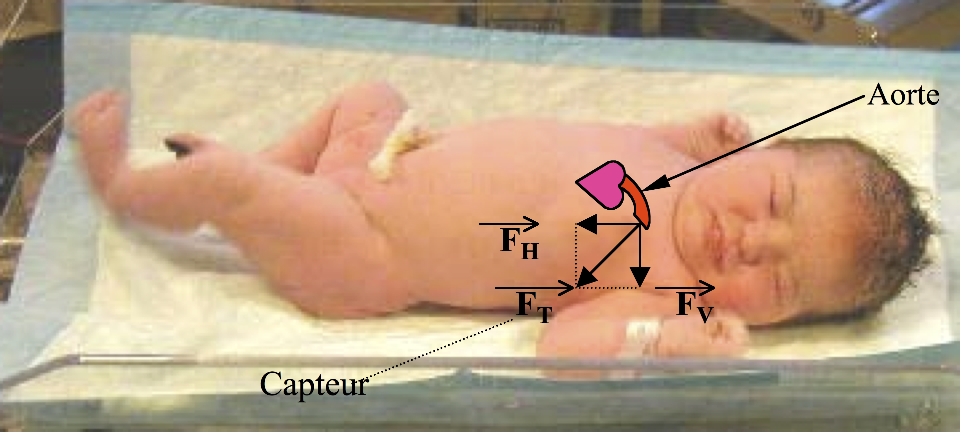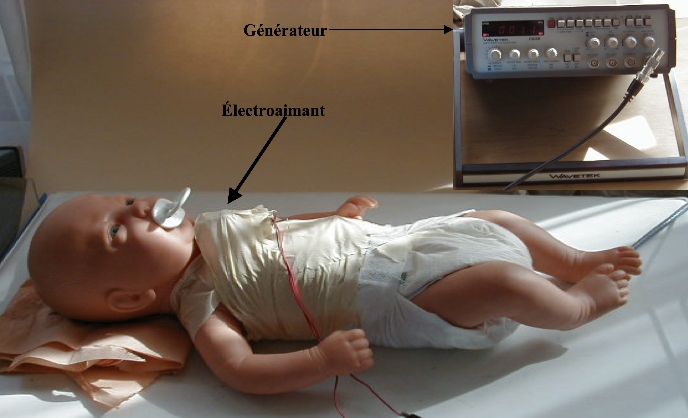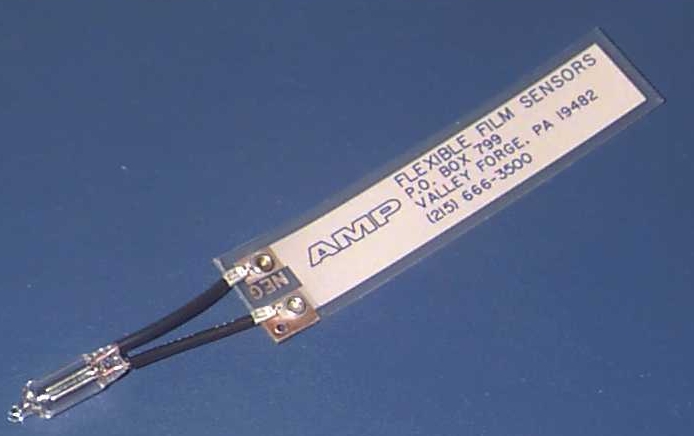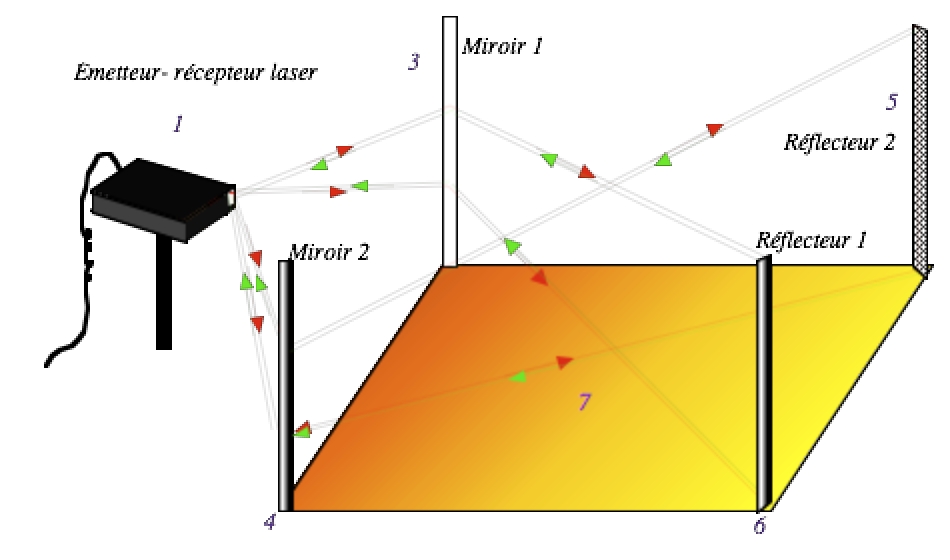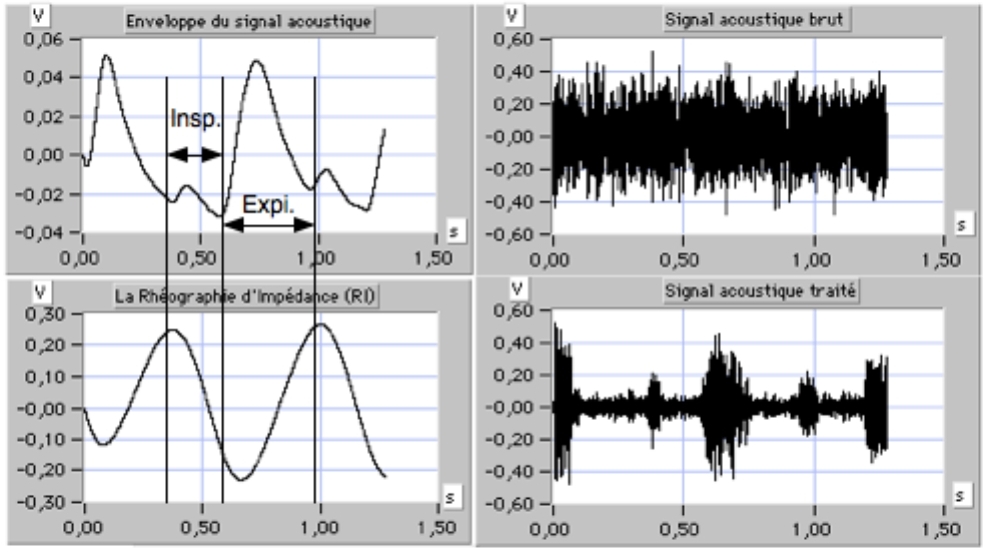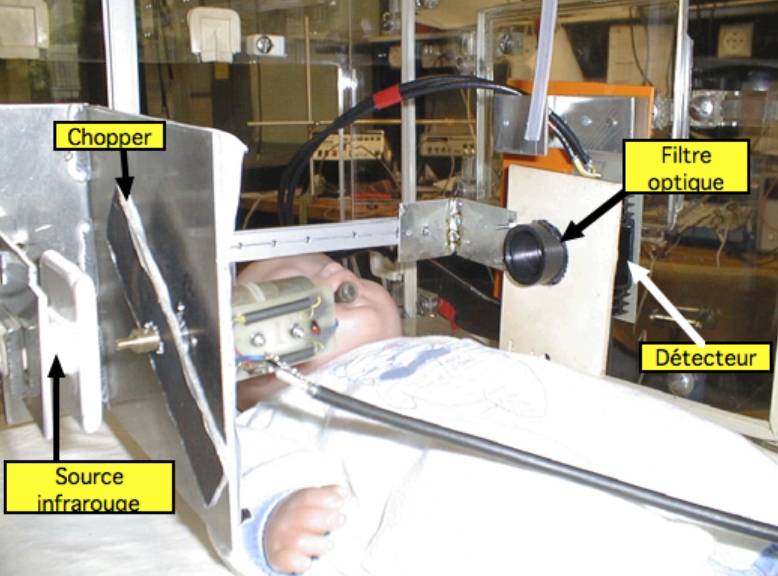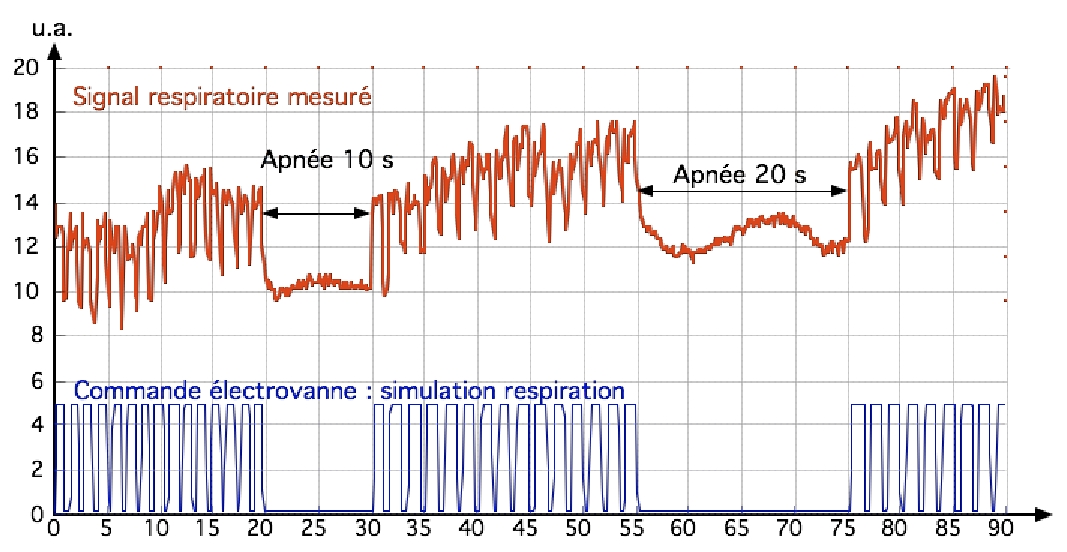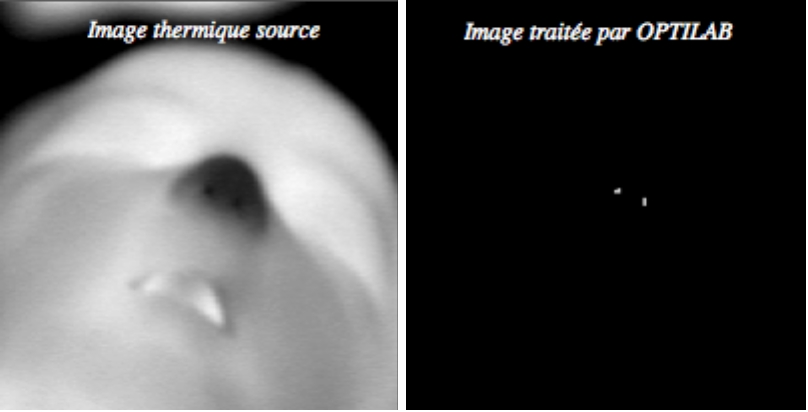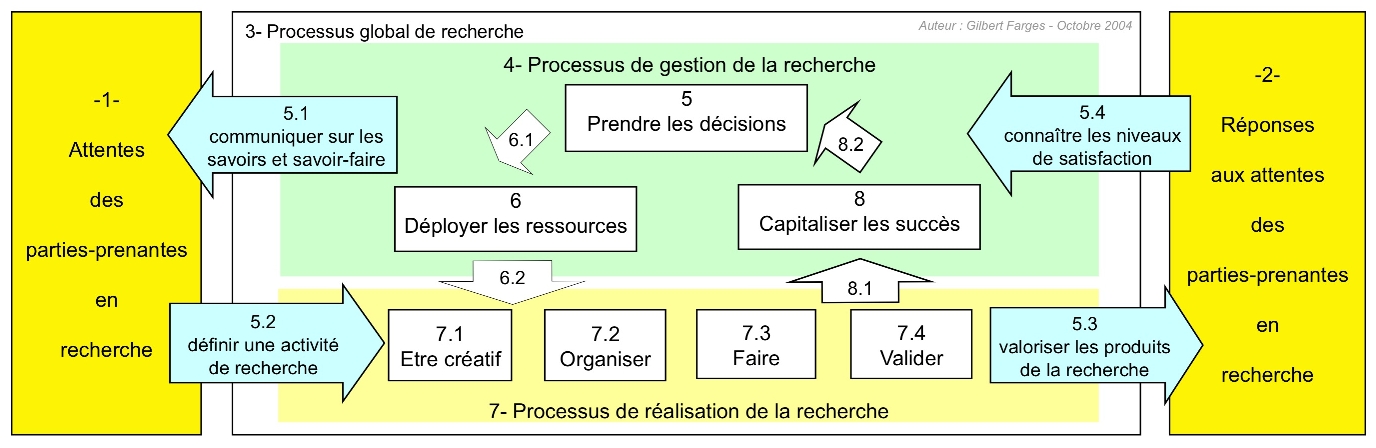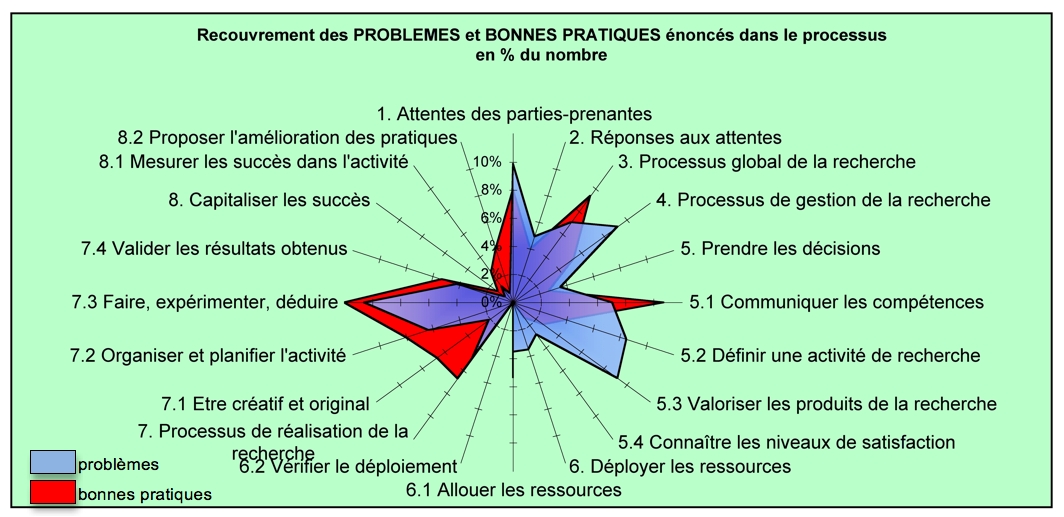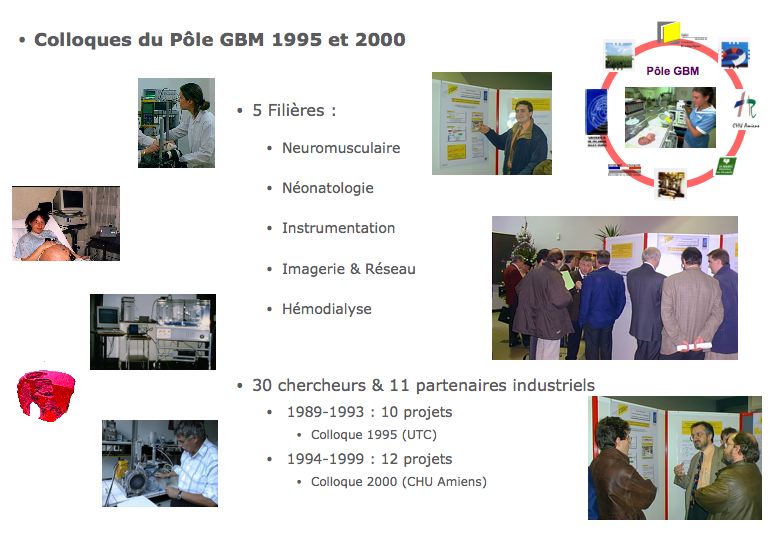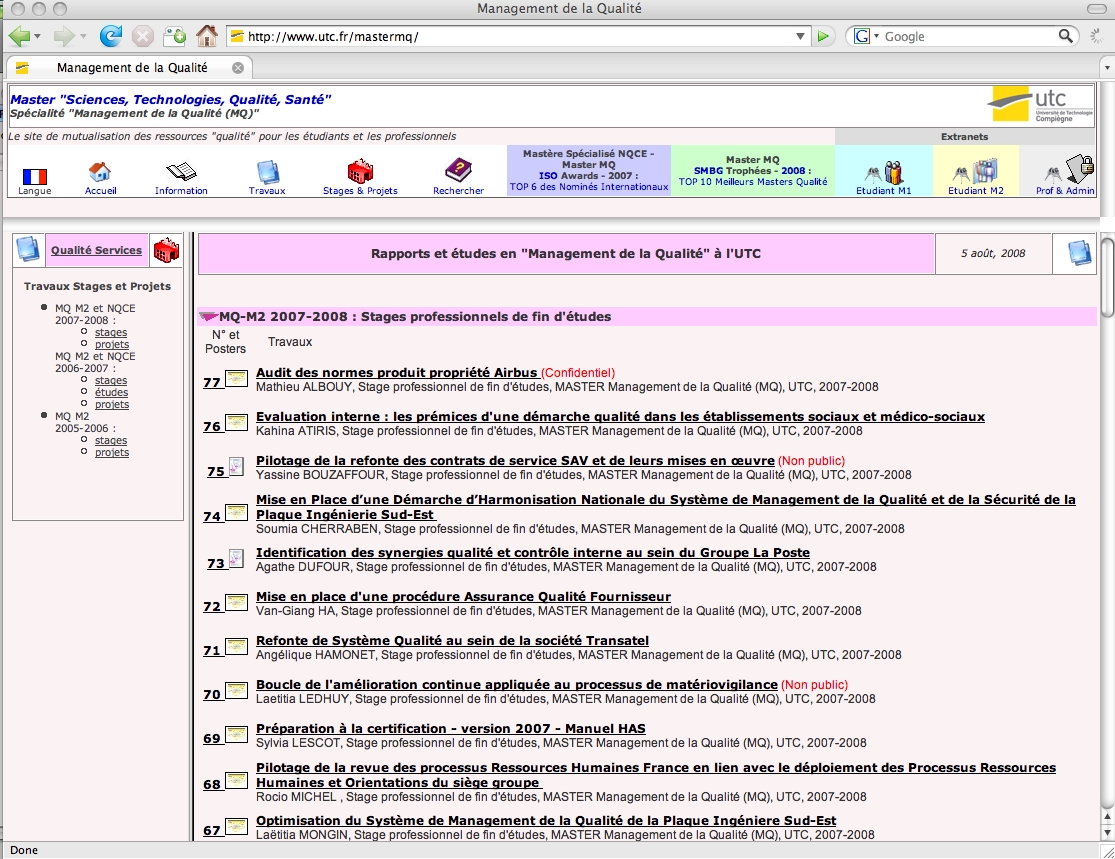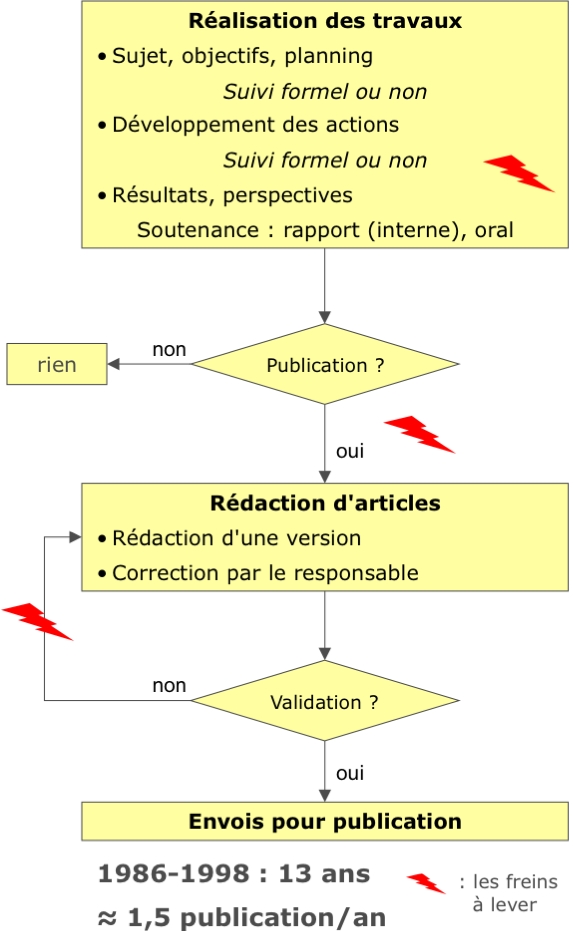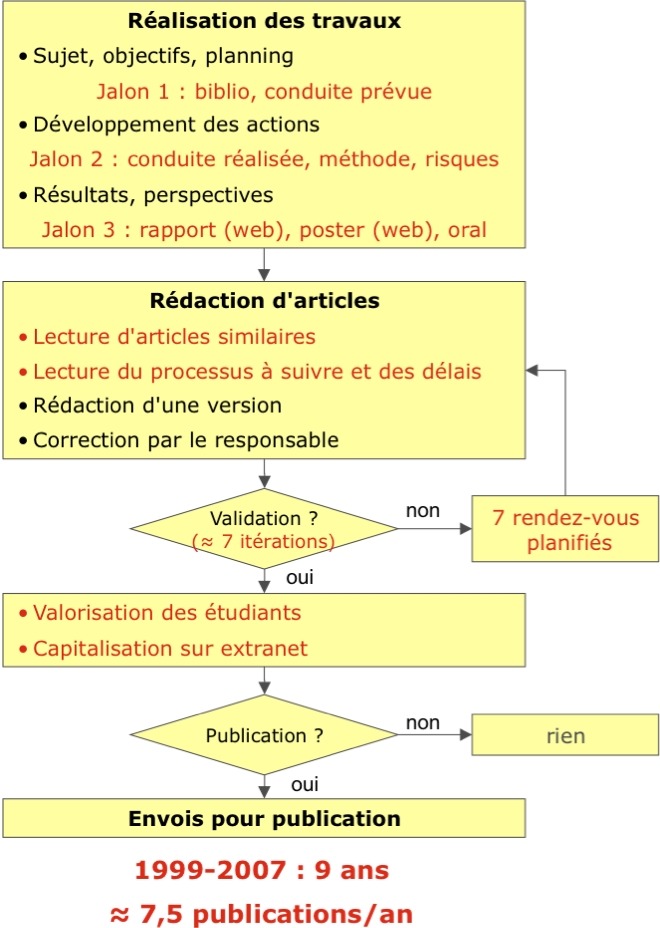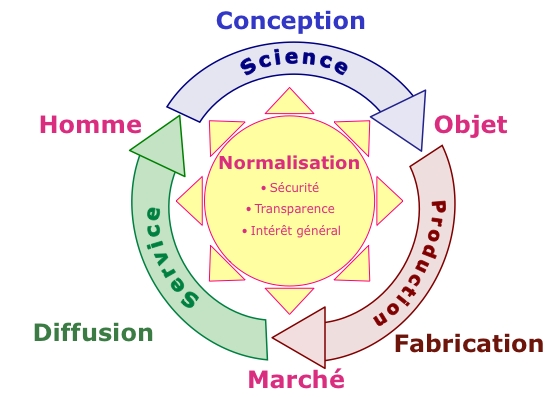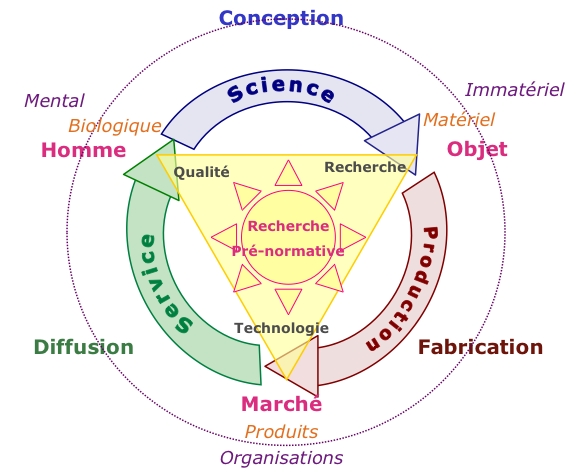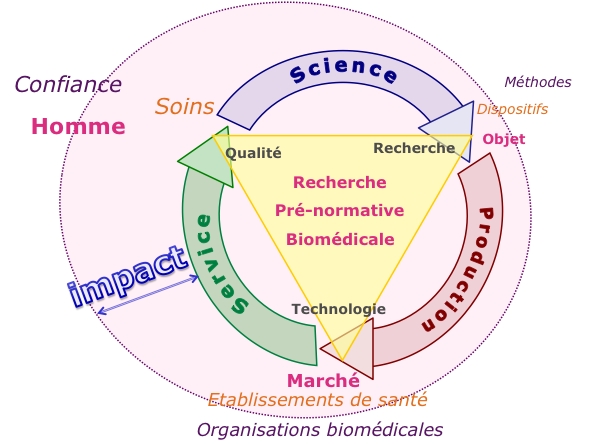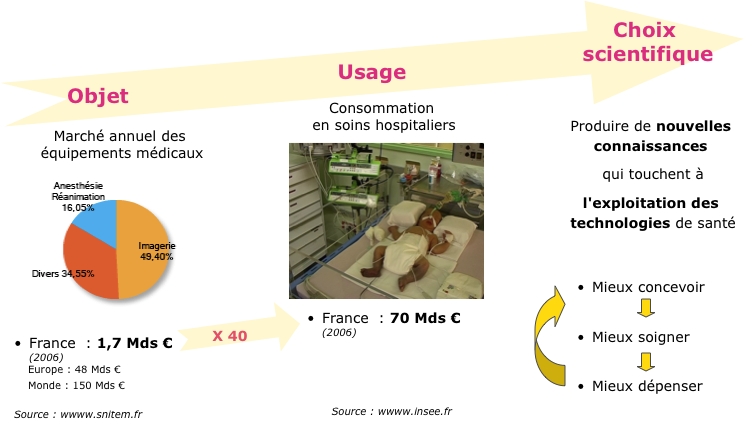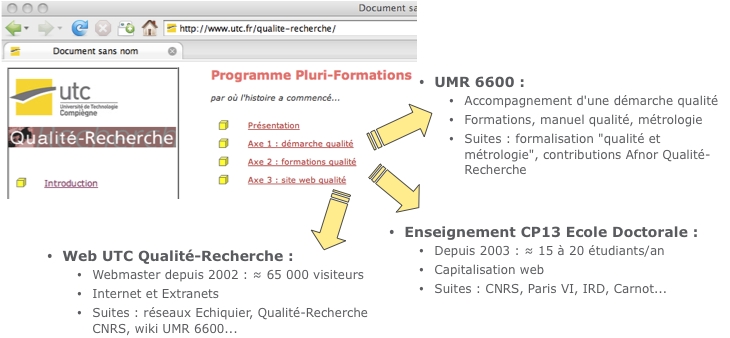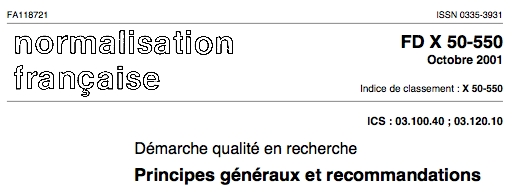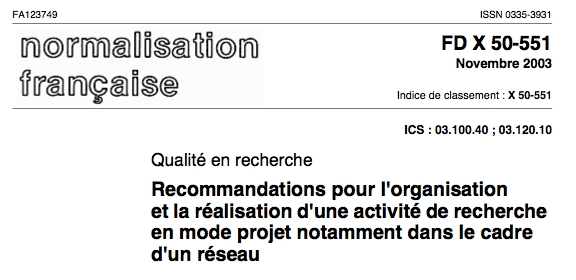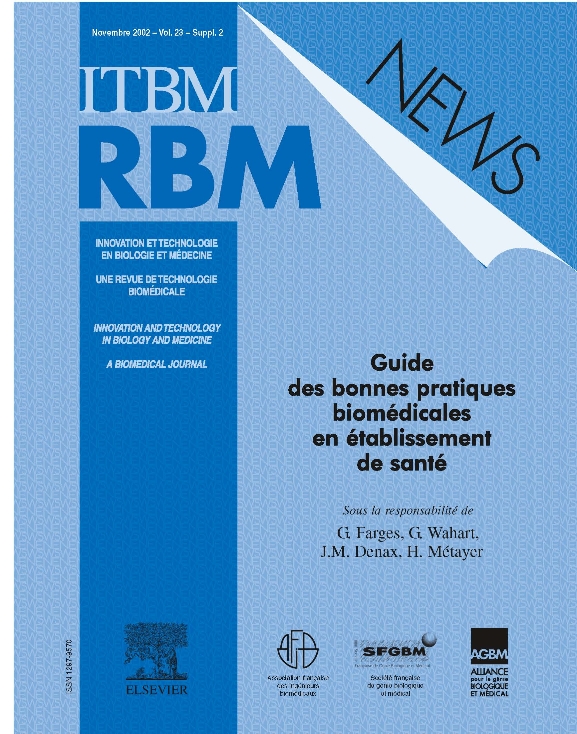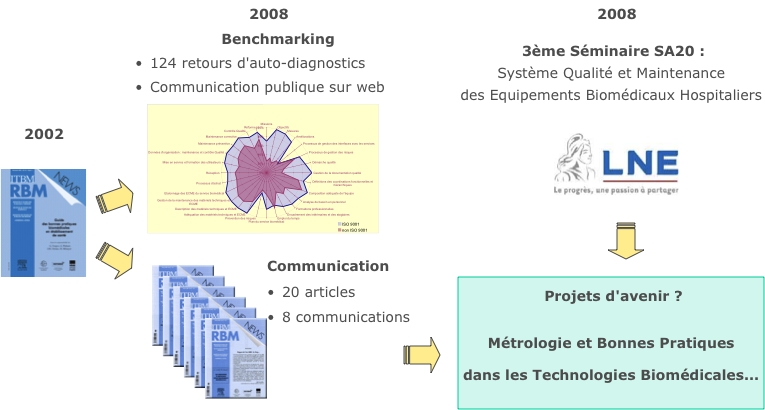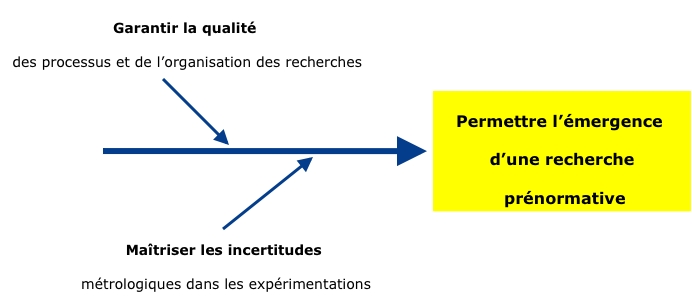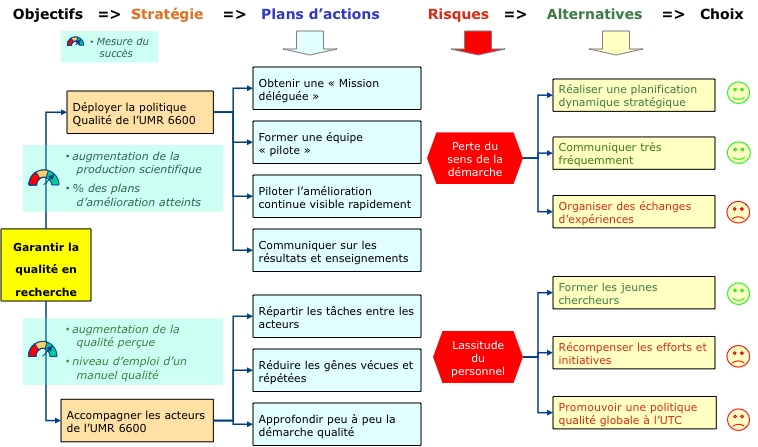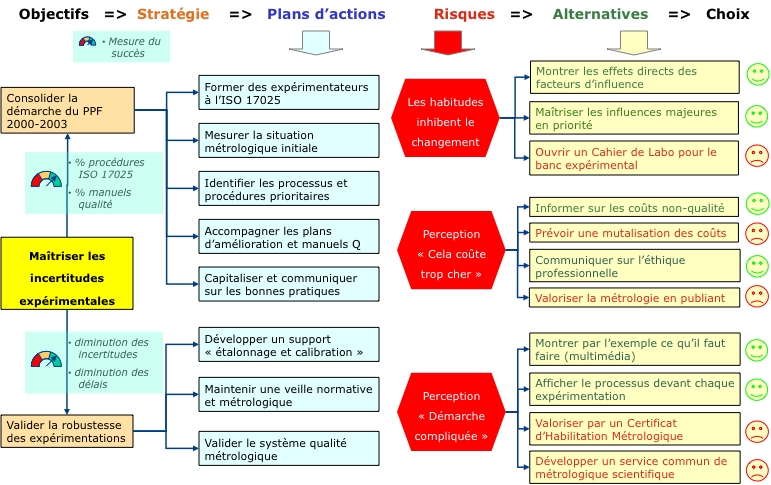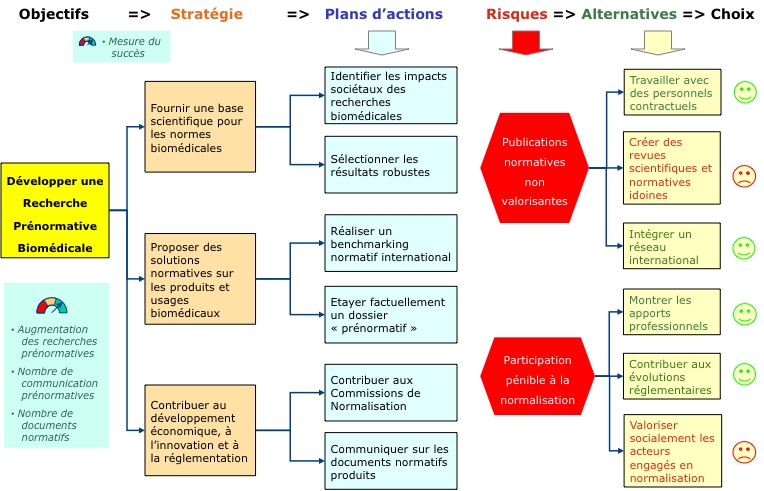https://www.utc.fr |
Travaux présentés
pour l’obtention
de l’Habilitation à
Diriger des Recherches de l’UTC |
Soutenance le 27 mai 2009
réf. BUTC : H 131 |
|
|
|
|
Vers une Recherche
Prénormative Biomédicale
|
|
Résumé :
L'Habilitation à Diriger des
Recherches (HDR) est un diplôme national "sanctionnant la
reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du
caractère original de sa démarche dans un domaine de la
science, de son aptitude à maîtriser une stratégie
de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment
large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs"
(Arrêté du 23 novembre 1988, JORF).
Ce mémoire présente les
travaux et perspectives dans un voie originale en recherche
prénormative biomédicale. Il est montré que la
nécessaire multisdisciplinarité (physiologie, clinique,
technique, industrielle) pour aboutir à un résultat en
recherche biomédicale (nouvelles connaissances, méthodes
ou pratiques, nouveaux dispositifs, processus ou systèmes) doit
aussi s'enrichir d'une nouvelle compétence normative afin
d'assurer la sécurité et l'acceptatbilité des
usages en exploitation des nouvelles conceptions. Une définition
de la recherche prénormative biomédicale est
proposée à partir du point de vue européen qui
vise à faire de la normalisation un vecteur important du
développement économique.
Mots-clefs : recherche,
génie biomédical, normalisation
|
Summary:
The accreditation to manage or lead research
(HDR stands for "Habilitation à Diriger des Recherches") is a
French national diploma "that recognises the high scientific competency
of the applicants, the originality of their concepts in a field of
science, their ability to manage a research strategy in a sufficiently
broad scientific or technological discipline and their capacity to
supervise young researchers" (Decree of November 23, 1988, JORF).
This thesis presents original work and new
perspectives in biomedical prenormative research. In order to control
and improve the ultimate benefits of new knowledge, product or service,
the biomedical prenormative researchers have to develop competencies
and make contributions to standardization. This new skill included in
the multidisciplinary biomedical research (that already involves
physiological, clinical, technical and industrial competencies) aims at
ensuring the safety and the social acceptability of the exploitation of
new biomedical devices, systems or practices. A definition of the
biomedical prenormative research is proposed from the European point of
view where standardization should become an important vector of social
economic development.
Keywords: research, biomedical
engineering, standardization
|
|
Soutenance de Gilbert FARGES pour l'obtention de
l'Habilitation à Diriger des
Recherches de l'UTC,
le 27 mai 2009 devant le Jury
composé de :
- M. FRANCONI Jean-Michel (Président rapporteur)
- M. KAJFASZ Eric (Rapporteur)
- M. RIVIERE Gérard (Rapporteur)
- M. TUFFERY Guy (Rapporteur)
- M. CHEVALLIER Georges (Membre)
- Mme HOBATHO Marie-Christine (Membre)
|
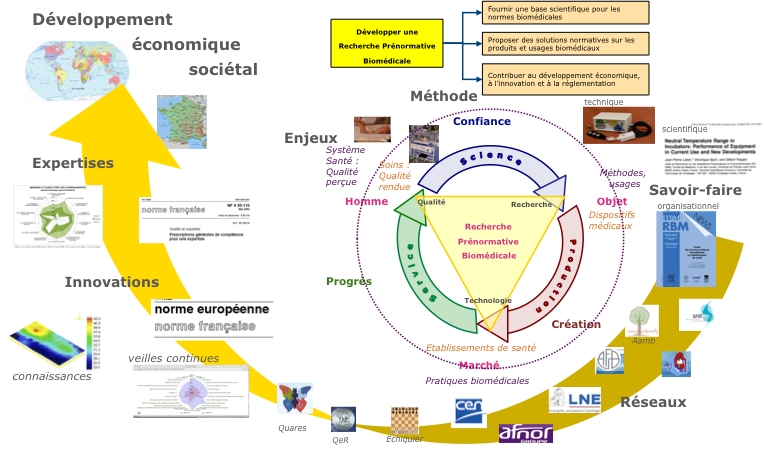
|
|
Référence
bibliographique à rappeler pour tout usage :
Farges
Gilbert (Dr Ing), Vers une Recherche Prénormative Biomédicale, Habilitation
à Diriger des Recherches,Université de
Technologie de Compiègne, 2009,
réf BUTC : H 131,
URL
: https://www.utc.fr/master-qualite/public/publications/autres_etudes/2008-2009/farges/farges_hdr.htm
|
|
Tables des matières
Remerciements
Je tiens à remercier les Membres du Jury de l’Habilitation
à Diriger des Recherches, qui me soutiennent dans le
démarrage d’une nouvelle voie de recherche visant des horizons
« prénormatifs » aux enjeux sociétaux
importants :
- Georges Chevallier, Membre, du Jury, Professeur des
Universités à l'Université de Technologie de
Compiègne, pour sa constante attention à mon
égard, son ouverture d’esprit sur les problèmes aux
interfaces entre l'homme, la technologie et les organisations, et sa
vision d'avenir toujours pragmatique et enrichissante,
- Jean-Michel Franconi,
Président du Jury et
Rapporteur, Professeur des Universités à
l'Université Victor Segalen Bordeaux 2, Directeur de l'UMR
CNRS 5536 "Résonance Magnétique des Systèmes
Biologiques", pour son implication dans le développement d'une
démarche qualité au sein de son unité de
recherche, son exemplarité à en faire profiter le plus
grand nombre et sa constante humilité pour en exposer les
succès,
- Marie-Christine Hobatho, Membre du Jury, Professeur
des Universités à l'Université de Technologie de
Compiègne, Directrice de l'UMR CNRS 6600 "BioMécanique et
BioIngénierie", pour sa confiance de longue date en mes
capacités, son soutien à l’originalité de mon
parcours scientifique et sa volonté de développer
ensemble une dynamique qualité au sein de son unité de
recherche,
- Eric Kajfasz, Membre du Jury et Rapporteur, Docteur
et HDR, Directeur de Recherche CNRS, Directeur de l’UMR CNRS 6550
"Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM)", pour son
intérêt aux démarches qualité dans le
pilotage des projets de recherche,
- Gérard Rivière, Membre du
Jury et Rapporteur, Docteur et ancien Président du programme
"Standardization and Research (STAR)" au Comité Européen
de Normalisation (CEN) à Bruxelles, dont la rencontre
récente et l’amicale attention me permettent d’envisager
des actions au niveau européen en recherche
prénormative,
- Guy Tuffery, Membre du Jury et Rapporteur,
Directeur de Recherche Emérite (et ancien
Délégué Qualité) à l'Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
(AFSSA) de Maisons-Alfort, Président de la Commission Nationale
de Normalisation Qualité-Expertise, pour sa décapante
aptitude à poser les « bonnes questions », son
enthousiasme permanent et sa capacité à aller
au-delà des frontières dans la pensée normative.
Je tiens
aussi à remercier les personnes qui m’ont permis
d’aboutir à mon épanouissement actuel et à une
vision clarifiée sur mes apports personnels dans un monde
complexe :
- Huguette, mon épouse qui m’a toujours
soutenu et supporté, même quand le travail envahissait la
maison et l’emploi du temps privé…
- Isabelle Nattier, dont
l’assistance calme et
efficace a toujours résolu mes problèmes de logistique et
d’organisation dans un agenda surchargé…
- Jean-Pierre Libert,
Véronique Bach, Michel
Freville, Gérard Krim, Alain de Broca et les membres de
l’équipe d’Amiens avec lesquels j’ai pu mener l’aventure
du Pôle GBM Périnatalité-Enfance, avec une
pensée toute particulière pour feu Pr Bernard Risbourg,
dont le dynamisme et la confiance étaient communicatifs,
- Pr Eric Mallet
du CHU de Rouen pour son action et support afin que mes premières
recherches instrumentales trouvent directement leur application… à domicile,
auprès
de Maximilian et de sa maman,
- Michel Cordonnier, France Darras, Anne Baleix
et les acteurs de l’association GRADIENT, sans qui je n’aurais
pas réalisé les partenariats industriels et les transferts
de technologie,
- Alain Donadey, François Langevin,
Jean-François Lerallut, Catherine Marque, collègues de
l’UTC dont l’ouverture d’esprit et les actions sur les
technologies biomédicales m’ont aidé à percevoir
de nouveaux enjeux,
- Francis Goubel, Chantal Perot, Didier Gamet et
Francis Canon dont les savoirs en physiologie m’ont toujours
été d’une grande aide et une source permanente de
curiosité,
- Michel Jaffrin, Cécile Legallais,
Marie-Danielle Nagel dont les qualités scientifiques ont souvent
été un modèle implicite pour moi,
- Jean-Jacques Vanhoutte,
Francisco Martinez, Yvon Guillot et Alain Adhemard du Service Electronique
de l’UTC, dont les
compétences en conception électronique ont
été fondamentales pour le succès de mon parcours,
- Boaz,
Christophe, David, Djaffar, Lorena, Mardson, Mohamad, Mokrane, Serge, Philippe,
Walid, Ziad dont les travaux de recherche sous ma direction ont contribué à
l’émergence de ce projet,
- Eva Giesen, Marc Mounin, Jean-Paul
Berthomé,
Vincent Dollé, Alain Hoquet, Denis Bertheau, Marie-Noêlle
Besson, Elise Douat, Henri Valeins, Catherine Chaléard,
Rémy Gautier, et tous les membres du Réseau Echiquier
pour leur dynamique collective à promouvoir de nouvelles
pratiques Qualité en Recherche,
- Jean-Pierre Caliste, Nicolas-Louis
Duclos, Louis Blache, Dritan Nace, Jean Escande, Manon Lalonde, Béatrice
König dont les dynamiques implications en management de la
qualité sont très prometteuses pour l'émergence et
la diffusion d'une recherche prénormative intégrée
à un enseignement de haut niveau,
- Solange Bonneaud, Secrétaire
Générale de l'UTC et Sabine Braule, Directrice des
Ressources Humaines pour leurs soutiens, intérêts et
actions de développement des démarches qualité en
enseignement supérieur,
- Ronan Stephan, Directeur de l’UTC et
Bernard Dubuisson, ancien Directeur à la Recherche de l’UTC,
pour leurs stimulations dans le développement de nouvelles voies originales
de recherche et d’expertise,
Grâce à vous tous, ce travail est à la
fois un aboutissement et un départ…
retour sommaire
Glossaire
- AERES : Agence d'Evaluation en Recherche et Enseignement Supérieur
- AFNOR : Association Française de NORmalisation
- ANR : Agence Nationale de la Recherche
- ANVAR : Agence Nationale pour la VAlorisation de la Recherche
- APHP : Assistance Publiques – Hôpitaux de Paris
- CA : Conseil d’Administration
- CCPPRB : Comité Consultatif pour la Protection des Personnes
en Recherche Biomédicale
- CDD : Contrat à Durée Déterminée
- CEN : Comité Européen de Normalisation
- CHU : Centre Hospitalier Universitaire
- CMR : Cardio Modulo Respirographie
- CNESMS : Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale
- CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
- CP13 : Connaisance Professionnelle n°13 (Enseignement Qualité-Recherche
en Ecole Doctorale)
- DEA : Diplôme d’Etudes Approfondies
- DESS : Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées
- DU : Diplôme d’Université
- ECHIQUIER : ECHanges Indépendants pour la QUalité, l’Innovation,
l'Enseignement et la Recherche
- ECRI : Emergency Care Research Institute
- ECG : ElectroCardioGramme
- GBM : Génie BioMédical
- GLEM : Groupement des Laboratoires d’Essais Médicaux
- HDR : Habilitation à Diriger des Recherches
- IBMH : Ingénieur BioMédical Hospitalier (Mastère
Spécialisé)
- IEMN : Institut d’Electronique et de Microélectronique
du Nord
- LNE : Laboratoire National de métrologie et d’Essai
- MBEC : Medical & Biological Engineering &
Computing
- MENRT : Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche
et de la Technologie
|
- MQ : Management de la Qualité (Master)
- MRCT : Mission Ressources et Compétences Technologiques
- MSIN : Mort Subite Inexpliquée du Nourrisson
- MTS : Management des Technologies en santé
(Master)
- NQCE : Normalisation, Qualité, Certification, Essais (Mastère
Spécialisé)
- PCRD(T) : Programme Cadre de Recherche et Développement (Technologique)
- PPF : Programme Pluri-Formations
- QeR : Qualité en Recherche (réseau CNRS)
- QUARES : QUAlité en Recherche et Enseignement Supérieur
(association)
- QUEOPS : QUalité, Evaluation, Organisation et Performance
en Santé
- RMN : Résonance Magnétique Nucléaire
- STAR : STAndardization and Research (programme du CEN)
- SPI : Sciences Pour l’Ingénieur
- ST2I : Sciences et technologies de l’Information et de l’Ingénierie
- SSC : Services Scientifiques Communs
- TSIBH : Technicien Supérieur en Ingénierie Biomédicale
Hospitalière
- UE : Unité d’Enseignement
- URA : Unité de Recherche Associée
- UMR : Unité Mixte de Recherche
- UPJV : Université Picardie Jules Verne
- UTC : Université de Technologie de Compiègne
- UV : Unité de Valeur
- VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
- VAP : Validation d’Acquis Professionnels
- VES : Validation d’Etudes Supérieures
|
retour sommaire
Bref Curriculum Vitae : FARGES
Gilbert
Formations et Diplômes
- UTC 3ème cycle
2001 Mastère Spécialisé
Normalisation, Qualité, Certification, Essais
- UTC 3ème cycle
1986 Docteur Ingénieur en Génie Biomédical
- UTC 3ème cycle
1983 Diplôme d’Etudes Approfondies en Génie
Biomédical
- UTC 3ème cycle
1979 Mastère Spécialisé
Ingénieur BioMédical Hospitalier (IBMH)
- ENSAM 2ème cycle
1978 Ingénieur Arts et Métiers (Cluny 1974-1978)
Expérience professionnelle : Enseignant-Chercheur
(UTC) depuis 1981
- Recherche :
- Encadrement de DEA, Masters Recherche et Direction de Thèses
de 3ème cycle en Génie Biomédical depuis 1985
- Membre associé UMR CNRS 6600, BioMécanique et BioIngénierie
depuis 1999
- Membre associé URA CNRS 858, Biomécanique et Instrumentaion
Médicale de 1989 à
1994
- Transfert :
- Membre de la Commission Nationale de Normalisation AFNOR « Qualité en
Expertise » depuis 2007
- Membre de la Commission Nationale de Normalisation AFNOR "Qualité en
Santé" depuis 2000
- Membre de la Commission Nationale de Normalisation AFNOR "Qualité en
Recherche" de 2000 à 2005
- Enseignement :
- Direction de stages et projets d’intégration en Masters
MQ et MTS et de thèses professionnelles en Mastère Spécialisé NQCE
- Thèmes enseignés :
électronique, capteurs, instrumentation, informatique, technologies
biomédicales, sûreté des systèmes, maintenance,
contrôle et management qualité dans les organisations, pour étudiants
de 2ème ou 3ème cycle, Ecole Doctorale, Master, Mastère
et formation continue. Partenariat pédagogique avec environ 50
entreprises.
- Animation et direction de stages professionnels (> 25/an)
- Développement des processus Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE), Validation d’Etudes Supérieures (VES), Validation
des Acquis Professionnels (VAP) et référentiels métiers
en Qualité et Génie Biomédical
- Admissions (>100/an) ; Jurys de diplôme (>60/an) ; Suivis
de stages et projets en entreprises (>30/an)
retour sommaire
Responsabilités
:
- Créateur et responsable de la spécialité du Master
Management de la Qualité (20
étudiants par an) depuis 2004
- Créateur et responsable de l'UV CP13-Ecole Doctorale : "Démarche
Qualité en Recherche " (20
étu/an) depuis 2002
- Créateur et animateur du réseau français d'échanges
indépendants d'expériences en qualité, innovation,
enseignement et recherche (ECHIQUIER) depuis 2002
- Co-animateur du Master Management des Technologies en Santé (15 à 20 étu/an)
de 1995 à 2008
- Créateur et responsable de la Certification Professionnelle TSIBH (niveau
III) depuis sa création en 1982
- Responsable du Programme Pluri-Formation
"Qualité en Recherche UTC", plan quadriennal recherche 2000-2003
- Responsable pédagogique du DU/DESS
"Quéops" (UTC+ENSP+Univ. Montréal) de 2000 à 2002
- Responsable du Service Electronique de l'Université de Compiègne
de 1990 à 2001
- Co-animateur du Pôle Régional GBM
"Périnatalité-Enfance" de la Picardie de 1994 à
2000 (50 personnes)
- Organisateur des Colloques Scientifiques du Pôle GBM de
la Région Picardie en 1995 et 2000 (120 participants)
- Directeur du Département des Services Scientifiques Communs
UTC, de 1994 à 1999 (18 personnes)
- Responsable du Projet "Démarche Qualité à l'UTC" de
1996 à 1997
- Responsable du Programme Pluri-Formation Services Scientifiques Commmuns
1992-1995 (contrat quadriennal)
Représentations :
- Membre de la Commission Nationale de Normalisation AFNOR « Qualité en
Expertise » depuis 2007
- Personnalité Qualifiée au Conseil National de l’Evaluation
Sociale et Médico-Sociale de 2006
à 2008
- Membre du Conseil d’Administration de l'Association Gradient de 1996 à 2005
(secrétaire de 1996 à 1999)
- Membre de la Commission Nationale de Normalisation AFNOR "Qualité en
Santé" depuis 2000
- Membre de la Commission Nationale de Normalisation AFNOR "Qualité en
Recherche" de 2000 à 2005
- Suppléant du représentant de la Conférence des Présidents
d’Universités à
la Commission AFNOR "Qualité en Recherche" de 2001 à 2004
retour sommaire
Introduction
« L’Habilitation à Diriger
des Recherches (HDR) sanctionne la reconnaissance du haut
niveau scientifique du candidat,
du caractère original de sa démarche dans un domaine
de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie
de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment
large et sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs
»
(Arrêté du 23 novembre 1988, Circulaire n°
89-004 du 5 janvier 1989, JORF).
Les prémices de ma motivation scientifique
sont apparus avant mon Baccalauréat : c’était en 1971, à l’âge
de 16 ans. En « 1ère » et « Terminale »,
j’ai eu l’occasion de travailler avec un professeur de technologie
dont l’approche pédagogique « projet » m’a permis
la conception et la réalisation complète, avec un groupe de
3 camarades sous ma « responsabilité », d’une
monture équatoriale pour un télescope d’amateur de 20 cm
de diamètre dont j’ai réalisé, poli,
argenté et contrôlé à λ/10 le miroir.
Ma curiosité naturelle sur les étoiles me faisait
rencontrer pour la première fois la réalité
concrète d’élaboration des outils de
recherche.
Plus tard,
en 1977, lors des « Journées Portes Ouvertes
» à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et
Métiers de Cluny, j’ai proposé et conduit le projet
« Pendule de Foucault » avec une équipe
d’élèves ingénieurs : conception, fabrication
(fonderie, usinage), installation (à 33 m de haut, dans le
clocher de l’abbaye de Cluny), communication pédagogique tout
public sur les observations de la rotation terrestre faites en direct,
élaboration de maquettes et explications sur le principe
physique. C’était ma seconde approche d’élaboration
d’outils expérimentaux pour découvrir et comprendre les
principes physiques qui nous entourent.
J’ai continué de ressentir
des attraits pour la recherche lors de mon service national, fait de 1979 à 1981
au Maroc, à
l’Ecole Mohamedia d’ingénieurs de Rabat, en tant qu’assistant
d’enseignement et de recherche dans une section de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) pour former des ingénieurs et
scientifiques en génie sanitaire et assainissement rural. J’ai
développé des bancs de mesures sur la qualité
physico-chimique et bactériologique de l’eau et divers
échantillons de matière.
Fort de cette expérience, dès
mon retour en France, j’ai
décidé de préparer un DEA en Génie
BioMédical (GBM) à l’UTC, soutenu en 1983, sur le
thème original de « la sécurité
électrique au bloc opératoire ». Pendant cette
période, un emploi d’enseignant-chercheur contractuel m’est
proposé avec la mission de contribuer au développement de
l’ingénierie biomédicale hospitalière. Ceci m’a
alors permis de mener des travaux scientifiques validés par ma
THESE de Docteur-Ingénieur en Génie BioMédical,
passée en 1986, sous la direction de Jean-François
Guyonnet, spécialiste des analyses en sûreté des
systèmes.
Mes trajectoires et centres d’intérêts ont
toujours
été profondément en synergie : en recherche, ils
portent principalement sur les capteurs et l’instrumentation biomédicale en périnatalité, dont les apports font
émerger des champs nouveaux de connaissances alimentant ainsi
l’enseignement supérieur que je délivre sur la
maîtrise des usages de la technologie en conditions
hospitalières.
Je postule à l’Habilitation à Diriger
des Recherches pour me permettre d’encadrer de jeunes doctorants et développer
une thématique exploratoire innovante en recherche
prénormative biomédicale. Ainsi, je pourrais consolider
mes actions de recherche sur la maîtrise des technologies en
santé, et capitaliser mes compétences «
qualité et normalisation» au profit de l’unité de
recherche qui m’accueille.
Ce mémoire présente les éléments
d’évaluation de mon parcours scientifique via mes travaux,
responsabilités, expériences professionnelles et projets
d’avenir en recherche sur les technologies biomédicales selon
trois parties :
I) Travaux scientifiques et technologiques
II) Implication
dans l’encadrement de jeunes
chercheurs
III) Projets en qualité et recherche
prénormative biomédicale
retour sommaire
Chapitre I : Présentation synthétique des
travaux scientifiques et technologiques
I - Présentation synthétique
des travaux scientifiques et technologiques
J’ai commencé mes premiers travaux scientifiques
en tant que Doctorant à l’UTC au sein de l’URA CNRS 858 «
Biomécanique et Instrumentation Médicale » en 1982
sur une thématique biomédicale instrumentale
correspondant à l’un des axes de recherche affichés de
l’unité de recherche. Ma thèse s’intitule «Mort
Subite Inexpliquée du Nourrisson : Conception d’un nouveau
moniteur cardio-respiratoire pour la surveillance à domicile et
contribution de l’approche Sûreté des
Systèmes» [164]. Les travaux scientifiques visaient
à concilier des connaissances physiologiques, cliniques et
technologiques pour répondre à un besoin sociétal
de surveillance médicale à domicile.
J’ai réalisé ces
travaux sous la direction de Jean-François Guyonnet, expert reconnu
en analyse de sûreté des sytèmes et avec l’aide des
collègues biomédicaux de l’UTC (Pr Francis Goubel, Pr
Jaffrin, Pr Chevallier). J’ai aussi pu établir des
coopérations multi-disciplinaires et inter-universitaires
durables sur les aspects médicaux avec les collègues
cliniciens du CHU d’Amiens (Pr Freville, Département
explorations fonctionnelles respiratoires, Pr Risbourg, Dr Alain De
Brocca, Dr Krim, Service de Réanimation Néonatale) et
ceux de la Faculté de Médecine d’Amiens pour les savoirs
physiologiques en périnatalité (Pr Libert, Dr Bach, EA
2088 Environnement Toxique Périnatal - Adaptations
Physiologiques et Comportementales).
Les résultats de cette dynamique
ont ouvert la voie à une
préoccupation scientifique originale dans le domaine encore
exploratoire de la recherche prénormative : il s’agit de
développer un corpus collectif de connaissances validées
et de le diffuser aux concepteurs ou exploitants de dispositifs
matériels ou immatériels afin d’en améliorer le
service rendu et d’en garantir la sécurité.
Dans ce cadre,
mon cheminement intellectuel s’est basé sur la
maîtrise de l’usage des technologies biomédicales, que ce
soit en site hospitalier ou à domicile. Les
éléments ci-dessous en dressent les principales
articulations.
retour sommaire
I-1 Travaux sur le monitorage cardio-respiratoire
I-1-1 Moniteur
ambulatoire de longue durée
Principe physique et traitement du signal
:
Mes travaux sur le monitorage cardio-respiratoire ont commencé
avec ma thèse de docteur-ingénieur (1982-1986, [164])
pour tenter de satisfaire le besoin de surveillance à domicile
de nourrissons à risque de mort subite inexpliquée dont
l’impact de mortalité infantile en France était
estimé à environ 4 pour 1000 naissances vivantes.
L’objectif technologique était de parvenir à
réaliser un dispositif ambulatoire, suffisamment fiable, simple
d’emploi et autonome, pour la surveillance continue de la
fréquence cardiaque (entre 60 et 140 b/mn) et des apnées
supérieures à 20 s.
Les résultats sont basés sur
l’exploitation d’un
phénomène naturel : le signal
électro-cardio-graphique (ECG) est modulé en amplitude
par la respiration (figure 1).
La détection d’un seul signal permet
donc le suivi simultané de 2 variables physiologiques, ce nouveau principe
a
été appelé la Cardio-Modulo-Respirographie
(CMR).
Pour ce nouveau procédé dont je suis l’inventeur,
l’association Gradient du Groupe UTC (maintenant disparue) a
déposé et obtenu un brevet français et 3
extensions internationales entre 1985 et 1987 [128].
Sous ma direction,
les travaux de DEA GBM de Philippe MEREAU (1986, [162]) et de Ziad BOUKHALED
(1990, [158]) ont permis d’affiner la
connaissance des positionnements optimaux sur le thorax du capteur
(figure 2) et l’optimisation de traitement du signal ECG.
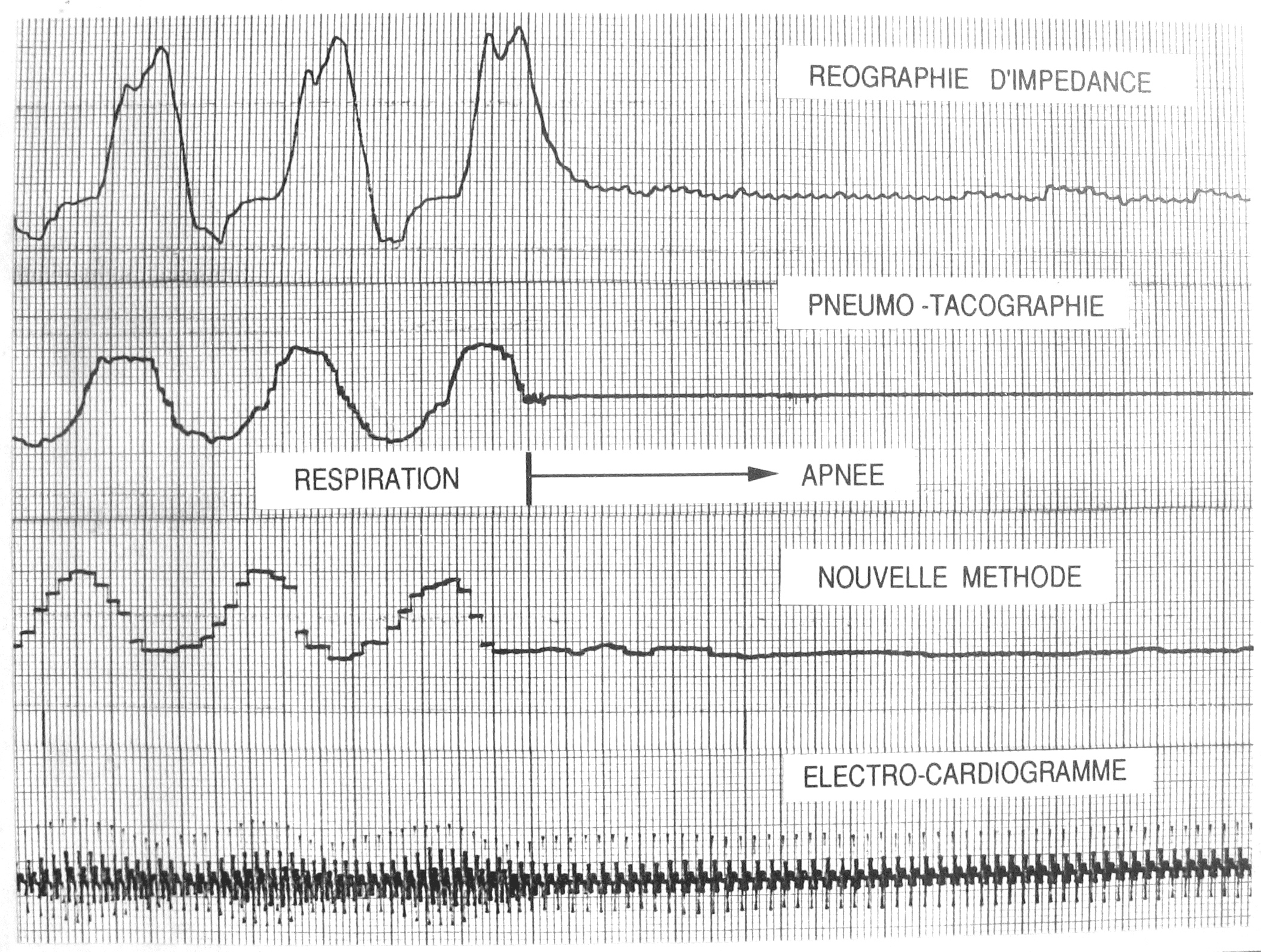
Figure 1 : Comparaison des signaux respiratoires obtenus par
des techniques
différentes sur un nourrisson en phase d’apnée
centrale [164] |
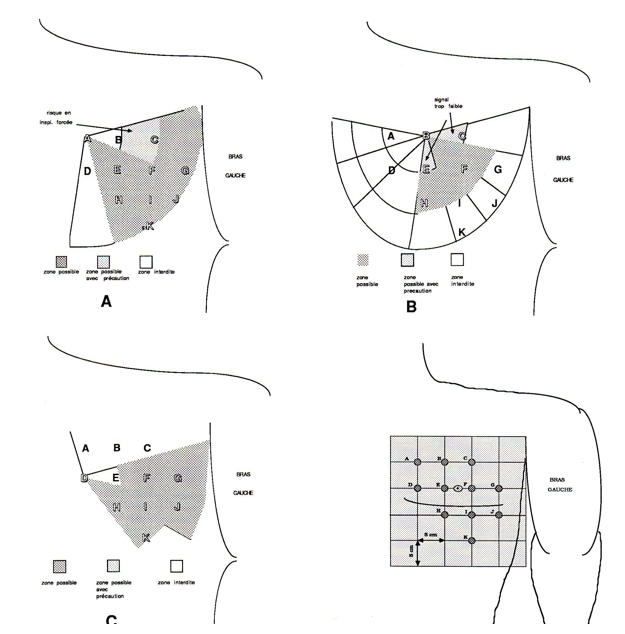
Figure 2 : Zones optimales pour la détection
de la modulation de l’ECG par la respiration [162] |
Ceci était
nécessaire car contrairement à la prise
classique de l’ECG qui vise à minimiser l’influence de la
respiration (le « ne respirez plus » chez le
cardiologue...), nous recherchons à l’inverse à la
maximiser.
Le signal respiratoire étant échantillonné par
le signal cardiaque, la théorie de Shannon s’applique. Pour avoir
un signal respiratoire représentatif, il est nécessaire
que la fréquence cardiaque (FC) soit au moins 2 fois
supérieure à celle de la fréquence respiratoire
maximale (FR) : FC / FR > 2
Généralement le
rapport FC/FR se situe entre 3 et 6 chez le nourrisson de moins d’un
an :
- Il n’y a donc aucun problème dans l’objectif
de détection des apnées où la fréquence
respiratoire est nulle.
- Il peut y avoir des erreurs de détection
en cas de bradycardie (fréquence cardiaque lente) et de
tachypnée (fréquence respiratoire élevée).
Sous
ma direction, une analyse approfondie de l’influence de la
respiration sur l’ECG a été faite avec les travaux de
THESE GBM de Mardson FREITAS DE AMORIM (1994, [142]).
Une double modulation existe, en amplitude et en fréquence
(Figure 3), ce qui conduit au modèle numérique de l’ECG
suivant :
Uecg(t) =[Aecg+Uam(t)].γecg[ωecg.t+2π∫Ufm(t)dt] , avec :
- Uecg(t) : signal ECG acquis
- Uam(t) : signal modulant la porteuse
en amplitude
- Aecg : amplitude moyenne
de l’ECG
- γecg : porteuse
impulsionnelle (QRS de l’ECG)
- ωecg : 2π.fecg
- fecg : fréquence
moyenne de l’ECG
- Ufm(t) : fréquence de modulation
de la porteuse impulsionnelle
Ce modèle a permis de réaliser des traitements numériques
plus complexes et de mesurer des niveaux de corrélation supérieurs à 87%
avec le volume ventilatoire, ce qui place la Cardio-Modulo-Respirographie
(CMR) au même niveau que les autres méthodes classiques
de surveillance de la respiration (rhéographie d’impédance,
ceintures résistives thoracique et abdominale).
Des idées de double échantillonnage sur les ondes QRS
et T de l’ECG et de double démodulation temporelle
(amplitude) et fréquentielle (rythme sinusal)
permettraient d’accroître la sensibilité.
Le facteur critique qu’est la qualité du signal ECG acquis
(porteuse) nous incitera plus tard à travailler sur les capteurs
et l’interface peau-électrode.
|
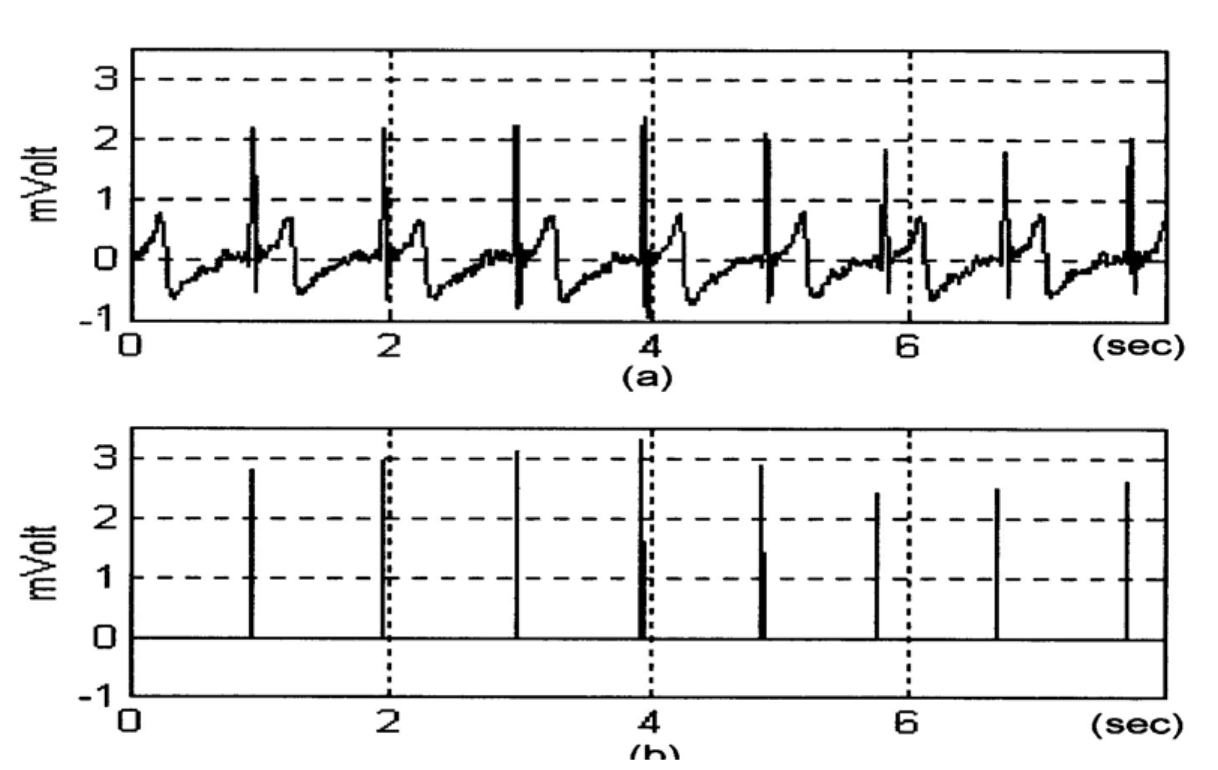
Figure 3 : Double modulation de l’ECG
par la respiration [142] |
retour sommaire
Capteur et instrumentation ambulatoire
:
La surveillance pouvant être de plusieurs mois, j’ai
été amené à concevoir un nouveau type de
capteur anti-agressif et hypo-allergénique (figure 4),
n’utilisant ni gel électrolytique, ni adhésif de peau
afin d’éviter les effets indésirables des
réactions cutanées [164].
Il est intéressant de savoir
que cette étape scientifique
réalisée en 1986, a donné lieu à une suite
contractuelle avec une entreprise en 2006, soit 20 ans après…
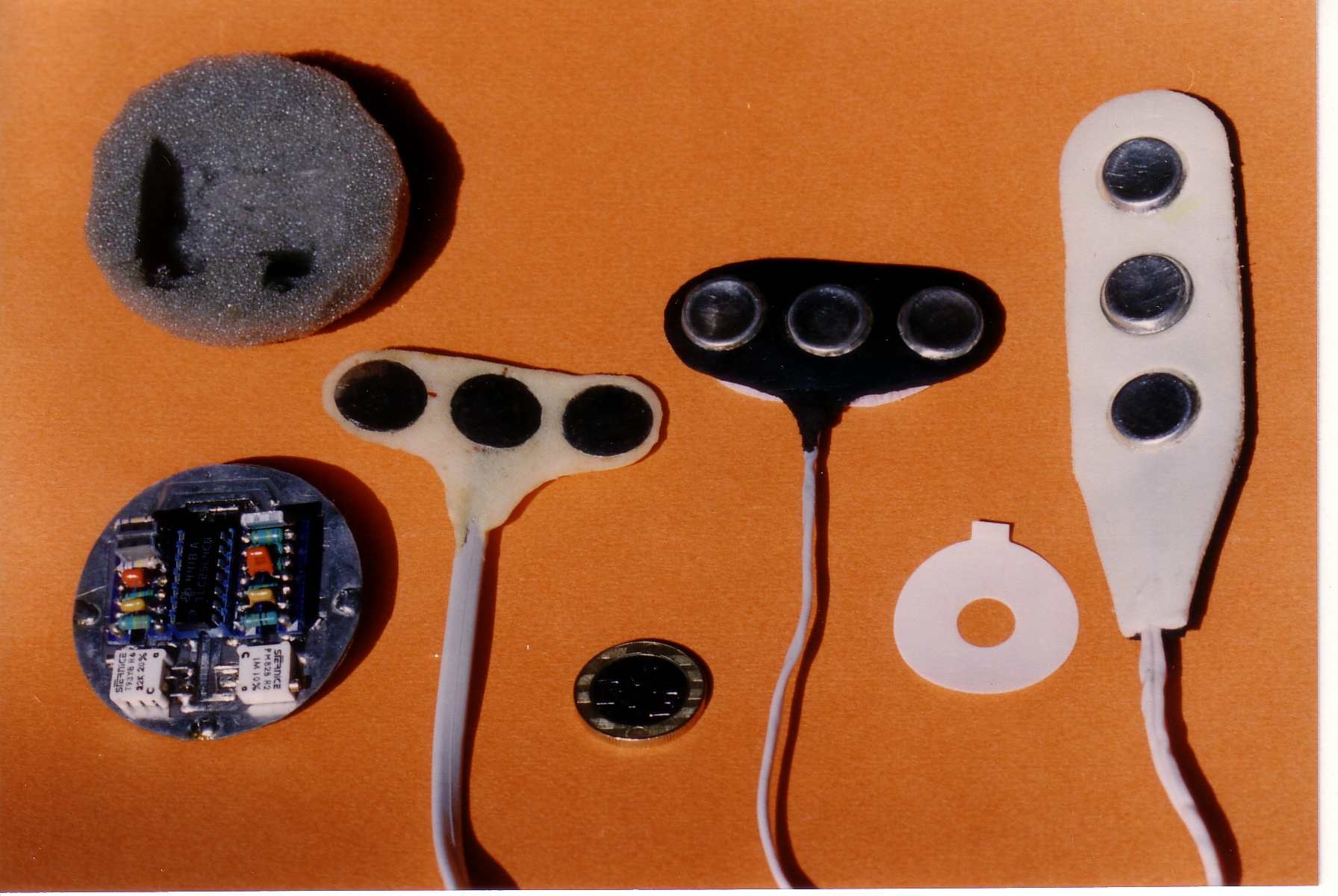
4a : Evolution
des capteurs réalisés
|
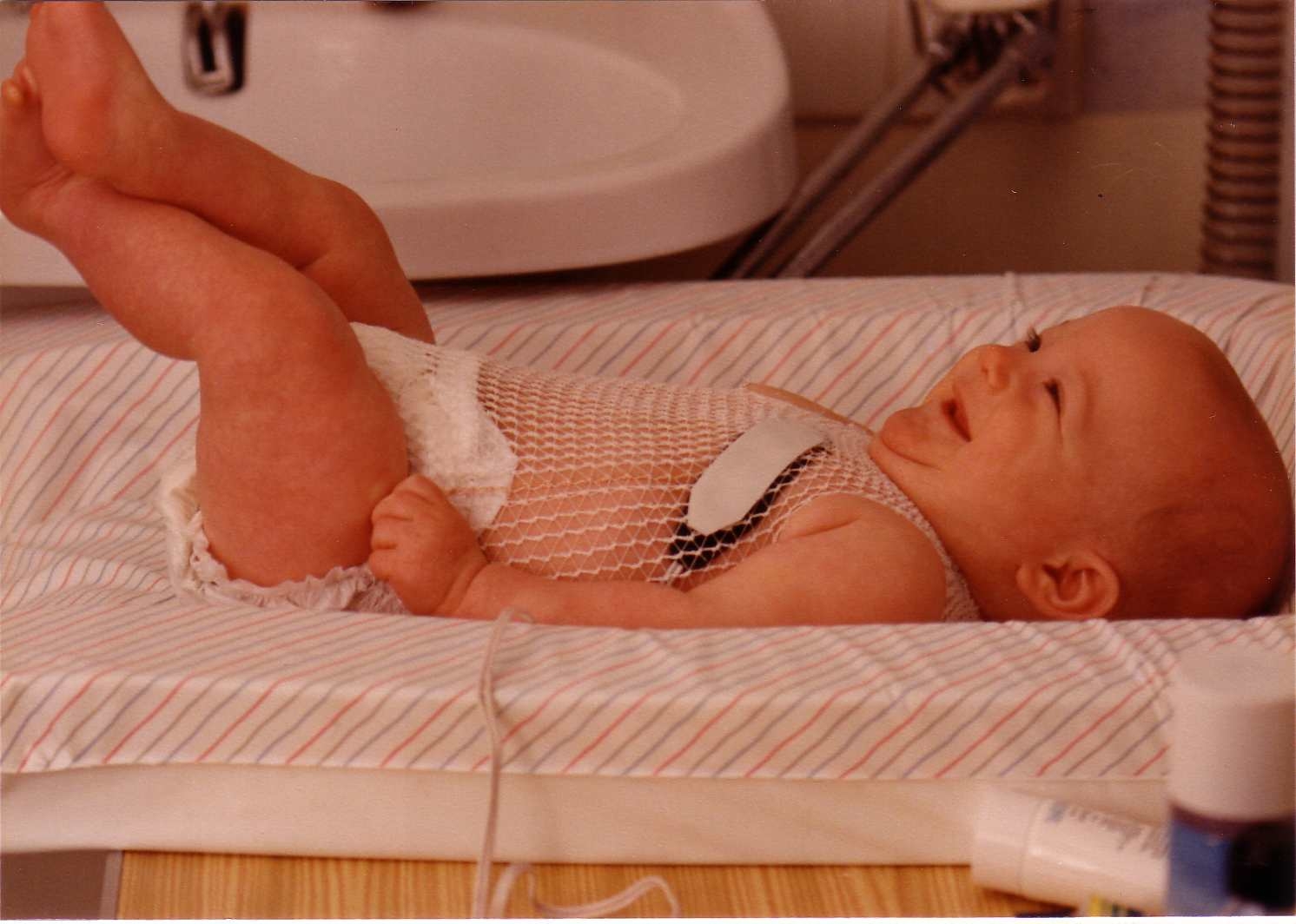
4b : Capteur
anti-agressif installé
|
Figure 4 [164] : Capteur anti-agressif
et hypo-allergénique |
retour sommaire
L’ECG modulé étant un signal émis
naturellement par l’organisme, il n’y a pas d’autre énergie à
dépenser que celle de fonctionnement du dispositif
médical. Le moniteur cardio-respiratoire lui-même a
été conçu avec des circuits d’ultra-faible
consommation (technologie CMOS) et de manière modulaire pour en
faciliter la maintenance et l’usage ambulatoire (figure 5). Une
consommation moyenne de 100 µA, associée à des
batteries au lithium de grande capacité, permet 2 ans
d’autonomie électrique (figure 6).

Figure 5 : Moniteur cardio-respiratoire conçu
pour l’usage
ambulatoire à domicile [164] |
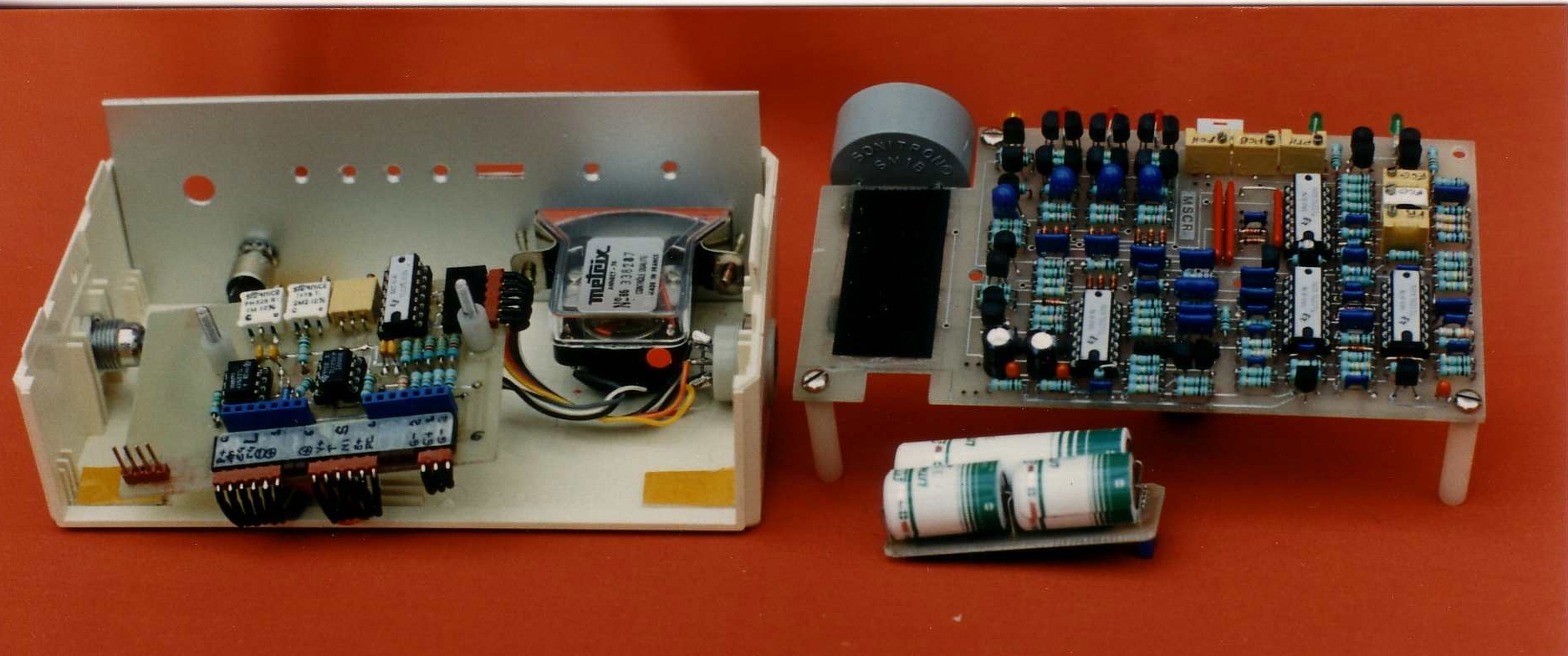
Figure 6 : Modules du moniteur conçus pour en faciliter
la maintenance
et l’autonomie électrique [164] |
retour sommaire
En plus de l’exploitation
d’un phénomène naturel
ayant mené à ce développement technologique, les travaux
ont également tenté d’aller jusqu’au bout de
la «
confiance » à accorder au dispositif électronique
en modélisant sa probabilité de défaillance. L’emploi
des approches scientifiques en sûreté des
systèmes a permis d’élaborer un arbre de
défaillances complet sur un événement
redouté : l’appareil reste muet alors que le nourrisson fait
un malaise pendant la période de 6 mois de surveillance à
domicile (figure 7).
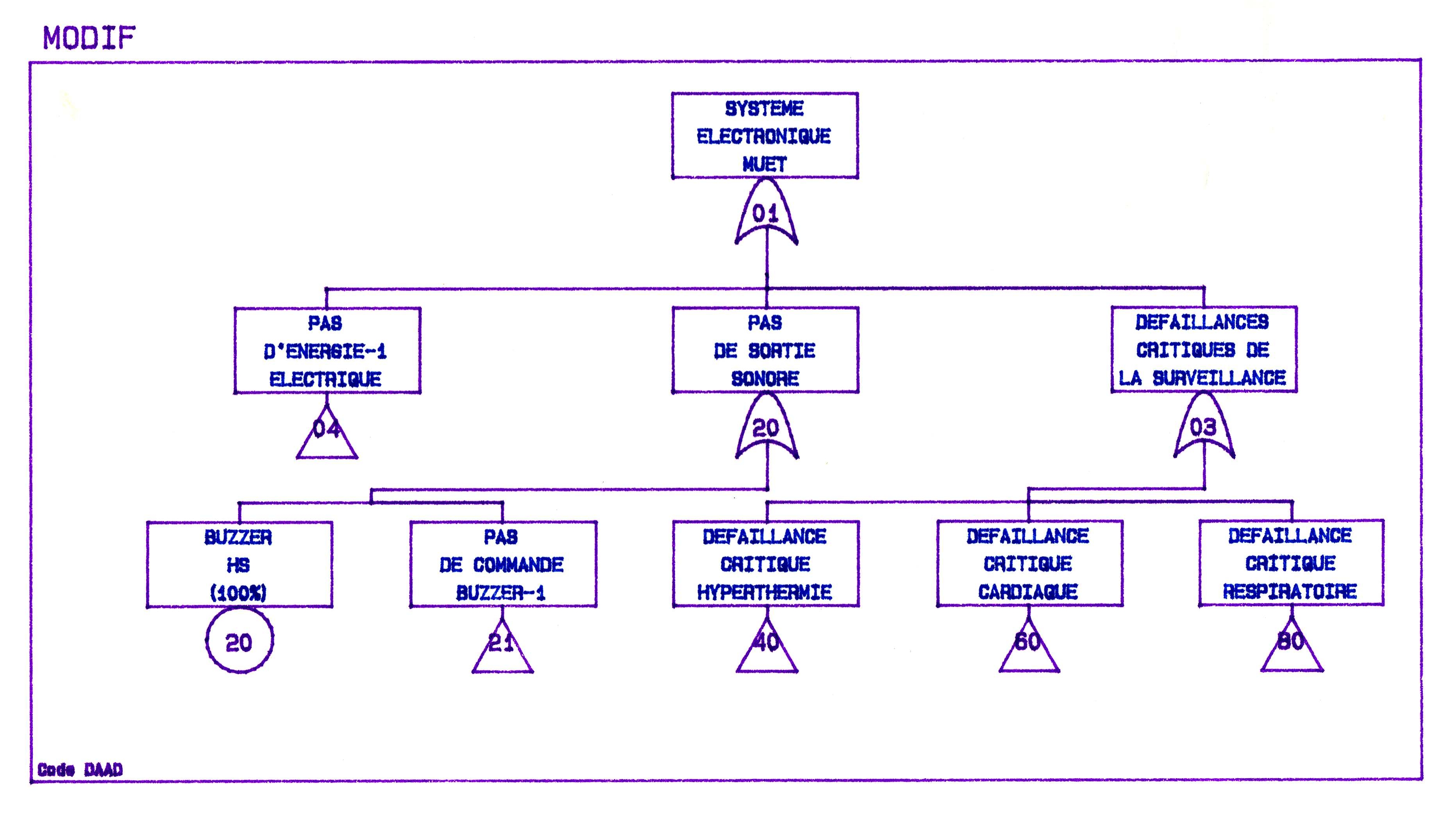
Figure 7 : Niveaux supérieurs de l’arbre de défaillances
du moniteur cardio-respiratoire
permettant d’estimer la probabilité de
l’événement redouté [164]
Avec une première conception du moniteur, la probabilité
d’occurrence estimée de cet événement a
été de 6,9.10-3, ce qui était supérieur
à l’objectif visé de 4.10-3 correspondant à la
valeur moyenne des dispositifs médicaux hospitaliers pour ce
type de surveillance cardio-respiratoire.
Des améliorations de conception
sur la structure et l’organisation du circuit électronique
ont permis d’atteindre
une probabilité estimée de 4,5.10-3 de l’occurrence
de la défaillance redoutée. L’objectif «
sûreté » se rapprochait ainsi suffisamment de la
valeur recherchée, répondant au niveau de qualité
souhaité pour ce nouveau dispositif [164].
Cette approche scientifique
d’estimation des probabilités des
états de dysfonctionnement d’un système associant
technologie et usages humains a été fondatrice de la
suite de mon parcours scientifique. Elle est aussi à la source
des nombreux travaux et des publications ou communications quant
à la maitrise des technologies biomédicales, que ce soit
à l’hôpital ou à domicile. Elle se déploiera
naturellement vers le contrôle qualité des dispositifs
médicaux, la normalisation des pratiques professionnelles
biomédicales et ensuite vers le management qualité des
organisations.
Il est important de remarquer que cette démarche était
en anticipation des besoins maintenant clairement exprimés de
sécurité sur les produits de santé.
retour sommaire
I-1-2 Système de prise en charge du syndrôme de
la Mort Subite Inexpliquée du Nourrisson (MSIN)
Le champ du Génie
BioMédical est parfaitement couvert
dans les travaux suivants qui nécessitent une interaction forte
entre la « technique » et la « clinique » au
bénéfice du patient.
Les enjeux vitaux associés à la
recherche (contribuer à faire baisser la mortalité infantile)
dynamisent les liens nécessairement multidisciplinaires
(physiologiques, cliniques, techniques) pour mener au succès
dans l’usage d’un nouveau dispositif biomédical dont l’impact
humain est très sensible (nourrisson, famille, médecin)
et les effets induits organisationnels très importants
(qualité du service rendu, hôpital, système de
santé).
Sous ma direction, l’analyse de la surveillance clinique
des nourrissons à risque de mort subite inexpliquée (MSIN) a
fait l’objet de travaux de DEA GBM (1988, [159]) et de THESE de
3ème cycle en GBM (1993, [143]) du Docteur Alain DE BROCA.
Pour agir
de manière rigoureuse et si possible pertinente, nous
avons d’abord tenté de modéliser les connaissances
physiologiques et cliniques afin d’identifier les causes possibles des
dysfonctionnements menant au décès subit sans signe
avant-coureur facilement détectable chez les nourrissons.
Une analyse « système » a
permis de clarifier les
éléments intervenant dans le champ complexe nourrisson -
technologie - environnement social (figure 8).
La construction de plusieurs
arbres de défaillances sur la
recherche des causes des syndrômes asphyxiques et d’insuffisance
cardiaque chez un enfant sans antécédent médical,
et la recherche de la détectabilité du malaise
cardio-respiratoire et des actions à mettre en œuvre en urgence
ou en prévention, ont permis d’élaborer un processus
global de prise en charge de la MSIN avec un télé-suivi
clinique de la surveillance réalisée à domicile.
Dans
ce cadre, une évaluation de l’utilisation à domicile
d’un moniteur de surveillance cardio-respiratoire a été
menée auprès de 22 familles : 43 % des alarmes
télé-transmises au service clinique hospitalier sont
fausses, dues à des problèmes techniques, ce qui doit
interpeller les technologues biomédicaux.
Les aspects psychologiques
et sociaux de la surveillance à
domicile ont aussi été analysés sur les parents et
la fratrie. L’intrusion de la technologie médicale n’est
pas anodine dans une famille : dans 5 cas, la psychologue du service
clinique a été amenée à suivre la fratrie,
3 couples sur 22 ont déclarés avoir été
perturbés par le monitorage, 4 couples ont estimé avoir
restreint leurs loisirs et sorties alors que 15 autres n’ont pas
ressenti de perturbation sur leur vie sociale.
Sur l’ensemble des parents,
2 mères et 4 pères ont
présenté des troubles psycho-pathologiques au cours de la
surveillance de leur nourrisson à domicile, sans que
l’appareillage soit directement mis en cause.
Toutes ces interactions
entre l’homme et la technologie montrent bien
que le champ de recherche du GBM a des problèmes
spécifiques à prendre en compte et à
résoudre : les savoirs et solutions technologiques doivent viser
la meilleure qualité de service rendu à l’homme. Pour
cela, la responsabilité du chercheur est de s’en assurer et
d’agir en permanence pour atteindre cet objectif.
retour sommaire
A partir de ces observations,
un nouveau dispositif de surveillance
à domicile avec télé-transmission des informations
au service hospitalier a été conçu en partenariat
avec la société ABS Median : le système s’appelle
ECRIN (enregistreur cardio-respiratoire informatisé).
Après
une phase probatoire d’évaluation clinique, le
système a pu être exploité en routine au CHU
d’Amiens (figure 9).
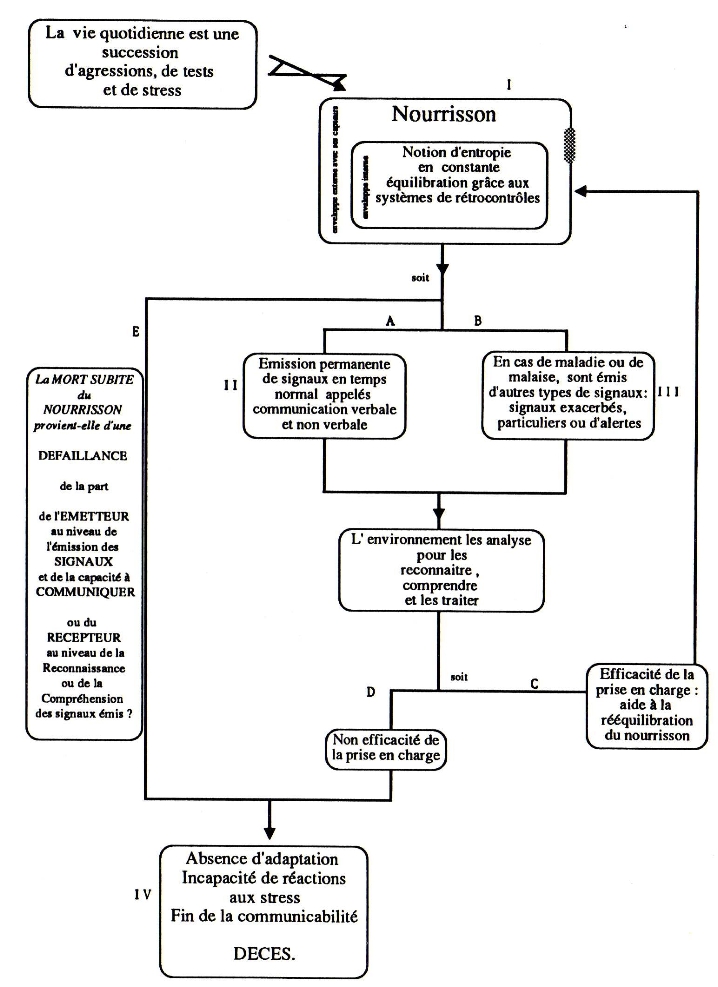
Figure 8 : Partie de logigramme tentant de modéliser les interactions
nourrisson-technologie-environnement associées
à l’apparition
de la MSIN et sa prise en charge [143]
|
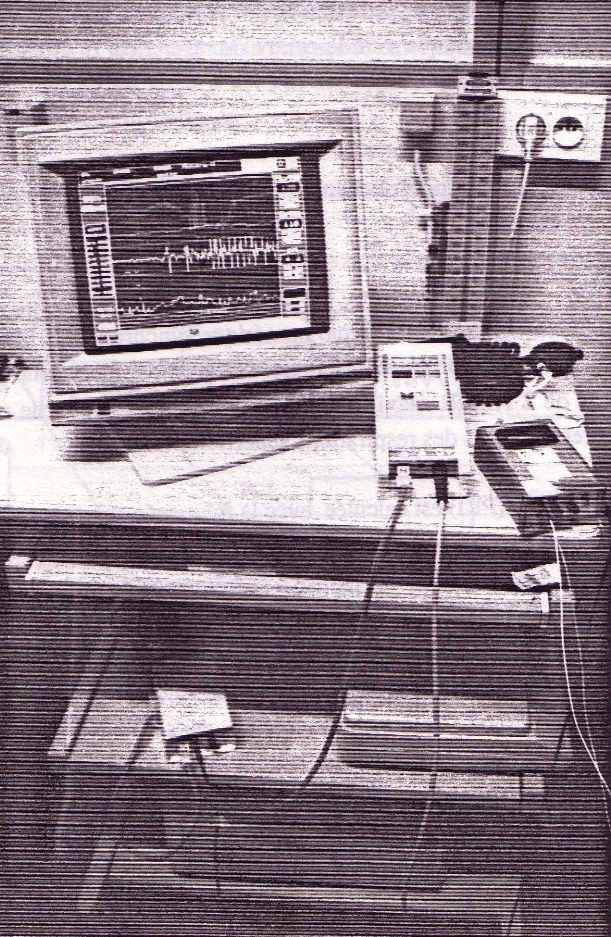
Figure 9 : Le système ECRIN en site hospitalier
[143]
|
retour sommaire
I-1-3 Bilan de cette recherche : collaborations,
valorisation et perspectives prénormatives
Cette recherche m’a
donné l’occasion d’animer ou de collaborer
avec de très nombreux groupes de compétences diverses :
- Service
Electronique de l’UTC pour la conception
des maquettes et prototypes électroniques
- CHU Amiens (Service Pédiatrie
Pr Risbourg) et CHU Rouen (Service Pédiatrie Pr Mallet) pour les aspects
cliniques de la détection cardio-respiratoire, et les
préparations au CCPPRB
- APHP-Hôpital Port Royal (Service
Pédiatrie Pr Moriette) pour l’évaluation clinique
- ANVAR
dans le cadre de la procédure
Transfert et Evaluation de Prototype (TEP)
- Groupement de Laboratoires d’Essais
Médicaux
(GLEM) pour l’évaluation technique des dispositifs
- Cabinet Brevatome
spécialisé dans la
rédaction et le dépôt des brevets
- Association Gradient
qui a servi de support permanent sur les financements et la gestion administrative
- Société Optelec
pour l’exploitation
du brevet
- Société ABS Median pour
l’exploitation du système ECRIN
- CCPPRB pour la garantie clinique
des
évaluations biomédicales
Cette recherche a donné lieu à un
effort de valorisation et de transfert :
- 1 brevet avec 3 extensions internationales
[128] et 1 cession de licence à la société Optelec
(système Phydel)
- 1 transfert de technologie avec la
société ABS Median (système Ecrin)
- 1 publication dans
une revue internationale [5]
- 2 publications dans des revues nationales [63,
86]
- 4 communications dans des congrès
internationaux « avec actes » [97, 98, 101, 105]
- 1 communication
dans des congrès nationaux
« avec actes » [110]
- 1 film à l’usage du public [173]
Mais le plus important est
que ce travail m’a permis d’imaginer
une nouvelle thématique de recherche que j’appelle «
prénormative » et qui est détaillée au
chapitre III de ce document.
Les suites prénormatives possibles des
travaux précédents et les perspectives d’actions scientifiques
concrètes pourraient être :
- identifier un indicateur d’allergénie
des
électrodes ECG en fonction de l’usage qui en est fait (courte
ou longue durée, nourrisson ou adulte…)
- identifier les points
faibles des moniteurs cardio-respiratoires au regard de leur sécurité
intrinsèque et surtout de la fiabilité de la surveillance
réalisée
- développer les analyses de
sûreté sur le système « homme-technologie
biomédicale », rechercher et proposer des alternatives
correctives aux problèmes identifiés
- contribuer au développement
des «
bonnes pratiques biomédicales à domicile », aux
conditions et protocoles d’usage des dispositifs médicaux
en hospitalisation à domicile (HAD).
retour sommaire
I-2 Travaux sur l’incubateur fermé pour
nourrisson
Ces
travaux s’insèrent dans une dynamique régionale de
recherche, animée par le Pôle GBM
Périnatalité-Enfance dont j’ai été
l’animateur pour l’UTC de 1994 à 2000. L’horizon de
recherche
était d’améliorer les connaissances sur le
développement humain avant (stade fœtal) et juste après
la naissance (stade néonatal), afin de réaliser un
« environnement physique et biologique » aussi favorable
que possible aux grands prématurés pour leur permettre
leur survie immédiate et la maturation assistée de leurs
fonctions physiologiques vitales, jusqu’à complète
autonomie.
Les outils technologiques sont d’une grande puissance pour
modifier et asservir l’environnement physique du prématuré selon
ses besoins biologiques : l’incubateur fermé représente
ainsi une « bulle environnementale » dont la maîtrise doit
être garantie autant sur les capacités techniques que sur
les façons de l’exploiter. Les travaux réalisés
ont apporté deux enseignements :
- si les ingénieurs peuvent être
très créatifs et performants en conception technique
biomédicale, leur éventuelle ignorance sur les
fondamentaux physiologiques et cliniques peut aussi mener à des
systèmes fonctionnellement dangereux.
- les pratiques médicales,
souvent basées sur de longues périodes d’observation
et d’apprentissage, induisent un conservatisme prudent pouvant être
relayé par des normes professionnelles, alors que les
progrès de la technologie peuvent les mettre en défaut en
dépassant les limites implicites existantes lors de leur
genèse.
Ces observations sont des éléments moteurs pour
faire
émerger des méthodes en recherche prénormative
dans le domaine biomédical afin que la pensée
scientifique accède à la normalisation et que ses apports
répondent plus rapidement aux enjeux sociétaux de la
santé.
retour sommaire
I-2-1 Asservissement de l’humidité
Les travaux sur l’incubateur
fermé pour nourrisson ont
visé dans un premier temps l’amélioration de
l’équilibre hydro-thermique, dans le cadre de la THESE de
3ème cycle en GBM (1994, [142]) de Mardson FREITAS de AMORIM,
réalisée sous ma direction.
Le prématuré a une
peau très fine et
perméable qui laisse évaporer de grandes quantités
d’eau interne provoquant du même coup son refroidissement
immédiat. Les incubateurs classiques chauffent l’air
(convection), quelquefois le matelas sur lequel repose le nourrisson
(conduction) et encore plus rarement les parois (rayonnement). Ces 3
composantes de chaleur sont assez bien maîtrisées en
général, que l’incubateur soit fermé (par
habitacle transparent) ou ouvert (incubateur dit « rayonnant
»), mais il en est autrement sur les pertes en eau :
réchauffer l’enfant provoque aussi immédiatement sa
déshydratation, qu’il est donc nécessaire de compenser.
Les incubateurs rayonnants ne sont pas compatibles avec
une compensation hydrique via l’environnement puisque ouverts sur
l’extérieur, en général l’enfant est
alimenté par perfusion. Les incubateurs fermés, quant
à eux, utilisent pour la plupart des systèmes
d’humidification « passive » comme une boîte à
eau sur laquelle passe un flux d’air chaud allant dans l’habitacle.
Dans les gammes de température usuelles, ces systèmes ne
permettent pas d’obtenir des niveaux d’humidité suffisants
pour
éviter des pertes hydriques importantes chez les
nouveaux-nés (figure 10).
Nous avons eu l’idée de développer
un système
actif, à partir de l’asservissement d’un nébuliseur
à ultra-sons (figure 11). Ce système est
intégré au circuit d’air chauffé de l’incubateur
fermé. Le nébulisat est directement produit par une
pastille piézo-électrique baignant dans un
réservoir d’eau stérile.
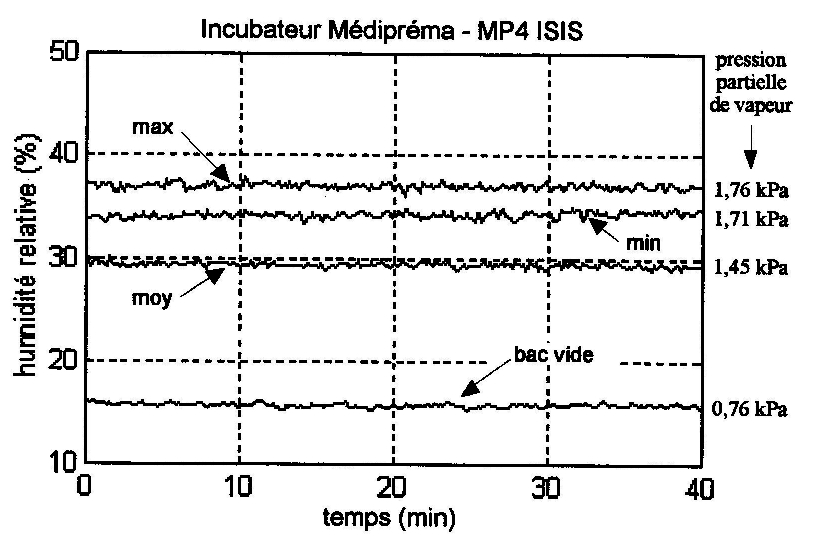
Figure 10 : taux d’humidité relative obtenus selon les
réglages
min et max
d’un incubateur équipé d’une simple
boîte à eau
comme système d’hudification [142]
|
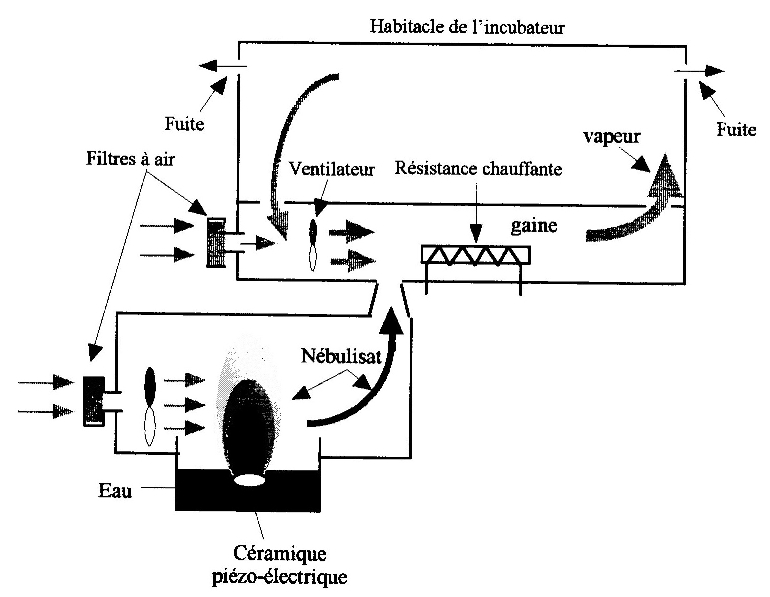
Figure 11 : Système d’humidification active
mis au point
pour l’incubateur fermé [142]
|
retour sommaire
La fréquence de pilotage
influe directement sur le diamètre des microgouttelettes du nébulisat,
ce qui permettrait en théorie de mieux maîtriser son impact
:
- d’un point de vue physique, plus les gouttelettes
sont fines, plus leur transport peut être lointain car elles ont
moins tendance à se déposer.
- d’un point de vue clinique, un nébulisat
contenant un principe médicamenteux pourrait alors être
transporté assez loin à l’intérieur des voies
aériennes du nourrisson, pouvant ainsi mieux contribuer à
un besoin de thérapeutique via les voies respiratoires.
L’humidité relative
RH s’exprime en % et est définie
par la formule : RH = 100.PV/PVS , avec :
- PV = pression partielle
de vapeur d’eau
- PVS = pression partielle de
vapeur d’eau à saturation
Le pilotage habituel des incubateurs
fermés en humidité
relative cache l’influence de la température sur les pertes
hydriques du nourrisson.
En effet, pour le même taux RH, la pression
partielle de vapeur d’eau PV n’est pas la même selon la
température
T puisque la pression partielle de vapeur d’eau à saturation
PVS en dépend selon la formule proposée dans la norme AFNOR
NF X 15-110 :
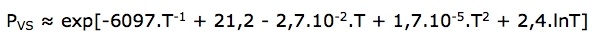
(unités : T en Kelvin et P en Pascal )
retour sommaire
Les pertes en eau
du nourrisson sont directement corrélées à la différence
des pressions partielles de vapeur d’eau entre celle de la peau du
nouveau-né
(PVN) et celle de l’environnement que l’on cherche à
contrôler (PV) : PVN=
5948 Pa pour Tpeau=36°C
Le pilotage a donc été développé en
pression partielle de vapeur d’eau (PV) et non en humidité
relative RH. Grâce à la puissance et la réactivité du
nébuliseur ultrasonore, des temps de réponse très
rapides aux montées en humidité et des niveaux
très stables ont été obtenus (figure 12).
Ceci permet
d’associer un réchauffement rapide du nourrisson
tout en minimisant ses pertes hydriques, ce qui devrait augmenter son
confort et donc sa capacité de guérison. Sous ma
direction, les travaux de DEA GBM de Lorena CEVALOS (1997, [153]) ont
grandement contribué à la validation clinique de ce
nouveau dispositif.
Le pilotage de l’humidité par le taux RH
est encore largement proposé par les constructeurs et donc communément
utilisé par les services médicaux hospitaliers. Sur
les incubateurs fermés disposant de systèmes actifs
d’humidité, cela pose un problème de
sécurité : il est possible d’obtenir des couples de
réglages de l’environnement (RH=90%, Tair=39°C, PVair=6300
Pa) qui induisent physiquement des inversions de flux des pressions
partielles de vapeur d’eau (figure 13).
Dans ce cas, le nourrisson
(RH=100%, Tpeau=36°C, PVN= 5948 Pa) est
un corps « froid » absorbant l’humidité ambiante
dans l’air : peu à peu son organisme et ses poumons se
remplissent d’eau, son refroidissement par évaporation passive
n’étant plus possible, il subit aussi une hyperthermie avec
des conséquences pouvant être léthales. Un article a
été publié pour avertir de ce
phénomène, qui est mieux maîtrisé avec une
gestion directe en pression partielle de vapeur d’eau [65].
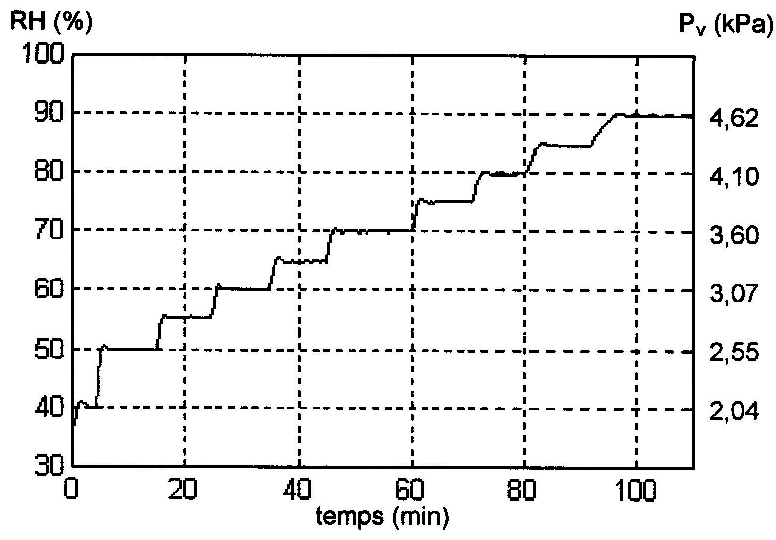
Figure
12 : Niveaux d’humidité obtenus avec le système
actif
dans un incubateur fermé. Rapidité, stabilité et
capacité sont
améliorés
par rapport au système
passif de la boîte à eau [142].
|
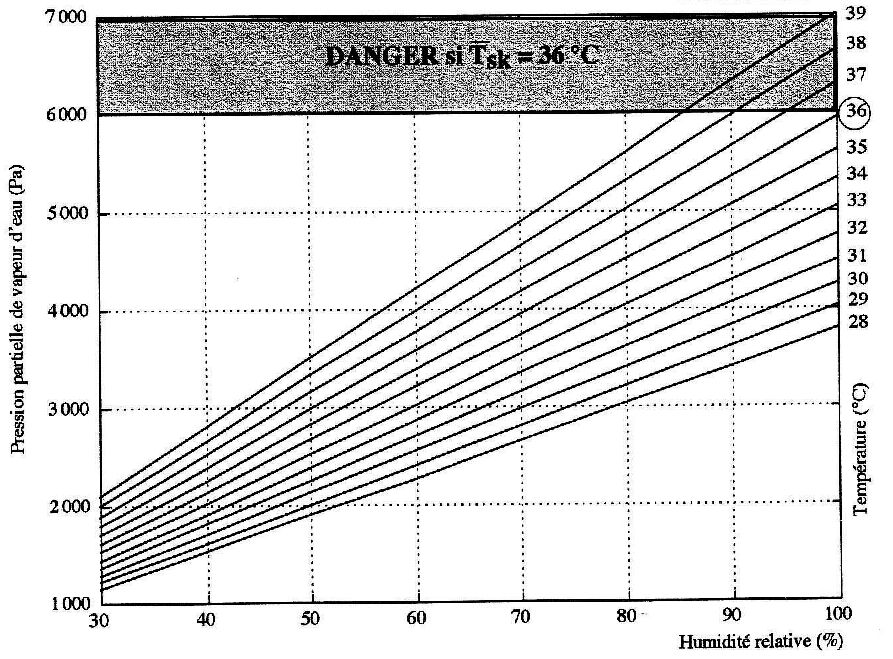
Figure 13 : Abaque montrant la zone de
danger physiologique
de l’humidité de
l’environnement en fonction
de la température
cutanée
du nourrisson (Tsk) [63]
|
retour sommaire
Les résultats
probants obtenus autant sur le plan
technique que clinique, ont permis au partenaire industriel Mediprema
de commercialiser dans sa gamme ISIS un nouvel incubateur «
SAHS : Système Actif d’Humidification Stérile »
(figure 14).
Pour des raisons commerciales et d’adaptation aux pratiques
médicales en cours, l’asservissement en humidité reste
toutefois sur des consignes en % d’humidité relative.
Le gain
technologique d’une gestion en pression partielle de vapeur
d’eau n’a donc pas été exploité.
L’ensemble
de ces travaux et des partenariats multidisciplinaires noués, ont
permis de rédiger un article collectif de fond
(83 pages, figure 15) sur le sujet du maintien de l’équilibre
hydro-thermique du nourrisson et des impacts sur les dispositifs
médicaux [4].
Le recensement des savoirs physiologiques a été
réalisé par mes collègues de la Faculté de
Médecine d’Amiens (JP LIBERT et V. BACH) pendant que j’assurais
la synthèse technique complète, de l’histoire du premier
incubateur aux perspectives futures, en passant par l’explication des
avantages et inconvénients des appareils actuels [4].
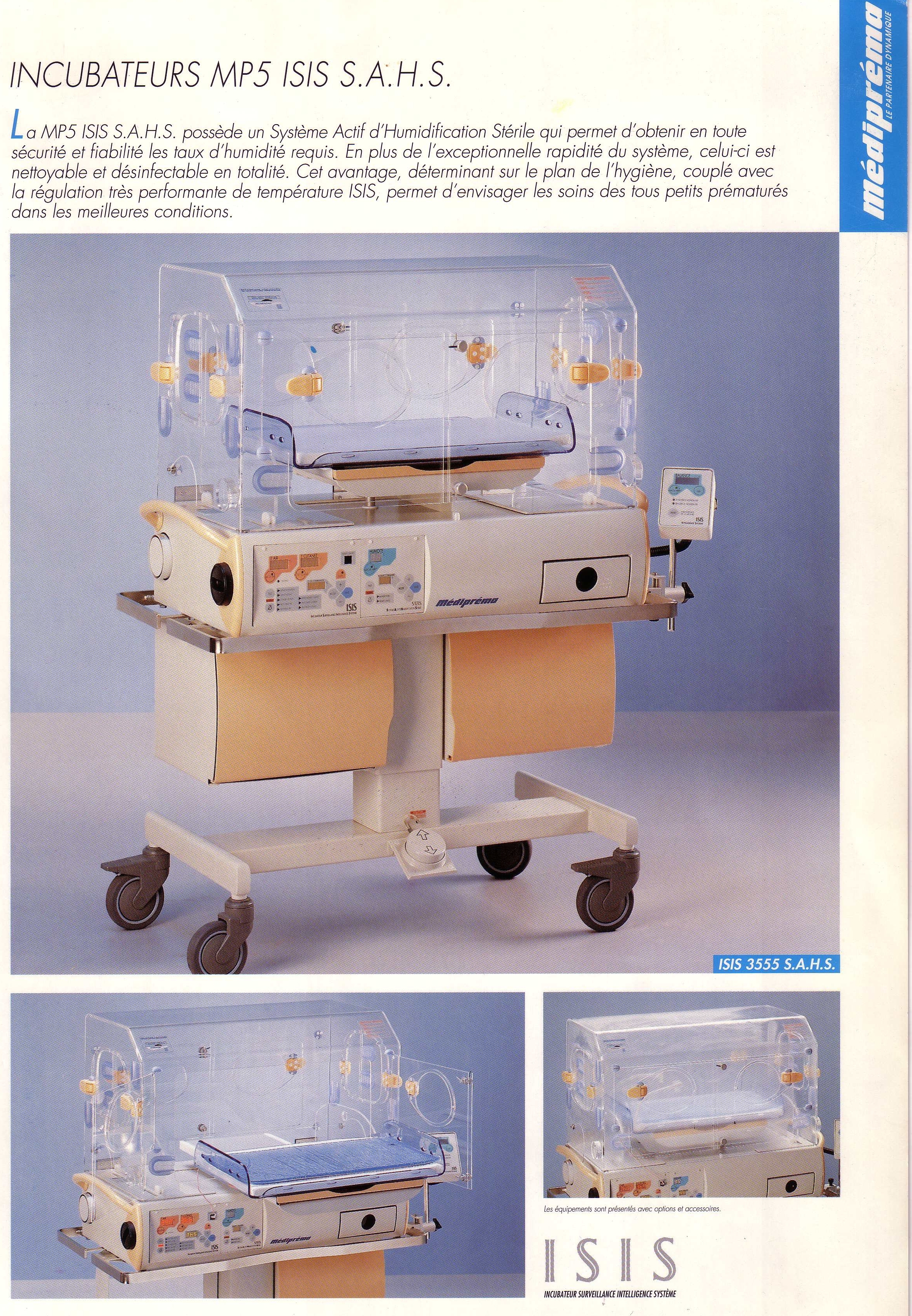
Figure 14 : Incubateur commercialisé avec un système actif
et piloté en
humidité relative |
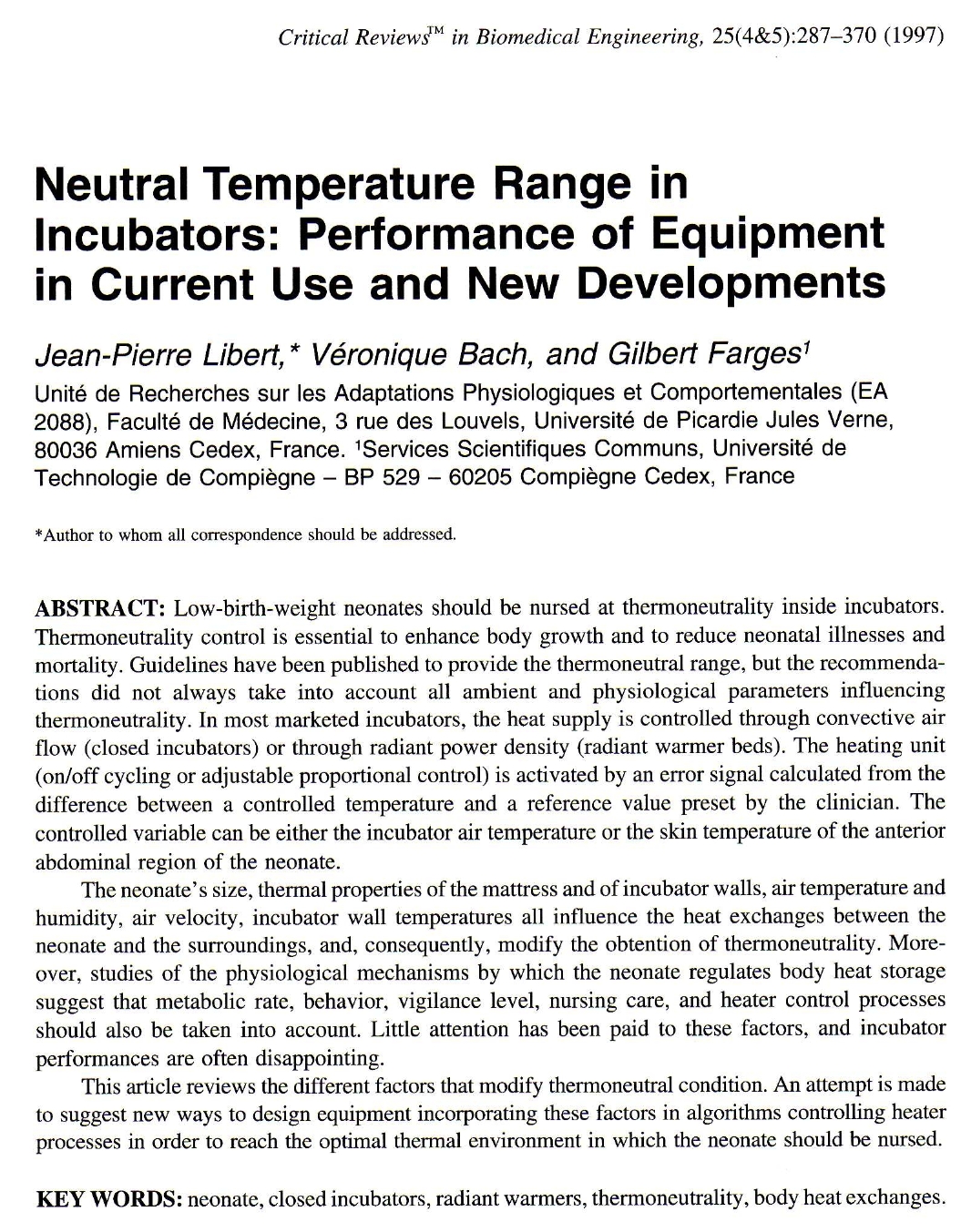
Figure 15 : Article de fond publié sur l’asservissement
en température et humidité des incubateurs pour nourrissons
[4] |
retour sommaire
I-2-2 Maîtrise des nuisances acoustiques
Dans un second temps, les travaux sur l’incubateur fermé ont
porté sur la maîtrise de l’environnement acoustique
(figure 16) avec 2 objectifs principaux :
- assurer le confort du nouveau-né afin
de contribuer à la rapidité de sa guérison,
- garantir
l’appel sonore au personnel médical
en cas de problème détecté, sans déranger
le nourrisson.
La genèse de cette interrogation est venue des observations
connexes réalisées au cours des travaux
précédents et d’une anticipation sur le fait qu’un
environnement assez silencieux permettrait éventuellement de
développer un nouveau type de détection respiratoire sans
contact via le bruit naturel de la respiration du nourrisson. Des
travaux ont été menés sous ma direction dès
1991 dans le cadre de la préparation d’un doctorat GBM de Ziad
BOUKHALED, mais n’ont pas été finalisés par une
soutenance de thèse suite à l'embauche du Doctorant en
1994 dans un emploi extérieur au monde académique [141].
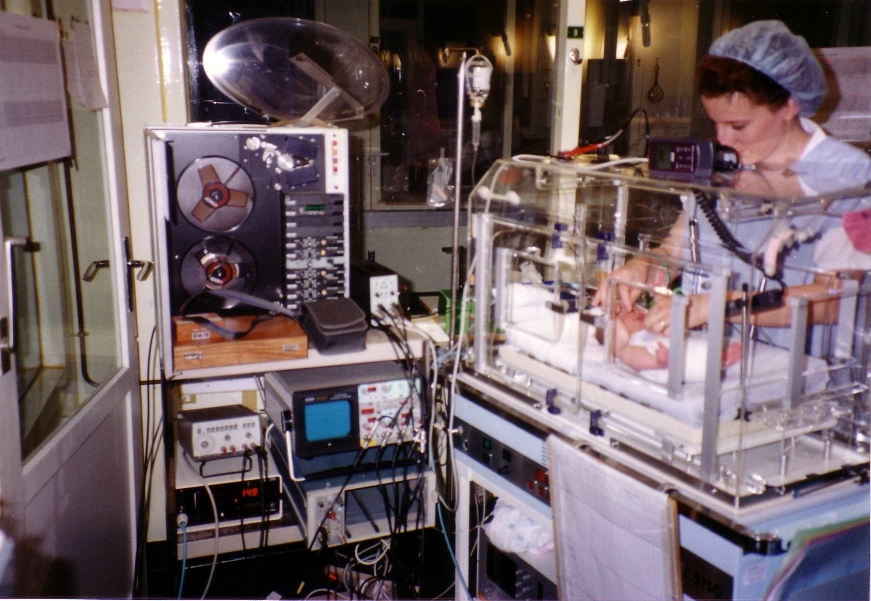
Figure 16 : Système d’analyse acoustique de l’environnement
du nourrisson [141]
retour sommaire
Les études
physiologiques montrent une sur-sensibilité
auditive des nourrissons par rapport aux adultes ainsi que des seuils
légèrement plus élevés (de 10 à 20
dBA). Les mesures acoustiques réalisées sur le spectre
[0, 20 kHz] dans le cadre de la THESE GBM, sous ma direction, de
Mokrane ABDICHE (2000, [140]) sur une série d’incubateurs en
sites hospitaliers confirment les résultats internationaux sur
le sujet : le nourrisson en incubateur fermé est en permanence
dans une ambiance sonore comprise entre 55 dBA et 69 dBA, la source
principale de bruit étant le service hospitalier lui-même
avec des contributions allant de 53 dBA à 64 dBA.
Le bruit propre des
incubateurs, en fonctionnement normal, au
niveau de la tête des nouveaux-nés est
généralement inférieur à la limite
normalisée de 60 dBA (norme AFNOR NF EN 60601-2-19).
La situation
est par contre critique quand l’incubateur émet une
alarme : dans 100% des cas, l’intensité sonore à 3 m
pour avertir le personnel médical est inférieure à la
valeur minimale normalisée de 80 dBA. En prenant comme
référence la norme américaine ANS/AAMI/CDV-1 II36,
le seuil minimal de 65 dBA n’est dépassé que par 40 %
des appareils. Des niveaux d’alarme à 3 m
inférieurs au bruit ambiant moyen des services (59 dBA) sont
même décelés dans 32% des cas (figure 17, [140]).
Il y
encore encore plus inquiétant quant à la
maîtrise de la technologie biomédicale et du service que
l’on en attend : dans 44% des cas, le niveau sonore de l’alarme
est plus important à la tête du nourrisson qu’à 3
m de l’incubateur… (figure 18, [140]).
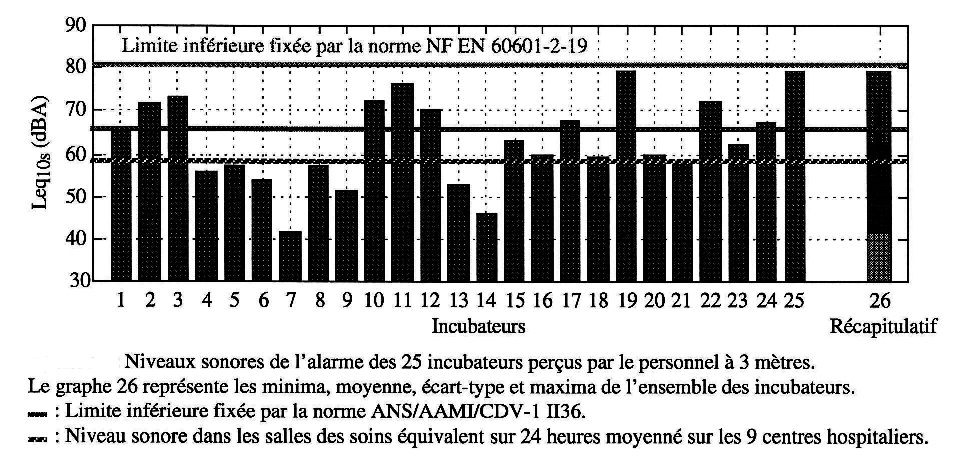
Figure
17 |
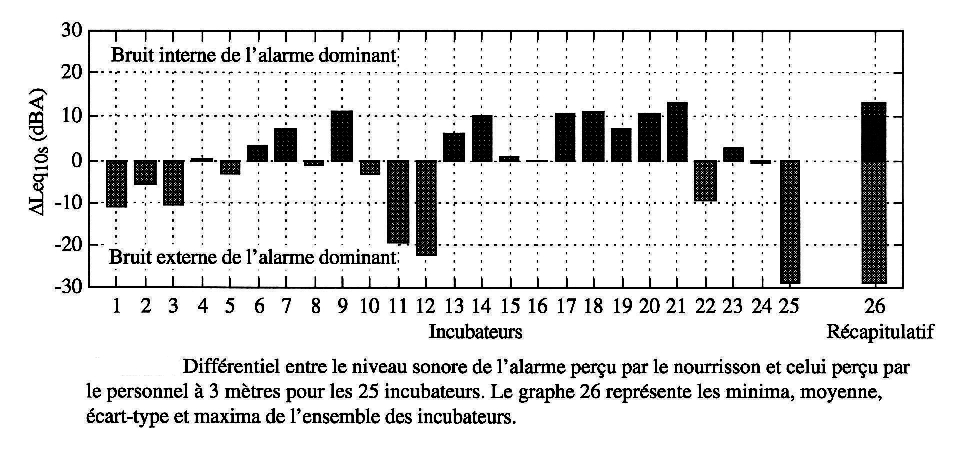
Figure 18
|
Ces constats nous ont amené à faire
des propositions d’amélioration portant sur les sources externes
et internes de bruit occasionnel ou continu dans le service hospitalier :
- sensibiliser le personnel médical à
cet aspect en se mettant « à la place » du
nourrisson (l’incubateur est une « caisse de résonance
» des bruits internes et externes…)
- faire évoluer les comportements
du personnel soignant (éviter la radio, les chocs, les discussions
proches, les appels téléphoniques, les interpellations et
éclats de voix, les claquements de porte, les objets sur
l’incubateur…)
- utiliser des poubelles dont le couvercle est muni
d’amortissseurs, des distributeurs de papier à feuilles
prédécoupées
- utiliser des chaussures à semelles
souples, des revêtements de sol et muraux non-bruyants et
non-réverbérants
- organiser le service en box ou salles individuelles
- contrôler les
niveaux sonores lors de la maintenance des appareils du service (ventilateurs,
humidificateurs…)
retour sommaire
Une recherche approfondie de caractérisation
vibro-acoustique intrinsèque de l’incubateur nous a permis de
réaliser
une cartographie des sources sonores du bâti lui-même en
chambre anéchoïque de l’UTC [140]. Les origines vibratoires
et les sources de rayonnement secondaires ont été
identifiées : ventilateur, conduit d’air, cache-bâti,
habitacle, alarme (figure 19, [140]).
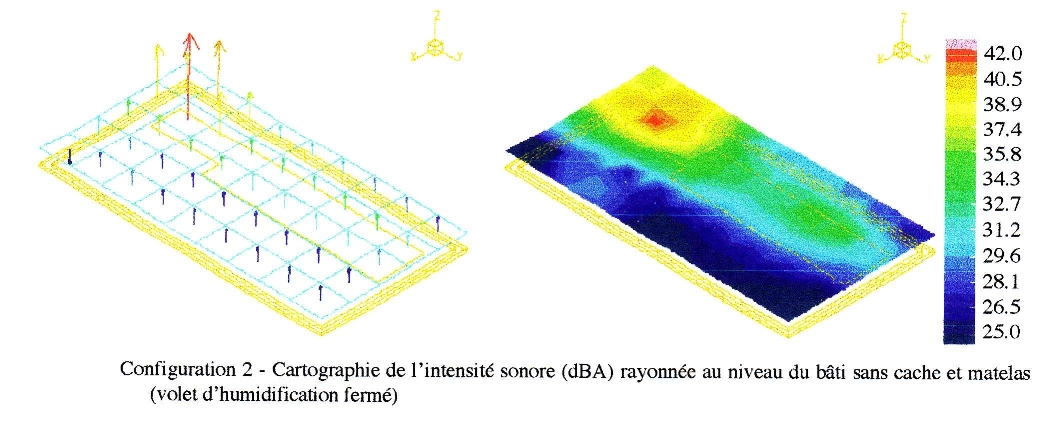
Figure 19 : cartographie des sources sonores du bâti d'un incubateur
pour nourrissons
De même, la fonction de transfert
acoustique des parois de l’habitacle a été mesurée
en salle réverbérante de l’UTC :
- l’interaction bâti-habitacle crée une
cellule d’amplification acoustique de 9,2 dBA du bruit propre de
l’incubateur testé.
- le temps de réverbération de
0,4 s d’un bruit impulsionnel (choc) pourrait être minimisé en
diminuant les dimensions de l’habitacle jusqu’aux limites possibles
imposées par les fonctions cliniques à remplir.
Les améliorations
instrumentales suggérées dans
ces travaux sont :
- dissocier le ventilateur du bâti et les
relier par un conduit souple assurant le découplage acoustique
- utiliser
un autre matériau que l’acier
peint, trop rayonnant, pour le cache-bâti comme du polycarbonate
par exemple
- agrandir les passages de l’air chaud et humide
tout au long de son parcours
- concevoir un habitacle à forme ronde
empêchant la pose d’objets, de dimensions aussi réduites
que possible, avec un joint anti-vibratoire au contact avec le
bâti
- concevoir des ouvertures et fermetures des portes
de l’habitacle sans bruit, douces, amorties…
- placer l’alarme
sonore au pied de l’incubateur (la
plus éloignée du nourrisson) dans une zone
découplée du bâti au niveau vibro-acoustique, et
orientée (ou orientable) vers la présence de
l’équipe médicale. Sinon, exploiter un système
de répétiteur d’alarme de poche porté par les
infirmières.
retour sommaire
I-2-3 Bilan de cette recherche : collaborations, valorisation
et perspectives prénormatives
J’ai mis en œuvre et animé différentes
collaborations avec des groupes de compétences multidisciplinaires
pour réaliser ces travaux :
- Service Electronique de l’UTC pour
la conception des prototypes électroniques
- EA 2088 du Pr Libert à la
Faculté de
Médecine d’Amiens pour ses connaissances sur la physiologie
du nouveau-né
- Services de Pédiatrie du CHU Amiens (feu Pr
Risbourg) et ceux des Centres Hospitaliers de Picardie pour les tests
cliniques
- Association Gradient pour le support
permanent sur les financements et la gestion administrative
- Société Mediprema
pour l’industrialisation de l’humidification active dans
ses incubateurs
- Société BioMS pour le soutien
technique
La valorisation scientifique et le transfert technologique
des travaux sur l’incubateur fermé s’est faite sous forme
de :
- l’industrialisation du procédé
d’humidification active par ultra-sons par la société
Mediprema (Incubateurs MP5 ISIS SAHS, http://www.mediprema.com)
- 3 publications
dans des revues internationales : [2, 3, 4]
- 7 publications dans des revues
nationales : [52, 53, 61, 62, 63, 64, 65]
- 9 communications dans des congrès
internationaux « avec actes » : [90, 91, 92, 93, 94, 96,
99, 100, 102]
- 5 communications dans des congrès nationaux
« avec actes » : [108, 109, 111, 112, 113]
Cette recherche comporte également
des potentiels de développement prénormatif dont les perspectives
pourraient être :
- proposer un nouvel objet de référence
pour la mesure des pertes hydriques et thermiques des nourrissons en
incubateur (prototype de mannequin radiant et suant
réalisé par l’équipe d’Amiens)
- intégrer
les équilibres et limites
physiologiques dans les seuils techniques normalisés
- identifier une
unité acoustique
spéciale « nourrisson » (dBN) prenant en compte sa
sensibilité perceptive propre dans le spectre [0,2 kHz - 20 kHz]
: l’unité « adulte » (dBA)
différenciée de l’unité physique (dBL) est
utilisée par défaut mais pas forcément la plus
pertinente.
- identifier des seuils acoustiques plus pertinents,
autant en fonctionnement normal, qu’en cas d’alarme.
- identifier
des références
architecturales dans la conception des services de
réanimation néo-natale ou de pédiatrie.
retour sommaire
I-3 Travaux sur les capteurs sans contact
Les travaux sur les
capteurs ont commencé sous ma direction,
dès 1990 avec les travaux de Ziad BOUKHALED [158]. Ils sont une
constante dans l’intérêt biomédical associé
aux nourrissons et à l’instrumentation, qu’elle soit
hospitalière ou à domicile. On cherche à mesurer
le maximum de variables physiologiques tout en minimisant les
traumatismes ou inconforts dus aux contacts et interactions
capteurs-nourrissons.
Ces travaux visent la surveillance continue, atraumatique,
voire sans contact, de 3 paramètres physiologiques fondamentaux pour
le suivi clinique des nourrissons en incubateur : la fréquence
cardiaque, la fréquence respiratoire et la température
interne.
De nombreuses idées très créatives ont
été recherchées, émises et testées
pour la détection « sans contact » de ces 3
variables. Le terme « sans contact » va de la
détection réellement « à distance »
à celle plus indirecte, mais toute aussi atraumatique, via le
support naturel sur lequel repose le nouveau-né (matelas, lit,
bâti..) ou l'interface entre le nourrisson et son matelas.
retour sommaire
I-3-1 Détection
de la fréquence cardiaque
La détection « sans contact » ou
atraumatique de la fréquence cardiaque d’un nourrisson en incubateur
fermé
peut s’obtenir :
- à partir des sons cardiaques :
- transmis par l’air :
- Voie non explorée pour cause d’absence
de bibliographie, de sensibilité des capteurs acoustiques
et des niveaux importants du bruit ambiant en incubateur.
- transmis
par le matelas sur lequel repose le nourrisson :
- Idée de développement
d’une matelas «
stéthoscope » exploitant une zone membranaire
spéciale et une cavité d’amplification acoustique
des bruits du cœur, voie non explorée.
- à partir des mouvements du myocarde transmis
au corps :
- interférométrie
ou télémétrie laser de la surface du thorax :
- Détection
des micromouvements surfaciques de quelques centièmes de mm,
bibliographie existante, voie non explorée.
- balisto-cardiographie
:
- Voie explorée sous ma direction via les travaux de DEA GBM
de Walid HASSAN (2002, [149]). L’idée expérimentée
est de détecter la quantité de mouvement pulsatile
du flux sanguin cardiaque (Q=m.V) conservée et transmise au
corps du nourrisson (Q=M.v), générant une force
mesurée à l’interface peau-matelas (figure
20).
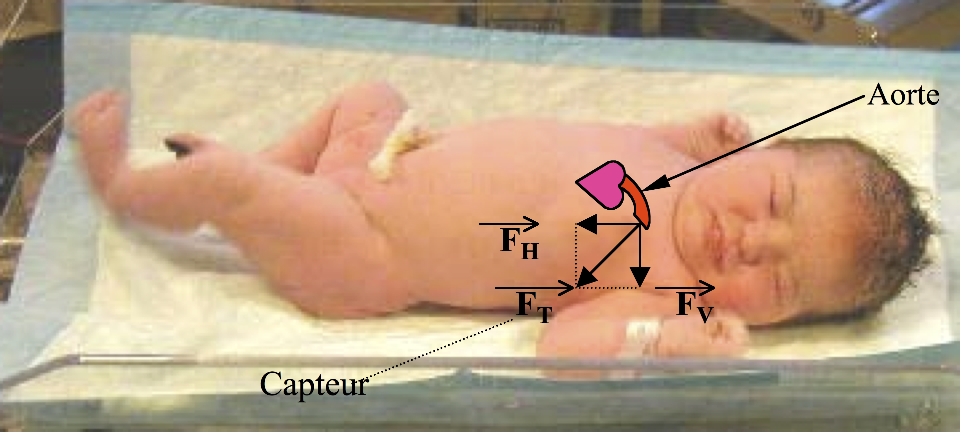
Figure 20 : Schématisation du principe de détection cardiaque
par balisto-cardiographie [149]
retour sommaire
- La masse sanguine pulsatile de 5 à 7 ml éjectée
à des vitesses de 26 à 36 cm.s-1, génère
une quantité de mouvement Q d’environ 140 à 270
g.cm.s-1. Pour un nourrisson compris entre 500 g et 2 kg, la force
F estimée au niveau de l’interface peau-matelas va de
9 à
180 mN.
- Un simulateur de nourrisson avec battements cardiaques a
été mis au point pour la circonstance afin de
démontrer la faisabilité technique d’une telle
détection (figure 21). Le capteur se présente sous
forme de plusieurs très fines lamelles piézo-électriques
(figure 22) positionnées en différents endroits sur
le matelas du nourrisson.
- Des mesures unipolaires (épaules,
hanches) et différentielles réalisées sur le
simulateur montrent des résultats motivants : la sensibilité du
capteur piézoélectrique est suffisante, le rapport
signal/bruit est amélioré par les mesures
différentielles et des filtrages conventionnels (Butterworth,
Chebyshev) ou adaptatifs. Ce travail sur le simulateur pourrait
connaître des suites dès que des conditions favorables
se présenteront (projet prénormatif ou clinique, partenaire
industriel…).
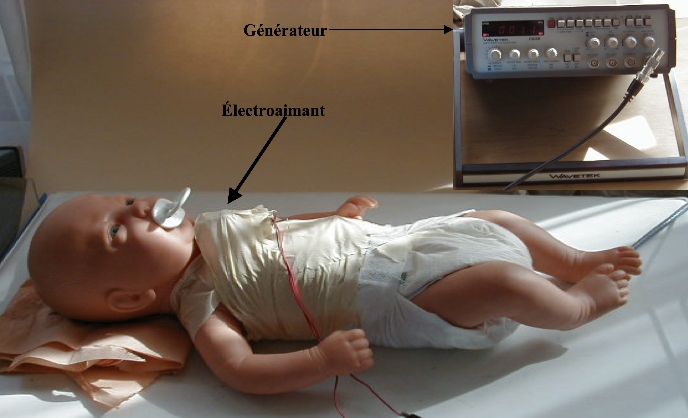
Figure 21 : Simulateur de nourrisson
avec battements cardiaques
mécaniques [149] |
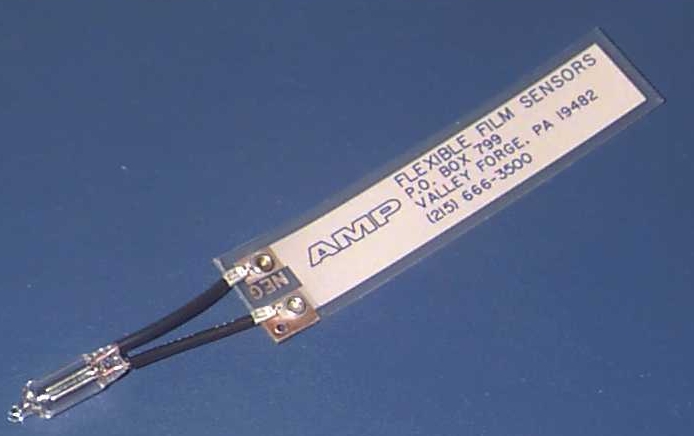
Figure 22 : Capteur piézo-électrique
utilisé pour
la balisto-cardio-graphie [149] |
retour sommaire
I-3-2 Détection de la fréquence respiratoire
La
détection « sans contact » de la fréquence
respiratoire d’un nourrisson en incubateur fermé peut s’obtenir
:
- à partir des mouvements respiratoires
thoraciques ou abdominaux :
- télémétrie ultrasonore :
- Mesure des mouvements à distance
par ondes acoustiques, voie non explorée
- télémétrie
laser :
- Idem détection cardiaque, quelques travaux, voie non
explorée
- faisceau laser coupé :
-
Voie explorée sous ma direction
via les travaux de Ziad BOUKHALED (1994, [141]). Une instrumentation
a été réalisée
avec un
émetteur d’un laser rouge HeNe de faible puissance
(inférieure aux normes) diffracté sous forme d’une
lame (de type barrière optique industrielle) et des renvois optiques
ingénieux croisant sur le volume où le nourrisson est
censé dormir (figure 23).
-
Des expérimentations sur simulateur
de nourrisson et sur adultes ont démontré une faisabilité physique
de ce principe sur la détectabilité des mouvements
respiratoires dans ce volume.
-
La sécurité laser-œil
et laser-peau du nourrisson est
à approfondir avant d’imaginer poursuivre dans cette
voie. Le travail a fait l’objet d’une communication au
Congrès
de la Société Française des Lasers Médicaux
en 1994 [114].
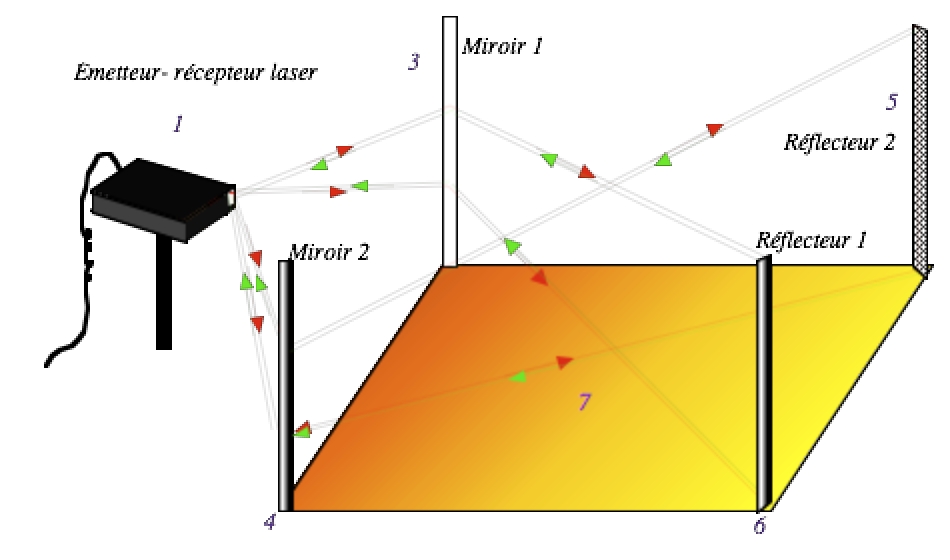
Figure 23 : Schématisation du principe de
détection
des mouvements respiratoires par coupure d’un
faisceau laser [141]
retour sommaire
- à partir des sons respiratoires
:
- mesure acoustique différentielle :
-
Mesure en 2 points, l’un
proche des voies aériennes, l’autre non
soumis aux sons respiratoires, pour éliminer le bruit acoustique
de mode commun : voie non explorée.
- mesure acoustique
directe du bruit de la respiration :
-
Voie explorée sous ma
direction via les travaux de Ziad BOUKHALED [141].
-
Une expérimentation
en milieu clinique a permis de recueillir les sons respiratoires
via un microphone visant la tête du
nourrisson, dans une gamme de fréquences élevées
[1600 Hz, 2300 Hz], exploitant les effets de rayonnement de l’habitacle
sur ses fréquences propres [230 Hz, 5900 Hz].
-
Un traitement
du signal fait ressortir une enveloppe corrélée au
rythme respiratoire (figure 24). Un synoptique de moniteur respiratoire
acoustique a été
proposé sur ce principe
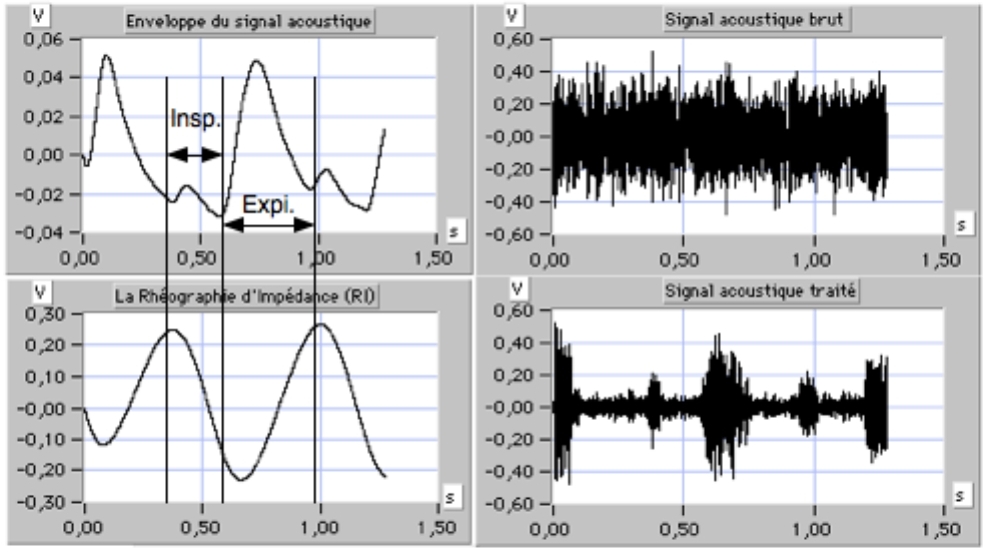
Figure 24 : A droite : sons respiratoires d’un nourrisson
en incubateur, avant et après traitement du signal acoustique.
A gauche : signaux respiratoires comparés avec une référence
en rhéoraphie d’impédance [141]
retour sommaire
- à partir des flux aériens respiratoires (avantage de
la détection des apnées obstructives) :
- analyse du gaz carbonique
expiré (CO2) :
-
Voie explorée sous ma direction via le
DEA GBM de David RYCHEN, 1998 [151].
-
Un simulateur de nourrisson qui expire
de l’air chargé en CO2
à 5% a été réalisé pour
expérimenter la faisabilité de détecter le flux
respiratoire en incubateur fermé (figure 25).
-
L’instrumentation
utilise un émetteur infrarouge à large
spectre associé à un système d’occultation
à 70 Hz pour améliorer le rapport signal/bruit, un filtre
interférentiel à 4,17 ± 0,017 µm et
un détecteur photoconducteur PbSe associé à une
cellule de refroidissement à effet Peltier.
-
Des volumes expiratoires
aussi petits que 16 ml par cycle, sur des fréquences de 35 cycles/mn,
sont aisément
détectés dans le flux d’air circulant, chaud et
humide, au sein de l’incubateur (figure 26).
-
La qualité de
détection est fonction du positionnement du
système émetteur-récepteur IR par rapport à
la tête du nourrisson, couché sur le dos. Les
écarts ne doivent pas dépasser ± 15° en
orientation de la tête et ± 5 mm en déplacement
longitudinal. Ces contraintes opérationnelles font que les
travaux nécessitent encore des approfondissements avant
d’envisager l’expérimentation clinique.
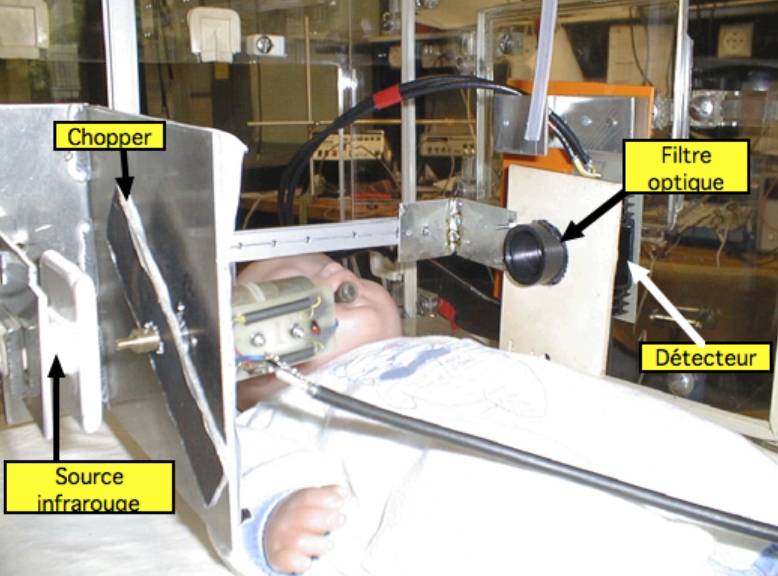
Figure 25 : Système de détection du CO2 expiré
par
mesure infrarouge [151] |
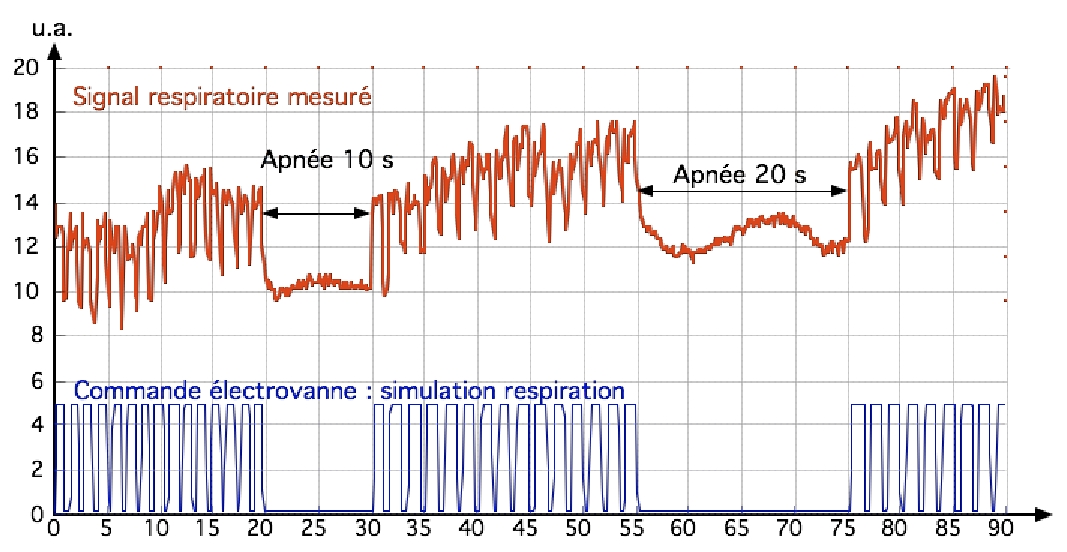
Figure 26 : Résultats expérimentaux sur simulateur
de la détection du CO2 expiré [151] |
retour sommaire
-
mesure thermique
des flux aériens
:
- Voie explorée sous ma direction via les travaux de Ziad
BOUKHALED (1994, [141]).
- Une expérimentation sur 10 nourrissons
au CHU de Lille a permis d’enregistrer le film thermographique
infrarouge de leurs voies aériennes (bouche et narines)
pendant leur sommeil en incubateur fermé.
- Des traitements
d’images différés (seuillage,
érosion, dilatation) ont montré la faisabilité
physique de surveiller les flux respiratoires par imagerie infrarouge
(figure 27).
- Des écarts moyens de 0,8°C entre l’air
inspiré et
expiré sont mesurés au niveau des narines (les
nourrissons respirent rarement pas la bouche).
- Cette faisabilité théorique
se heurte toutefois au coût, à l’encombrement
et à la complexité du
suivi et des traitements d’images en temps réel pour
en faire un type de monitorage efficient.
retour sommaire
I-3-3 Détection
de la température interne
La détection « sans contact » de
la température interne d’un nourrisson en incubateur fermé
peut s’obtenir :
- soit par thermométrie RMN (Résonance
Magnétique Nucléaire)
- en détectant l’influence
de la température sur les caractéristiques RMN du corps :
voie non explorée, appareillage encore incompatible
- soit par thermométrie
infrarouge (IR) :
- mesure auriculaire : capteur IR au fond de
l’oreille, pseudo-contact et mise en œuvre délicate,
voie non explorée
- mesure cutano-interne : le capteur IR (pouvant
être intégré dans le matelas) vise la peau. Le
modèle de corrélation Tpeau vs Tinterne est à
mettre au point, voie non explorée.
- soit par thermométrie
ultrasonore :
- Mesure de l’influence de la température sur
la vitesse de déplacement des ondes ultrasonores dans le corps
humain : pseudo-contact nécessaire, voie non explorée
- soit
par thermométrie micro-ondes :
- Mesure passive par détection
de l’énergie µonde (radiométrique) émise
naturellement par le corps humain entre 1 Ghz et 10 GHz :
pseudo-contact, voie explorée en partenariat avec Pr Maurice
Chivé de l’IEMN (Villeneuve d’Ascq) en 1997 dans le
cadre de la thèse de son étudiante Virgine SAGOT-TESSIER
retour sommaire
I-3-4
Bilan de cette recherche : collaborations, valorisation et perspectives
prénormatives
Pour mener ces travaux de recherche, différentes
collaborations multidisciplinaires ont été nécessaires
:
- Service Electronique de l’UTC pour la conception
des prototypes électroniques
- EA 2088 du Pr LIBERT à la Faculté de
Médecine d’Amiens pour ses savoirs sur la physiologie
du nouveau-né
- IEMN de Villeneuve d’Ascq pour ses
compétences en thermométrie micro-onde
- Services de Pédiatrie
et de Réanimation Néonatale des CHU d’Amiens et Lille
pour des tests cliniques
- Association Gradient pour le support
permanent sur les financements et la gestion administrative
La valorisation
scientifique des travaux de recherche sur les capteurs sans contact s’est
faite sous forme de :
- 1 publication dans une revue internationale
: [1]
- 5 communications dans des congrès
internationaux « avec actes » : [88, 89, 91, 103, 104]
- 1 communication
dans des congrès nationaux
« avec actes » : [114]
Les perspectives en recherche prénormative
pourraient être
:
- mettre au point un simulateur biomécanique
de nourrisson avec simulation :
- de la respiration,
- des battements cardiaques (électriques et
mécaniques)
- et des températures interne et
cutanée
retour sommaire
Chapitre II : Implication dans l’encadrement de chercheurs
II - Description de l’implication dans l’encadrement
de chercheurs
II-1 Directions de quatre thèses
-
Développement d'une plate-forme de
diagnostic et de monitorage acoustique appliquée aux incubateurs
pour nourrissons. M. Mokrane ABDICHE - GBM - Thèse GBM soutenue
à l’UTC en janvier 2000
- Partenaire industriel : BioMS
- Débouché de
l’étudiant : Poste
d’ingénieur projets en mesure acoustique dans une
société de services technologiques
-
Suivi des variables physiologiques
par des capteurs sans contact adaptés à la surveillance des
nouveaux-nés en incubateur. M. Ziad BOUKHALED - GBM –
début en 1991, non terminée
- Partenaire industriel : BioMS
- Débouché de
l’étudiant : embauche du
thésard par une entreprise en 1994
-
Contribution à la conception
et au développement d'un nouvel incubateur : Système de
contrôle d'humidité relative et monitorage
cardio-respiratoire. M. Mardson FREITAS DE AMORIM - Thèse GBM
soutenue à l’UTC en juillet 1994.
- Partenaire industriel : Médipréma
- Débouché de
l’étudiant : Professeur à
l’Université de Curitiba au Brésil
-
Prévention
de la mort subite du nourrisson. Analyse systèmique et de défaillance
du système
nourrisson. Evaluation de l'utilisation actuelle de moniteurs à
domicile. Développement d'un nouveau moniteur adapté
à cet objectif. Dr Alain De BROCCA - Thèse GBM soutenue
à l’UTC en décembre 1993.
- Partenaire industriel : ABS
Médian
- Débouché de l’étudiant : Praticien
hospitalier au CHU Amiens
retour sommaire
II-2 Encadrements de dix-sept DEA
-
2003-2004
: Etude de faisabilité d’un banc de
test des performances des électrodes
électrophysiologiques (contrat avec société C3A).
M. MBOM NTAMACK – GBM - Débouché de l’étudiant
: Ingénieur support en radiothérapie, Sté BrainLab,
Toulouse
-
2002-2003 : Contribution au développement
d'un nouveau capteur ECG pour le système ©CardioPic
(contrat avec société C3A). M. DIAB (Liban) – GBM -
Débouché de l’étudiant : Thèse en
co-tutelle UTC-Liban
-
2002-2003 : Approche scientifique
de la conception et validation de bonnes pratiques en contrôle qualité des
systèmes médicaux de ventilation artificielle (contrat
avec société SODEREL). Ch. PETIT – GBM -
Débouché de l’étudiant : Ingénieur Produit,
Sté SAIME, Paris
-
2001-2002 : Faisabilité d'une
détection sans contact de la fréquence cardiaque chez les
nourrissons et développement d'un simulateur biomécanique
cardiaque. W. HASSAN (Liban) – GBM - Débouché de
l’étudiant : Enseignant-Chercheur, Université au
Liban
-
2000-2001
: Etude de faisabilité de capteurs
sans contact pour la surveillance cardiaque des nourrissons en
incubateur. C. AMARAL - GBM – non terminé, retour au pays
(Brésil). Débouché de l’étudiant
: inconnu
-
1997-1998
: Etude de faisabilité d'un
détecteur respiratoire sans contact pour le nourrisson en
incubateur. D. RYCHEN GBM, Débouché de l’étudiant
: Ingénieur Conception Electronique, Sté EMKA Tech, Paris
-
1996-1997
: Conception d'un système de
détection respiratoire sans contact des nourrissons en
incubateur. M. TCHOUNDA - GBM - non terminé, retour au pays.
Débouché de l’étudiant : inconnu
-
1994-1997 : Contribution à l’analyse
et
à la validation clinique d’un nouvel incubateur asservi en
humidité. Mme L. CEVALLOS - GBM - non terminé pour
cause de maternité. Débouché de l’étudiant
: praticienne hospitalière au CHU Amiens
-
1992-1994 : Bases
de développement d’un outil
informatique de traitement de l’ECG. Dr JF KULIK - GBM -
Débouché de l’étudiant : Président de la
société Planet HealthCare, Loos
-
1991-1992 : Elaboration
d'un prédicteur et
optimisation d'un algorithme d'asservissement d'actionneurs pilotant la
surface d'un miroir. D. OUATTARA - CDS - Débouché de
l’étudiant : inconnu
-
1990-1991 : Commande
optimale en optique adaptative, simulation des performances d’un algorithme
utilisant la décomposition modales du miroir. M. NEMOUCHI - CDS -
Débouché de l’étudiant : inconnu
-
1990-1991 : Elaboration
d’une plate-forme temps
réel de traitements d’image vidéo associés
à la reconnaissance de formes, applications biomédicales.
M. MANSOURI - GBM - Débouché de l’étudiant
: inconnu
-
1989-1990 : Etude et réalisation d'un
protocole d'évaluation technique et clinique d'une nouvelle
méthode de détection de la respiration à partir de
l'ECG chez le nourrisson (collaboration avec le CHU d'Amiens). Z.
BOUKHALED - GBM - Débouché de l’étudiant :
ingénieur produits chez BioMS.
-
1986-1988 : La
M.S.I.N. : Etat actuel des connaissances et mise en place d'un système
d'exploration multi-fonctionnelle pour des nourrissons de moins de 6 mois,
en vue d'explorer leur statut neuro-végétatif et neuro-hormonal
(collaboration avec le CHU d'AMIENS). Dr A. DE BROCA - GBM -
Débouché de l’étudiant : praticien hospitalier
CHU Amiens
-
1986-1988 : Asservissement de l'injection
d'halogénés liquides dans un circuit fermé
d'anesthésie (en collaboration avec le CHU d'AMIENS). S.
LARGILLIERE - GBM - Débouché de l’étudiant
: PDG Société BOW Medical
-
1985-1987 : Surveillance
instrumentale de la respiration (en collaboration avec le CHU de STRASBOURG).
M. LICHNEWSKY - GBM - Débouché de l’étudiant
: inconnu
-
1985-1986 : Etude des facteurs physiques et
physiologiques de modulation de l'ECG chez l'enfant et l'adulte.
Critères d'optimisation. Ph. MEREAU - GBM -
Débouché de l’étudiant : inconnu
retour sommaire
II-3 Mission particulière « Qualité en Thèse
et Post-Doc »
J’ai accepté de prendre la responsabilité d’animer
un travail collectif que m’a confié la Mission Qualité du
Ministère de la Recherche en 2004. L’objectif était de
mesurer « l’état du terrain » en terme de
qualité perçue et d’en synthétiser les
éléments pertinents et constructifs pour
l’amélioration éventuelle de la situation.
Pour ce faire,
j’ai mis au point une cartographie
générique d’un processus de recherche pour communiquer
facilement et identifier explicitement les points concernés par
les vécus exprimés (figure 28). Un site web extranet a
aussi été ouvert pour la diffusion de l’action, la
traçabilité et la capitalisation des travaux menés
[170].
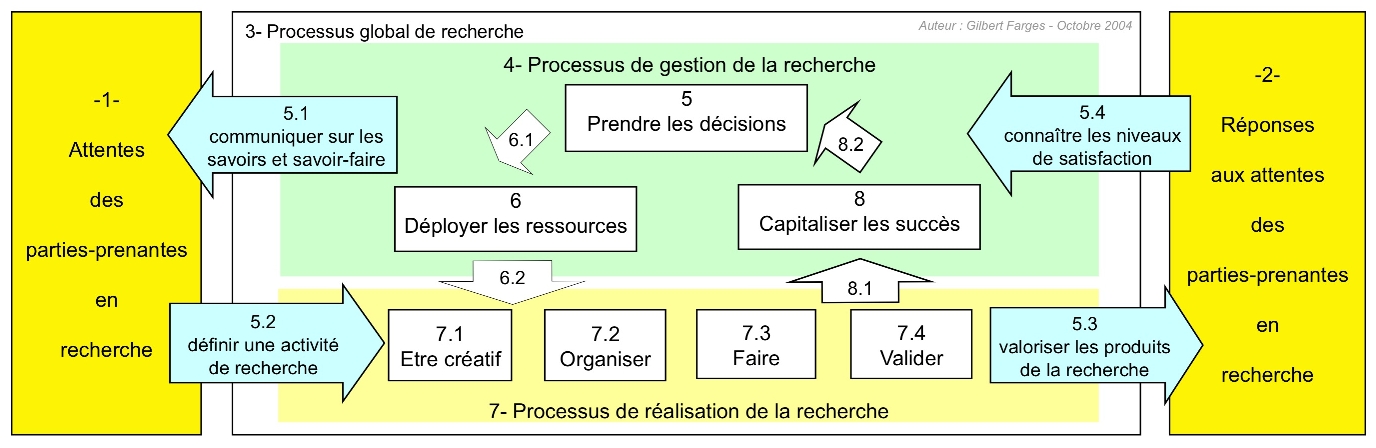
Figure 28 : Cartographie processus d’une activité de
recherche exploitée pour identifier
les problèmes et bonnes
pratiques vécus par les acteurs du terrain
En un an, d’octobre
2004 à octobre 2005, j’ai pu recueillir
des données auprès de 160 contributeurs exprimant 217 faits
vécus, se répartissant en 142 problèmes et 75
bonnes pratiques.
La cartographie processus générale d'une activité
de recherche a permis à chaque contributeur de situer exactement
sur les sous-processus concernés les faits relatés,
qu'ils soient considérés comme "problèmes" ou
"bonnes pratiques". Une représentation synthétique sous
forme de graphe radar (figure 29) montre alors clairement un
recouvrement important des problèmes perçus par les
bonnes pratiques exprimées.
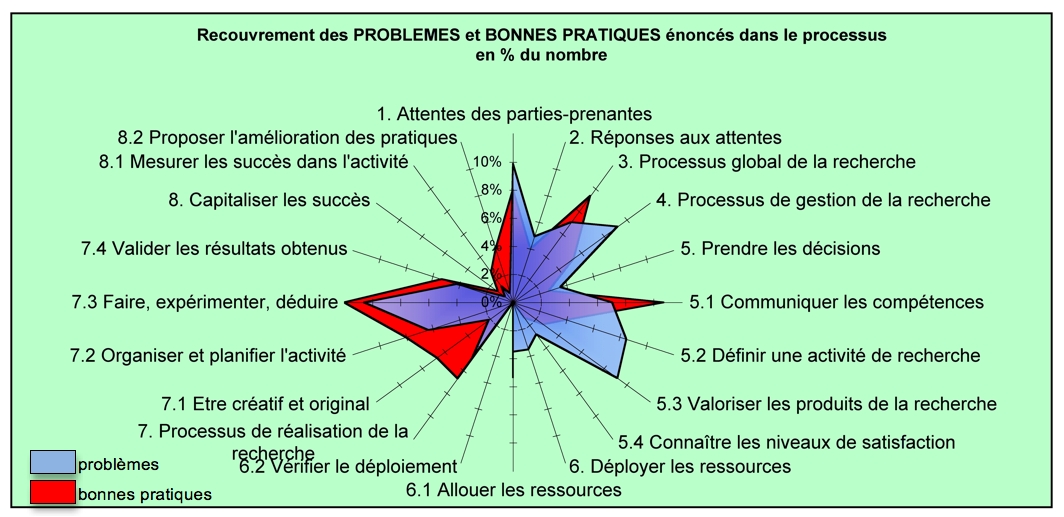
Figure 29 : Recouvrement important des problèmes
(en bleu) par les bonnes pratiques (en rouge)
lors de l’analyse des faits
exprimés par les contributeurs au groupe de travail «
Qualité en Thèse et Post Doc »
Ce constat montre que généralement
des solutions existent déjà aux problèmes vécus
et qu’une
mutualisation sur les pratiques en recherche pourrait apporter du
progrès. Ceci a permis d’exprimer un ensemble de recommandations
qui pourrait être publié sous forme d’un recueil de
« bonnes pratiques pour les travaux de thèse et post-doc
».
retour sommaire
II-4 Encadrements d’autres étudiants
Une activité importante
d’ingénierie pédagogique,
de suivi et d’organisation logistique m’incombe à ce niveau
avec une moyenne annuelle d’encadrement d’étudiants :
- 20
en Ecole Doctorale, UE CP13 «
Démarches Qualité en Recherche » (créateur
et responsable depuis 2003)
- 20 en Master, spécialité «
Management de la Qualité » (créateur et
co-responsable depuis 2005)
- 15 en Master, spécialité «
Management des Technologies en Santé » (MTS) (Sciences,
Technologies et Santé STS depuis septembre 2008)
- 20 en Certification
Professionnelle Biomédicale, Titre homologué de niveau III,
code NSF 255r, en ingénierie biomédicale hospitalière
(créateur et responsable depuis 1982)
II-5 Charges d’enseignement
Ecole Doctorale :
- CP13 : Démarches Qualité en Recherche
(créateur et responsable)
- 48 h d’enseignement avec suivi d’un
projet, 4 jalons, soutenance orale, rédaction d’un article
et capitalisation web
Master Sciences, Technologies, Santé (STS) (anciennement
Master Recherche "BMGBM" et Master Professionnel "MTS") :
- STS 70 (anciennement
SM06) : Management des Organisations Biomédicales (créateur
et responsable)
- 57 h d’enseignement, projet, jalons, soutenance
orale, article, capitalisation web
- STS 51 (anciennement GB02) : Capteurs et
instrumentation biomédicale
- 7 h d’enseignement, fiche technique,
soutenance poster
Master Management de la Qualité (MQ) :
- QP01 : Pilotage du Progrès
et de la Performance (créateur et responsable)
- 36 h d’enseignement,
ateliers d’appropriation,
capitalisation web
- QP10 : Projet d’Intégration en Management
Qualité (créateur et responsable)
- 60 h d’enseignement,
projet, soutenance orale, poster, article, capitalisation web
- ST01 : Stage
d’Observation et de Découverte
- recherches d’offres et
suivis par an en Management Qualité 1ère année (≈ 10/an)
- rapports écrits, évaluations
tuteurs
- ST02 : Stage Professionnel de Longue Durée
(16 à 20 semaines)
- recherches et gestion des offres auprès
des entreprises (> 100/an)
- ≈ 15 suivis sur site /an et ≈ 30 rapports
écrits, posters, soutenances orales, évaluations tuteurs,
capitalisations web
Cursus « Ingénieur» :
- BM04 : Acquisition et traitement de
données
biomédicales
Certification Professionnelle « Technicien
Supérieur en
Ingénierie Biomédicale Hospitalière »
- 11 semaines
d’enseignement théorique :
organisation générale, suivi, ≈ 60h d’enseignement/an
- 11
semaines de stage pratique : recherches d’offres, suivis sur sites,
rapports, posters, oraux, capitalisations web (≈ 15/an)
- Particularité :
la seule Certification depuis la création de l’UTC, auto-financement
total.
retour sommaire
II-6 Responsabilités administratives et de gestion
Recherche
:
- Responsable de l'UV CP13 en Ecole Doctorale :
"Démarche Qualité en Recherche" depuis 2002.
- Animateur du premier
réseau français
d'échanges d'expériences en qualité-recherche
(ECHIQUIER) depuis 2002.
- Animateur du Programme Pluri-Formation
"Qualité en Recherche UTC", plan quadriennal recherche 2000-2003.
- Organisateur
des Colloques Sientifiques du
Pôle GBM de la Région Picardie en 1995 et 2000 (≈ 120
participants) (figure 30)
- Co-animateur du Pôle Régional GBM
"Périnatalité-Enfance" de la Picardie de 1994 à
2000 (50 personnes).
- Animateur-Relais pour la Picardie du réseau
européen AIRE-VALUE de 1994 à 1996.
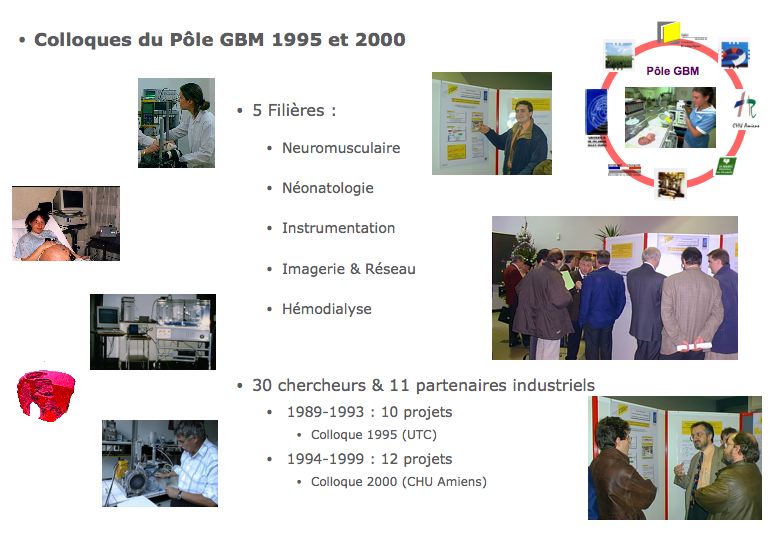
Figure 30 : Colloques Sientifiques du Pôle
GBM
de la Région
Picardie en 1995 et 2000
Enseignement :
- Co-responsable de la spécialité du
Master Management de la Qualité depuis 2004.
- Co-animateur du Master
Management des Technologies en Santé de 1995 à 2006.
- Responsable
de la Certification Professionnelle TSIBH (ingénierie biomédicale)
depuis sa création en 1982
- Co-responsable pédagogique du DESS
"Quéops" (UTC+ENSP+Univ. Montréal) de 2000 à 2002
devenu une modalité « à distance » du Master
Qualité sur le secteur Santé.
Gestion d’équipes
:
- Responsable du Service Electronique de
l'Université de Compiègne de 1990 à 2001 (6
personnes)
- Directeur du Département des Services
Scientifiques Communs UTC, de 1994 à 1999 (18 personnes)
- Responsable
organisation et gestion du Projet
"Démarche Qualité à l'UTC" de 1996 à 1997
- Responsable
du Programme Pluri-Formations SSC 1992-1995 (contrat quadriennal avec MENRT)
Responsabilités
collectives :
- Membre de la Commission Nationale de Normalisation
AFNOR « Qualité en Expertise » depuis 2007
- Membre
de la Commission Nationale de Normalisation AFNOR "Qualité en Santé" depuis
2000
- Membre de la Commission Nationale de Normalisation AFNOR "Qualité en
Recherche" de 2000 à 2005
- Suppléant du représentant de
la Conférence des Présidents d’Universités à
la Commission AFNOR "Qualité en Recherche" de 2001 à 2004
- Personnalité Qualifiée
au Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale
de 2006
à 2007
- Membre du Conseil d’Administration de l'Association
Gradient de 1996 à 2005 (secrétaire de 1996 à 1999)
- Membre
du CA de l'Institut de Maintenance Biomédicale de Bordeaux de 1995 à 1999
- Trésorier-Adjoint de la
Fédération Nationale des Pôles en Génie
Biomédical de 1996 à 1998
- Membre du CA de la Fédération
des Pôles de Recherche en Génie Biomédical de 1994
à 1998
- Membre du Jury du Prix Intermédica en 1991
et 1995 (Salons professionnels)
- Président de l'Association Picarde
de Recherche sur la Mort Subite du Nourrisson de 1986 à 1994
retour sommaire
II-7 Bénéfices
mutuels et progrès capitalisables
II-7-1 Progrès sur la visibilité externe
et la notoriété de l’activité
Pour assumer
mes activités d’ingénierie
pédagogique, j’ai développé des savoir-faire
importants sur les systèmes d’information qui me permettent
via des sites en internet ou extranet, de gérer, suivre et
capitaliser toutes les activités au bénéfice des
étudiants, professeurs et administrateurs des formations.
Actuellement, je suis webmaster de 7 sites différents visant la
capitalisation et la traçabilité des travaux
réalisés.
Les résultats en fin 2008, de cette action
démarrée depuis 1997, permettent l'accès à
429 travaux d’étudiants (stages, projets, études…),
validés, autorisés et capitalisés sur internet
(figure 31) :
- 176 au titre du Master Management des Technologies
en Santé ou DESS Technologies Biomédicales
Hospitalières (Master Sciences, Technologies, Santé en
septembre 2008)
- 77 au titre du Master Management de la
Qualité (démarrage en 2005)
- 176 au titre de la Certification
Professionnelle TSIBH
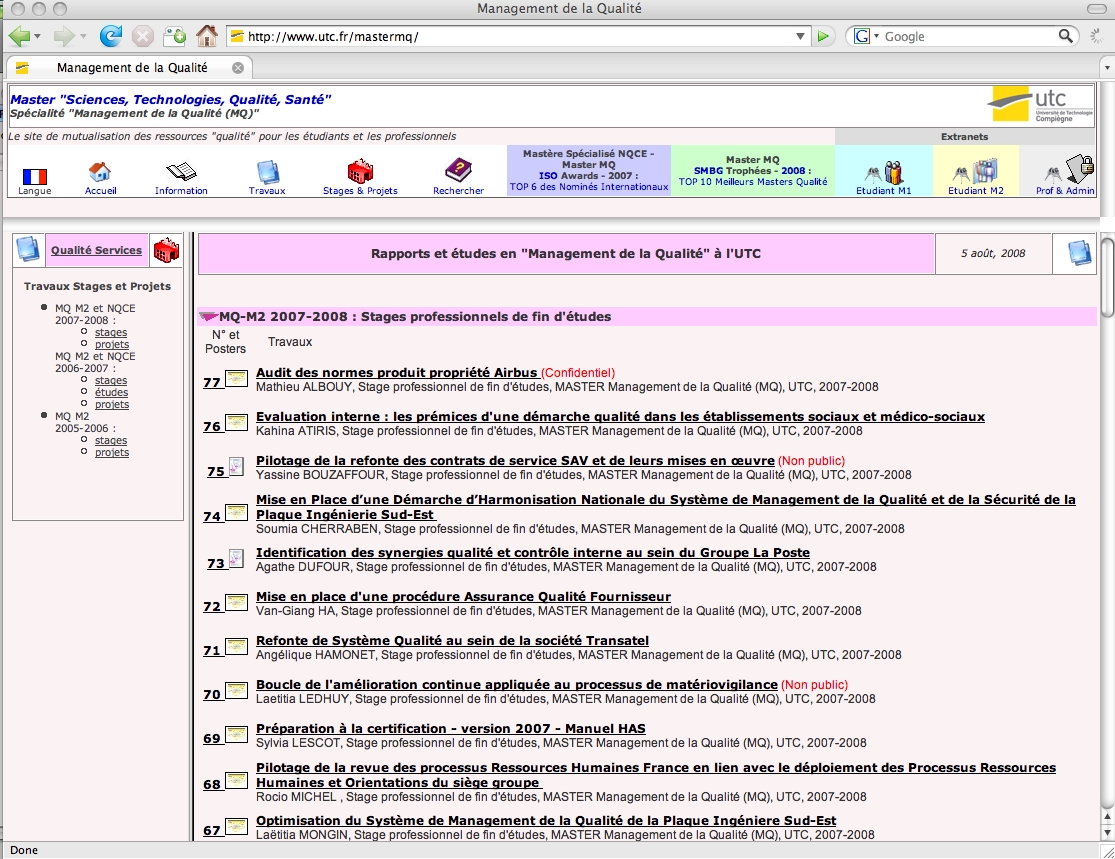
Figure
31 : Exemple de page web de capitalisation des stages et projets d’étudiants
sur Internet (Master Management de la Qualité)
Ceci a induit une dynamique de valorisation avec des
effets bénéfiques mutuels auto-entretenus :
- l’étudiant
est valorisé : son travail
validé est visible de tous (son futur employeur, sa famille…)
- la
formation obtient des résultats de
meilleure qualité : les étudiants savent que leur travail
sera visible de tous (ils développent alors naturellement plus
d’efforts pour qu’il soit de bon niveau…)
- l’enseignant est responsabilisé sur la
validation des travaux de ses étudiants (la qualité de
son expertise est implicitement engagée.
Le succès des
savoir-faire appliqués a été
démontré par les classements 2007 et 2008 du cabinet de
recrutement SMBG (www.smbg.fr) dans le « TOP 10 des
meilleurs masters » et mastères spécialisés
français du Master Management de la Qualité de l’UTC
(la seule création pédagogique du quadriennal UTC 2004-2007).
En
septembre 2007, l’ISO (www.iso.ch)
a également retenu le
programme de formation mutualisé Mastère
Spécialisé NQCE et Master MQ dans le « TOP 6 des
Nominés Internationaux »
(www.iso.org/iso/the_2007_iso_award)
pour la contribution à
l’enseignement et au développement de la normalisation.
Cela prouve
que la maîtrise des processus associée
à l’attractivité scientifique peut valoriser très
rapidement une action d’enseignement supérieur.
retour sommaire
II-7-2 Progrès
sur les processus et performances internes
La vocation de la recherche est
de produire de nouvelles connaissances et de les diffuser au sein de
la société.
Les deux missions convergent sur le besoin de communication : il s’agit
de publier et de communiquer auprès des publics concernés.
Dès le départ de l’activité de recherche, il est
implicitement demandé un effort de publication, en
qualité et quantité, et des communications dans des
congrès internationaux. Cette demande peut toutefois être
ralentie par des effets d’attente suite à la prise de brevets
et les cessions de licence associées.
De 1986 à 1998, j’ai
décliné mon activité
de recherche au sein de l’URA CNRS 858, puis de l’UMR 6600 avec
cette attente implicite de production scientifique sans avoir un accès
facile à des exemples ou des directives claires pour mettre en
œuvre et développer mes « talents » en publication
et communication.
Selon leur qualité perçue, les travaux
réalisés donnaient lieu à une publication
scientifique vécue un peu « comme une cerise sur le
gâteau ».
Le processus de publication que j’appliquais était
souvent implicite et peu formalisé (figure 32). Le résultat
chiffré de cette période de 13 ans indique une moyenne de
production d’environ 1,5 publication par an.
A partir de 1999, j’ai
concentré mon intérêt sur
les démarches qualité, entrepris une formation
personnelle sur ce thème et commencé à appliquer
pour moi-même les outils et méthodes d’amélioration
continue. J’ai observé mes pratiques, les ai comparées
à celles de collègues très productifs
scientifiquement et mis en œuvre des améliorations dans mes
façons de travailler.
La nouvelle approche que je mets en œuvre
consiste à
considérer une publication comme le résultat d’un
processus maîtrisé entre plusieurs acteurs. La
cartographie du nouveau processus montre des jalons de suivi et des
itérations de rédaction beaucoup plus formalisés
(figure 33). Le résultat chiffré montre que sur la
période 1999-2007, soit sur 9 ans, mon taux de production moyen
atteint 7,5 publications par an.
La maîtrise actuelle du processus de
production quantitative des publications ouvre le champ à l’amélioration
qualitative. Le processus maintenant bien maîtrisé sur le champ «
professionnel » peut être capitalisé sur celui de la
« recherche ».
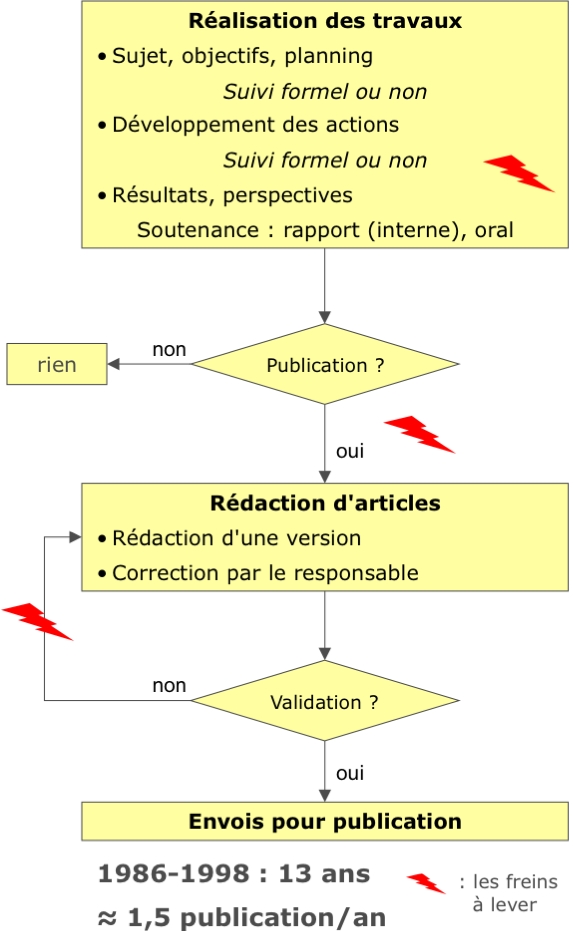
Figure 32 : Processus de publication utilisé « avant » |
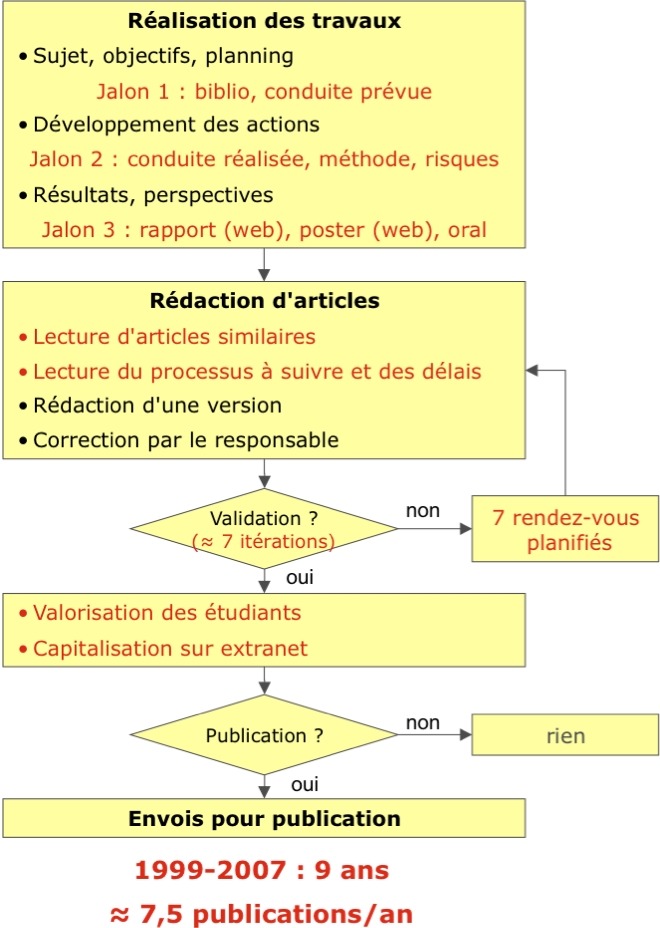
Figure 33 : Processus de publication « après » |
retour sommaire
Chapitre III : Recherche Prénormative Biomédicale
III Recherche Prénormative Biomédicale
III-1 Définitions
et cartographies des concepts
La recherche prénormative n’est pas
spécifique au secteur
de la Santé ou du Génie Biomédical, mais ces
domaines peuvent représenter de bons terrains d’analyse et
d’élaboration de méthodes avec des enjeux
sociétaux et économiques importants. Ces domaines sont
encore exploratoires et nécessitent de rechercher des
définitions quand elles existent ou d’en proposer de nouvelles.
C’est ce que je propose ci-dessous en m’aidant de
représentations graphiques des concepts et interactions mis en
jeu afin de bien justifier le sens, la raison d’être et la
robustesse de l’activité de recherche envisagée.
III-1-1
Regards sur la « Normalisation»
Le point de départ de la
réflexion est la normalisation
dont l’importance s’est considérablement accrue avec d’une
part la mondialisation des échanges économiques et d’autre
part la dynamique d’intégration européenne pour de
nombreux pays tiers. Les définitions réglementaires
françaises sur la normalisation se trouvent dans un
Décret de 1984, dont le contenu fait l’objet depuis 2008 d'une
étude modificative :
Avec l’évolution
de la définition proposée
sur la normalisation, une tendance apparaît quant à la raison
d’être d’une norme : de la seule résolution de
problèmes techniques ou commerciaux entre partenaires (version
de 1984), elle viserait principalement le consensus entre toutes les
parties intéressées, sur un secteur élargi aux
méthodes et organisations, avec un soutien à
l’économie et l’innovation respectant l'environnement
et le progrès social. Il est aussi explicitement annoncé que
les normes peuvent servir de support aux réglementations en
vigueur (spécifications à respecter) et proposer des
réferentiels de bonnes pratiques (exemples de bonnnes
pratiques).
A ma connaissance, ce projet de loi, accompagné d'un
nouveau décret sur la normalisation, pourraient se concrétiser
en 2009. Ils feraient suite à l'article 137 de la Loi de
Modernisation Economique du 4 août 2008 et le Décret
associé n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 concernant
la reconnaissance officielle du Comité Français
d'Accréditation (COFRAC) comme seule entité nationale
d'accréditation et la modification du Code de la Consommation
rendant l'accréditation obligatoire pour les organismes de
certification de produits et de services.
retour sommaire
- Définition de la « normalisation » d’après
la Commission Européenne en mars 2008 :
-
« L’activité de normalisation résulte d’une
coopération volontaire entre l’industrie, les consommateurs,
les autorités publiques et les autres parties
intéressées pour élaborer des
spécifications techniques fondées sur un consensus. La
normalisation complète la concurrence axée sur le
marché, notamment pour atteindre des objectifs tels que
l’interopérabilité des produits/services
complémentaires et parvenir à un accord sur les
méthodes d’essai et les exigences en matière de
sécurité, de santé, d’organisation et
d’environnement. » (source : Commission des Communautés
Européennes, 11/03/2008, COM(2008) 133 final)
-
Cette définition
apparaît dans un document transmis par
la Commission Européenne au Conseil Européen, au Parlement
Européen et au Comité Economique et Social
Européen sur le sujet : « Vers une contribution accrue de
la normalisation à l’innovation en Europe ». Il
explicite l’engagement stratégique des décideurs
européens pour qu’une normalisation « vivante et forte
» soit un vecteur de soutien majeur pour contribuer à
relever les défis économiques, environnementaux et
sociaux.
La Commission Européenne affirme ainsi clairement un lien
fort entre normalisation et innovation, alors que généralement
la perception implicite sur ce couplage est totalement contraire. Pour
la Commission, une normalisation dynamique est un vecteur important
d’innovation par :
- l’égalité des chances induite qui
permet l’interopérabilité et la concurrence entre les
produits et services,
- la diffusion des connaissances inscrites dans les
normes permettant de faciliter l’application des technologies,
- l’accompagnement
des nouveaux marchés et
l’introduction facilitée de systèmes complexes dans des
environnements en développement.
Les plans d’action proposés
dans ce document par la Commission Européenne peuvent favoriser l’épanouissement
d’une
recherche prénormative européenne visant à :
- promouvoir des modèles de
réglementation fondés sur le recours à des normes
volontaires,
- faciliter l’inclusion de nouvelles connaissances
dans les normes, à partir notamment de programmes de recherche
et d’innovation,
- faciliter l’accès à la normalisation
de toutes les parties prenantes en minimisant la complexité du
langage des normes et le coût des produits finis,
- instaurer une métrologie
européenne
forte par l’association des instituts de métrologie nationaux.
En
synthèse des regards précédents, nationaux et
européens, la normalisation vise donc à :
- expliciter des références
pour résoudre des problèmes répétés,
- rechercher
des consensus entre toutes les parties intéressées,
- soutenir le développement économique
et l’innovation,
- servir de support à la réglementation,
- développer les bonnes pratiques,
- intégrer l’évolution
des connaissances.
retour sommaire
Les conséquences sociétales et d’intérêt
général recherchées par une normalisation «
vivante et forte » sont de :
- garantir les exigences de sécurité,
santé, organisation et environnement,
- garantir l’interopérabilité,
la prédictibilité et l’égalité des chances
dans un système concurrentiel,
- contribuer à l’innovation
et à la
compétitivité,
- respecter les progrès sociaux et
environnementaux.
Pour préciser et illustrer le concept, je situe la normalisation
à la confluence de trois champs principaux d’activités
humaines (figure 34). Les mots étant par essence
réducteurs de la pensée, ceux choisis ci-dessous doivent
être interprétés avec leur sens le plus large
possible :
- Le champ « Science » qui est à
la source de la « Conception » permettant la
création des « Objets » matériel ou
immatériels visnt à répondre aux attentes de
« l’Homme ».
- Le champ « Production » qui vise
la
« Fabrication » des « Objets »
précédents afin de les mettre à disposition sur un
« Marché » où ils pourront être
exploités.
- Le champ « Service » dont la
vocation est d’optimiser la « Diffusion» des « Objets
» (matériels ou immatériels) disponibles sur le
« Marché » pour les mettre à la disposition
de « l’Homme ».
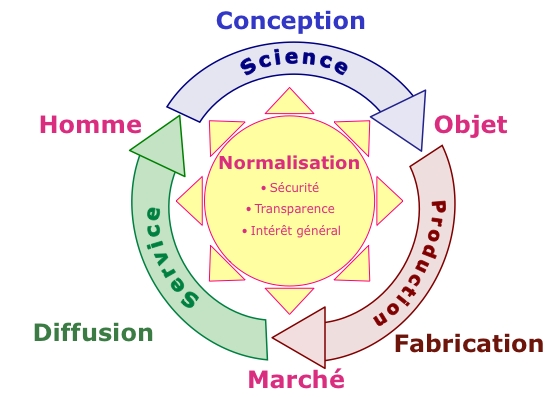
Figure 34 : Schéma de positionnement
de la « Normalisation» dans
les activités humaines
La normalisation a pour vocation d’assurer
la sécurité
associée à l’exploitation des objets (matériels
ou immatériels) mis sur le marché, en confortant ainsi un
niveau de confiance auprès de leurs utilisateurs.
La figure 34, qui
souligne la position confluente de la normalisation, montre aussi très
nettement qu’elle ne peut pas se
réduire à un texte régalien intangible, mais au
contraire s’insère dans un processus « en boucle »
de génération permanente de consensus, allant des besoins
humains perçus aux objets censés les satisfaire.
retour sommaire
III-1-2 Concept de la « Recherche Prénormative »
Le concept de « recherche prénormative » est
assez nouveau dans la culture scientifique européenne et la
faisabilité de tels projets est assurément laissé
à l’initiative des acteurs motivés. Les tutelles et
institutions de recherche ne sont pas encore vraiment
sensibilisées puisqu’une interrogation en 2008 des moteurs de
recherche associés à leurs sites internet donne les
résultats suivants :
- Union Européenne : 1 citation pour le
6ème PCRDT (2002-2006)
- ANR : 1 citation, programmes
"Sécurité" et "Systèmes Interactifs et Robotique"
de 2006
- CNRS : 3 renvois sur des décisions pour le
6ème PCRDT (2002-2006)
- CEN : 1 programme "StaR" (Standardisation and
Research, créé1992) qui distingue la recherche
prénormative (production d'une nouvelle connaissance pouvant
donner lieu à une nouvelle norme) de la recherche
conormative (production d'une nouvelle connaissance dans le cadre de
l'élaboration d'une norme).
Une interrogation réalisée
en janvier 2009 sur le site de veille technologique internationale du Ministère
Français
des Affaires Etrangères et Européennes
(http://www.bulletins-electroniques.com/)
donne seulement deux résultats pertinents avec "recherche prénormative" :
- un
projet de recherche européen sur la normalisation des
nanotechnologies (Allemagne 2006),
- un renvoi sur le projet
européen VAMAS concernant les matériaux avancés,
créé en 1982, et explicitement engagé dans une
dynamique prénormative, d'échanges et de réseau
international (http://www.vamas.org/).
Il apparaît donc que la
recherche "normative" est soutenue principalement par les instances
européennes et le Comité Européen de Normalisation
sur des enjeux généralement de sécurité, de
santé, d'interopérabilité ou de métrologie.
Ces
faits démontrent le caractère amont et encore
exploratoire de toute recherche prénormative où le
« produit » scientifique (la nouvelle connaissance, le
nouvel objet) est autant prioritaire en terme d’intérêt
d’investigation que le « service » qu’il rend à la
société (l'usage qui est fait de la nouvelle connaissance
ou du nouvel objet).
Le principe d’une recherche prénormative
s’est progressivement
dégagé au niveau européen à l’occasion
du 6ème Programme Cadre de Recherche et Développement (PCRD)
:
"La recherche prénormative vise à fournir une base
scientifique pour l'élaboration des prescriptions et normes
européennes" (source : Décision du Conseil et du
Parlement Européens relative au 6ème PCRD - JOCE L 232/2
29.8.2002 FR)
retour sommaire
La recherche prénormative est donc corrélée
aux missions de la normalisation dont elle fonde les prescriptions sur des
bases scientifiques. Elle apparaît comme une
nécessité dans un espace économique et
réglementaire commun en construction, encore cloisonné
par de très nombreuses références à des
exigences réglementaires ou des normes nationales.
Avec ces
nouveaux éclairages et en reprenant le schéma
précédent, la recherche prénormative peut
être représentée et illustrée comme la
convergence de trois outils opérationnels «
Recherche-Technologie-Qualité » associés aux trois
champs sociétaux globaux « Science-Production-Service
» (figure 35) :
- Recherche : Instrument méthodologique de la
« Science », la « Recherche » vise à la
création de nouveaux « Objets » matériels ou
immatériels visant à satisfaire les attentes et besoins
de « l’Homme »
- Technologie : Outil de la « Production
» par excellence, la technologie fait le lien entre «
l’Objet » nouveau (matériel ou immatériel) et
« l’Homme » via le média du « Marché
», ce dernier concernant autant les produits matériels
(objets consommés) qu’immatériels (les organisations)
- Qualité :
Démarche d'identification
des perceptions humaines (mentales) et des besoins explicites
(concrets, biologiques) de « l’Homme », la Qualité
vise à concilier au mieux les « Objets » et le
« Marché » pour la satisfaction biologique et/ou
mentale des collectivités humaines
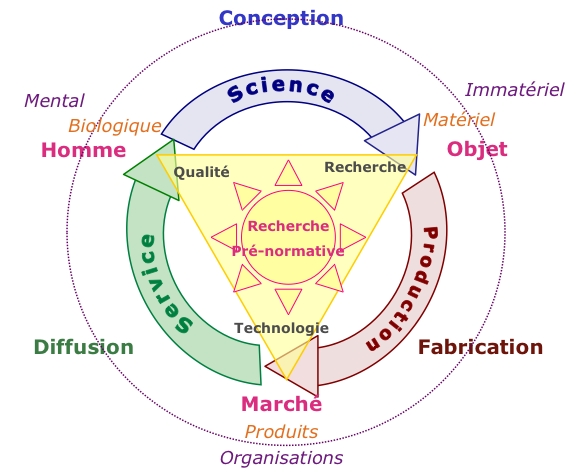
Figure 35 : Position du concept de la recherche prénormative
dans les
activités humaines (…............. :
limite concret/abstrait)
En résumé :
-
la fabrication d’un nouvel objet nécessite
de prendre en considération les connaissances scientifiques
actualisées, les besoins humains à résoudre et les
possibilités de production. C’est l’axe « Recherche
» de l’activité prénormative.
-
La technologie choisie
pour la réalisation
et la diffusion va impacter le prix, la fiabilité,
l’accès, la sécurité, la maintenance… C’est
l’axe
« Technologie » de l’activité prénormative.
-
Enfin, l’usage de l’objet va induire des
perceptions générant plus ou moins de confiance ou de
sécurité, c’est l’axe « Qualité » de
l’activité prénormative.
Ces trois axes sont autant de
regards différenciés et
complémentaires utiles à l’élaboration d’une
norme pouvant avoir un fort impact sociétal.
retour sommaire
III-1-3 Définition
et cartographie de la « Recherche
Prénormative Biomédicale »
Examinons plus particulièrement
le cas de ce que devrait
être la Recherche Prénormative Biomédicale à
la lumière des analyses précédentes (figure 36) :
- Produits
de la “Science”, via les processus de
“Recherche”, les objets matériels et immatériels
deviennent respectivement les “Dispositifs Médicaux” et
les
“Méthodes en Pratiques Médicales” visant à
délivrer des “Soins” au bénéfice de “l’Homme”.
- Le
système de “Production” quant à
lui met à disposition les Dispositifs Médicaux et les
Méthodes Médicales via les “Etablissements de
Santé” en général et plus précisement les
“Organisations Biomédicales” pour les dispositifs, où la
“Technologie” joue un rôle prépondérant (la
médecine est “technico-dépendante”, et l’efficience
du système de santé est liée aux technologies de
l’information)
- Le “Service” (médical, en santé)
est alors proposé à la collectivité humaine et il
s'agit de garantir un niveau de confiance sur les apports de la
“Technologie” et un service perçu satisfaisant en terme
de
“Qualité” des soins et de vie.
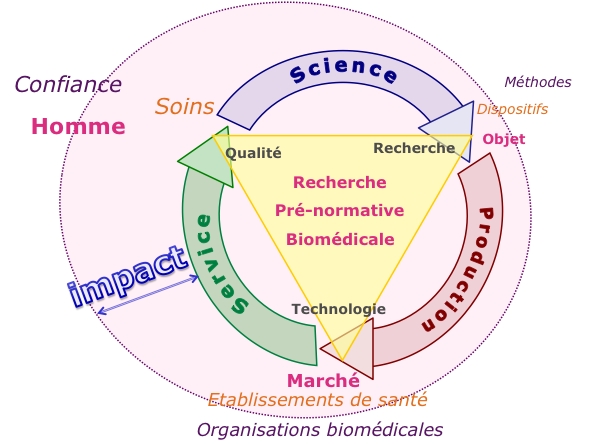
Figure 36 : Positionnement de la recherche prénormative biomédicale
et de son impact dans la société
Avec l’échelle
de quantification implicite de “l’impact”, il est
possible d'illustrer qu’une connaissance scientifique peut produire
de nouveaux objets, pouvant à leur tour diffuser sur des
marchés importants pour rendre service à un nombre
potentiellement très important d’individus : il existe donc
une cascade amplificatrice dans les impacts respectifs de
la Recherche, de la Technologie et enfin de la Qualité.
L’enseignement à en tirer est que toute connaissance nouvelle
produite en recherche biomédicale, que ce soit sur les
dispositifs médicaux ou les méthodes, induira des impacts
amplifiés sur les marchés respectifs
(établissements de santé, entreprises, services
biomédicaux..) et aura des conséquences sur un grand
nombre de patients en terme de confiance et de qualité de soins.
Le
cycle prénormatif “Recherche-Technologie-Qualité” est
en boucle et donc “auto-entretenu”, ce qui implique qu’il
est possible de le réaliser à partir de n’importe quel
point d’entrée :
- Entrée “Qualité” :
un besoin de confiance en santé ou de qualité de soins induit
une activité de “Recherche” pouvant mener à de
nouvelles réponses “Technologie” et l’apparition
de nouveaux marchés. La recherche "co-normative" est basée
sur ce principe, quand le besoin initial de la "Recherche" provient d'un
travail de normalisation et que les résultats ont vocation
à être intégrés dans un document normatif.
- Entrée “Technologie” :
un dispositif médical ou une technologie biomédicale, plus
ou moins bien maitrisés ou perçus, induisent une analyse
“Qualité” éventuellement suivie d’une “Recherche”.
- Entrée “Recherche” :
habituelle pour les scientifiques, une nouvelle connaissance, éventuellement
produite par d’autres secteurs de recherche, induit de nouvelles
“Technologies” et l’émergence de nouveaux marchés,
pouvant donner lieu à des besoins en “Qualité”.
A
partir de cette analyse, je suggère une définition pour
la “recherche prénormative biomédicale”, concept
scientifique encore nouveau en 2009, plutôt soutenu par la
dynamique européenne et qui s'inspire des projets
d'évolution réglementaire française sur la
normalisation :
« La recherche prénormative biomédicale vise
à fournir une base scientifique pour l'élaboration de spécifications,
recommandations, bonnes pratiques et normes en Santé, comportant des
solutions consensuelles aux problèmes techniques ou aux usages concernant
les produits, services, méthodes ou organisations en Santé, et
contribuant au développement économique, à
l’innovation et au support éventuel de la réglementation,
dans le respect de l'environnement et du progrès social » |
Sur
le plan scientifique "technologie et santé", la recherche
prénormative biomédicale vise à fournir des bases
crédibles et robustes quant aux recommandations de conception ou
d’usage sur les dispositifs médicaux. Elle contribue à développer
la confiance dans le service rendu par la technologie
pour améliorer la qualité perçue des soins délivrés.
retour sommaire
III-2 Retours d’expérience pour lancer une recherche
prénormative biomédicale
Les chiffres suivants permettent
de situer les enjeux
économiques du secteur et de quantifier l’impact d’une
action de normalisation :
- En 2006, le marché français des seuls
dispositifs médicaux dits « d’équipements »
(à usage clinique et hospitalier) représentait 1,7 Mds €
(source www.snitem.fr, statistiques consultées en janvier 2009).
- Sur
la même année, la consommation en
soins hospitaliers (usage des technologies biomédicales, toutes
dépenses confondues avec salaires et frais de fonctionnement)
est estimée à 70 Mds € en France (source www.insee.fr,
consultation en janvier 2009), soit environ 40 fois plus que le
marché précédent.
- Ceci implique que toute nouvelle connaissance
produite dans le domaine des usages des technologies
biomédicales porte sur un champ économique et social
largement amplifié par rapport à celui de la conception
des dispositifs médicaux (figure 37).
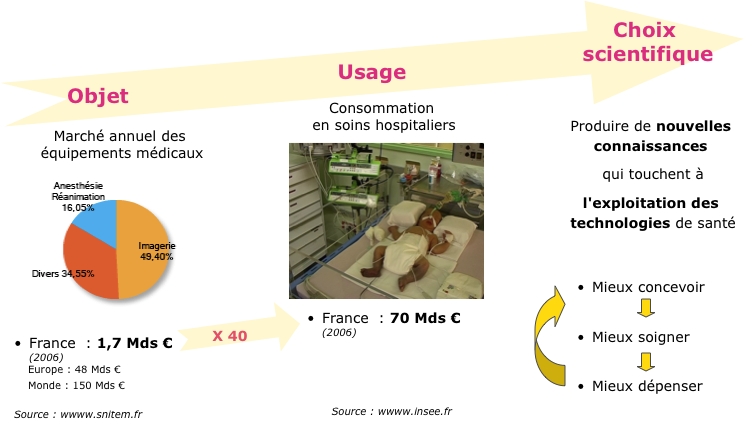
Figure 37 : Enjeux économiques comparés entre
les « objets » et « usages »
des technologies biomédicales
(chiffres 2006)
retour sommaire
III-2-1 Mes activités
vues dans la perspective d’une recherche
prénormative biomédicale
Sans le savoir au départ, j’ai
mis en pratique les concepts de la recherche prénormative biomédicale.
Mon parcours professionnel biomédical m’a en effet permis d’apprendre,
comprendre et maitriser des capacités génériques
en Recherche, Technologie et Qualité.
Les apprentissages de la rigueur
scientifique (lien Recherche-Technologie), de la maitrise des processus
et de l’obtention
des consensus (lien Recherche-Qualité) et du travail
collaboratif en réseau (lien Qualité-Technologie) me
conduisent maintenant à pouvoir les capitaliser pour contribuer
au développement d'une recherche prénormative
biomédicale.
III-2-1-1 Lien Recherche-Technologie :
La maîtrise des capacités
requises sur le lien Recherche-Technologie est illustrée par les 14
DEA et 3 Thèses finalisés ayant conduit à de nouveaux
« produits scientifiques » (connaissances, capteurs,
instrumentations…) sur le secteur des dispositifs médicaux.
Ces travaux ont été la source de la synthèse
présentée dans les chapitres précédents de
ce document.
retour sommaire
III-2-1-2 Lien Recherche-Qualité :
La maîtrise des
capacités requises sur le lien
Recherche-Qualité est démontrée par mes
actions de compréhension et d’amélioration des processus
associés à la créativité et au
succès des projets de recherche : j’ai appris à percevoir
et comprendre l’interaction des différents
éléments (humains ou technologiques) permettant d’aboutir
à un résultat scientifique de qualité.
Cette maîtrise
s’est largement développée avec la
responsabilité de deux Programmes Pluri-Formations (PPF) pour
l’UTC :
- Le 1er concernait la gestion d’équipements
scientifiques pour les 4 Services Scientifiques Communs (SSC, 18
personnels IATOS) dont j’assurais la supervision en tant que Directeur
du Département SSC de 1994 à 1999.
- Le 2ème portait explicitement
sur Qualité-Recherche de 2000 à 2003 et m’a permis de
contribuer au lancement d’une dynamique qualité en recherche,
aussi bien localement (UMR 6600) qu’au niveau national (figure
38)
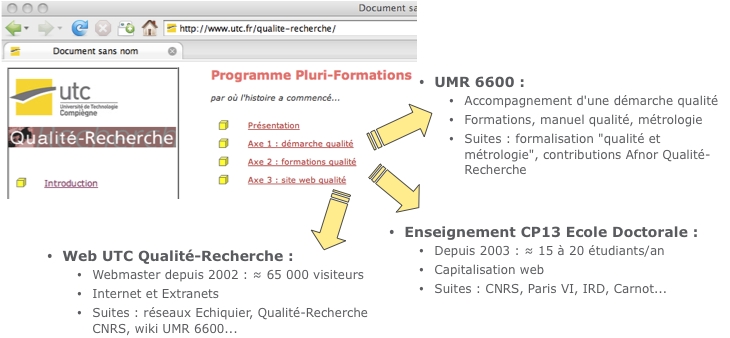
Figure 38 : Axes du Programme Pluri-Formations Qualité-Recherche
de l’UTC.
Au
niveau local, les actions qualité-recherche ont permis
:
- d’initier une démarche pilote au sein de
l’UMR 6600 avec une mise à niveau sur le
référentiel ISO 17025 d’une activité ciblée
en recherche concernant la caractérisation des
propriétés mécaniques des tissus osseux par
ultra-sons.
- de réaliser un enseignement annuel en Ecole
Doctorale sur la qualité en recherche avec un accompagnement
individualisé des doctorants dans leur projet
d’amélioration de leurs pratiques, une fertilisation
croisée des approches et une capitalisation des résultats
(UE CP13 : Démarches Qualité en Recherche : principes,
méthodes et expériences, depuis 2002).
- D’ouvrir un site web dédié à
la qualité en recherche (https://www.utc.fr/qualite-recherche)
avec de nombreuses ressources documentaires mises à disposition
de tout public (référentiels, formations, réseaux,
exemples..) et des parties à accès réservés
pour gérer et capitaliser certaines actions (qualité UMR
6600, réseau Echiquier, séminaires etc..)
Au niveau national,
le développement de la qualité en
recherche s’est d’abord opéré via le CNRS
intéressé par des séminaires de formation avec un
accompagnement individualisé. Chaque année depuis 2004,
une vingtaine de personnels des départements sciences de
l’ingénieur (SPI, ST2I) sont formés aux outils
qualité et mettent en œuvre une amélioration au sein
de leur laboratoire [181].
Le succès de cette approche s’est traduit
par la création
en 2008 du premier réseau qualité en recherche au CNRS,
transversal et inter-départemental, avec le soutien de la
Mission Ressources et Compétences Technologiques (MRCT) du CNRS
[177] et l’appui des anciens personnels formés prêts
à collaborer et à diffuser leurs savoir-faire dans ce
domaine.
retour sommaire
- FD X 50-550 : Démarche
qualité en recherche - Principes généraux et
recommandations [137] (figure 39)
- FD X 50-551 : Qualité en
recherche - Recommandations pour l'organisation et la
réalisation d'une activité de recherche en mode projet
notamment dans le cadre d'un réseau [131] (figure 40)
- GA X 50-552 : Systèmes
de management de la qualité - Guide d'application de l'ISO 9001
dans des organismes de recherch
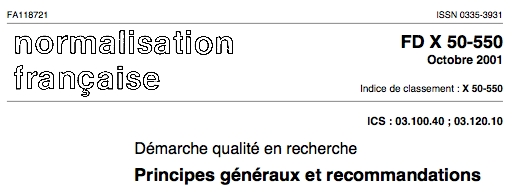
Figure 39 : En-tête du document FD X 50-550 |
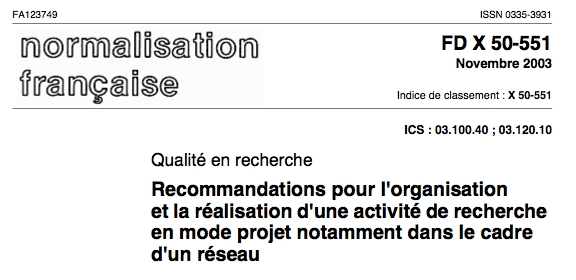
Figure 40 : En-tête du document FD X 50-551 |
L’expérience acquise en normalisation « santé
» et « recherche » se continue en 2009 par une
participation à la Commission de Normalisation «
Qualité en Expertise » dont les travaux visent à
améliorer la confiance dans les expertises en accompagnant la
norme existante, NF X 50-110 « Qualité en expertise –
Prescriptions générales de compétences pour une
expertise » (mai 2003, Ed Afnor), de recommandations approfondies
sur trois aspects :
- conception et réalisation d’une expertise
- expertise de projet
- source et valeur des données d’entrée
retour sommaire
III-2-1-1 Lien
Qualité-Technologie :
Le lien Qualité-Technologie (biomédicale)
s’associe aux
deux précédents de manière cohérente vis
à vis de l’objectif principal en recherche prénormative
sur l’amélioration des usages des technologies
biomédicales. Les principaux résultats prouvant la
maîtrise des capacités requises sont :
- La
contribution à 6 documents normatifs
dans le cadre de deux Commissions de Normalisation :
- Commission « Maintenance
des dispositifs médicaux » : XP X 99-170
[139] NS S 99-171 [138] NF
S 99-172 [133]
- Commissionn « Management de la qualité
en santé » : FD S 99-130
[135] FD S 99-133 [136] FD
S 99-134 [132]
- L’animation du projet (sur 2 ans) et la
rédaction du 1er Guide des Bonnes Pratiques
Biomédicales
en Etablissement de Santé (figure 41), édité
collectivement par les associations professionnelles
biomédicales hospitalières françaises en 2002 (Ed
Elsevier, ITBM RBM News) avec 48 co-auteurs [134]. Le Guide est
téléchargeable librement sur internet après accord
avec l’éditeur et les auteurs [172].
- Une grille d’auto-diagnostic
sur le Guide a
été réalisée sous ma direction et mise
à disposition librement auprès des professionnels [41].
Des benchmarks périodiques permettent aux responsables de
services biomédicaux de situer leur niveau de qualité par
rapport aux moyennes nationales de leurs pairs [172].
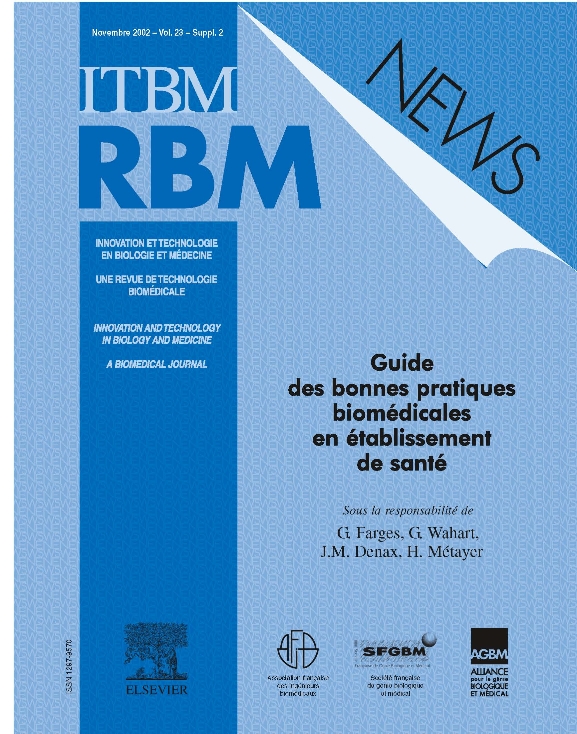
Figure 41 : Guide des Bonnes Pratiques Biomédicales
en Etablissement de Santé
La reconnaissance
acquise et l’accès permanent au réseau des professionnels
biomédicaux hospitaliers français et internationaux sont
des clefs de succès pour le développement futur d’une
recherche prénormative en instrumentation biomédicale. Le succès
du Guide auprès de la profession
biomédicale hospitalière est mesurable depuis son
édition en 2002 jusqu'à fin 2008 :
- 20 articles dans des revues
nationales : [13, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37,
39, 40, 41, 42, 44, 45]
- 8 communications dans des congrès nationaux
« sans actes » : [116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123]
L’attente
implicite et légitime de «
sécurité » dans l’usage des technologies
biomédicales, en site hospitalier, et de plus en plus dans
l’avenir à domicile, fait qu’un organisme comme le Laboratoire
National d’Essais (LNE) s’intéresse de près au
Guide (3ème séminaire en 2008 [180]) et pourrait être éventuellement
associé à
des recherches prénormatives communes sur le sujet (figure 42).
Il est à noter
que l'élaboration de "bonnes pratiques
biomédicales" est en phase avec l'évolution de la
normalisation projetée par le Ministère Français
de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi ainsi qu'avec l'approche
normative européenne préconisant une action ouverte,
consensuelle et menée en réseau.
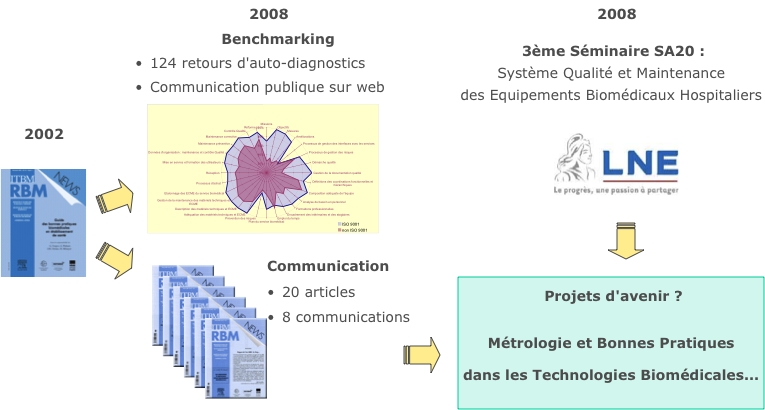
Figure 42 : L’expérience acquise avec le Guide et les compétences
du LNE
pourrait donner lieu à un projet de recherche prénormative
biomédicale
retour sommaire
III-2-2 Propositions de
projets qualité et prénormatifs
en recherche biomédicale à l’UTC
Une fois positionnés
les concepts clefs et nouveaux de la recherche prénormative biomédicale,
et les atouts permettant d’espérer un succès dans cette
voie, il est possible de décliner diverses propositions de projets
concrets pouvant être menés à l’UTC dans mon
domaine de compétence.
En préalable, il est important de considérer
que la recherche prénormative ne peut s’épanouir que
dans un environnement où la qualité scientifique et
métrologique est assurée. Elle vise en effet à
contribuer à l’émergence de consensus qui seront d’autant
plus faciles à atteindre s’ils se basent sur des faits
scientifiquement mesurés et garantis.
C’est pourquoi, deux étapes
sont indispensables avant
de décliner toute ambition en recherche prénormative (figure
43) :
- prouver une réalisation des recherches
selon les meilleurs standards qualité de la profession.
- prouver la
maîtrise des facteurs d’influence
et des incertitudes associées aux résultats
publiés.
Ces deux préalables
font l’objet des premiers projets d’action
proposés à la mise en œuvre au sein de l’UMR CNRS 6600
« BioMécanique et BioIngénierie ».
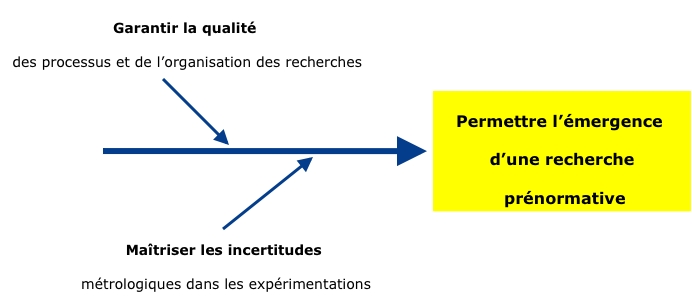
Figure 43 : Facteurs permettant l’émergence d’une
recherche prénormative
retour sommaire
1. Projet Qualité-Recherche de l’UMR
6600 :
Les grandes lignes du projet peuvent se décliner de
manière visuelle selon un diagramme des décisions :
celui-ci vise à communiquer facilement auprès des acteurs
concernés et présente en un coup d’œil les objectifs
du projet avec leurs mesures de succès envisagées, les plans
d’action majeurs à mettre en œuvre, les principaux risques
identifiés avec pour chacun d’entre-eux les différentes
alternatives envisageables associées à un choix
préférentiel d’application si cela s’avère
nécessaire (figure 44).
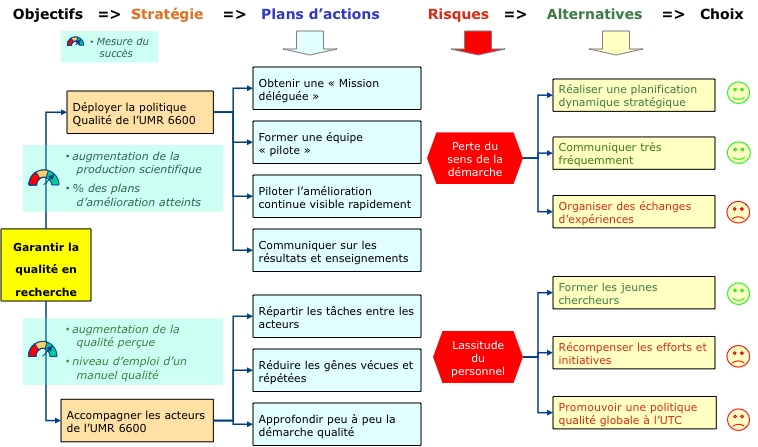
Figure 44 : Déclinaison des objectifs mesurables, plans
d’action, risques et alternatives
pour le projet « Qualité-Recherche
au sein de l’UMR 6600 »
Objectifs :
- Aider la nouvelle Direction à
déployer sa politique qualité affichée lors de
sa prise de fonction.
- Accompagner les acteurs à tous les niveaux
dans la mise en place opérationnelle des processus
améliorés.
Méthodologie prévue :
- Obtenir une mission déléguée
explicite de la Direction de l’UMR 6600 sur l’action «
démarche qualité ».
- Organiser la répartition des
tâches
à réaliser pour développer le système
qualité, en estimant la ressource humaine nécessaire
à un équivalent temps-plein de 30%.
- Former une équipe « pilote »
interne aux concepts, méthodes et outils qualité
(exploitation des acquis capitalisés depuis 2004 sur les actions
de formation CNRS Qualité en Recherche).
- Identifier les freins, gênes, obstacles ou
inhibiteurs concrets et répétés dans les
activités quotidiennes qui pourraient très rapidement
être minimisés afin de dégager du temps disponible
pour la créativité scientifique et l’amorce d’autres
plans de gains sur les processus scientifiques en cours.
- Piloter une dynamique
continue d’améliorations pragmatiques et concrètes dans
les pratiques quotidiennes qui se cumuleront pour des
bénéfices visibles et perçus par les chercheurs.
- Approfondir
peu à peu la démarche sur
des projets plus conséquents avec l’aide d’étudiants
en Master Management de la Qualité, sur des processus structurants
(cartographie de l’activité de recherche, accueil
optimisé des nouveaux entrants, exploitation du cahier de
laboratoire, adéquation
activités-compétences-poste, traçabilité
des activités, capitalisation et sauvegarde des données
etc…).
- Communiquer périodiquement sur les
résultats atteints et les enseignements pouvant être
tirés afin d’avoir un progrès partageable et
partagé.
Mesures possibles du succès :
- % des plans d’amélioration
atteints versus ceux prévus.
- augmentation de la qualité perçue
par le personnel de son environnement et de ses conditions de travail.
- augmentation
de la production scientifique par chercheur.
- existence et emploi d’un manuel qualité sur
les plateformes et bancs expérimentaux (en lien avec le Label
Carnot).
retour sommaire
Risques et alternatives sur ce projet
-
Risque 1 : Perte
de sens de la démarche : les acteurs oublient ou ne voient pas ce
que la démarche qualité peut leur apporter
- Alternative 1 : réaliser une planification
dynamique stratégique validée par l’UMR 6600 (mission,
vision, stratégie, objectifs, plans d’action..) et l’afficher
en plusieurs endroits physiques (salles de détentes et couloirs de
passages fréquents via des posters A0) et numériques
(site web de l’UMR, wiki, site UTC…).
- Alternative 2 : communiquer
rapidement sur les gains concrets obtenus par les acteurs volontaires
pour eux-mêmes, réaliser un document « success story
» et le diffuser via l’extranet de l’UMR.
- Alternative 3
: organiser des échanges
d’expériences avec des laboratoires extérieurs afin
d’enrichir les points de vue, d’exciter les curiosités
et de rehausser les motivations internes.
-
Risque 2 : Lassitude
organisationnelle : les acteurs voient les apports mais n’envisagent
pas de mettre en œuvre les évolutions dans leurs pratiques.
- Alternative
1 : identifier une «
récompense » interne permettant d’augmenter
l’attractivité au changement (subvention UMR augmentée,
frais de fonctionnement pris en charge, bourse complémentaire
pour les doctorants…).
- Alternative 2 : former les jeunes chercheurs
et doctorants aux démarches et outils qualité afin de
compenser les lassitudes détectées chez les acteurs
de leur entourage.
- Alternative 3 : promouvoir auprès de la
Direction à la Recherche et de l’UTC une politique
d’établissement afin de bien montrer l’implication
globale de tous les acteurs sur une démarche qualité et favoriser
ainsi un effet d’entraînement collectif.
retour sommaire
2. Projet « Plateforme en Métrologie
Biomédicale » :
Le diagramme des décisions de ce projet
est un peu plus
étoffé que le précédent au niveau des
risques identifés et des alternatives envisagées (figure
45). Cette proposition se doit bien sûr d’être comprise,
amendée et validée par les différents chercheurs
et ingénieurs qui seront contributeurs à la
démarche de maîtrise des incertitudes
expérimentales.
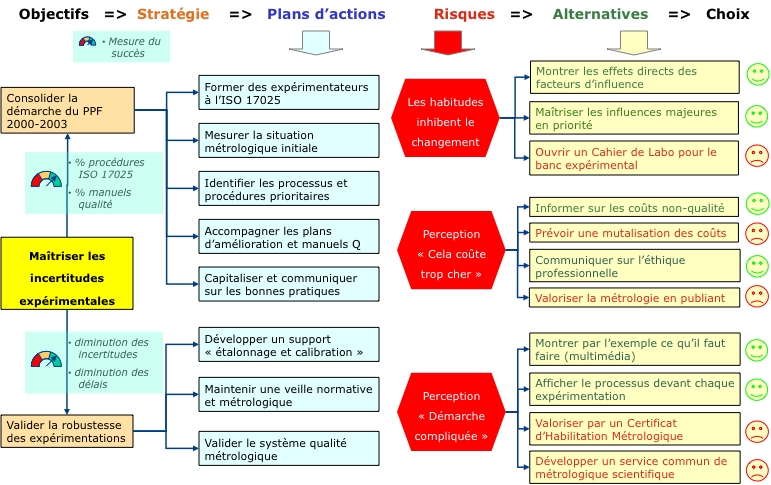
Figure 45 : Déclinaison des objectifs mesurables, plans
d’action, risques et alternatives
pour le projet « Plateforme en
Métrologie Biomédicale »
Objectifs :
- Consolider et diffuser la démarche
d’amélioration continue des pratiques scientifiques
débutée lors du contrat quadriennal 2000-2003 (PPF
Qualité-Recherche).
- Valider la robustesse des expérimentations
mises en œuvre au sein de l’UMR 6600 Biomécanique et
Bioingénierie
Méthodologie prévue :
- Former des expérimentateurs volontaires
aux principes de la maîtrise métrologique et au respect des
exigences de l’ISO 17025.
- Mesurer la situation initiale quant au niveau
de robustesse métrologique sur les expérimentations
montées.
- Identifier les processus et procédures
pertinentes à suivre pour améliorer cette robustesse.
- Accompagner
la mise en œuvre des plans d’action et
la maîtrise des facteurs d’influence sur les mesures
réalisées.
- Valider le système de qualité et de
traçabilité dans la chaine de mesure associée aux
expérimentations.
- Développer un support technique à la
calibration ou à l’étalonnage des appareils de mesure
avec l’aide du service électronique de l’UTC (étalons,
procédures normalisées, laboratoires
agréés, suivis des dispositifs de contrôle…).
- Maintenir
une veille normative sur la métrologie applicable dans le secteur
scientifique biomédical, éditer et communiquer des synthèses
utiles.
- Capitaliser et communiquer sur les bonnes pratiques
probantes en expérimentation afin d’en diffuser l’usage.
Mesures
possibles du succès :
- % des procédures respectées de
maîtrise métrologique ISO 17025 (chapitre 5) pour chaque
nouvelle expérimentation.
- diminution de l’incertitude dans les
mesures réalisées.
- diminution du délai pour obtenir une
série de résultats expérimentaux
maîtrisés.
- % de manuels qualité mis en œuvre dans
les expérimentations.
retour sommaire
Risques et alternatives sur ce projet :
- Risque 1 : Complexité
apparente de la démarche : les acteurs trouvent que c’est
« usine à gaz » par rapport à leurs besoins
et leurs habitudes.
- Alternative 1 : agir directement
sur les principaux facteurs d’influence dans l’expérimentation
concernée afin de montrer par « les faits » les
écarts sur les résultats mesurés.
- Alternative 2 : insister
sur la maîtrise des risques ou facteurs d’influence majeurs et
laisser de coté ceux qui sont secondaires.
- Alternative 3 : ouvrir
un cahier de laboratoire spécifique au banc expérimental
afin de partager les informations avec les autres chercheurs et
rehausser ainsi la perception du besoin de rigueur.
- Risque 2 : Perception
financière négative : « Tout cela coûte trop
cher par rapport au budget de ma recherche…».
- Alternative 1 : prévoir
une mutualisation budgétaire au sein de l’UMR, de la Direction
à la Recherche (Bonus Qualité Recherche), de l’UTC ou
de UTeam Groupe UTC (Label Carnot) et communiquer aussi sur le coût
de la non-qualité…
- Alternative 2 : communiquer sur l’éthique
professionnelle inhérente au secteur biomédical qui
incite à pouvoir prouver en permanence la rigueur scientifique
d’obtention des résultats, base de la notoriété
des publications.
- Alternative 3 : valoriser les
actions de maîtrise métrologique en publiant dans
des revues scientifiques (notes techniques) et en communiquant
publiquement sur internet.
- Risque 3 : « C’est bien,
mais un peu trop compliqué à mettre en œuvre…»
- Alternative 1 : montrer par
l’exemple les actions pratiques à réaliser,
développer des modules multi-média sur les
activités génériques en métrologie et les
mettre à disposition sur un serveur web accessible (service TICE
de l’UTC).
- Alternative 2 : afficher un
macro-processus simple devant chaque banc expérimental avec
renvois aux ressources disponibles pour plus de détails
(ex : 1, 2, 3 mesure !...).
- Alternative 3 : développer
un « certificat d’habilitation métrologique » pour
valoriser les acteurs ayant fait l’effort d’acquérir les
compétences requises.
- Alternative 4 : développer
un service de sous-traitance métrologique garantissant la
conformité pour l’usage des dispositifs génériques
de mesures (service électronique de l’UTC)
retour sommaire
3. Projet « Recherche Prénormative
Biomédicale » :
Avec le succès et la pérennisation
des projets précédents, les activités de recherche
prénormative vont émerger d’un environnement scientifique
où les meilleurs standards professionnels sont appliqués
et où les incertitudes associées aux résultats
publiés sont maîtrisées.
Le « terreau d’émergence » n’a
pas d’autres
caractéristiques à satisfaire puisque qu’une recherche
universitaire devient « prénormative » en fonction
de l’impact sociétal de ses résultats. Il n’est pas
toujours possible de travailler sur des secteurs scientifiques
où les implications sociétales des résultats son
identifiables a priori.
Dans ce cas, seule l’analyse a posteriori
permettra d’identifier les conclusions d’une étude comme
potentiellement « prénormatives ». La robustesse de
l’environnement scientifique d’émergence sera alors un
critère majeur pour valoriser ces nouvelles connaissances via un
processus de normalisation.
De mon expérience professionnelle, je peux
identifier deux typologies distinctes en recherche prénormative :
Recherche
prénormative « instrumentale
» :
C’est celle qui porte sur des objets matériels
et concrets comme les capteurs, instruments, dispositifs, simulateurs ou
équipements biomédicaux. Des exemples sont à
l’état latent via les travaux de recherche
présentés précédemment et peuvent servir de
sources possibles pour lancer l’activité :
- développer, valider et diffuser des
méthodes efficaces d’analyses des risques du système
« homme-technologie biomédicale »,
- identifier, valider
et communiquer des références architecturales dans la conception
des services médicaux hospitaliers (par exemple :
réanimation néo-natale ou pédiatrie, avec
les retours d'expérience déjà acquis sur
l'environnement acoustique),
- concevoir, valider et veiller en continu aux
outils, méthodes et pratiques professionnelles de contrôle
qualité et sécurité associés à
l’exploitation des dispositifs médicaux : les « bonnes
pratiques d’efficience biomédicale», à
l’hôpital ou à domicile,
- contribuer à l’évolution
et à
l’internationalisation du Guide des Bonnes Pratiques
Biomédicales en Etablissement de Santé, en exploitant les
nouvelles technologies coopératives d'internet (web2),
- développer, tracer et capitaliser sur les
nouveaux travaux scientifiques afin de favoriser ultérieurement
l’émergence et le développement "naturel" de la recherche
prénormative.
retour sommaire
Quel que soit le secteur de déploiement, le projet «
recherche prénormative biomédicale » peut se
décliner des objectifs mesurables aux plans d’action, en passant
par l’identification des risques et l’anticipation
d’alternatives, de la même façon que les
précédents (figure 46).
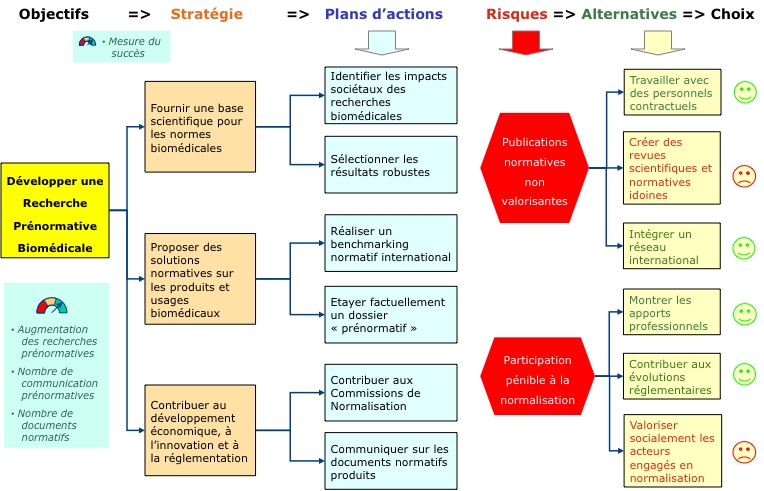
Figure 46 : Déclinaison des objectifs mesurables, plans
d’action, risques et alternatives
pour le projet « Recherche Prénormative
Biomédicale »
Objectifs :
- fournir une base scientifique pour
l'élaboration de recommandations, prescriptions et normes en
Santé,
- proposer des solutions consensuelles aux
problèmes techniques et aux usages concernant les produits,
biens ou services en Santé,
- contribuer au développement
économique, à l’innovation et au support éventuel
de la réglementation.
Méthodologie prévue :
- réaliser ou identifier des recherches
dans des secteurs aux impacts sociétaux a priori importants (usage
commun de dispositifs, technologies ou méthodes en santé)
- sélectionner les résultats qui
présentent toutes les garanties de robustesse et
crédibilité dans leur obtention
- réaliser un benchmarking scientifique et
normatif national, européen et mondial sur le sujet
- étayer le dossier « prénormatif
» par les éléments factuels disponibles et
solliciter l’avis des organismes de normalisation français et
européen, ou des autorités nationales ou
européennes
- contribuer aux commissions de normalisation
nationales ou européennes adéquates sur le sujet
- valider et
diffuser largement les nouveaux documents normatifs produits, contribuant
ainsi aux objectifs de la normalisation vis à vis de l’innovation
et du développement économique.
Mesures possibles de succès
:
- augmentation du nombre de résultats de
recherche pouvant être considérés comme «
prénormatifs »
- nombre de documents produits, communiqués
et potentiellement prénormatifs
- nombre de documents normatifs produits
avec une contribution de l’UMR 6600
retour sommaire
Risques et alternatives sur ce projet :
- Risque 1 : les publications «
prénormatives » ou « normatives » ne sont pas
valorisantes professionnellement
- Alternative 1 : travailler
avec des personnels contractuels dont le référentiel
métier est plus librement valorisable sur ces contributions. Ce
point pourrait être favorisé par la loi sur l'autonomie
de tous établissements d'enseignement supérieur
français en 2010.
- Alternative 2 : identifier
ou créer des revues idoines pour le secteur «
prénormatif » avec le soutien de scientifiques reconnus,
des autorités nationales et des services de la Commission
Européenne ou du Comité Européen de Normalisation.
- Alternative
3 : intégrer un réseau
d’échanges en recherche et normalisation afin
d’internationaliser l’action et prouver son impact
sur le plus grand nombre.
- Risque 2 : la participation aux
processus de normalisation est longue, pénible, coûteuse
et fait perdre du temps…
- Alternative 1 : dire
la réalité des vécus afin d’anticiper
de futures frustrations. Montrer les apports concrets dans les
bénéfices professionnels associés aux
échanges entre experts qui se retrouvent périodiquement
autour d’un sujet important socialement.
Exploiter les arguments explicités dans le guide européen
"Exploiting Research Through Standardization" : avantage
compétitif (pour les développements industriels futurs),
reconnaissance internationale, compatibilité avec les directives
européennes, mise en valeur de la qualité et de la
notoriété. (source : http://www.cen.eu/cenorm/workarea/advisory+bodies/star+(standardization+and+research)/bpg.pdf,
page consultée en janvier 2009)
- Alternative 2 : contribuer
aux
évolutions des décrets et lois sur la normalisation en
cours. Insister pour que les secteurs d’intérêt
général (éducation, recherche, santé)
soient dispensés de contribuer aux frais de fonctionnement et
d’élaboration des normes (contrairement au secteur marchand,
la recherche publique n'a pas de clients finaux pour contribuer à
ces financements. A ma connaissance, le projet d'avril 2008 sur la
nouvelle loi concernant la normalisation intègre cette
proposition à laquelle j'ai contribué en février
2008...).
- Alternative 3 : valoriser en terme de
reconnaissance sociale les acteurs internes qui contribuent à la
recherche prénormative (chapitre spécifique dans le
rapport d’activité de l’UMR, communication extensive
via l’UTC).
retour sommaire
Conclusion
La recherche prénormative est une
activité scientifique
soutenue par les instances européennes et relayée
principalement par le Comité Européen de Normalisation
(CEN) via son programme Standardization and Research (STAR,
créé en 1992). Ce dernier différencie la recherche
prénormative (nouvelle connaissance pouvant donner lieu à
une norme) et la recherche conormative (nouvelle connaissance
recherchée et produite suite à un besoin normatif).
Depuis les
années 1980, une recherche prénormative
européenne est initiée afin de favoriser le
développement économique entre les pays européens,
les échanges de produits et services et la
sécurité d'usage pour les citoyens. Le programme VAMAS
sur les matériaux avancés et de référence
est un bon exemple de ce qui est recherché : une
problématique scientifique, un réseau international, des
applications industrielles, des enjeux sociétaux...
La culture "norme" n'est
pas encore naturelle chez les scientifiques
œuvrant dans les universités ou établissements
d'enseignement supérieur. Le taux d'universitaires
français présents dans les Commissions de Normalisation
est très faible si j'en crois mon expérience de 10 ans au
sein de trois Commissions.
L'intérêt normatif est un peu plus développé
dans les établissements publics à caractère
scientifique et technologique (EPST), comme par exemple le Centre
national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des
forêts (Cemagref), l'Institut de Recherche et
Développement (IRD) ou ceux à caractère industriel
et commercial (EPIC) comme l'Institut Français de Recherche pour
l'Exploitation de la Mer (Ifremer).
La culture normative est bien développée dans les agences
qui ont des missions de sécurité et de veille comme par
exemple l'Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Aliments (Afssa) ou l'Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (Afssaps)
qui attribuent des fonctions explicites pour cela à certains de
leurs personnels.
Ce constat indique que la perception des scientifiques universitaires
est généralement d'associer les normes à des
objectifs de sécurité, de réglementation, de
protection ou de lobbying. Très souvent les mots "normes" et
"réglements" sont accouplés pour dresser l'état
d'une situation. Dès lors, il en faut peu pour que l'ignorance
sur les apports normatifs dans notre société humaine
éloigne pour longtemps la créativité universitaire
à œuvrer dans ce domaine.
Pourtant la situation évolue très
rapidement et devrait amener de plus en plus de scientifiques et universitaires
à s'investir dans des activités de recherche
intégrée, allant de la connaissance produite à
celle de son usage par les citoyens :
- la dynamique européenne impose
l'intégration rapide de nombreux pays aux cultures et
savoir-faire différents. La capacité d'échanger
ensemble des produits, des méthodes ou des pratiques passe par
une explicitation ouverte et consensuelle via un média neutre et
crédible : la norme européenne ou internationale.
- les recherches
financées au niveau national
(Agence Nationale de la Recherche en France) ou européen
(Programme Cadre de Recherche et Développement) impliquent une
gestion par projet où les aspects qualité du management
et impacts sociétaux sont pris en compte.
- les nouvelles technologies
de l'information mettent les nouvelles connaissances à la portée
du grand public très rapidement et favorisent ainsi les interrogations
légitimes sur les conséquences des résultats des
recherches dans la société.
- le scientifique est implicitement
vu comme un expert pour certains problèmes de notre société et
doit soit rechercher, soit fournir des réponses de confiance,
sûres et applicables. Des normes de qualité en
expertise (NF X 50-110), des réseaux (Echiquier, QeR, Quares...)
et des soutiens (CEN/Star) sont disponibles pour permettre le
développement de ce point
retour sommaire
Sur le secteur biomédical, la recherche
prénormative est
portée par la même dynamique. Les développements
futurs les plus importants peuvent être attendus sur
l'interaction entre les nanotechnologies et le vivant. Les dispositifs
médicaux représentent un champ d'investigation
scientifique prénormative autant sur leur conception que sur
leur exploitation en établissement de santé ou à
domicile.
L'impact économique moyen en France varie de 1 à 40 entre
le coût d'achat d'un dispositif médical et la
dépense totale associée à son usage. Il semble
donc tout autant pertinent de développer des connaissances
normatives sur les modes d'usage des dispositifs médicaux
(contrôles, méthodes, bonnes pratiques...) que sur leur
conception (sécurité, signalétique,
compatibilité...).
L'action de recherche prénormative ne peut se développer
en absence d'environnement scientifique sûr et
maîtrisé. La crédibilité des équipes
et des acteurs à la source des travaux de recherche est une
condition préalable nécessaire. C'est pourquoi, j'ai
proposé de démarrer au sein de l'UMR 6600
"BioMécanique et BioIngénierie" deux plans d'action
préliminaires : l'un pour "Garantir la qualité en
recherche" et l'autre pour "Maîtriser les incertitudes
expérimentales".
Ces initiatives, qui peuvent être menées sur deux ans,
serviront tous les acteurs de l'UMR 6600 qui
bénéficieront directement de l'amélioration de
leurs processus. L'excellence scientifique déjà acquise
pourra alors être consolidée et associée à
une qualité démontrée, autant dans le management
que dans les pratiques quotidiennes.
L'activité de recherche prénormative biomédicale pourra
alors se déployer plus naturellement dans un
environnement compatible. Ma démarche et mes résultats en
recherche font apparaître la cohérence de mon parcours
avec cette future activité :
- au départ, une activité assez
classique en génie biomédical, dans la conception de
capteurs et d'instrumentations médicales,
- en permanence, une implication
dans les aspects pluridisciplinaires, normatifs et sociétaux de
ce champ scientifique,
- pour l’avenir, des idées de recherches
prénormatives originales appliquées au secteur
biomédical, dans les domaines instrumental et organisationnel.
L'Université de
Technologie de Compiègne est un
environnement adéquat pour une telle recherche
prénormative, avec une notoriété
déjà affirmée et reconnue dans le domaine de
l'enseignement supérieur en qualité et normalisation
(Master Management de la Qualité et Mastère
Spécialisé Normalisation, Qualité, Certification,
Essais). Il lui faut maintenant consolider cette bonne image
"enseignement supérieur" avec celle d'une recherche reconnue sur
une thématique "qualité" (recommandation AERES 2008).
Les expériences
passées démontrent la
difficulté à obtenir une reconnaissance scientifique
quand la "qualité" est mise comme seul focus d'une recherche.
L'enseignement que j'en tire est que la "qualité" n'est pas
un objet scientifique mais un outil au service des nouvelles
connaissances, elles-mêmes générées
au profit de l'Homme.
C'est pourquoi il me semble crucial de faire porter tout
effort de recherche sur la production d'une nouvelle connaissance, acquise
après mesure fiable et maîtrisée, que ce soit dans
le domaine matériel des dispositifs médicaux ou
immatériel de l'organisation des soins et de la confiance dans
la technologie médicale.
La recherche prénormative, voire
conormative, semble donc une voie scientifique à
privilégier pour le lien qu'elle crée entre connaissance,
qualité et société (figure 47).
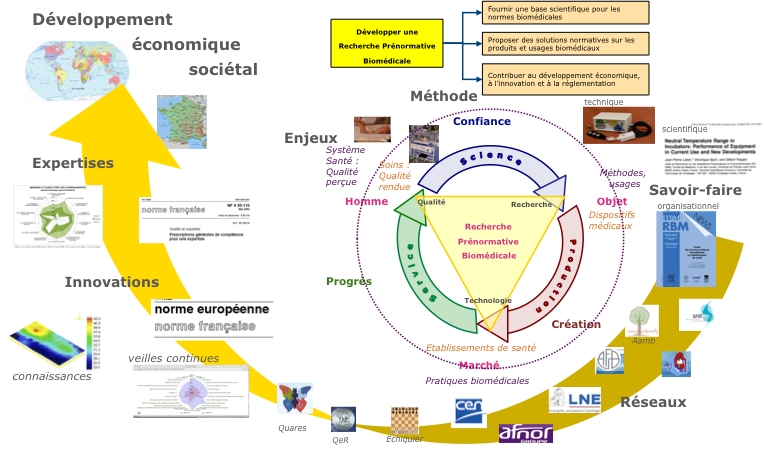
Figure 47 : Eléments fondamentaux et effets induits de la « Recherche
Prénormative Biomédicale »
retour sommaire
L'intérêt
de la Direction de l'UMR 6600 pour les démarches qualité et
l'implication sociétale des
recherches actuelles induisent une opportunité réelle
d'émergence pour une recherche prénormative. Grâce
à ces conditions professionnelles assez nouvelles, je suis
motivé pour porter et construire progressivement cette
thématique originale en accompagnant des doctorants dans des
parcours productifs en nouvelles connaissances et épanouissants
intellectuellement et socialement.
Pour cela, il faut à la fois maîtriser
les processus associés à une recherche
créative de
qualité, mais aussi transmettre un enthousiasme pour
cheminer dans des voies encore inexplorées.
Chaque personnalité scientifique
se positionne en fonction de son tempérament, de sa culture
et de ses attraits intellectuels. L’essentiel est de créer de
l’adhésion
à un projet s’inscrivant dans une vision
d’évolution
dynamique de l’action et dans une projection sur les impacts
sociétaux possibles et les reconnaissances attendues.
Je remercie mes
pairs de participer par leurs conseils et recommandations au succès
de ce projet scientifique qui pourrait compléter les thématiques
de recherche de l’UMR 6600
« BioMécanique et BioIngénierie » et
contribuer au rayonnement de l’Université de Technologie de
Compiègne, dont je suis un « produit scientifique »
à part entière.
Je laisse le mot de la fin au philosophe pour
expliciter l’état
d’esprit qui peut guider au succès :
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous
n’osons pas,
c’est parce que nous n’osons pas qu’elles
sont difficiles »
Sénèque (vers 4-65 ap JC)
retour sommaire
Annexe bibliographique - Liste des publications
et travaux au 27 mai 2009
Publications « Revues Internationales » :
- 1. ECG
sensor for obese and hairy patient based on Cardio-Modulo-Respiratory Method,
M.O. Diab, G. Farges, Systemics, Cybernetics and Informatics, Vol 8, pp
: 7-12, July 2008.
- 2. Humidity control tool for neonatal incubator.
M. Abdiche, G. Farges, S. Delanaud, V. Bach, P. Villon and JP. Libert,
Med. Biol. Eng. Comput., March 1998, pp 241-245
- 3. Dynamic
Programming Approach for Newborn's Incubator Humidity Control. D. Bouattoura,
P. Villon, G. Farges, IEEE Trans. Biom. Eng., January 1998, Volume 45,
Number 01, pp 48-55
- 4. Neutral Temperature range in Incubators
: Performance of equipments in current use and new developments. J.P.
Libert, V. Bach, G. Farges, Critical Reviews in Biomedical Engineering,
Vol. 25 (4&5), 287-370, 1997
- 5. Lactantes con riesgo
de Muerte Subita. Conducta a seguir. Utilizacion de la Monitorizacion Domiciliaria.
A. De Broca, ML. Bernard, N Kalach, C. Devoldere, O. Mouterde, G. Farges,
L. Cevallos, Anales Espanoles de Pediatria, Oct 1993, Extra. 55, Vol 39,
pp 19-28
retour sommaire
Publications « Revues Nationales » :
- 6. Amélioration
des pratiques en expertise : un outil d'autodiagnostic basé sur la
norme NF X 50-110, G. Farges, JP Caliste, R. Carrillo, L. Dormard, A. Gobin,
K. Montero, Revue Experts, 2009, n° 83, pp 39 à 41
- 7. Proposition
d'une nouvelle structure pour le Guide des Bonnes Pratiques Biomédicales
version 2010, F. Midenet, JM Rabier, O. Boni, G. Farges, IRBM News, 2009,
Vol. 30, n° 1, pp 3-6
- 8. Enseignements 2003-2008 et
projet v2010 du Guide des Bonnes Pratiques Biomédicales en Etablissement
de Santé, G. Farges, IRBM News, 2008, Vol. 29, n° 6, pp 3-9
- 9. Mise à disposition
de dispositifs médicaux à domicile : Mise en œuvre des
engagements de service de la norme NF X 50-796. Fascicule de documentation
FD X 50-707, M. Delorme (Pdte Commission Normalisation), G. Farges & 25
membres, Ed Afnor, octobre 2008
- 10. Réflexions sur
une nouvelle structure du Guide des Bonnes Pratiques Biomédicales,
L. Bedos, R. Junqua, JC. Roudet, G. Farges, IRBM News, 2008, Vol. 29, n° 5,
pp 3-6
- 11. Mise à disposition de dispositifs
médicaux à domicile : Engagements de service. Norme
française homologuée NF X 50-796, M. Delorme (Pdte
Commission Normalisation), G. Farges & 25 membres, Ed Afnor,
septembre 2008
- 12. La sécurité électrique
dans les établissements de santé : impact de la norme NF C
15-211, Y. Assier, H. Chtiha, F. Cardinale, Koné Aboulay, G.
Farges, D. Abdelaziz, IRBM News, 2008 Vol. 29, n° 3-4, pp 3-7
- 13. Comment
améliorer la confiance dans
l'autodiagnostic associé au Guide des Bonnes Pratiques
Biomédicales ? V. Arfib, C. Driard, F. Hanoomie, M. Plantevin,
G. Farges, IRBM News, 2008, Vol. 29, n° 2, pp 8-10
- 14. Dynamique
de progrès et Guide de Bonne
Exécution des Analyses de Laboratoire. LF Plassa, S. Saez, G.
Farges, Ed Elsevier, IRBM News, 2008, Vol. 29, n° 1, pp 9-12
- 15. Qualité au
sein des Services biomédicaux : Proposition d’un tableau de
bord dynamique de progrès. M. Sarracanie, G. Rouffy, G. Farges, Ed
Elsevier, IRBM News, 2008, Vol. 29, n° 1, pp 5-7
- 16. A
French University : Encouraging hads-on experience, JP Caliste, G. Farges,
ISO Forum, 2007, novembre, pp 13-14
- 17. Optimisation du
choix des référentiels de qualité et de maintenance,
S. Ben Maiz, L. Egarnes, C. Neyret, G. Farges, Ed Elsevier, IRBM News, 2007
Vol. 28, n° 5-6, pp 11-14
- 18. Processus et Qualité pour
le Contrôle des Dispositifs Médicaux, N. Domingé, Y.
Janson, N. Maurel, G. Farges, Ed Elsevier, IRBM News, 2007, Vol. 28,
n° 5-6, pp 15-18
- 19. Contribution aux Bonnes Pratiques
en Recherche Biomédicale : acteurs et processus de publication. G.
Farges, H. Brockaert, TT Dao, O. Goundiam, , Ed Elsevier, IRBM News, 2007,
Vol. 28, n° 4, pp 1-6
- 20. Guide des Bonnes Pratiques
Biomédicales :
évolutions 2004-2007 et perspectives d’une version 2, G. Farges,
Ed Elsevier, IRBM News, 2007, Vol. 28, n° 4, pp 7-12
- 21. Les
services techniques hospitaliers : Quels référentiels métiers
utiliser ? Ph Cozic, M. Deslandes, M. Douik, G. Farges, A. Jaborska, Ed Elsevier,
IRBM News, 2007, Vol. 28, n° 4, pp 13-15
- 22. « Guichet
Unique » sur le Guide des
Bonnes Pratiques Biomédicales : un projet inter-associatif, G.
Farges, Ed Elsevier, IRBM News,. 2007, Vol. 28, n° 3, pp 9-13
- 23. Proposition
d’une nouvelle bonne pratique
relative à l’encadrement et l’accueil d’un stagiaire.
G. Batan, M. Dossou, M. Dupin, J. Gonzalez, G. Farges, Ed Elsevier-Masson,
IRBM News, 2007, Vol. 28, n° 1-2, pp 7-11
- 24. Intérêts
d’une certification ISO
9001 version 2000 des services biomédicaux. M. Eraud, B. Dadi
Saãd, M. Lahcen, S. Guy, G. Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News,
2007, Vol. 27, n° 5-6, pp 3-5
- 25. Criticité et
pertinence du contrôle
qualité en hémodialyse, S. Chehade, A. Kartoubi, S.
Rousselin, C. Veraldo, G. Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2006,
Vol. 27, n° 4, pp 21-24
- 26. Prolonger la durée
de vie des dispositifs médicaux : premières réflexions
et propositions, M. Degrain, M. Malacrino, A. Dabi, A. Bellaoui, G. Farges,
Ed Elsevier, ITBM-RBM News 2006, Vol. 27, n° 6, pp 13-16
- 27. Le
projet d’amendement de la Directive 93/42/CEE
et son impact sur le marquage CE, N. Hannouch, M. Fawzi, D. Boyer, G.
Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2006, Vol. 27, n° 3, pp 10-12
- 28. Intérêts
d’avoir une personne
compétente en radioprotection au sein du service
biomédical, J. Bouvier, S. Hautdidier, A. Hyvert, M. Laborde, G.
Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2006, Vol. 27, n° 2, pp 9-11
- 29. Proposition
d’une bonne pratique en
coopération internationale biomédicale, K. Megdiche, C.
Vivarelli. M. Sbaï, J. Koehler, G. Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM
News, 2005 Vol. 26, n° 6, pp 13-16
- 30. Management de
l’externalisation de la maintenance
biomédicale, D. Georgin, J. Natan, H. Szymczak, G. Farges, Ed
Elsevier, ITBM-RBM News, 2005 Vol. 26, n° 6, pp 7-11
- 31. Convergence
des référentiels
qualité et implications pour la fonction technique
biomédicale. B Achmirowicz, PY Delobel, Ch. Kichenassamy-Appou,
G. Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2005 Vol.
- 26, n° 5, pp 15-17
- 32. Proposition d’une « Bonne
Pratique Opérationnelle » : « Prévention des risques
pour le personnel au service biomédical », JB. Beck, D. Da
Silva, C. Desreumaux, G. Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2005 Vol.
26, n° 5, pp 11-14
- 33. La communication de la fonction
biomédicale : points-clef de succès, Adjedj, S. Hantzo,
V. Pauchard, E. Saillant, G. Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2005
Vol. 26 n° 3-4, pp 35-38
- 34. Guide des bonnes
pratiques biomédicales en
établissement de santé : retours d’expérience
2004, G. Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2005 Vol. 26 n° 3-4,
pp 31-34
- 35. Guide des bonnes pratiques biomédicales
en
établissement de santé : un outil qui atteint son
objectif ? Richard, A. Viollet, B. Hernandez, G. Farges, Ed Elsevier,
ITBM-RBM News, 2005 Vol. 26 n° 3-4 pp 28-30
- 36. Analyse
de pratiques biomédicales à
l’étranger : les prémices d’un réseau
biomédical hospitalier international ? P.D.
Château-Naulet, H. Viard, G. Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News,
2005, Vol. 26 n° 2, pp 22-24
- 37. Contribution
méthodologique aux bonnes
pratiques en contrôle qualité des ventilateurs artificiels
en usage hospitalier, Ch. Petit, A. Donadey, G. Farges, Th Gigout, Ed
Elsevier, ITBM-RBM, Janvier 2005, Vol. 26 n° 1, pp
110-116
- 38. Radioprotection et personne compétente
dans le service biomédical, V. Carrière, A. Graillot, G.
Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2004 Vol. 25 n° 5-6, pp
6-8
- 39. Proposition de « Bonne Pratique » :
Contrôle qualité interne en mammographie analogique de
dépistage systématique, S. Debeux, D. Ferron, G. Farges,
Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2004 Vol. 25 n° 4, pp 8-10
- 40. Validation
d'un service en "Bonnes Pratiques
Biomédicales" : les voies possibles, D. Battin, E.
Bérenger, G. Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2004 Vol.
25 n° 3
- 41. Contribution à la démarche
de validation en "Bonnes Pratiques Biomédicales" : la grille
d’évaluation, A. Guyard, L. Tamames, G. Farges, Ed Elsevier,
ITBM-RBM News, 2004, Vol. 25, n° 2
- 42. Premiers
retours d’expérience du "Guide
des Bonnes Pratiques Biomédicales en Etablissement de
Santé" G. Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2004, Vol.
25, n° 1, pp 5-9
- 43. L'accréditation ISO 17025
: une réponse au décret du 5 décembre 2001. Oui, mais...
A. Akin, N. Pin, G. Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2003, Vol. 24,
n° 4, pp 7-9
- 44. Outil de diagnostic pour le Guide des
Bonnes Pratiques Biomédicales en Etablissement de Santé, M.
Dhorne, Ph. Tappie, G. Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2003, Vol.
24, n° 2, pp 5-8
- 45. Naissance du "Guide des Bonnes
Pratiques Biomédicales en Etablissement de Santé", G. Farges,
Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2003, Vol. 24, n° 1, pp 5-9
- 46. Marquage
CE : application aux produits de la recherche biomédicale, S. Claris,
A. Dejean, G. Farges , S. Luu, M. Roche, Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2002,
Vol. 23, n° 6, pp 7-9
- 47. Maintenance et contrôle
qualité :
comment anticiper l'application du décret n° 2001-1154 ? E.
Peltier, F. Prodhomme, C. vedovini, G. Farges , JP Caliste, Ed
Elsevier, ITBM-RBM News, 2002, Vol. 23, n° 4, pp 7-9
- 48. Les
enjeux de l'externalisation des activités : Réflexions pour
le service biomédical,
L. Cecile, M. Contoux, K. Habbache, G. Farges , F. Thibault, Ed
Elsevier, ITBM-RBM News, 2002, Vol. 23, n° 3, pp 6-8
- 49. Les
services biomédicaux hospitaliers
certifiés ISO 9002 : Quelle évolution avec la version
2000 ? C. David, N. El Tannir , G. Farges , R. Gigleux , M. Iracane, Ed
Elsevier, ITBM-RBM News, 2002, Vol. 23, n° 2, pp 8-10
- 50. RSQM
: vers la maîtrise de la
traçabilité pour les dispositifs médicaux, F.
Thibault, G. Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2002, Vol. 23, n°
1, pp 6-8
- 51. Démarche de création d'une fonction
biomédicale répondant aux besoins de qualité et de
sûreté, A. Chakri, G. Farges, G. Germain, M.
Poujet-Sanchez, JF. Tellier, F. Thibault, Ed Elsevier, ITBM-RBM News,
2001, Vol. 22, n° 5, pp 6-8
- 52. Evaluation acoustique
des incubateurs pour nourrissons par rapport à la norme européenne
NF EN 60601-2-19, M. Abdiche, G. Farges, JM. Ville, Techniques
Hospitalières, Octobre 2001, n° 660, pp 37-40
- 53. Diagnostic
et évaluation de l’alarme des
incubateurs, M. Abdiche, G. Farges, JM. Ville, JP Libert, Ed Elsevier,
ITBM-RBM, 2001, 22 : 153-8
54. Réflexions sur l'intégration de
nouvelles fonctionnalités dans les logiciels de GMAO, JM.
Didelot, X. Gouyer, C. Roncalli, L. Siwiec, G. Farges, F. Thibault, Ed
Elsevier, ITBM-RBM News, 2001, Vol. 22, n° 5, pp 11-12
- 55. Mise
en place d'une planification stratégique dans un service biomédical
hospitalier, M. Coulibaly, A. Meunier, G. Farges, Ph. Durand, F. Thibault,
Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2001, Vol. 22, n° 4, pp 9-12
- 56. Le
projet de décret "contrôle
qualité" en un coup d’œil…S. Didier, G. Manibal,
A. Picard, N. Pipart, G. Farges, F. Thibault, E. Jullian, Ed Elsevier, ITBM-RBM
News, 2001, Vol. 22., n° 3, pp 10-12
- 57. Le service
biomédical : partenaire pour
l'Assurance Qualité en stérilisation, F. Botella, E.
Marques, G. Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2001, Vol. 22, n°
2, pp 7-9
- 58. Contrôle Qualité et NF EN 45001
: du service biomédical au laboratoire biomédical, A.
Lorimier, S. Taupiac, G. Farges, A. Labarre, Ed Elsevier, ITBM-RBM
News, Février 2001, Vol. 22, n° 1, pp 6-8
- 59. Logiciels
Qualité et systèmes
d'information dans les établissements de Santé, D. Dugor,
L. Forcadell, S. Geyssens, G. Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2000,
Vol. 21, n° 3, pp 7-9
- 60. Evolution des normes ISO 9000
version 2000 : incidences pour le service biomédical, H. Dion, H.
Mignardot, G. Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News, 2000, Vol. 21, n° 2,
pp 7-8
- 61. Les nuisances sonores dans les services
pédiatriques, M. Abdiche, G. Farges, JM. Ville, JP Libert,
Techniques Hospitalières, Septembre 2000, n° 649, pp
18-20
- 62. L'environnement sonore des nourrissons
placés en incubateur dans les hôpitaux, M. Abdiche, G.
Farges, JM Ville, JP Libert, RBM, 1999, Vol. 21, pp 185-192
- 63. Evaluation
de l'équilibre
neurovégétatif chez le nourrisson, A. de Broca, J.
Ducrocq, M. Abdiche, B. Kabeya, I. Aubron, L. Leke, G. Farges, RBM,
1999, Vol. 21, Suppl. 2, pp 218-225
- 64. Générateur
de bruit pour la stimulation auditive des nourrissons. M. Abdiche, J. Ducrocq,
G. Farges, JM. Ville, A. De Broca, JJ. Vanhoutte, JP. Libert, RBM, 1999,
Vol. 21, n° 2, pp 20-25
- 65. Contrôle de l'environnement
thermique dans les incubateurs pour les nouveau-nés prématurés.
V. Bach, F. Telliez, G. Farges, G. Zoccoli, G. Krim, JP Libert, RBM,
1999, Vol. 21, n° 2, pp 6-19
- 66. Accréditation
EN 45001 au Service Biomédical ? G. Farges, RBM News, 1999, Vol. 21,
n° 10, pp
10-12
- 67. L'ISO 9000 est-elle attractive ? F. Faure G.
Farges, RBM News, 1999, Vol. 21, n° 8, pp 7-8.
- 68. Accréditation
et Maintenance Biomédicale : Outil de Diagnostic, F. Thibault, G.
Farges, RBM News, 1999, Vol. 21, n° 6, pp 6-8
- 69. L'assurance
Qualité et les Achats dans un
service biomédical hospitalier, G. Fernandes, Y. Rochais, G.
Farges, F. Thibault, RBM News, 1999, Vol. 21, n° 3, pp 7-8.
- 70. Faisabilité d'une
approche stéréotaxique de la biopsie thoracique sous scanner.
Mesure et intégration des mouvements respiratoires. L. Menant,
G. Farges, R. Carrier, G. Beaudoin, C. Poulain, A. Malo, G. Levesque,
J. Preovault, V. Oliva, RBM, 1999, Vol. 21, n° 2, pp 26-32
- 71. Gestion
de la Qualité : faut-il un logiel
? G. Machecler, C. Maliges, G. Farges, F. Thibault, RBM News, 1999,
Vol. 21, n° 1, pp 7-8
- 72. EN 46000 : l'ISO 9000 des
dispositifs médicaux. Y. Rochais, G. Farges, RBM News, Vol. 20, n° 8,
pp 7-8, 1998.
- 73. Dis, dessine-moi la Qualité. G.
Farges, RBM News, Vol. 20, n° 1, p 7, 1998.
- 74. Mise
en place de contrôles qualité
en imagerie par résonance magnétique. C. Colombini, M.
Pommier, G. Farges, F. Langevin, RBM, 1997, Vol 19, n° 1, pp 30-35
- 75. Assurance
Qualité du service
biomédical : implantation et méthodologie. S. Teilhaud,
J. Corre, G. Farges, RBM, 1997, Vol 19, n° 1, pp 54-58
- 76. L'évaluation
pour l'assurance qualité des prestations et de l'organisation des
services techniques biomédicaux. S. Cablan, G. Farges, P. Plassais,
H. Serpolay, RBM, 1996, Vol 18, n° 1, pp 51-55
- 77. Système
de Contrôle Actif
d’Humidité dans un Incubateur. M. Freitas de Amorim, G. Farges,
P. Villon, JP. Libert, L. Cevallos, RBM, 1995, Vol 17, n°1, pp 36-40
- 78. Partage
d'un IRM entre plusieurs
établissements : éléments techniques,
médicaux et juridiques. S. Darsy, F. Langevin, G. Farges, RBM,
1994, Vol 16, n° 2, p 51
- 79. Assurance qualité en
radiodiagnostic - Protocole de contrôle qualité des images de
mammographie. M. Diop, JM. Cavanihac, G. Farges, F. Langevin, RBM, 1994,
Vol 16, n° 2, p 58
- 80. Le contrôle de sécurité des
équipements biomédicaux. Z. Soro, R. Talec. M. Bricq, G.
Farges, A. Donadey, RBM, 1994, Vol 16, n° 2, p 61
- 81. Mise
en œuvre des gaz médicaux :
règles de sécurité. K. M'Bra, JP. Voinot, A.
Noyelle, G. Farges, A. Donadey, RBM, 1994, Vol 16, n° 2, p 63
- 82. Evacuation
des gaz anesthésiques. M.
Diallo, J. Ancellin, A. Donadey, G. Farges, RBM, 1994, Vol 16, n°
2, p 66
- 83. La sécurité des équipements
médicaux. A. Julé, Y. Dubourg, B. Lepage, G. Farges, P.
Plassais, RBM, 1994, Vol 16, n° 2, p 70
- 84. Habilitation
des agents de maintenance. A. Julé, Y. Dubourg, B. Lepage, G. Farges,
P. Plassais, RBM, 1994, Vol 16, n° 2, p 77
- 85. La maintenance
: de l'industrie à
l'hôpital. D. St Ouen, S. Largillière, Y. Dubourg, G.
Farges, RBM, 1994, Vol 16, n° 2, p 79
- 86. La place du
monitorage à domicile dans le
contexte de la prévention de la MSN. A. de Broca, G. Farges,
M.L. Bernard, D. Dorival, B. Risbourg, La Revue du Praticien, 1992,
n° 14, pp 1753-1757
- 87. L'ingénieur biomédical
et hospitalier, rôle de la formation. F. Langevin, A. Donadey, G.
Farges, C. Moreau, RBM, 1986, Vol 8, n° 4, pp 283-284
retour sommaire
Congrès internationaux « avec Actes » :
- 88. A
Non-Aggressive Thermo-Cardio-Respiratory Sensor Conception Associated To
Cardio-Modulo-Respiratory Method For Long-Term Monitoring. M.O. Diab, W.
Hassan, G. Farges, IEEE SSD, Fourth International Multi-Conference on Systems,
Signals & Devices,
Hammamet, Tunisia, 2007, March 19-22, Vol. 4, pp 384-387
- 89. A
contact-less cardiac frequency detection system for premature newborns,
W. Hassan, G. Farges, Proceedings of the IASTED International Conference,
Biomedical Engineering, Salzbourg, Austria, 2003, June 25-27, 386-020 pp
213-215
- 90. Bacteriological
analysis of ultrasonic nebulizer for neonates’s closed incubator,
A. Menudier, G. Farges, M. Abdiche, B. Risbourg and JP. Libert : World
Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Nice (France),
September 14-19, 1997.
- 91. Neonate’s temperature measure by microwave
radiometry in incubators, V. Tessier, L. Dubois, JP. Sozanski, M.
Chive, G. Farges, V. Bach, JP. Libert, World Congress on Medical
Physics and Biomedical Engineering, Nice (France), September 14-19,
1997.
- 92. Epidermal water loss : a polynomial model, M.F.
Amorim, G. Farges, L. Cevallos, JP Libert, World Congress on Medical
Physics and Biomedical Engineering, Nice (France), September 14-19,
1997.
- 93. Humidity - air temperature interactions in closed
incubator. M. Abdiche, G. Farges, V. Bach, JP Libert, World Congress on
Medical Physics and Biomedical Engineering, Nice (France), September
14-19, 1997.
- 94. Newborn’s incubator humidity active
control based on the dynamic programming method, D. Bouattoura , P. Villon
, G. Farges, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering,
Nice (France), September 14-19, 1997.
- 95. Présidence
de séances orales au
World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Nice,
France, Septembre 14-19, 1997 : Cardiovascular and respiratory
surveillance in neonatology: Chairman: G. Farges (France) Co-chairman:
L. Blache (UK)
- 96. Conforto Térmico do Recém-nascido
em Ambiente com Umidade Controlada : Uma Nova Ferramenta e Testes
Preliminares, M.F. Amorim, G. Farges, L. Cevallos, JP Libert,
Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde,
Campos do Jordao-Sao Paulo, Brasil, 19-17 Outubro 1996, ANAIS, Vol. 1,
pp 201-202
- 97. Demodulação em amplitude do
ECG para obtenção do sinal respiratório :
análise comparativa entre as derivações DI, DII,
DIII, V1, V2 e V6, M.F. Amorim, G. Farges, K. M. Ferreira, Fórum
Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, Campos do
Jordao-Sao Paulo, Brasil, 19-17 Outubro 1996, ANAIS, Vol. 1, pp 135-136
- 98. Cardio-Módulo-Respirografia
CMR : otimizando a obtenção do sinal respiratório,
K.M. Ferreira, M.F. Amorim, G. Farges, VII Simposio Latino-americano de
Ingenieria Biomedica, Bucaramanga, Colombia, 9-12 Outubro 1996
- 99. The
Importance of Humidity in Incubarors for an Appropriate Thermal Balance :
an Active Control System, L. Cevallos, G. Farges, 5th Intern. Conf. on Fetal & Neonatal
Physiological Measurement, Keele University, Staffordshire, UK, 2/5 Sept.
1995, p 125
- 100. Validation of a skin derivative servo-controlled
heating program incubator. F. Telliez, V. Bach, S. Delanaud, G. Farges,
JP Libert, 5th International Conference on Fetal and Neonatal
Physiological Measurement, Keele University, Staffordshire, UK,
2/5 Sept. 1995
- 101. A Comparative Analysis of the respiratory
Monitoring Technics : Results of the Cardio-Modulo-respirography, M.
Freitas de Amorim, G. Farges, World Cong. Med. Phy. Biomed. Eng., Rio
de Janeiro, Brazil, 1994,Vol 39a, p 895, OS35 - 3.6
- 102. Active
System for Humidification of Incubator, M. Freitas de Amorim, G. Farges,
World Cong. Med. Phy. Biomed. Eng., Rio de Janeiro, Brazil, 1994,Vol 39a,
p 738, OS28 - 1.2
- 103. Acoustical Method for Contactless
Respiratory Monitoring, Z. Bou Khaled, G. Farges, World Cong. Med. Phy.
Biomed. Eng., Rio de Janeiro, Brazil, 1994,Vol 39a, p 739, OS28 - 1.4
- 104. Contactless
Respiratory Monitoring by Infrared Imaging, G. Farges, Z. Bou Khaled, World
Cong. Med. Phy. Biomed. Eng., Rio de Janeiro, Brazil, 1994,Vol 39a, p 145,
OS06 - 2.7
- 105. First Approach for Respiraroty Monitoring
by Amplitude Demodulation of the ECG, Z. Boukhaled, G. Farges, 14th Ann.
Intern. Conf. of The IEEE Eng. in Med. and Biol. Soc., Paris - France,
29 oct/1 nov 92.
- 106. Clinical Engineering in France : Situation
and New Perspectives of the Profession, F. Langevin, A. Donadey, G. Farges,
M. Fauchet, P. Plassais, J. Ancellin, 14th Ann. Intern. Conf. of The
IEEE Eng. in Med. and Biol. Soc., Paris - France, 29 oct/1 nov 92.
- 107. Clinical
Engineering Education at Compiègne University, A. Donadey, F. Langevin,
G. Farges, P. Plassais, 14th Ann. Intern. Conf. of The IEEE Eng. in Med.
and Biol. Soc., Paris - France, 29 oct/1 nov 92.
retour sommaire
Congrès nationaux « avec Actes » :
- 108. Etude
statistique de l'environnement sonore des nourrissons en incubateur, M. Abdiche,
G. Farges, JM Ville, JP. Libert, IXème Congrès Société Francophone
de Recherche en Pédiatrie, Tours, 7 mai, 1999
- 109. Evaluation
des bruits propres aux incubateurs, M. Abdiche, G. Farges, JM Ville, JP.
Libert, IXème
Congrès Société Francophone de Recherche en
Pédiatrie, Tours, 7 mai, 1999
- 110. Méthode
précise pour
l'étude de la variabilité cardiaque chez les nourrissons,
M. Abdiche, A. de Broca, J. Ducrocq, G. Farges, IXème
Congrès Société Francophone de Recherche en
Pédiatrie, Tours, 7 mai, 1999
- 111. Contrôle
d'humidité en incubateur
pour une contribution à l'étude du confort thermique chez
le nouveau-né, L. Cevallos, G. Farges, Xème
Journées d'Etudes en Thermobiologie, Société
Française des Thermiciens, Paris, 17 Janvier 1996
- 112. Confort
Thermique du Nourrisson et Contrôle d'Humidité en Incubateur
: nouvel outil et tests préliminaires, L. Cevallos, G. Farges, Actes
du Congrès
Annuel de la Société Française des Thermitiens,
1995, pp 560-566
- 113. Equilibre thermique du nourrisson
et contrôle d'humidité en incubateur, L. Cevallos, G. Farges,
Société Française des Thermiciens, LET-ENSMA,
Futuroscope-Poitiers, 17-19 mai 1995, C106F, p 130
- 114. Surveillance
respiratoire par laser chez un nourrisson, Z. Bou Khaled, G. Farges, XIII
Congrès de la
Société Française des Lasers Médicaux -
France, 24/28 Janvier 1994
- 115. Méthodes et outils
d'amélioration
de la sécurité électrique au bloc
opératoire, G. Farges, J.F. Guyonnet, 4ème Coll. Inter.
sur la Fiabilité et la Maintenabilité, CNET,
PERROS-GUIREC, 1984, Vol. 2, pp 578-581
retour sommaire
Congrès nationaux « sans Actes » :
- 116. Evolution
du Guide des Bonnes Pratiques Biomédicales en Etablissement de Santé :
bilan 2003-2008 et enseignements pour une version 2, G. Farges, AAMB, 26èmes
Journées Techniques Biomédicales, Pau, octobre 2008, Ed
AAMB
- 117. Guide des Bonnes Pratiques Biomédicales
en Etablissement de Santé : bilan 2007 et perspectives, G.
Farges, AFIB, 12èmes Journées Techniques
Biomédicales, Toulouse, septembre 2007, Ed AFIB
- 118. Evolution
du Guide des Bonnes Pratiques Biomédicales en Etablissement de Santé :
bilan et perspectives 2006, G. Farges, AAMB, 24èmes Journées
Techniques Biomédicales, Salon de Provence, octobre 2006, Ed AAMB
- 119. Usages
comparés, enseignements et
évolutions du Guide des Bonnes Pratiques Biomédicales en
Etablissement de Santé, G. Farges, AAMB, 22èmes
Journées Techniques Biomédicales, Nevers, octobre 2004,
Ed AAMB
- 120. Guide des Bonnes Pratiques Biomédicales
en Etablissement de Santé : bilan 2004, benchmarking et
perspectives, G. Farges, AFIB, 9èmes Journées Techniques
Biomédicales, Angers, septembre 2004, Ed AFIB
- 121. Retours
d’expériences sur le Guide des
Bonnes Pratiques Biomédicales en Etablissement de Santé
et perspectives, G. Farges, AAMB, XXIèmes Journées
Techniques Biomédicales, Pau, octobre 2003, Ed AAMB
- 122. Retour
d’expérience et évaluation
de la mise en œuvre du Guide des Bonnes Pratiques Biomédicales
en Etablissement de Santé et perspectives, G. Farges, AFIB,
Journées Techniques Biomédicales, Lille, septembre 2003,
Ed AFIB
- 123. Génèse et contenu du Guide des
Bonnes Pratiques Biomédicales en Etablissement de Santé.,
G. Farges, AAMB, XXèmes Journées Techniques
Biomédicales, Strasbourg, octobre 2002, Ed AAMB
- 124. FD
X 50-550 - Démarche Qualité en
Recherche, G. Farges, SISQUAL 2001, Paris, 18, 19, 20 septembre 2001,
Ed BIRP, pp 515 à 529, ISBN 2-87717-080-2
- 125. Les
apports des outils Internet à la
profession biomédicale, G. Farges, XVIèmes
Journées Techniques Nationales Biomédicales, AAMB, Pau,
octobre 1998
- 126. Formation pour l'Assurance Qualité
appliquée au domaine biomédical hospitalier, G. Farges,
Association Française des Ingénieurs Biomédicaux,
Paris, 19/20 Septembre 1996, Afib-Info n° 41, pp 65-69
- 127. Techniques
statistiques pour l'Assurance Qualité appliquée au domaine
biomédical
hospitalier, G. Farges, Association Française des
Ingénieurs Biomédicaux, Paris, 19/20 Septembre 1996,
Afib-Info n° 41, pp 71-73
retour sommaire
Brevet :
- 128. Appareil Cardio-Respiratoire - Inventeur : G. Farges
- Propriétaire
: Gradient - France : France n° 85.16576 (08/11/85) - International
: USA n° 048.367 ; Europe n° 87.401045.7 ; Canada
n° 536.555 (07/05/87)
Ouvrages et documents collectifs :
- 129. L’évaluation
interne : Guide pour les
établissements et services sociaux et médico-sociaux,
CNESMS, Conseil National de l’Evaluation Sociale et
Médico-Sociale, Ministère de l’Emploi, de la
Cohésion Sociale et du Logement, Ministère de la
Santé et des Solidarités, Direction de l’Administration
Générale, du personnel et du Budget, Mission Prospective
et Modernisation, 14 Avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, septembre
2006, 36 pp
- 130. Modèle et définition pour
l'établissement et la gestion du registre
sécurité, qualité et maintenance d'un dispositif
médical (RSQM), norme française NF S 99-171. F. Thibault
(Pdt Commission Normalisation), G. Farges & 21 membres, Ed Afnor, S
99-171, 2ème tirage, juillet 2006
- 131. Qualité en
recherche - Recommandations pour l'organisation et la réalisation
d'une activité de
recherche en mode projet notamment dans le cadre d'un réseau, FD
X 50-551. MA Piédallu (Pdte Commission Normalisation), G. Farges
& 40 co-auteurs, Ed Afnor, X 50-551, novembre 2003
- 132. Guide
de management de la qualité
appliqué aux activités de la fonction technique des
établissements de santé, FD S 99-134. H. Leclet (Pdt
Commission Normalisation), G. Farges & 46 membres, Afnor, S
99-134, octobre 2003
- 133. Exploitation des dispositifs médicaux –
Gestion des risques liès à l’exploitation des dispositifs
médicaux dans les établissements de santé, norme
française NF S 99-172. F. Thibault (Pdt Commission
Normalisation), G. Farges & 22 membres , Ed Afnor, S 99-172,
septembre 2003
- 134. Guide des Bonnes Pratiques Biomédicales
en Etablissement de Santé, Farges G. (UTC), Wahart G. (Pdte
AFIB), Denax J.M. (Pdt AAMB), Métayer H. (Pdt ATD) et 45
co-auteurs, ITBM-RBM News, Ed Elsevier, novembre 2002, vol. 23, Suppl.
2, 23s-52s
- 135. Lignes directrices pour la mise en œuvre
d'un système qualité dans un établissement de
santé, FD S 99-130. H. Leclet (Pdt Commission Normalisation), G.
Farges & 46 membres, Afnor, S 99-130, novembre 2002
- 136. Guide
de management de la qualité
appliqué aux cabinets et services d'imagerie médicale, FD
S 99-133. H. Leclet (Pdt Commission Normalisation), G. Farges & 46
membres, Afnor, S 99-133, mai 2002
- 137. Démarche
qualité en recherche,
Principes généraux et recommandations, FD X 50-550, MA
Piédallu (Pdte Commission Normalisation), G. Farges & 40
co-auteurs, Ed Afnor, X 50-550, novembre 2001
- 138. Maintenance
des dispositifs médicaux -
Modèle et définition pour l'établissement et la
gestion du registre sécurité, qualité et
maintenance d'un dispositif médical (RSQM), norme
française expérimentale NF S 99-171, F. Thibault, G.
Farges & 21 co-auteurs , Ed Afnor, XP S 99-171, juin 2001
- 139. Maintenance
des dispositifs médicaux –
Modèle pour l’assurance qualité en production,
installation et prestations associées, norme française
expérimentale XP S 99-170. Afnor, G. Farges & 29 membres, Ed
Afnor, S 99-170, septembre 2000
retour sommaire
Directions de Thèses :
- 140. Développement d'une
plate-forme de diagnostic et de monitorage acoustique appliquée aux
incubateurs pour nourrissons. M. Mokrane Abdiche - GBM - Thèse de
3ème cycle soutenue à l’UTC en janvier 2000
- 141. Suivi
des variables physiologiques par des capteurs sans contact adaptés à la
surveillance des nouveaux-nés en incubateur. M. Ziad Boukhaled - GBM –
Thèse de 3ème cycle débutée en 1991,
non terminée
- 142. Contribution à la conception
et au développement d'un nouvel incubateur : Système de
contrôle d'humidité relative et monitorage
cardio-respiratoire. M. Mardson Freitas de Amorim – GBM - Thèse
de 3ème cycle soutenue à l’UTC en juillet 1994.
- 143. Prévention
de la mort subite du nourrisson. Analyse systèmique et de défaillance
du système nourrisson. Evaluation de l'utilisation actuelle de
moniteurs à domicile. Développement d'un nouveau moniteur
adapté à cet objectif. Dr Alain De Brocca – GBM -
Thèse de 3ème cycle soutenue à l’UTC en
décembre 1993
Participations à des jurys de thèse :
- 144. Contrôle
de l’environnement thermique en
incubateur et influence de la nutrition sur les régulations
physiologiques du nouveau-né, Frédéric Telliez ,
Thèse GBM UTC Docteur Européen, 1997
- 145. Contribution à l’appréciation
du risque pour l’homme lié à la présence de
phycotoxines neurologiques dans les coquillages. Mise en place d’un
système de management de la qualité en recherche, Ronel
Biré, Thèse Université Paris VII,
Spécialité Interactions Toxiques dans les
Ecosystèmes, 2004
Directions de DEA :
- 146. Etude de faisabilité d’un
banc de test des performances des électrodes électrophysiologiques
(contrat avec société C3A), Boaz samuel Mbom Ntamack, DEA
GBM UTC, 2004
- 147. Contribution au développement
d'un nouveau capteur ECG pour le système ©CardioPic (contrat
avec société C3A), Mohamad Diab, DEA GBM UTC, 2003
- 148. Approche
scientifique de la conception et validation de bonnes pratiques en contrôle
qualité des
systèmes médicaux de ventilation artificielle (contrat
avec société SODEREL), Christophe Petit, DEA GBM UTC, 2003
- 149. Faisabilité d'une
détection sans
contact de la fréquence cardiaque chez les nourrissons et
développement d'un simulateur biomécanique cardiaque,
Walid Hassan, DEA GBM UTC, 2002
- 150. Etude de faisabilité de
capteurs sans contact pour la surveillance cardiaque des nourrissons en incubateur,
Carlos Amaral, non terminé, retour au pays (Brésil) , DEA
GBM UTC, 2001
- 151. Etude de faisabilité d'un
détecteur respiratoire sans contact pour le nourrisson en
incubateur, David Rychen, DEA GBM UTC, 1998
- 152. Conception
d'un système de
détection respiratoire sans contact des nourrissons en
incubateur, M. Tchounda, non terminé, retour au pays, DEA GBM
UTC, 1997
- 153. Contribution à l’analyse et à la
validation clinique d’un nouvel incubateur asservi en humidité,
Lorena Cevallos, non terminé pour cause de maternité, DEA
GBM UTC, 1997
- 154. Bases de développement d’un
outil informatique de traitement de l’ECG, Dr Jean-François
Kulik, DEA GBM UTC, 1994
- 155. Elaboration d'un prédicteur
et optimisation d'un algorithme d'asservissement d'actionneurs pilotant la
surface d'un miroir, Djaffar Ouattara, DEA Contrôle des
Systèmes UTC, 1992
- 156. Commande optimale en optique
adaptative, simulation des performances d’un algorithme utilisant la
décomposition modales du miroir, M. Nemouchi, DEA Contrôle
des Systèmes UTC, 1991
- 157. Elaboration d’une
plate-forme temps réel
de traitements d’image vidéo associés à la
reconnaissance de formes, applications biomédicales, M.
Mansouri, DEA GBM UTC, 1991
- 158. Etude et réalisation
d'un protocole d'évaluation technique et clinique d'une nouvelle méthode
de détection de la respiration à partir de l'ECG chez le
nourrisson (collaboration avec le CHU d'Amiens), Ziad Boukhaled, DEA
GBM UTC, 1990
- 159. La M.S.I.N. : Etat actuel des connaissances
et mise en place d'un système d'exploration multi-fonctionnelle
pour des nourrissons de moins de 6 mois, en vue d'explorer leur statut
neuro-végétatif et neuro-hormonal (collaboration avec le
CHU d'AMIENS), Dr Alain de Brocca, DEA GBM UTC, 1988
- 160. Asservissement
de l'injection d'halogénés liquides dans un circuit fermé
d'anesthésie (en collaboration avec le CHU d'AMIENS), Serge
Largillière, DEA GBM UTC, 1988
- 161. Surveillance
instrumentale de la respiration (en collaboration avec le CHU de STRASBOURG),
Michel Lichnewsky, DEA GBM UTC, 1987
- 162. Etude des facteurs
physiques et physiologiques de modulation de l'ECG chez l'enfant et l'adulte
- Critères
d'optimisation, Philippe Mereau, DEA GBM UTC, 1986
retour sommaire
Thèses et mémoires
personnels :
- 163. Thèse
professionnelle du Mastère
Spécialisé Normalisation, Qualité, Certification,
Essai, UTC, janvier 2001 : Planification Stratégique et Amélioration
Continue de la Qualité en Enseignement Supérieur, Recherche
et Santé : Expériences nord-américaines et transferts
possibles en France (disponible sur Internet, https://www.utc.fr/~farges)
- 164. Thèse
de 3ème cycle
Docteur-Ingénieur en Génie Biomédical, UTC,
décembre 1986 : Mort Subite Inexpliquée du Nourrisson : Conception
d’un nouveau
moniteur cardio-respiratoire pour la surveillance à domicile et
contribution de l’approche Sûreté des Systèmes.
- 165. Mémoire
de DEA en Génie
Biomédical, UTC, octobre 1982 : Etude de faisabilité d'une
méthode de contrôle de
la sécurité électrique au bloc opératoire
(convention avec le Centre National des Equipements Hospitaliers.
- 166. Mémoire
d’Ingénieur
Biomédical Hospitalier (cycle IBMH devenu Mastère
Spécialisé « Equipement Biomédicaux), UTC,
juin 1979 : Critères de choix en maintenance externe et interne.
Méthodologie de choix et d’implantation d’un scanner
au Centre Hospitalier de Colmar.
- 167. Mémoire d’Ingénieur
Arts et Métiers, ENSAM, juin 1978 : Analyse de l’usure
des outils de coupe en fraisage. Proposition d’améliorations
en méthode d’usinage.
Réalisations en communication internet et multi-média
:
Sites
Internet et Extranet (capitalisation et mutalisation des connaissances) :
Film à l’usage du public :
- 173. "Vivre...
tout simplement", 1er film
français sur la prévention de la mort subite du
nourrisson. Participation avec le CHU d'Amiens, Distrib. Filmed
(Minitel 36 14 FILMED), 1991
retour sommaire
Séminaires Scientifiques et Professionnels :
- 174. Démarche qualité en recherche :
améliorer la traçabilité et la capitalisation des
connaissances, G. Farges, JP Caliste, Cemagref, Antony, décembre
2008
- 175. L’amélioration continue de ses pratiques
professionnelles en documentation, G. Farges, Réseau National de
l'Information Scientifique et technique (Renatis) CNRS, Action
Nationale à Gestion Déconcentrée -
Délégation Aquitaine-Limousin, La Rochelle, novembre 2008
- 176. Choix
stratégiques,
périmètres et processus en recherche. G. Farges,
Certificat de Spécialité CS 27 "Organisation et
Management Qualité en Recherche", Conservatoire National des
Arts et Métiers (CNAM), septembre 2008
- 177. Comment
mettre en œuvre une démarche
qualité dans un laboratoire ? G. Farges, Réseau
Qualité en Recherche, CNRS MRCT, Action Nationale à
Gestion Déconcentrée - Délégation
Aquitaine-Limousin, Bordeaux, mai 2008,
http://www.rmsb.u-bordeaux2.fr/wikiQualite
- 178. Approches
et outils pour une démarche
qualité en recherche, G. Farges, Laboratoire XLIM-Carnot,
Limoges-Brive-la-Gaillarde, avril 2008
- 179. Choix stratégiques,
méthodes et
sens pour une démarche qualité en laboratoire, G. Farges,
Institut de Recherche et de Développement, 2007 (5
séminaires délocalisés)
- 180. Système
qualité et maintenance des
équipements biomédicaux hospitaliers, G. Farges,
Séminaires Laboratoire National d’Essais (LNE), Paris ,
mai 2006, mai 2007, mai 2008
- 181. Démarche
qualité en recherche :
améliorer la traçabilité et la capitalisation des
connaissances dans les laboratoires de sciences pour
l'ingénieur, G. Farges, JP Caliste, CNRS Département
« Ingénierie » & ST2I – Action Nationale
à Gestion Déconcentrée - Délégation
Aquitaine-Limousin, décembre 2004 ; janvier, mai et juin 2005 ;
mars, mai, novembre 2006 ; février, mars et septembre 2007,
février, mars, mai et septembre 2008
- 182. Choix stratégiques,
périmètres et processus en recherche, G. Farges, Institut
Fédératif de Recherche 02 – Inserm- CNRS-
Délégation aux Entreprises – Paris, Novembre 2004 –
Université de Paris VI avril et décembre 2006, mars et
juin 2007
- 183. Démarches Qualité en Recherche
: enjeux et principes, G. Farges, CNRS- Délégations Nord
Pas de Calais – Picardie – Haute Normandie – Saint Jean
aux Bois, Octobre 2004
- 184. Qualité-Recherche : modèles
et outils méthodologiques, G. Farges, Ecole Doctorale ENSAM -
Paris, Mars 2003, Mars 2004, Mars 2005
- 185. Qualité-Recherche
: référentiels et outils méthodologiques, G. Farges,
IDEHAP-Euroqual-Lausanne- Suisse, Mai 2003
- 186. Démarches
Qualité en Recherche :
enjeux, expériences et impacts, MC Hobatho, G. Farges,
Séminaire UMR 6600 - UTC, Mars 2003
- 187. Planification
dynamique stratégique,
résolution de problèmes et outils de la qualité,
G. Farges, ESABIO - Université Léonard de Vinci - Paris,
Novembre 2002
- 188. Méthodologie d'application de
l'ISO 9000 en Génie Biomédical et Hospitalier. Maintenance
et normes ISO 9000 en Génie Biomédical et Hospitalier, G. Farges,
F. Thibault, Séminaires Divergent, Compiègne, Avril et
Juin 1996, Octobre 1997, Mai, Octobre et Décembre 1998,
Décembre 1999 à 2000.
- 189. Le référentiel
normatif ISO 9000 et les exigences du modèle ISO 9002 appliqué au
domaine biomédical hospitalier, G. Farges, L. Sevestre, Association
Française des Ingénieurs Biomédicaux, Paris, 19 et
20 Septembre 1996.
- 190. La Qualité appliquée à la
maintenance hospitalière. La Maintenance et les Normes ISO 9000
en PME-PMI, G. Farges, F. Thibault, JE Menard, Séminaires
Divergent, Compiègne, Octobre 1995.
retour sommaire
Réalisations d’expertises technologiques
:
- 191. Auprès de DIVERGENT SA pour l'analyse
d'opportunités sur la cession de licences d'exploitation de
brevets internationaux sélectionnés par le British
Technology Group (1991).
- 192. Auprès de MATRA-ESPACE
pour l’identification des technologies adaptées au suivi non
invasif du contenu minéral osseux chez les astronautes en mission
spatiale (1991).
- 193. Auprès de l'ANVAR (Agence Nationale
pour la VAlorisation de la Recherche) pour l'analyse des applications
biomédicales de la carte à micro-processeur (1989).
- 194. Auprès
de la Société
THOMSON-CGR pour des analyses de maintenabilité et
l'élaboration d'Arbres de Diagnostic de Pannes sur la table de
radiologie PRESTILIX 1600S (1987).
Réalisations de missions à l’étranger :
- 195. CANADA-Québec-Montréal
(Avril 2007, Mars 2008) : Formation (présentiel et à distance)
pour les directeurs ou managers hospitaliers en charge des démarches
qualité
et d’accréditation (Maîtrise Quéops-i :
Qualité, Evaluation, Organisation et Performance en
Etablissement de Santé, programme International)
- 196. CHILI-Temuco
(Février 2001) : Formation d’ingénieurs biomédicaux
chiliens dans le cadre d’un partenariat UTC et Université Arturo
Prat du Chili, première session d’un « Master en Ingenieria
Biomedica
».
- 197. CANADA-Québec-Montréal (Juin
à Septembre 2000) : Mise au point d’un programme de formation
(présentiel
et
à distance) pour les directeurs ou managers hospitaliers en
charge des démarches qualité et d’accréditation
(DESS Quéops : Qualité, Evaluation, Organisation et
Performance en Etablissement de Santé)
- 198. USA-Wisconsin-Madison (Février à
Mai 2000) : Découverte et étude des transferts possibles en
France sur les démarches qualité applicables en enseignement
supérieur, recherche et santé.
- 199. ANGLETERRE-London,
Keele, Portsmouth, Southampton (Mai 1993, Mai 1994, Juin 1995) : Développement
d'une collaboration européenne basée
sur des échanges d'expérience entre ingénieurs et
techniciens biomédicaux hospitaliers français et anglais. Réseau
ENAQT : "European Network for Analysis in Quality and
Technology"
- 200. COTE D'IVOIRE-Abidjan, Yamoussoukro,
Bouaké… (Octobre 1987, Avril 1989, Septembre 1991) : Analyse
de la situation des C.H.U. d'Abidjan et proposition d'une stratégie
de maintenance pour l'ensemble du pays à la
demande du Ministère de la Santé et de la Protection
Sociale ivoirien. Planification des besoins en personnel technique et des
formations complémentaires. Proposition d’un système
de programmation des équipements
biomédicaux des installations techniques et de leur maintenance
pour les formations sanitaires du pays. Suites données : Projet suite à un Appel
d’Offres
International - FORMATION DU PERSONNEL TECHNIQUE HOSPITALIER IVOIRIEN EN
FRANCE (Septembre 1991 à Février 1994 - 200 k€). Projets
Banque Africaine de Développement (BAD) et Kredit
Für Wiederaufbau (KFW) concernant 6 ingénieurs, 5
techniciens supérieurs, 13 manipulateurs de radiologie et 13
laborantins. Réalisé en partenariat avec l'UTC, le CHU de Bordeaux
et l'Institut International Supérieur Spécialisé de
Formation des Cadres de Santé de Lyon (IISSFCS).
- 201. VENEZUELA-Caracas
(Mai 1989) : Expert biomédical invité par l'Ambassade de France
à Caracas pour présenter l'offre biomédicale en
maintenance hospitalière française aux trois
Journées Techniques Franco-Vénézuéliennes
"Gestion et Maintenance Médico-Hospitalière"
- 202. TUNISIE-Tunis,
Sfax, Souss (Mars 1983) : Analyse des problèmes de maintenance hospitalière
pour le Ministère des Relations Extérieures.
- 203. MAROC-Rabat,
Casablanca, Marrakech, Meknès, Fès, Tétouan… (Septembre
1979 - Août
1981 - Avril 1994) : Analyse et bilan des actions de coopération biomédicale
avec le Maroc, structures des services de maintenance dans les
hôpitaux de la capitale et provinciaux (Avril 1994). Enseignement d'un
cours d'assainissement rural aux futurs ingénieurs sanitaires marocains
ou africains, ayant pour objet l'approvisionnement en eau potable et l'évacuation
des eaux usées en milieu rural (1979 à 1981). Amélioration
de la maintenance biomédicale dans le
système de santé du Royaume du Maroc, participation
à la création de la Cellule Centrale de Maintenance (1979
à 1981)
retour sommaire