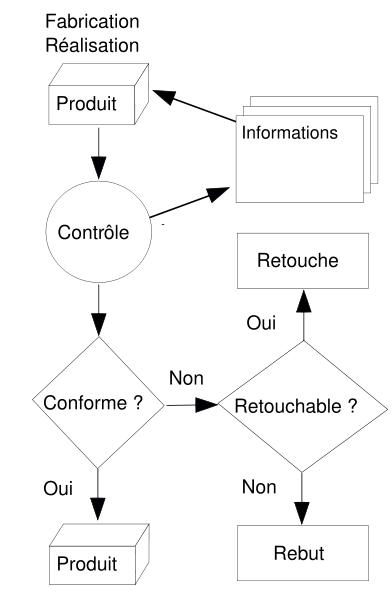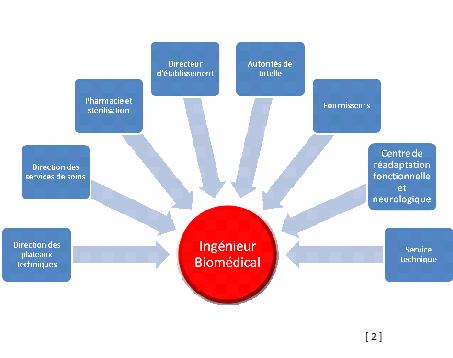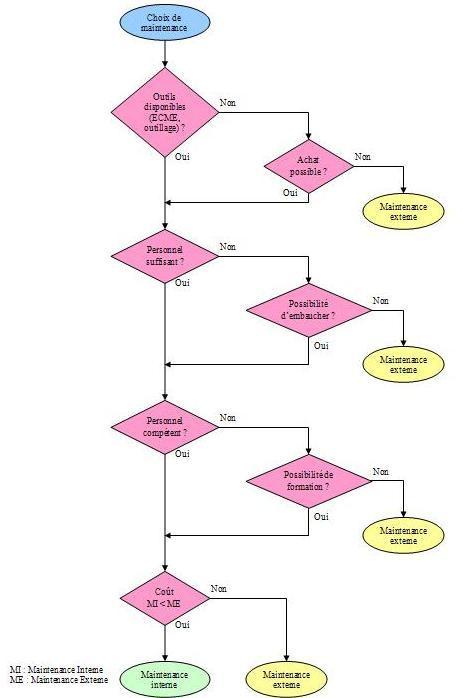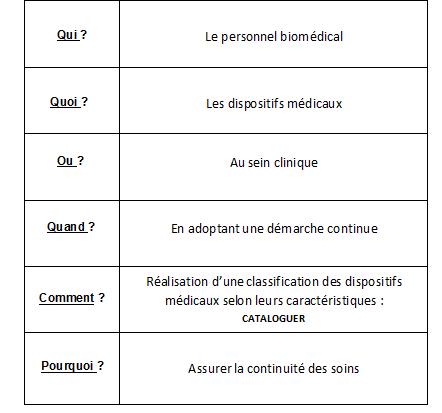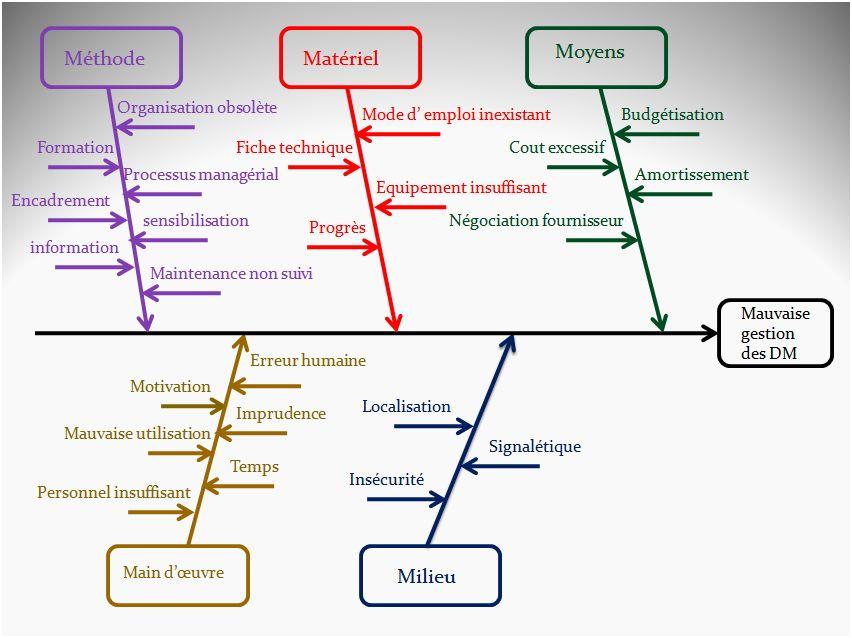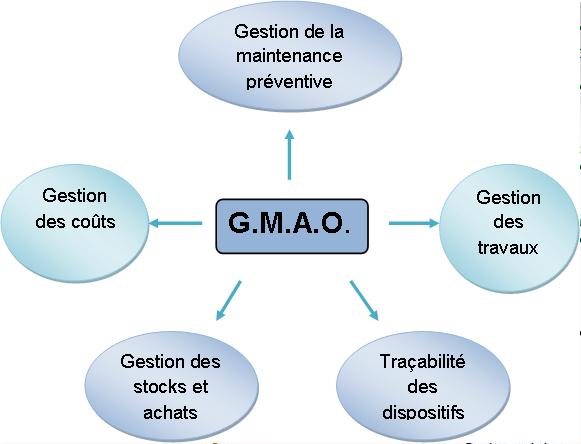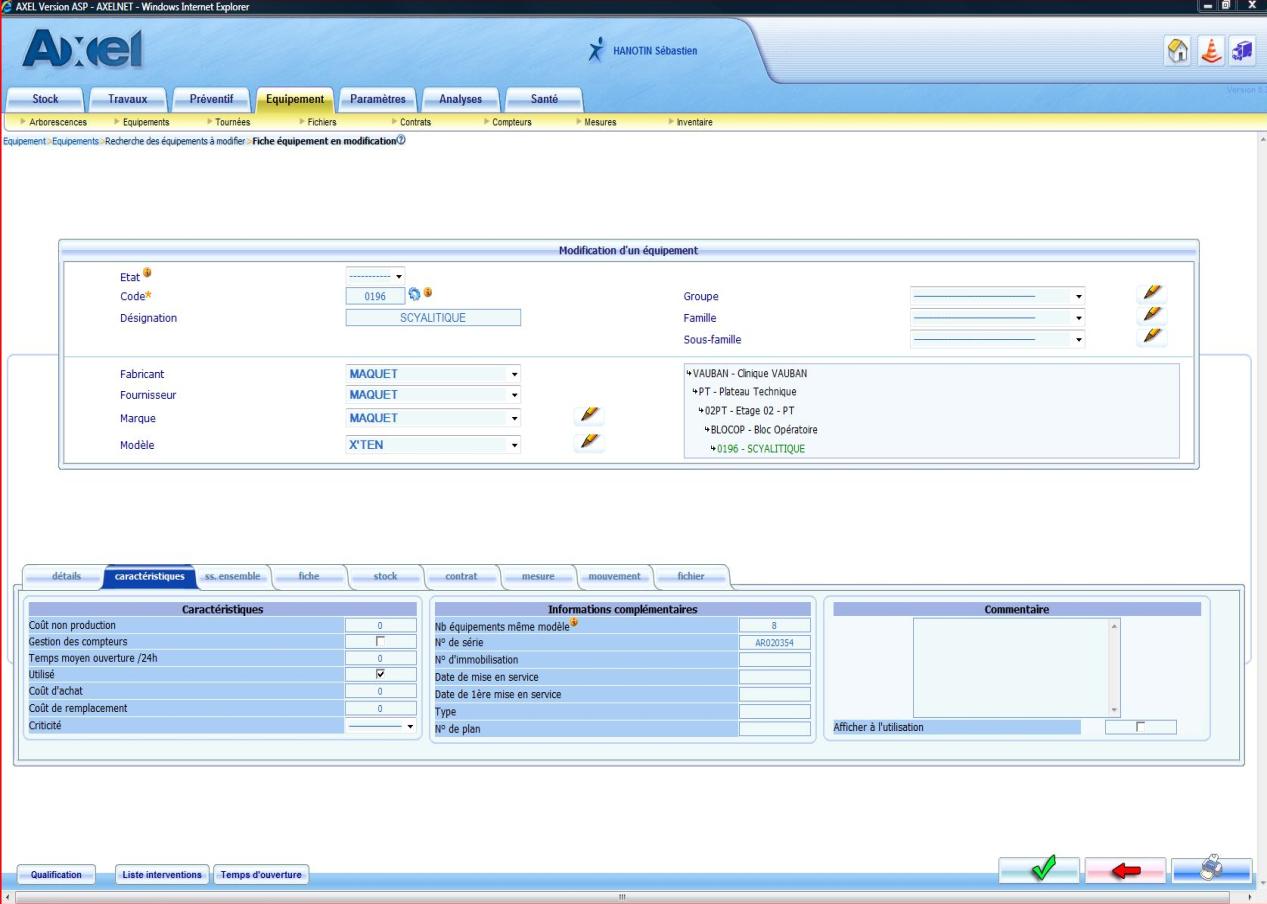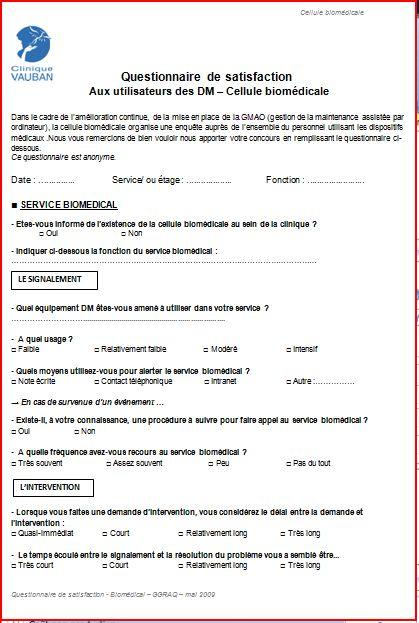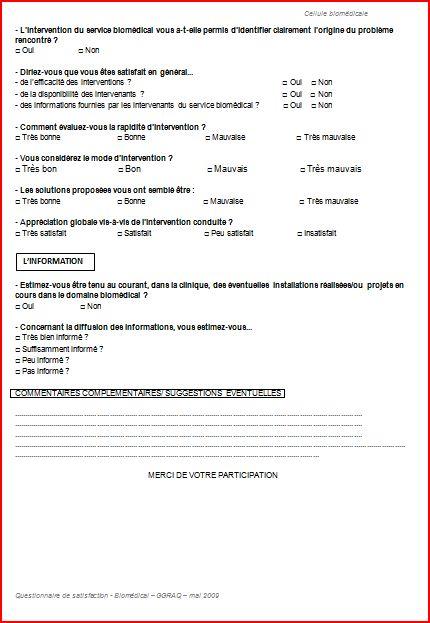Réglementation
<!
Avant
propos
Dans
un monde ou les pratiques médicales sont de plus en plus
fréquentes, le respect de la réglementation
apparaît essentielle, cela pour préserver la
sécurité et l’intégrité du patient. La
sécurité du patient est une constante
préoccupation que le personnel hospitalier, les associations et
les organismes de contrôle tentent d’améliorer
au quotidien.
Un certain nombre de décrets,
arrêtés, directives et articles encadrent les pratiques
dans les milieux hospitaliers, tout cela dans une approche
d’amélioration des soins données aux patients ; les
organismes et autorités de tutelle émettent par ailleurs
des recommandations et établissent des contrôles visant le
bon déroulement de cette démarche.
- Le
décret n°2001-1154 du 5 décembre 2001 impose
aux utilisateurs des dispositifs médicaux de mettre en place des
maintenances et des contrôles qualités internes ou
externes de leurs dispositifs. Ces dispositions ayant été
codifiées aux articles R 5211-5 ET R 5212-25 à 5212-35 du
code de la santé public
- L’arrêté
du 3 mars 2003 stipule
que les dispositifs médicaux soumis à cette obligation de
maintenance et de contrôle qualité notamment en radiologie
et radiothérapie, impose des contrôles qualité
internes et externes sont imposés aussi sur les dispositifs de
classe II b et III. (annexe1)
- La
mise sur le marché d’un dispositif médical est
régie par trois directives européennes :
-
90/385/CEE pour les
DM implantable actifs (DMIA) ;
- 93/42/CEE pour les autres DM
(31/12/1994 et obligatoire en 1998 ;
- 98/42/CEE pour les DM de
diagnostic in vitro (DMDIV)
Cette loi
s’inscrit dans le code de la santé publique .D’un point de vue
juridique cette transcription permet de mettre en relation le code de
la santé publique et le code pénal.
- Le
décret 96-32 du 15 janvier 1996
décrit le système de matériovigilance qui
définit la surveillance du risque de dangerosité des
dispositifs médicaux lors de leurs utilisations et
l’organisation du système national de matériovigilance.
- L’arrêté
du 3 octobre 1995
précise les conditions d’utilisation et de contrôle des
dispositifs médicaux et matériels, impose la mise en
place dans tout les établissements de santé d’une
organisation spécifique pour s’assurer que tout le
matériel et dispositifs médicaux destinés à
l’anesthésie et la surveillance poste interventionnelle soient contrôlés
lors de la première mise en service et lors de
toute remise
en service pour s’assurer que l’installation est faite
conformément aux spécifications prévus à
son exploitation ; ce matériel doit faire l’objet d’un
contrôle de son bon fonctionnement avant chaque utilisation et
qu’il doit faire l’objet d’une maintenance organisée,
adaptée à ses conditions d’utilisation.
- Article
L.5212-1 du Code de la Santé Publique
précise que l’exploitant est tenu de s’assurer du maintien des
performances et de la maintenance des DM inscrits sur une liste
fixée par le DG de l’AFSSAPS. Cela donne lieu le cas
échéant à des contrôles de qualité.
Les organismes de
contrôle des établissements de santé
·
La
HAS
(Haute Autorité de Santé)
« La
HAS a été créée par la loi du 13 août
2004 relative à l'Assurance Maladie afin de
contribuer au maintien d'un système de santé solidaire et
au renforcement de la qualité des soins, au
bénéfice des patients
»
<!
La HAS est une autorité publique indépendante à
caractère scientifique et disposant d'une autonomie
financière.
Elle évalue l'intérêt médical des
dispositifs et des médicaments et les actes professionnels des
établissements de santé et propose ou non leur
remboursement à l'assurance maladie.
Elle à un rôle d'information des professionnels de
santé et du public.
L’AFSSAPS
(Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Produits de santé)
<!"
L’AFSSAPS a été créée par la loi du 1er
juillet 1998 instituant un dispositif de veille et
de sécurité et de
sécurité sanitaire . C'est un
établissement public de l'Etat
placé sous tutelle du
Ministère chargé de la
santé ."
- L’AFSSAPS à une mission d’évaluation des
risques nutritionnels et sanitaires dont le champ très large
concerne toutes les catégories d’aliments destinés
à l’homme ou à l’animal ; il intègre l’ensemble de
la chaîne alimentaire et s’exerce sur chacune de ses
étapes, de la production à la consommation.
- une mission de recherche et d’appui scientifique
notamment en matière de santé animal et de maladies
d’origine animales.
- des responsabilités spécifique en
matière de médicament vétérinaire motamment
le pouvoir de délivrer, de suspendre ou retirer les
autorisations de mise sur le marché des médicaments
vétérinaire.
- l'évaluation des risques,des
bénéfices,ainsi que la synthèse
bénéfice/risque et les propositions sur les conditions
d'emploi des produits phytopharmaceutiques (ou produits phytosanitaires
ou encore pesticides).
d)
Le service biomédical
L’ingénieur
biomédical, comme les organismes cité ci-dessus, a
une mission de veille sanitaire, de ce fait il
doit mettre en place et faire respecter la réglementation.Dans
les gros établissements, la cellule biomédicale est
composée d’un ingénieur biomédical et de
techniciens. Dans les établissements de taille réduite
comme la clinique Vauban le service biomédicale est
composé uniquement que d’un ingénieur biomédical,
qui doit être polyvalent dans ses fonctions (achat, maintenance…).
Il
s’agit d’une fonction en plein développement puisque les
plateaux techniques font appel à des technologies de plus en
plus évoluées, l’ingénieur biomédical est
amené à se spécialiser sur des domaines
très pointus. Du positionnement de
l’ingénieur biomédical au sein de la clinique
dépend son niveau d’autonomie. Il travaille en étroite
collaboration avec les services et est le principal interlocuteur
en cas de dysfonctionnement constaté. Il définit avec les
service de la cliniques l’ensemble des besoins en terme
d’équipements biomédicaux (renouvellement et nouvelles
acquisitions).
Il exerce le rôle de correspondant en Matériovigilance et
peut aussi être amené à s’occuper de la
radioprotection.
■
C’est un métier à multiples facettes qui s’exerce depuis
le projet d’acquisition d’un équipement biomédical, en
passant par le suivi et la maintenance de cet appareil jusqu’à
sa mise en réforme
Fonctions
de l’ingénieur biomédical au sein de la clinique
- Etablir
un plan d’équipement.
- Veiller
au bon fonctionnement des équipements médicaux
- Evaluer
les budgets du service en matière d’équipement et de
veille sanitaire
- Réaliser
un inventaire du parc équipement
- Définir
les besoins de matériel médical
- Programmer
l’achat de fournitures
- Veiller
à l’application des réglementations sanitaires des
équipements hospitaliers.
- Assurer
le suivi et la maintenance des opérations mises en œuvre
- <Veiller
au suivi des contrats d’entretien
- Assurer
le suivi de la Matériovigilance
I.
Identification des
acteurs en relation avec le service biomédical
Les rôles de chaque acteur n’étant
pas complètement définie mon premier travail était
d’identifier les différentes personnes en relation direct avec
le service biomédical.
<!
Autorités
de tutelle :
L’ingénieur
biomédical, par sa formation, doit connaitre
nécessairement les réglementations en vigueur sur les
dispositifs médicaux et doit se tenir au courant des nouvelles
dispositions. Il doit veiller au bon fonctionnement des dispositifs
médicaux.De plus, il coopère avec l’AFSSAPS dans le cadre
de la veille sanitaire et reçoit les alertes sanitaires
lorsqu’un événement indésirable se produit
concernant un DM.
<!
Directeur
d’établissement
A
la Clinique Vauban, pour les achats de dispositifs et
d’équipements de nature diverse, l’ingénieur
biomédical travaille directement avec le directeur ; il
peut en outre discuter les contrats de maintenance.
<!
Fournisseurs
L’ingénieur
biomédical doit en plus de ses connaissances techniques faire
appel à ses talents de négociateur avec les fournisseurs
pour pouvoir diminuer les coûts qui peuvent être
conséquents
<!
Services
techniques
Au
sein de la clinique, la cellule biomédicale est en étroite
collaboration avec le service technique pour les livraisons, les
préparatifs d’installations des équipements. Les
rôles dévolus à chacun ne sont vraisemblablement
pas connus par le personnel médical et paramédical.
Certaines interventions dans les différents services ne
concernent pas les dispositifs médicaux : elles sont
pourtant effectuées par le service biomédical.
<!
Pharmacie
et stérilisation
La
pharmacie et le service biomédical travaillent ensemble assez
souvent, leur collaboration se poursuit notamment avec la mise en place
des fiches sécurité qui concernent le service de
stérilisation. Dans la perspective de lutte contre les
infections nosocomiales et pour l’amélioration continue de la
qualité des soins et de la prise en charge des malades,
l’alliance des deux services s’avère indispensable.
<!
Les
différents cadres de service
L’ingénieur
biomédical est constamment en lien avec les cadres de service et
les référents de chaque service de
l’établissement. Les cadres signalent à la cellule
biomédicale tout événement engendrant la survenue
d’un problème relatif aux DM. Le contact
téléphonique, établi en permanence, permet une
rapidité d’intervention du service biomédical.
Cette entente contribue à favoriser le bon fonctionnement
des services utilisateurs des DM.
retour
sommaire
II.
La
maintenance
La
maintenance des dispositifs médicaux peut être
réalisée soit en interne au sein même de la
clinique ou en externe par le fabricant du dispositif lui-même ou
par des sociétés extérieures grâce à
l’établissement de contrats de maintenance. Le choix entre la
maintenance interne et la maintenance externe dépend de
plusieurs facteurs :
- Au
sein de la clinique, la cellule biomédicale est composée
de l’ingénieur biomédical qui s’occupe du parc
équipement dans sa globalité ; la
maintenance interne est difficile à mettre en place de part la
taille de la structure et du nombre d’interventions trop
conséquent.
- L’ingénieur
biomédical partage son bureau avec le directeur de la
communication et le directeur du système d’information. L’espace
est exigu et ne permet donc pas d’effectuer les
réparations d’équipement (DM). Il n’existe pas de local
technique ou d’atelier de travail dédié à la
cellule biomédicale pour ces réparations ; il en
résulte un manque d’équipement de contrôle (ECME).
-
La
formation du personnel biomédicale est une question à
soulever. Dans l’établissement, la plupart
des équipements médicaux sont récents
et sont soumis à des contrats de maintenance, incluant une
garantie s’ils se trouvent être non utilisables. Ainsi la
politique de l’établissement se trouve être dirigée
vers une maintenance externe auprès de la société
ou des prestataires externes : les formations ne sont alors pas
prévues au sein de la structure.
Problématique
Le
fonctionnement du service biomédical au sein d’un
établissement de santé privé à un but
lucratif nécessite toute une organisation cohérente avec
la politique de l’établissement : il a été
mis en évidence un certain nombre d’incohérences, l’une
d’entres elle porte sur la gestion et le suivi des dispositifs
médicaux. Il s’agit d’étudier cette hypothèse, une
des réponses formulées à des dysfonctionnements
constatés sur le terrain.
- Comment
assurer la gestion et le suivi des dispositifs médicaux au sein
d’un établissement de santé privé type
clinique ?
La
méthode dite QQOQCP
a permis d’analyser la situation, plus particulièrement le
problème sur lequel on s’est focalisé, en recherchant de
façon systématique des informations, et
d’anticiper ainsi sur la recherche des causes.
<!
QUI ?
La
gestion des dispositifs médicaux et leur
suivi concernent tout particulièrement le personnel
biomédical. Il doit permettre la fonctionnalité des
équipements. Il doit aussi veiller à la
sécurité des patients et du personnel soignant qui les
utilise afin d'assurer des conditions de travail adéquate au
sein de cette clinique.
<!
QUOI ?
La
maintenance des dispositifs médicaux est concernée par
l’arrêté du 3 mars 2003 qui rend obligatoire la
maintenance de certaines catégories d’équipement à
usage médicale.
<!
OU ?
La
clinique Vauban comme tous les établissements de santé
ont un objectif commun : assurer la sécurité et la
qualité des soins.
<!
QUAND ?
L’établissement
est entré dans une démarche qualité continue
depuis déjà quelques années et la mise en place
d’une gestion des dispositifs médicaux doit refléter ce
processus constant.
!--
COMMENT
?
Le
service biomédical s’est doté d’un logiciel de Gestion de
Maintenance Assistée par Ordinateur, GMAO. Ce logiciel va nous
permettre de contrôler et de classifier les équipements
médicaux appartenant à la clinique. Cela
permettra une organisation au cœur de cette cellule ainsi qu’avec les
différents services qui traduisent leurs demandes d’intervention.
<!·
POURQUOI ?
Afin
d’assurer le bon fonctionnement du service biomédical,
d’optimiser la qualité des soins et d’améliorer les
conditions de travail du personnel, qu’il soit salarié de
l’établissement ou prestataire externe.
Ce que l’on attend…
Les
enjeux découlant de cette bonne gestion des dispositifs
médicaux sont multiples : en effet, cette démarche a
un impact considérable sur plusieurs aspects.
<!
MANAGEMENT
Une
bonne gestion des équipements médicaux permettra de
gagner du temps et permettra de fait la mise en place d’une
organisation fiable et efficiente.
<!
MEDICAL
La
gestion des dispositifs médicaux est définie par
l’arrêté du 3 mars 2003. La gestion de la maintenance
assistée par ordinateur (GMAO) permet une meilleure organisation
du service biomédical. Les différents services pourront
envoyer leur demande d’intervention avec ce logiciel. Les informations
de tout ordre, concernant les dispositifs seront ainsi accessibles plus
facilement et permettront à l’avenir un gain de temps
appréciable par l’ensemble du personnel.
<!
RESSOURCES
HUMAINES
Le
gain de temps qui sera ainsi gagné pourra être mis
à profit pour travailler sur la communication avec le personnel
soignant et personnel administratif. Les rôles propres à
chacun seront clairement définis afin d’assurer la
continuité des soins et l’efficience au sein de la clinique
.Enfin les demandes d’interventions pourront être directement
réalisées sur le logiciel par les utilisateurs
<!
COUTS
En
outre, la bonne gestion des DM pourrait dégager des
économies sur les coûts et les budgets affectés
à la cellule biomédicale. En termes de qualité des
soins, la bonne gestion des DM contribuerait à favoriser la
bonne prise en charge du patient entré. Une bonne organisation a
un impact économique qui devient visible sur le long terme.
Les
équipements sont constamment en évolution ; ils
coûtent de ce fait de plus en plus chers ; l’argent qui sera
gagné indirectement par l’organisation de la maintenance
préventive pourra être réinvesti. Les
équipements pourront ainsi être renouvelés.Ces
aspects améliorés permettent de dégager un gain de
temps assez important, l’ingénieur biomédical peut alors
organiser le service de telle sorte à réduire, de
façon certaine, les délais entre la demande d’une
intervention et l’intervention elle-même. Le mode d’intervention
devient alors dépourvu de failles, le service fonctionne
dès lors de façon optimal.Cela laisse la
possibilité à l’ingénieur biomédical de
s’attacher à d’autres projets biomédicaux dans son champ
de compétences. L’ingénieur biomédical
peut accorder davantage de temps à une planification de ses
activités. A long terme, ces projets en cours seront
achevés. Le temps dégagé lui permettra de
s’investir davantage dans une politique d’investissement et maintenance
des équipements biomédicaux.Il pourra
notamment mettre à jour les procédures et autres
documents référents en matière d’intervention de
la cellule biomédicale.
Sur le long terme, l’ingénieur biomédical pourra se
pencher sur le suivi et le contrôle des interventions de
maintenance en vue de réduire les coûts attachés
à ce service.
b) Problème : causes
éventuelles
■
Représentation :
Causes – effets
Les
dysfonctionnements relevés au sein de cette clinique sont
nombreux :
On y distingue plusieurs aspects :
<!
METHODE
La
formation du personnel peut engendrer des difficultés au sein
des différents services. La plupart des appels donnés au
service biomédical concernent principalement des
problèmes d’utilisation des dispositifs médicaux. Durant
les visites effectuées dans les divers services de la clinique,
il est constaté un manque d’information et de sensibilisation du
personnel sur l’importance des équipements médicaux.
Les enjeux ne sont vraisemblablement pas connus des professionnels et
des personnels.
L’encadrement du personnel se révèle être un
facteur non négligeable qui devrait pouvoir contribuer à
l’efficience du service biomédical.
<!
MATERIEL
La
classification des notices et modes d’emploi des équipements
médicaux est essentielle à la cellule
biomédicale : elle pourra ainsi être utile au moment
de la formation des utilisateurs, y compris celle du personnel
soignant.
Les
évolutions technologiques génèrent de nouvelles
problématiques car il convient de s’adapter,
perpétuellement, aux changements : le personnel
détiendra la connaissance des nouvelles technologiques qui lui
permettront alors d’utiliser convenablement les équipements
médicaux.
<!
MOYENS
Déterminer
un budget semble par évidence une étape essentielle. Le
budget alloué au service biomédical fixe les
possibilités du service biomédical. Certains projets
pourront voir le jour, d’autres non, étant soumis à des
contraintes financières pesantes. Un budget limité
restreint fait les perspectives. La
détermination du budget reflète un
impact considérable sur le fonctionnement du service : si
les ressources sont amoindries, le parc d’équipements ne sera
pas ou peu alimenté.
<!
MAIN
D ŒUVRE
Le
facteur humain est une donnée particulièrement importante
sur laquelle on peut difficilement intervenir. Il s’avère
pourtant nécessaire de s’y attarder. Le manque de motivation et
d’implication conduit à une mauvaise façon de travailler
au sein d’une structure. Il en découle une mauvaise
utilisation du matériel et une certaine imprudence peut
naître.
<!
MILIEU
Dans
les différents services, le stockage des équipements
médicaux reste un point sensible. Au cours de l’inventaire et de
la classification des dispositifs, on remarque une nouvelle
difficulté : retrouver le matériel entreposé
dans divers espaces et zones non adaptées.
retour
sommaire
La GMAO
Le
grand nombre de réglementations entrées en vigueur et le
nombre non négligeable d’équipements médicaux au
sein d’une structure hospitalière ont amené les services
biomédicaux à investir dans des logiciels de maintenance.
Avant la mise en place de ce logiciel, des étapes longues mais
indispensables doivent être engagées :
Fonctions
La
GMAO [6]
La
GMAO permet de nombreuses choses…
<!
La
gestion des travaux :
La
gestion des interventions permet une organisation et une structuration
des procédures de travail, une facilité à
recueillir les informations et tout ceci concours vers une gestion des
priorités.
La maintenance corrective se développe notamment avec la gestion
des demandes d’intervention permettant à toute personne
autorisée de la clinique de signaler une anomalie, devant
être prise en compte par la maintenance.
La
gestion de la maintenance préventive :
Le suivi de la maintenance préventive au sein de la GMAO permet
de se libérer du suivi manuel et permet ainsi d’obtenir
instantanément toutes les informations techniques que l’on
à besoin. Elle est systématique et fait un état
prévisionnel des situations. Elle permet d’anticiper les
défaillances du système.
<!
La
gestion des stocks et des achats :
La
gestion des stocks permet d’observer le stock de pièces
détachées restantes au sein du service biomédical
.Grace à un système de mise à jour automatique,
cela permet de contrôler les pièces restant en stock et
celles qui doivent être à commander. Ainsi, on tend
à assurer une meilleure gestion et une réduction des
coûts au niveau de la main d’œuvre, des pièces
détachées et du traitement administratif.
<!
Traçabilité
des dispositifs :
La
traçabilité des équipements est engagée
pour répondre à des contraintes réglementaires.
Mais elle garantit le suivi et permet de se tenir au courant des
éventuels dommages qui se sont produits dans les services
utilisateurs de DM.
Assurer la traçabilité permet de diagnostiquer les
problèmes assez rapidement et donc de solutionner ceux-ci. C’est
une visée d’anticipation et ce principe de précaution
traduit la volonté de réduire voire anéantir les
problèmes. On souhaite par ce moyen, une amélioration de
la fiabilité mais aussi de la disponibilité des
équipements médicaux.
♦
Etude de terrain à mener auprès des utilisateurs des
dispositifs médicaux au cours des différentes
interventions du service biomédical ♦
→
La mise en place de la GMAO : un enjeu manifeste du service
biomédical ?
●
OBJECTIFS recherchés
Que
veut-on ressortir de cette étude de terrain, de ce travail
d’observation ?
Les
objectifs visés par cette étude sont multiples : il
s’agit de recenser l’ensemble des problèmes d’ordre
général qui se produisent dans les différents
secteurs d’activité où le service biomédical est
amené à intervenir. Plusieurs possibilités peuvent
être alors exploitables. Il s’agit de mettre en évidence
l’une d’entre elles : une solution possible serait la mise en
place de la GMAO.
●
METHODOLOGIE d’élaboration
de l’étude de terrain
Cette
étude, établie en référence aux
propositions du service biomédical, a été
élaboré en tenant compte :
<!Des
remarques formulées par le personnel,
<!Des
observations de terrain,
<!Des
questionnements dirigés (semi-directifs) aux divers
interlocuteurs
●
ETUDE
D’OBSERVATION
La
cellule biomédicale est complètement
intégrée dans la clinique Vauban : elle participe
à la plupart des réunions de service et entre dans une
réelle dynamique de travail collectif. Son implication est sans
bornes, elle traduit une volonté certaine de conduire des
projets jusqu’à aboutissement. L’établissement s’enrichit
de ce service qui installe une véritable politique de
maintenance. Chaque appareil fait l’objet d’une opération de
contrôle, et la confiance apportée à ce service
semble conforter l’ensemble des personnels, utilisateurs ou non des DM,
ce qui apporte sécurité et bonnes relations de travail.
Toutes
les opérations de maintenance et de contrôle sont
tracées. La GMAO permettra a fortiori de stabiliser le
système.
Néanmoins,
il a été constaté au cours des différentes
interventions durant la période s’étalant du 11 mai 2009
au 29 mai 2009, un certain nombre de dysfonctionnements.
Les dysfonctionnements
repérés par cette étude de terrain :
- Les
signalements sont systématiquement opérés par
contact téléphonique
- La
procédure de demandes relatives aux dispositifs médicaux
est le plus souvent méconnue des personnels utilisateurs, et
lorsqu’elle est connue, elle ne se trouve généralement
pas respectée.
- Les
demandes d’intervention, lorsqu’elles sont faites, ne sont pas
systématiquement transcrites par écrit
- Délais
jugés trop long entre la demande et l’intervention par les
utilisateurs des DM
- Temps
écoulé entre le signalement et la résolution du
problème estimés parfois long suite à un manque de
communications avec les différends services.
- La
grande majorité des personnels disent qu’il n’y a pas
d’identification de l’origine des problèmes rencontrés
qui est du à un manque de formation.
- L’intervenant
du service biomédical, faute de temps, se trouve assez souvent
indisponible.
- Les
informations divulguées par l’intervenant du service
biomédical ne sont pas systématiquement
communiquées.
- Le
personnel n’est pas systématiquement tenu au courant des
éventuelles installations réalisées et/ou projets
en cours dans le domaine biomédical.
- La
diffusion des informations est non efficiente.
4
–Synthèse
→
Des mesures correctives/ des actions d’amélioration doivent
être apportées afin de résoudre l’ensemble des
dysfonctionnements recensés.
→
Une approche de résolution des problèmes peut être
développée : la classification des DM avec la mise
en place de la GMAO.
→
Améliorer le mode organisationnel du service biomédical
afin de pouvoir alors enclencher les résolutions dans les autres
aspects.
Une
évaluation du service biomédical pourra ainsi être
mis en place grâce a un questionnaire de satisfaction afin de
voir l’impact de la GMAO sur les différends services de la
clinique.
La
gestion de la maintenance assistée par ordinateur est une
démarche qui se veut améliorer l’aspect organisationnel
du service biomédical. Tenir les équipements
médicaux en état permet de garantir la bonne prise en
charge du patient depuis son entrée jusque sa sortie de la
clinique.
L’inventaire
des équipements, la classification qui en est faite, ainsi que
l’enregistrement des incidents survenus sont un moyen de
détecter les dysfonctionnements plus pointus.
Ce
processus appliqué au sein du service biomédical
dégage de larges bénéfices : le gain de temps
offre la possibilité à l’ingénieur
biomédical de s’investir dans d’autres projets visant
l’amélioration continue de son service.
La
mise en place de la GMAO
a permis de dégager du temps, ce temps nécessaire au
management opérationnel avec l’implication des personnels, et
des intervenants potentiels. Les ressources humaines s’avèrent
être un point essentiel dans le bon fonctionnement du service
biomédical. Il s’agit à l’avenir de développer la
participation de tout le personnel, ceci pour favoriser
l’efficacité des interventions.
La
mise en place de la maintenance préventive au sein de cette
clinique a permis un nouveau départ dans le fonctionnement du
service biomédical.
Durant
le stage on a pu constater de nombreux problèmes d’organisation,
dû à l’inexistence de la GMAO. Avec la mise en place de
celle-ci, on va pouvoir sur le long terme évaluer le
fonctionnement du service biomédical à travers les
utilisateurs des dispositifs médicaux par une
enquête.
Après
une étude de terrain effectuée avant la mise en place de
cette organisation, il a été mis en évidence
certains dysfonctionnements à travers les différentes
rencontres informelles du personnel.
Après
avoir installé la GMAO, l’examen de l’impact
dégagé de cette classification devra être fait.
Pour cela, une seconde enquête sera envisagée dans des
conditions définies.
Celle-ci
aura pour but d’évaluer la mise en place de la GMAO, de voir si
elle a eu des effets positifs et si elle a permis des évolutions
par la suite.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
■
Un travail particulièrement important reste à programmer
dans la planification des interventions sur les dispositifs
médicaux, globalement l’aspect organisationnel.
L’ingénieur biomédical, ayant réalisé sa
planification, sera moins demandé par ces interventions. Il
dégagera du temps pour l’explication des
démarches d’intervention aux utilisateurs. La transmission de
ces conseils tend à l’avenir vers une éducation pour tous
à la maintenance : chaque utilisateur pourra de
façon autonome être acteur, à proprement dit, dans
l’organisation et le fonctionnement de la cellule biomédicale.
■
Cette approche implique en parallèle la mise en place des
formations aux utilisateurs afin qu’ils puissent eux-mêmes
régler sur le terrain les problèmes d’ordre mineur.
Là encore, du temps sera dégagé permettant
à l’ingénieur de développer d’autres projets et
d’attacher un investissement particulier à de nouvelles
perspectives d’avenir pour la pérennité de la clinique.
Si les formations apparaissent non évidentes à
planifier pour cause de non disponibilité des professionnels
médicaux et paramédicaux, il
faut alors envisager d’avoir recours à des interventions plus
mobilisatrices. Comment fédérer le personnel ?
Cela passe par une mesure :
imposer les contraintes à tous. Ce
sont des professionnels qui ne
souhaitent pas que l’on rallonge leur temps de travail d’autant que ça n’entre pas dans
leur champ d’activités
Il faut trouver une façon de les impliquer : parler de
l’enjeu de la sécurité, et de la responsabilité
médico-légale de chacun des membres composant
l’équipe. Les attacher aux principes de responsabilité et
d’éthique professionnelle qui gouvernent l’activité
médicale… cela dans le but de leur faire prendre conscience de
l’utilité de la formation sur « les principes de
fonctionnement des DM »
car, au bout du compte, elle s’avèrera essentielle pour
favoriser une bonne prise en charge du patient.
►Dans
le cas probable où la formation ne serait pas faite, que pourrait-il se passer ? Les personnels utiliseront les DM sans
avoir eu d’informations, et comme ces gestes là
ne figurent pas dans leurs compétences et leur champ
d’activités, ils risqueraient de commettre des imprudences dans l’utilisation des DM, et dans le pire des scénarios, des
conduites qui seraient néfastes au patient.
La
formation permettrait d’éviter les maladresses et sans doute
d’autres conséquences beaucoup plus fâcheuses, autant pour
l’utilisateur que pour le patient.
Maintenant
se pose la question des vacataires, présents pour une
période déterminée, la formation doit-elle
être donnée au personnel qui ne restera pas dans la
clinique. Le retour sur investissement ne serait pas atteint ici.
■
Les gains financiers qui découlent de la mise en place de la
G.M.A.O. à long terme, seront une plus-value pour la structure.
En effet les économies engendrées permettront d’appuyer
de nouveaux projets, une marge de manœuvre importante pour
l’évolution de la clinique.
BIBLIOGRAPHIE
<!
OUVRAGES :
●
Coisne, D. (2006), Ingénierie biomédicale. Les
XIes journées d’études de l’Association
française des ingénieurs biomédicaux, p. 25-29
●
Pillot, A. (1989), Installation d’une G.M.A.O en milieu hospitalier
(gestion de maintenance assistée par ordinateur),
volume 44-521, p. 35-38
●
Poyet,
A. (2003), Le dispositif médical, aspects
réglementaires et économiques, évolution
sur les dix dernières années. Thèse de
doctorat en pharmacie, Lyon : Université Lyon-I
<!
SITOGRAPHIE:*
●
http://www.has-sante.fr
●
http://www.afssaps.fr
●
http://www.afib.asso.fr
[1]: http://www.clinique-vauban.fr
[2] :
« Principe de contrôle d’un
équipement »
http://fr.wikipedia.org/wiki/fichier:logigramme_controle.svg
[3] :
Acteurs en relation avec le service biomédical,
réalisé par l’auteur
[4] : »
Maintenance préventive et contrôle qualité du
défibrillateur », S. Coing, stage
TSIBH,
UTC, 2006
[5] :
Ce que l’on recherche, réalisé par l’auteur
[6] :
Représentation Causes-effet, réalisé par l’auteur
[7] :
La GMAO, réalisé par l’auteur
[8] :
Enquête de satisfaction, réalisé par l’auteur
ANNEXES
Annexe
1 :
<!
Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes
des dispositifs médicaux soumis
à l’obligation de maintenance et au contrôle de
qualité mentionnés aux articles L. 5212-1 et D. 665-5-3
du code de la santé publique.
Annexe
2 :
<!
Organigramme hiérarchique de la clinique Vauban
Annexe
3 :
<!
Procédure de demande d’intervention
Annexe
4 :
<!
Formulaire
de « Demande d’intervention »