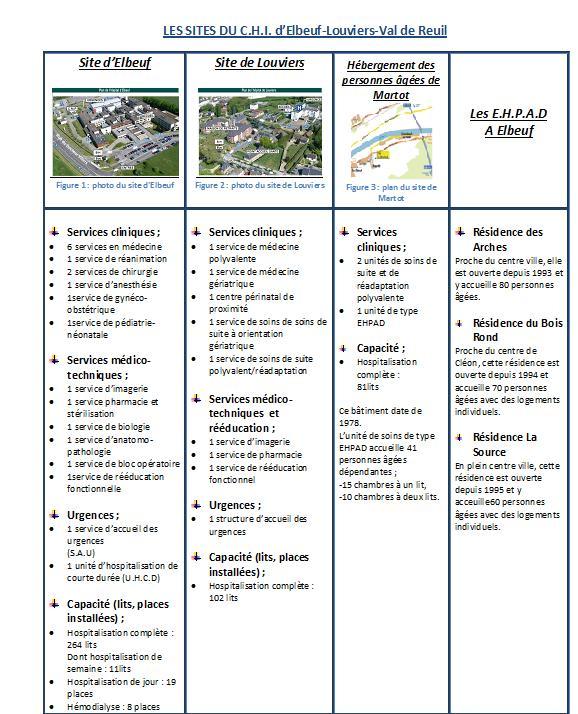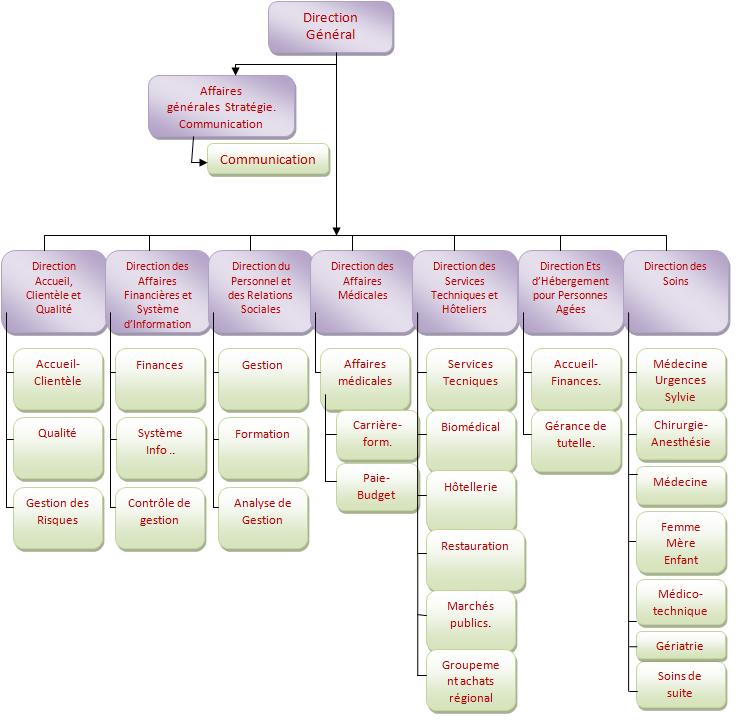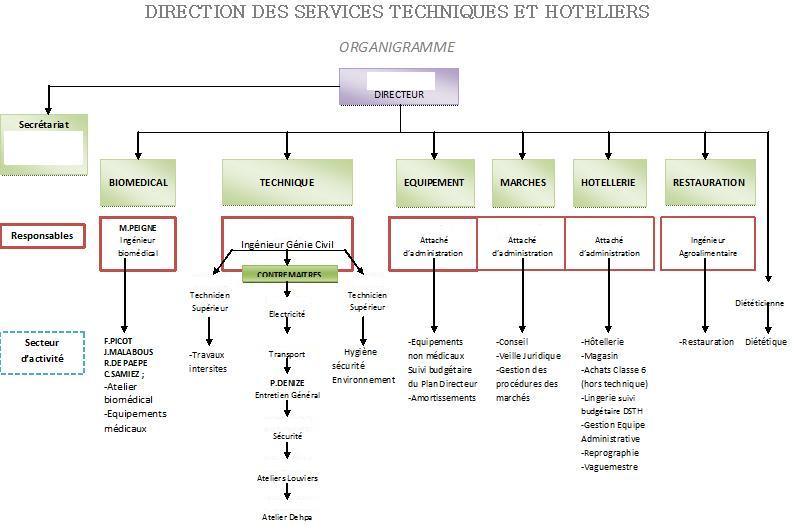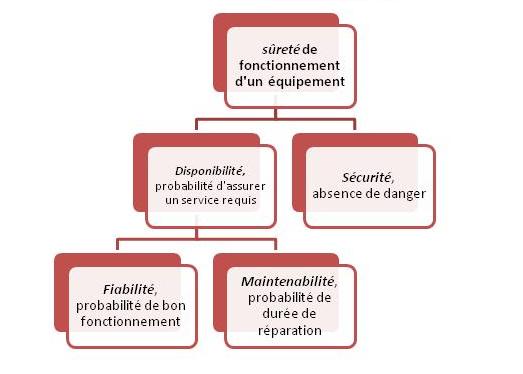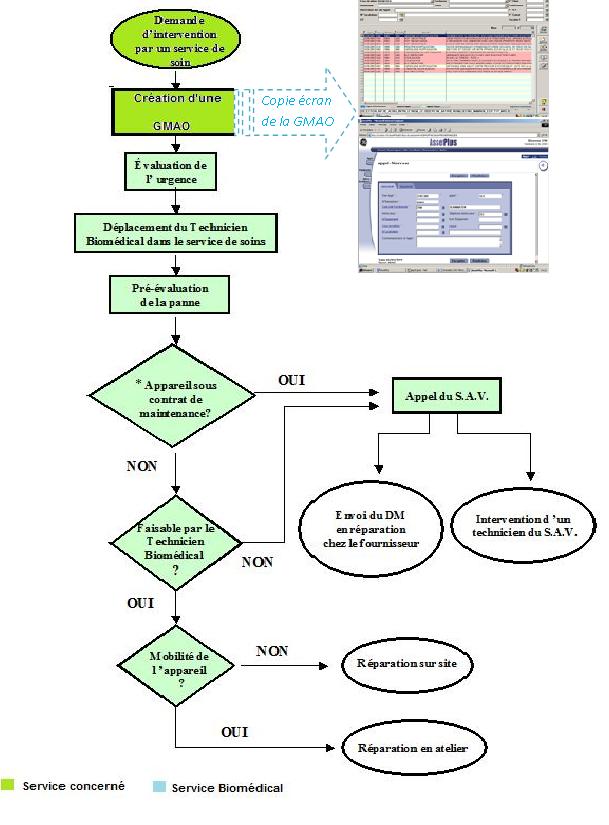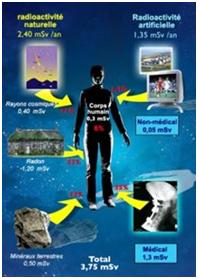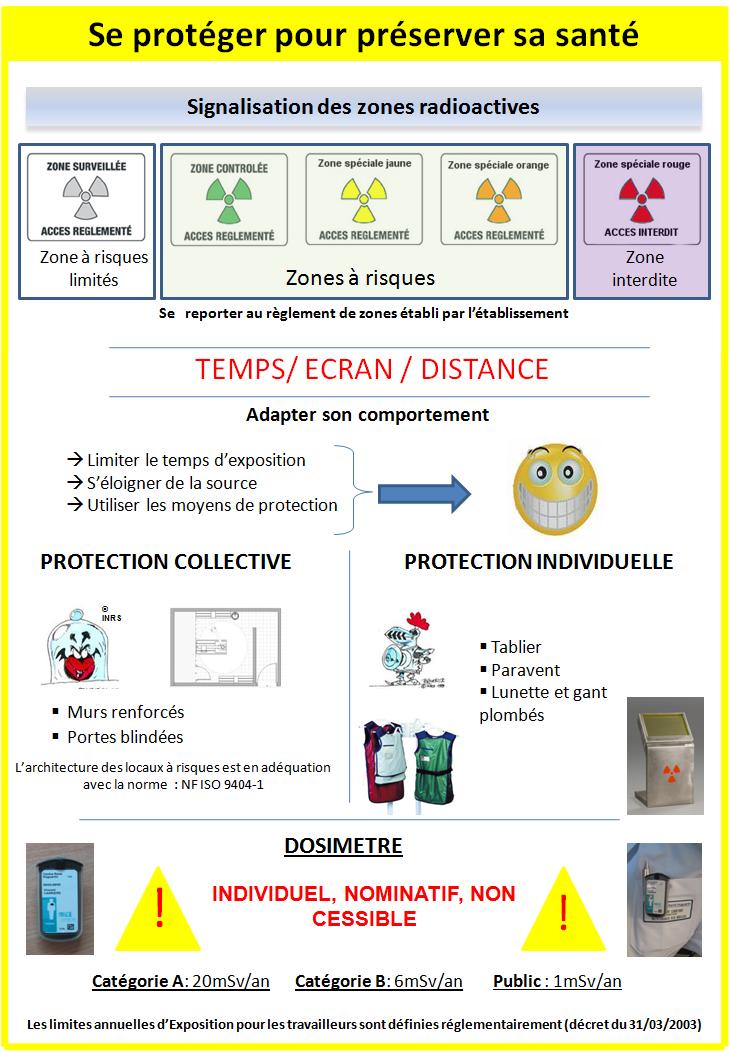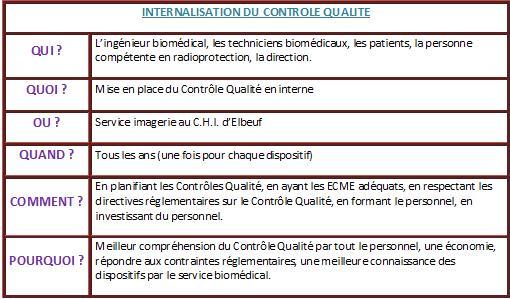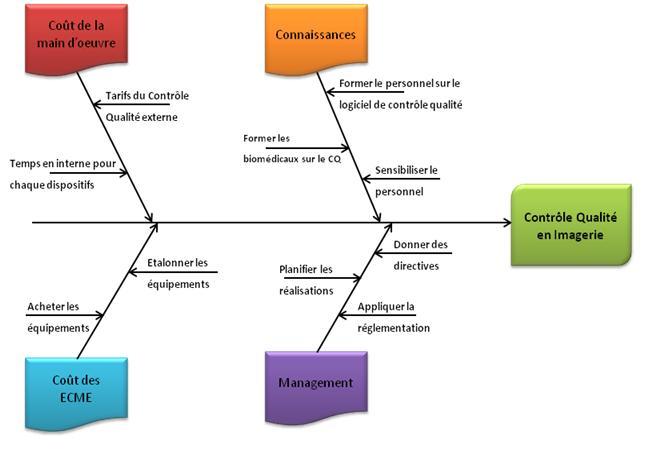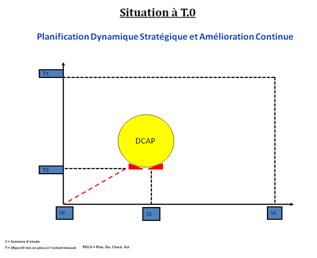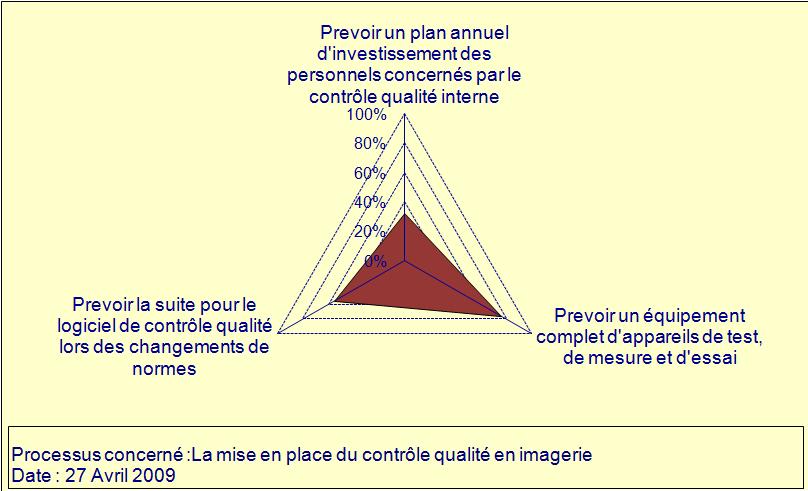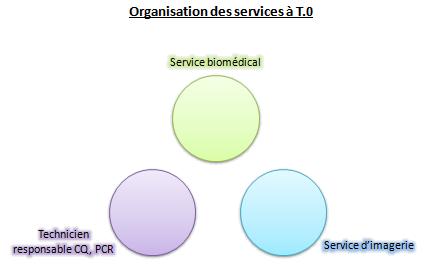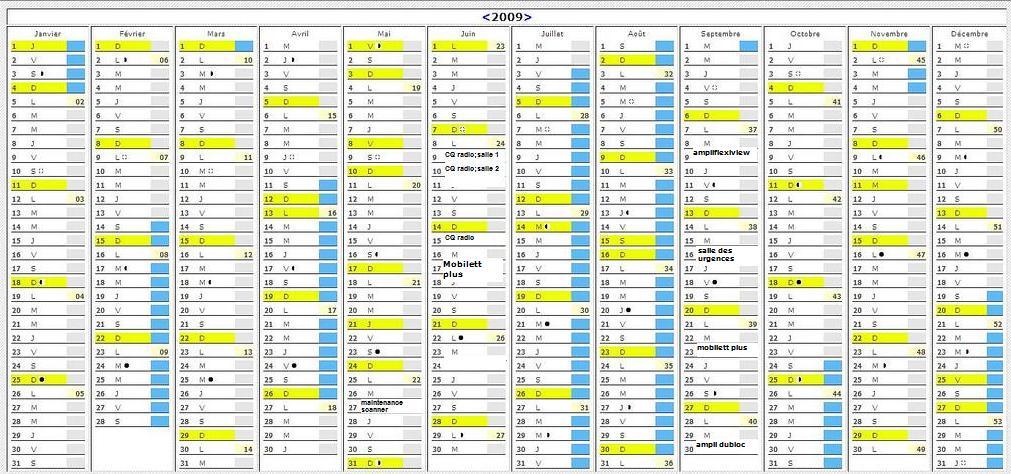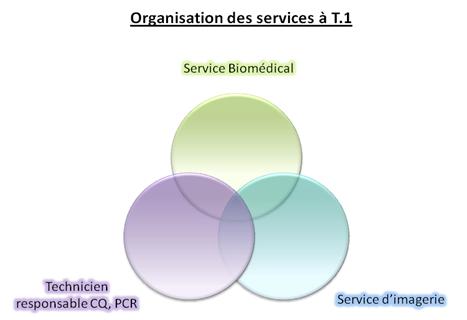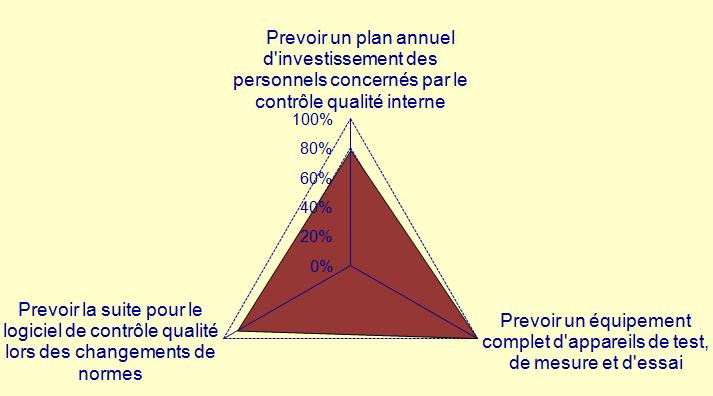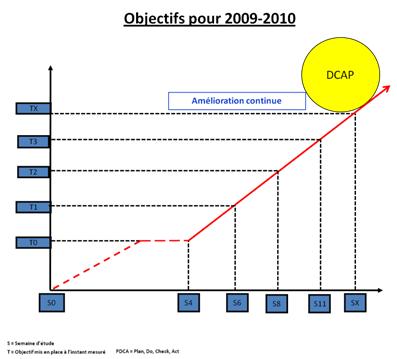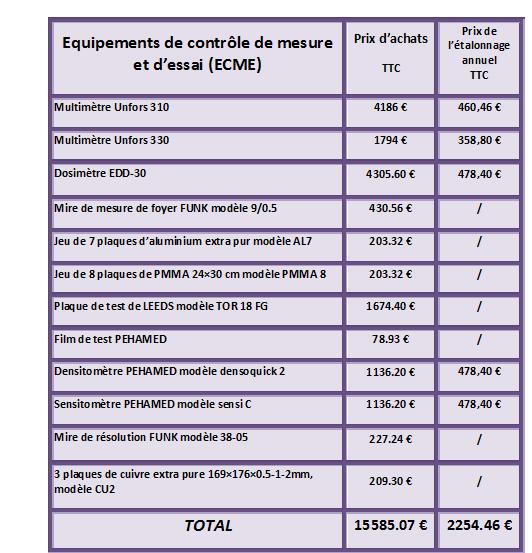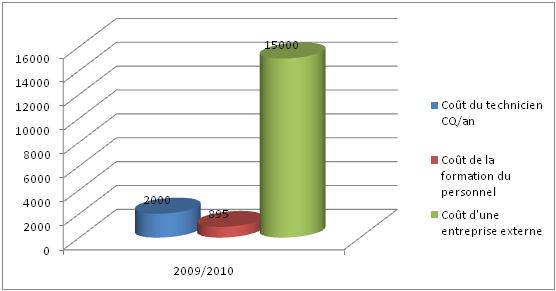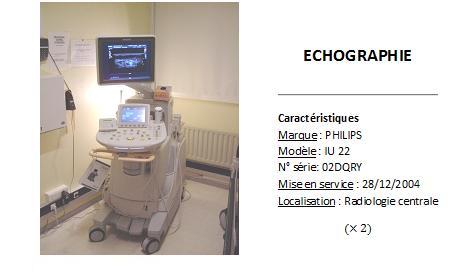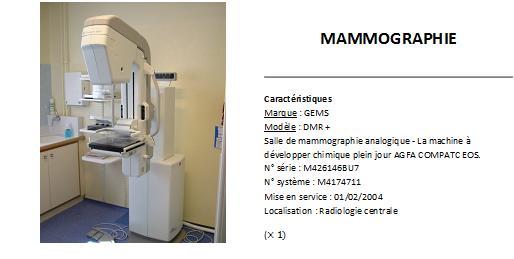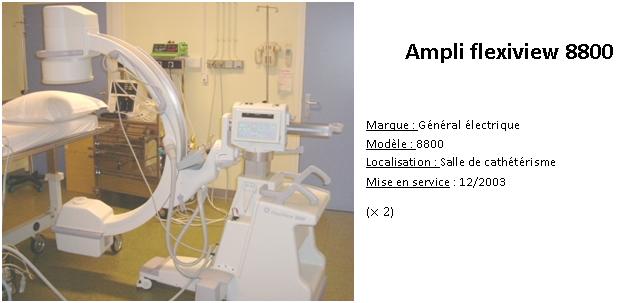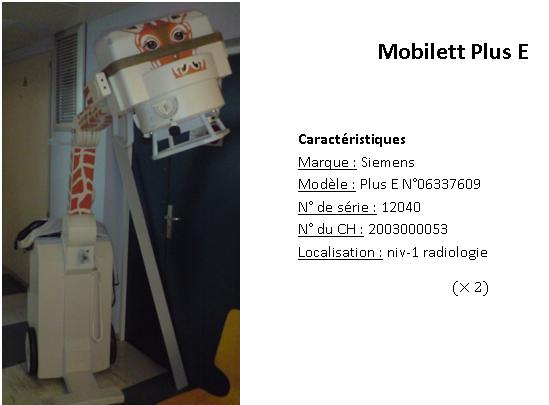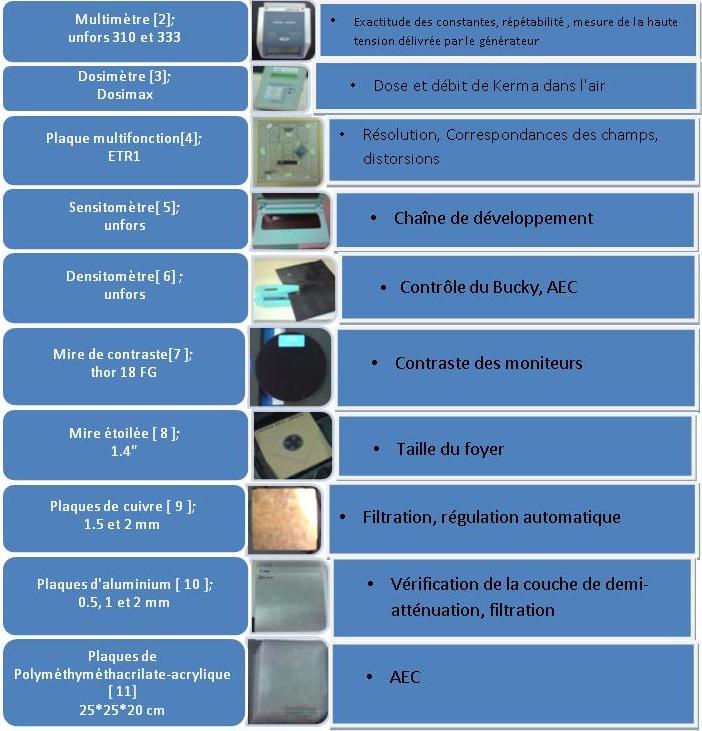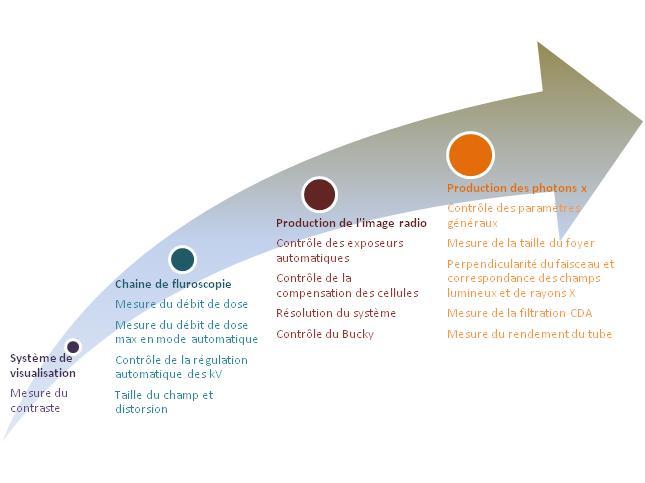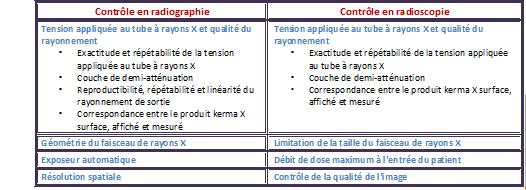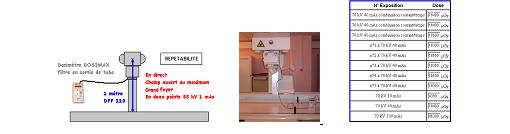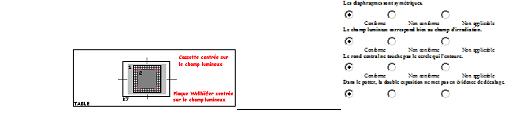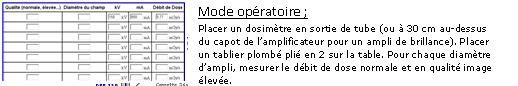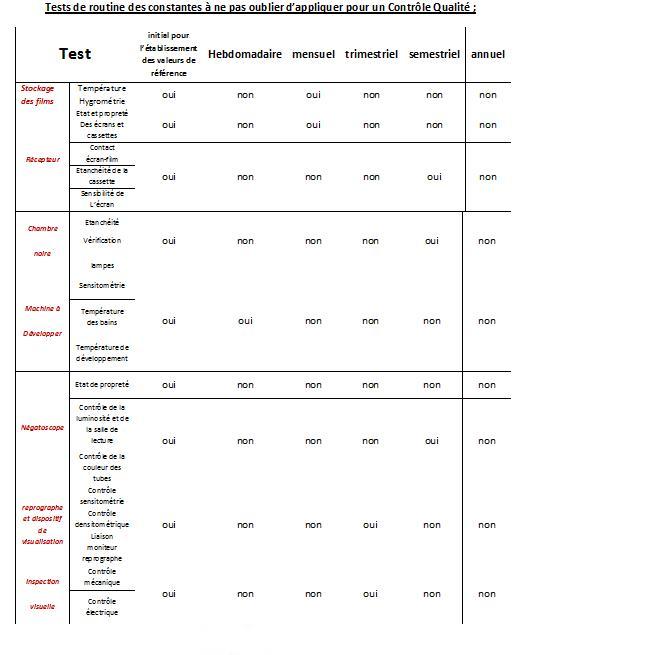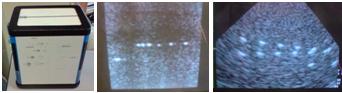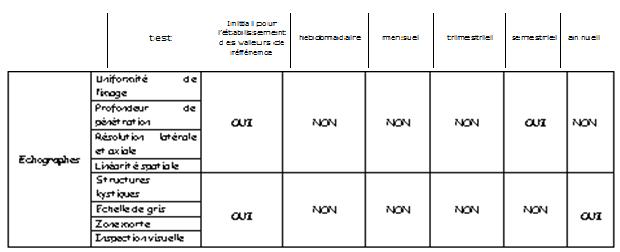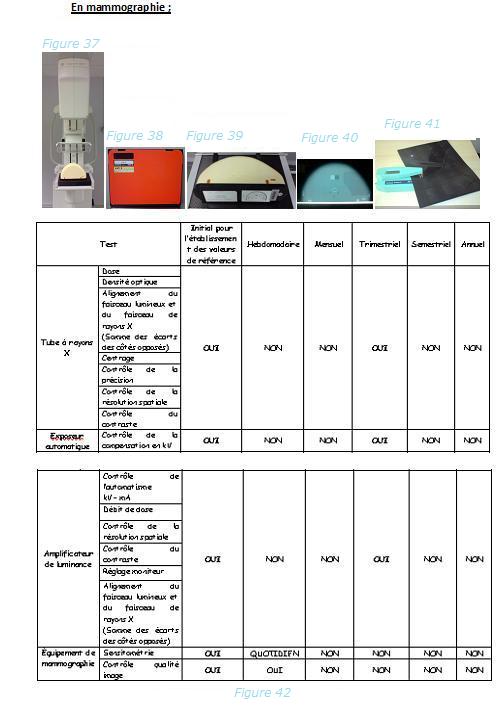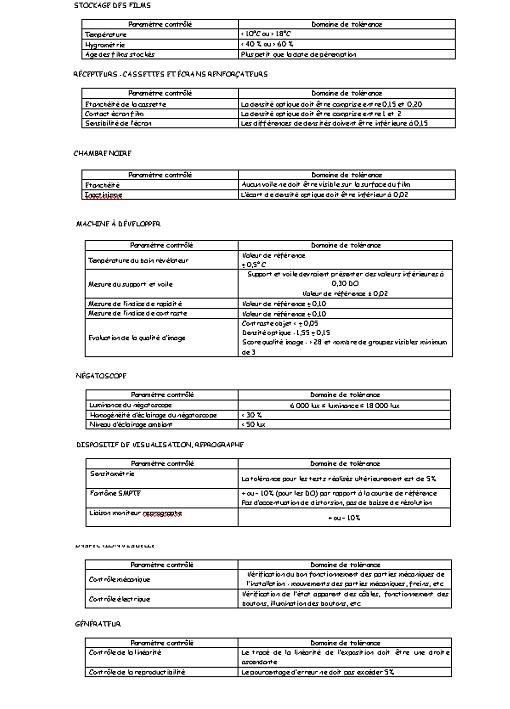LES
SITES DU C.H.I.
d’Elbeuf-Louviers-Val
de Reuil
Figure 4
Son
organisation
L’organisation des soins répartis par pôles
d’activités au C.H.I. d’Elbeuf
Activité
des soins du site
Figure 5
-->
Quelques chiffres sur le
C.H.I. Elbeuf/Louviers ;
L’hôpital est doté de 946 lits dont 469 lits de
médecine chirurgie obstétrique, soins de suite et de
réadaptation, d’un plateau technique conséquent (blocs
opératoires, services d’imagerie avec scanner et I.R.M.,
laboratoires) et 477 lits pour personnes âgées.
Il compte un effectif de 1428 personnes dont plus de 150
médecins.
en 2007, L’hôpital a enregistré 26 361 entrées en
hospitalisations et 180 873 en consultations externes.
Le centre hospitalier Intercommunal dessert un bassin de près de
200 000 habitants de la Seine-Maritime et de l’Eure.
54% des patients accueillis
(hospitalisés et externes)
sont
domiciliés en Seine-Maritime et 43% sont de l’Eure.
- Sur le
site de Louviers :
89% des patients
accueillis (hospitalisés et externes)
sont
domiciliés dans l’Eure et 6% des patients sont de Seine-Maritime.
En 2007, le C.H.I.
a été certifié par la Haute
Autorité de Santé sans aucune remarque au regard de la
qualité de ses services.
Organigramme de direction du
C.H.I.d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil
Direction des services
techniques et hoteliers
Figure 7
2.
Présentation du
service biomédical
Dans le cadre de
l'activité d'Hémodialyse, les
techniciens biomédicaux assurent, en alternance et chacun leur
tour, la maintenance préventive, curative et le contrôle
qualité du lundi au samedi inclus.
L'activité d'Hémodialyse nécessite des
interventions journalières sur le traitement de l'eau et
ponctuel (préventive et curative) sur les
générateurs d'Hémodialyse.
QUATRE
TECHNICIENS SONT PRESENTS AU SEIN DU SERVICE BIOMEDICAL AVEC UNE
ORGANISATION COMME LA SUIVANTE ;
Un technicien responsable de dialyse
(Horaires
: 8h - 12h et 13h - 16h30)
Sa fonction :
• Il prend
en charge la dialyse de 8h à 16h30
et le BIP de 8h à 9h.
• Toutes les semaines, il gère la
désinfection du traitement d'eau en réanimation.
• Le technicien de dialyse est d'astreinte le samedi
et les jours fériés de 7h à 18h30. Il est
présent dans le service d'hémodialyse le samedi à
7h pour le contrôle du traitement d'eau et pour la maintenance
des générateurs d'hémodialyse.
• Le technicien de dialyse assure les
dépannages et également les urgences sur les sites
annexes.
Un technicien responsable d'atelier
(Horaires
: 8h - 12h et 13h - 16h30)
Sa fonction :
• Il prend
en charge les dépannages à
l'atelier, les dépannages en retard de sa semaine de BIP,
lorsqu'il était technicien d'urgence et le préventif dans
son secteur de référence.
Un technicien d'Urgence (de BIP)
(Horaires :
9h - 12h et 13h - 17h30 le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. 9h
- 12h et 13h - 23h30 le mercredi.)
Sa fonction :
• Il prend
en charge les nouveaux appels GMAO, les
urgences sur le BIP et les messages sur le répondeur du service.
• Il assure la maintenance curative des
équipements du service d'hémodialyse (traitement d'eau et
générateurs) de 15h30 à 17h30.
• Le mercredi de 17h30 à 23h, il est
chargé de la désinfection du traitement d'eau de
l'hémodialyse et de la stérilisation.
Un technicien de préventif
(Horaires :
8h - 12h et 13h - 16h30.)
Sa fonction :
•
Pendant
sa semaine de préventif et
d'atelier, le technicien référent assure et organise la
maintenance préventive, le contrôle de qualité des
équipements IIa et IIb, la rédaction et la mise à
jour des procédures des générateurs
d'hémodialyse, du matériel de stérilisation.
•
Pendant
sa semaine de préventif et
d'atelier, le technicien référent la maintenance
préventive, le contrôle de qualité des
équipements IIa et IIb, la rédaction et la mise à
jour des procédures du matériel d'anesthésie, de
réanimation et de bloc opératoire.
• Pendant sa
semaine de préventif et
d'atelier, le technicien référent assure la maintenance
préventive, le contrôle de qualité des
équipements IIa et IIb, la rédaction et la mise à
jour des procédures du matériel de cardiologie, de
médecine, d'explorations fonctionnelles et du petit
matériel.
• Pendant sa
semaine de préventif et
d'atelier, le technicien référent assure la maintenance
préventive, le contrôle de qualité des
équipements IIa et IIb, la rédaction et la mise à
jour des procédures du matériel de radiologie et
d'imagerie.
• Chaque
technicien assure en
priorité la
maintenance préventive des dispositifs médicaux se
rapportant au secteur pour lequel il est référent, mais
aussi les maintenances préventives des " petits
équipements " selon la charge de travail et le planning commun.
Le
but du
service biomédical est le suivant;
Le
but du service biomédical vu précédemment est
visé grâce à l’organisation décrite dans le
logigramme suivant ;
Le but de l'imagerie médicale est
de créer une
représentation visuelle intelligible d'une information à
caractère médical. Cette problématique s'inscrit
plus globalement dans le cadre de l'image scientifique et technique :
l'objectif est en effet de pouvoir représenter sous un format
relativement simple une grande quantité d'informations issues
d'une multitude de mesures acquises selon un mode bien défini.
L'image obtenue peut être traitée informatiquement pour
obtenir par exemple :
• une
reconstruction tridimensionnelle d'un organe ou
d'un tissu ;
• un film montrant l'évolution ou
les
mouvements d'un organe au cours du temps ;
• une imagerie quantitative qui
représente les
valeurs mesurées pour certains paramètres biologiques
dans un volume donné ;
• une représentation multimodale
recalant
plusieurs données au sein d'un même document (contour du
cœur et mobilité des parois par exemple).
Dans un sens plus large, le domaine de l'imagerie
médicale englobe toutes les techniques permettant de stocker et
de manipuler ces informations. Ainsi, il existe une [norme] pour la
gestion informatique des données issues de l'imagerie
médicale : la norme DICOM.
2.
Les
différentes techniques d'imagerie
médicale
Suivant les techniques utilisées, les examens d’imagerie
médicale permettent d’obtenir des informations sur l’anatomie
des organes (leur taille, leur volume, leur localisation, la forme
d’une éventuelle lésion, etc.) ou sur leur fonctionnement
(leur physiologie, leur métabolisme, etc.). Dans le premier cas
on parle d'imagerie structurelle et dans le second d'imagerie
fonctionnelle.
Parmi les méthodes d'imagerie structurelles les plus couramment
employées en médecine, on peut citer d'une part les
méthodes tomographiques basées soit sur les rayons X
(radiologie conventionnelle, tomodensitomètre ou CT-scan,
angiographie, ...) soit sur la résonance magnétique
(IRM), les méthodes échographiques (qui utilisent les
ultra-sons), et enfin les méthodes optiques (qui utilisent les
rayons lumineux).
Les méthodes d'imagerie fonctionnelles sont aussi très
variées. Elles regroupent les techniques de médecine
nucléaire (TEP) basés sur l'émission de rayons
gamma par des traceurs radioactifs qui, après injection, se
concentrent dans les régions d'intense activité
métabolique, les techniques électro physiologiques qui
mesurent les modifications de l'état électrochimique des
tissus (en particulier en lien avec l'activité nerveuse).
Ces différents types de techniques sont souvent employés
de façon complémentaire parfois même au sein d'un
même système d'imagerie qui permet alors des acquisitions
multimodales, simultanées ou non.
Les
champs
magnétiques
• Imagerie
par résonance magnétique
(IRM), utilisant l'effet d'un champ magnétique intense. C'est un
procédé permettant d'obtenir des "coupes virtuelles" du
corps suivant trois plans de l'espace. En fonction des
paramètres choisis, l'IRM permet d'obtenir des images
très contrastées de certains tissus en fonction de leurs
propriétés. C'est donc un outil particulièrement
utilisé en imagerie cérébrale. Les examens IRM
sont considérés à ce jour sans risque sur
l'organisme. Cependant, tout objet ferromagnétique, sensible au
champ magnétique (piercing, pacemaker, certaines
prothèses, etc.), est dangereux.
• La
magnétoencéphalographie (MEG) est
une technique de mesure des faibles champs magnétiques induits
par l'activité électrique des neurones du cerveau.
Contrairement à l'IRM, elle ne repose pas sur l'aimantation
préalable des tissus. Par conséquent, la présence
d'objet magnétique ne pose aucun risque.
• La
magnéto cardiographie est une technique
très analogue à la précédente qui consiste
à mesurer les champs magnétiques induits par
l'activité électrique des cellules du muscle cardiaque au
niveau du torse. Elle n'est que très peu utilisée.
Les
rayons
X
L'utilisation de rayons X est d'usage courant. Ces rayonnements,
comme
les rayons gamma sont ionisants et donc dangereux. En particulier,
l'irradiation d'une cellule en phase de mitose peut provoquer une
mutation de l'ADN et qui peut provoquer l'apparition d'un cancer
à terme. Toutefois, grâce aux mesures de radioprotection,
le risque inhérent aux examens X est limité autant que
possible.
Différents types d'examens utilisent les rayons X :
•
Radiographie, utilisant des rayons X et parfois
l'injection de produit de contraste. Les images obtenues sont des
projections des organes et des différents systèmes
suivant un plan. Généralement, la radiographie est
utilisée pour le système osseux car il s'agit du
système le plus visible sur une radiographie du corps.
• Scanner
X, tomographie utilisant les rayons X. Les
images obtenues sont des coupes millimétriques (ou
infra-millimétriques) pouvant être étudiées
dans tous les plans de l'espace, ainsi que des images
tridimensionnelles.
• Scanner
DEXA mesurant la densité osseuse (ou
ostéodensitométrie).
Les
ultrasons
•
Échographie, utilisant des ultrasons.
L'image obtenue est une coupe de l'organe étudiée. Il
peut être associé à un examen doppler analysant la
vitesse du sang dans les vaisseaux ou dans les cavités
cardiaques ou à une mesure du module de Young par couplage
à une vibration de basse fréquence (technique des
années 2005).
Les rayons lumineux
Les technologies d'OCT (Optical Coherent Tomography) permettent
d'obtenir une image par réalisation d'interférences
optiques sous la surface du tissu analysé. Ces
interférences sont mesurées par une caméra (OCT
plein champ) ou par récepteur dédié (OCT
traditionnelle). Ces techniques sont non destructives et sans danger.
• OCT plein
champ. C'est la plus performante des
techniques OCT. L'image obtenue est une biopsie optique virtuelle.
C'est une technologie en développement qui permet, grâce
à sa résolution (1 µm dans les 3 dimensions X, Y,
Z) de voir l'organisation cellulaire en 3 dimensions. Les images son
réalisées en plan, à la manière de photos
prises au dessus du tissu, mais à différentes profondeurs
sous la surface du tissu observé. Cette technique utilise une
source lumineuse blanche (spectre large).
• OCT
traditionnelle. L'image obtenue est une coupe
du tissu étudié. La résolution est de l'ordre de
10 à 15 µm. Cette technologie utilise un laser pour
réaliser les images.
La
radioactivité;
Figure
10
Les
techniques de scintigraphie nucléaire reposent sur
l'utilisation d'un traceur radioactif qui émet des rayonnements
détectables par les appareils de mesure. Ces molécules
radio pharmaceutiques sont choisies pour se fixer
préférentiellement sur certaines cellules selon le type
de diagnostic voulu. Un traitement informatique des données
permet ensuite de reconstituer l'origine spatiale de ces rayonnements
et de déduire les régions du corps où le traceur
s'est concentré. L'image obtenue est le plus souvent une
projection mais on peut obtenir une coupe ou une reconstruction 3D de
la répartition du traceur.
•
Tomographie d'émission mono photonique :
elle utilise l'émission de photons gamma par une molécule
marquée par un isotope radioactif injecté dans
l'organisme.
•
Tomographie à émission de positon
(TEP ou PET) : elle utilise le plus souvent du sucre (un analogue du
glucose) marqué par un corps radioactif émettant des
positons (e.g., Fluor 18), et permet alors de voir les cellules
à fort métabolisme (ex : cellules cancéreuses,
infection...).
La TEP permet en général d'obtenir des images
de
meilleure qualité que la TEMP. Toutefois, le nombre et la
disponibilité des radios pharmaceutiques utilisables en TEMP
ainsi que le coût modéré des gamma-caméras
compensent ce défaut.
3.
Quelques notions
sur la radioprotection
Figure 11
D’autres
notions sont fournies sur le dépliant joint en annexe
(annexe 1), obtenue lors d’une formation sur la radioprotection
le Lundi 18 Mai 2009 par Mme Poulain (PCR).
III. Présentation
du projet
La
qualité est l'aptitude qu'a un objet
ou une fonction à répondre à des exigences,
à des besoins définis par l'utilisateur, par des normes.
" Ensemble des propriétés et caractéristiques d'un
produit ou service qui lui confèrent l'aptitude à
satisfaire à des besoins exprimés ou implicites. "
Les services biomédicaux sont de plus en plus concernés
par la maintenance et le contrôle de qualité des
dispositifs médicaux.
Depuis la parution au Journal officiel du décret n°2001-1154
du 5 décembre 2001 et de son arrêté d'application
du 3 mars 2003, les services biomédicaux ont dorénavant
obligation de maintenance pour tous les équipements de classe
IIb et de classe III, ils ont obligation de maintenance, de
contrôles de qualité interne et externe pour les
équipements émetteurs de rayonnements ionisants.
Le contrôle de qualité est défini par l'ensemble
des opérations destinées à évaluer le
maintien des performances.
Le contrôle de qualité est dit interne s'il est
réalisé par l'exploitant ou sous sa
responsabilité par un prestataire.
Il est dit externe s'il est réalisé par un organisme de
contrôle agréé par l'AFSSAPS.
C'est le directeur de l'AFSSAPS qui définit les modalités
de contrôle sous la forme de circulaires et de
décisions publiées.
Deux
solutions s'offrent aux services biomédicaux pour
répondre aux contraintes réglementaires :
- Sous-traiter les interventions de
maintenance et de contrôle de qualité. Mais
les prestations externes ont un coût relativement
élevé. Un marché de maintenance et de
contrôle de qualité visant à mettre en concurrence
des sociétés pour la maintenance préventive et le
contrôle de qualité externe des équipements de
radiologie est publié au JO. A l'heure actuelle, seule la
mammographie est concernée par le contrôle de
qualité externe.
- La deuxième possibilité est de
prendre en charge en interne, dans le cadre des
compétences propres au service, les interventions de
contrôle de qualité interne.
Un
QQOQCP est mis en œuvre afin de ciblé les différents
points importants à la réalisation du CQ ;
Figure 12
Personnel
concerné;
Le directeur de l’établissement est responsable de tout
problème au niveau de la protection des personnels soignants.
Bien sûr il ne peut pas gérer tout cela tout seul, il
délègue donc des droits à une personne
compétente de la radiologie. Pour Elbeuf cette personne est la
responsable de la radiologie qui est elle-même Personne
Compétente en Radioprotection.
En collaboration avec l’ingénieur biomédical et le
service biomédical, le service de radiologie (manipulateur et
PCR) devra réaliser les contrôles de qualité,
suivre l'évolution des indicateurs de qualité,
réfléchir sur l'amélioration des contrôles
et des performances. Pour une entente et un contrôle
qualité excellent, il faut, bien entendu, avoir une bonne
organisation. Pour cela une ébauche de planning pourrait
être réalisée et validée par tous les
acteurs qui participent au Contrôle Qualité comprenant la
date, l’heure, les différents tests à réaliser.
Traçabilité;
Chaque protocole de contrôle de qualité est
accompagné d'une fiche d'enregistrement. Au CHI d’Elbeuf, les
protocoles sont enregistrés avec le logiciel
développé par un ancien technicien biomédical du
site pour se qui concerne les appareils de radiologie fixes et mobiles.
Ce logiciel a été créé sur un support
PHP/MySQL et assure l’accompagnement des tests de Contrôle
Qualité en imagerie et permet d’imprimer le rapport
d’intervention complet ainsi que tous les tests effectués.
Les protocoles devront être validés par le service de
radiologie, par la cellule qualité, par les constructeurs, par
l'AFSSAPS.
POURQUOI LE CONTROLE DE QUALITE EN
INTERNE ?
3 raisons de réaliser le
contrôle de qualité
interne par le service de radiologie, on retrouve les différents
points du « pourquoi » du tableau précédent
(QQOQCP) ;
• Il s'agit
dans
un
premier temps de répondre
aux contraintes réglementaires, à savoir le décret
du 5 décembre 2001 et à son arrêté
d'application du 3 mars 2003. Quelques points sont mis en
évidence dans ce décret ;
La maintenance est réalisée
soit par
:
- le fabricant,
- le fournisseur,
- l'exploitant.
La définition issue du texte ne distingue pas la maintenance
préventive de la maintenance curative.
-->Le contrôle de qualité est sous la
responsabilité de l'exploitant. Il peut choisir de le
réaliser en interne ou de le sous-traiter.
C'est le directeur de l'AFSSAPS qui détermine les
modalités de contrôle, publiées sous la forme de
décisions au JO, or aujourd'hui seuls les équipements de
radiothérapie, de médecine nucléaire et la
mammographie sont concernés (circulaire du 3 mars 2003).
• De
plus,
l'exploitant doit tenir à jour un
inventaire des dispositifs médicaux dans un souci de
traçabilité.
L'arrêté du 3 mars 2003 fixe la liste des
dispositifs
médicaux concernés par le décret d'obligation
ainsi que les délais de l'application.
Les équipements de radiologie sont très largement
concernés par l'obligation de maintenance, de contrôles de
qualité interne et externe.
Le contrôle de qualité externe ne concerne pour
l'instant que la mammographie,
La maintenance et le contrôle de qualité interne doivent
être mis en application depuis le 1er janvier 2005. La
maintenance préventive des équipements de radiologie fait
l'objet d'un marché de maintenance.
Un autre point important est mis en évidence dans
l'arrêté : sont soumis également à
l'obligation de maintenance et de contrôle de qualité les
matériels nécessaires à la production et à
l'interprétation des images. Il faut donc intégrer aux
procédures le contrôle des négatoscopes et des
systèmes de développement.
• Et
pour finir
l’Intérêt
économique
Les contrats de maintenance et de contrôle de
qualité proposés par les sociétés sont
très onéreux. Le matériel de test
nécessaire à la réalisation du contrôle de
qualité interne est nettement plus faible, d'autant plus que la
majorité du matériel nécessaire a
déjà été acquis. Il faut toutefois tenir
compte de la vérification et de l'étalonnage annuel des
appareils de mesures (kilovoltmètres et des
dosimètres.)
Définir des
indicateurs de qualité, valeurs
numériques de performances mesurables qui permettront un suivi
de l'évolution dans le temps. Toute dérive d'un
élément contrôlé pourra aboutir soit
à une action corrective soit à un processus
d'amélioration. Le but de l'identification d'indicateurs de
qualité est d'inscrire nos contrôles de qualité
dans une démarche d'amélioration de la qualité.
Décision de l’AFSSAPS
L’AFSSAPS a mis en place en novembre 2006 un texte
réglementaire
sur les modalités du contrôle interne en radiodiagnostic.
Il ne précise nullement les modalités du contrôle
externe.
Le contrôle qualité interne doit être
réalisé par l’exploitant ou par un prestataire
extérieur en étant sous sa responsabilité.
Le contrôle qualité externe est réalisé par
un organisme indépendant du fabricant et de celui qui
assure la maintenance. Cet organisme doit être
agréé par l’AFSSAPS.
Les modalités du contrôle qualité externe sont
déterminées depuis la décision du 24 septembre
2007.
D’où les points suivants ;
-->Champ
d‘application pour le contrôle qualité
Plusieurs dispositifs ne rentrent pas dans le champ
d’application du
contrôle qualité en radiodiagnostic comme :
• La
mammographie
• La scanographie
• Le radiodiagnostic utilisé dans la
cadre de
la radiothérapie
• La radiographie dentaire à
l’exception
des installations de téléradiologie à quatre
mètres
On retrouve également :
• Les
cassettes avec les écrans classiques
• Les cassettes avec écran radio
luminescents
à mémoire (ERLM)
• Les reprographes
• Les négatoscopes utilisés
en
radiodiagnostic
-->Périodicité
Pour les installations en service au 1er mars 2007, le
contrôle
qualité interne initial doit être effectué au
maximum au 1er mars 2008 pour les générateurs de plus de
10 ans, et au plus tard au 1er mars 2009 pour les autres installations.
Ce contrôle est à renouveler tous les ans à compter
de l’initial.
Pour les installations en fonctionnement avant le 1er mars 2009, le
premier contrôle externe doit être réalisé au
plus tard six mois après cette date. Pour les dispositifs
installés après le 1er mars 2009, le premier
contrôle devra avoir lieu au maximum 3 mois après la mise
en service.
-->Traitement
des non-conformités
Les non-conformités mises en évidence par le
contrôle qualité sont de deux types :
• Graves.
Elles nécessitent
l’arrêt du dispositif jusqu'à remise en
conformité, avec signalement à l’AFSSAPS
• Mineures. Elles permettent la
poursuite de
l’installation avec une mise en conformité dès que
possible. Une contre-visite devra avoir lieu dans un délai
maximal de 6 mois.
-->Registre
Sécurité Qualité Maintenance (RSQM)
L’exploitant devra mettre à jour le RSQM. Il
comportera
plusieurs informations :
• Fonctions
généralement
utilisées : radiographie ou radioscopie
• Modes de radioscopie utilisés
• Les traitements d’images les plus
couramment
utilisés
• Les valeurs de tension maximale et
minimale
utilisées
• Les valeurs de courant maximal et minimal
ainsi que
la valeur des charges associées à la tension
Afin
d’être guidé au mieux lors de la démarche de
remise en place du contrôle qualité et de répondre
à la question précédente (pourquoi le
contrôle qualité en interne ?), la création d’un
diagramme d’Ishikawa a été réalisé
;
Figure 13
2. Etat de l’existant
au
niveau du contrôle qualité
Figure 14
Voici
le résumé du niveau de l’existant de la continuité
de l’amélioration du contrôle qualité.
L’augmentation que l’on observe à partir de S0 est dû au
travail important d’un technicien biomédical qui a fait en
sorte de mettre en place le contrôle qualité en interne.
Ce technicien, à partir des applications réglementaires,
a mis au point un logiciel de contrôle qualité qui
est très bien présenté et qui permet d’avoir
un rapport d’intervention des plus clairs. Au niveau de T0, on
peut voir que le projet d’avancement stagne, il est dû au
départ de ce technicien qui avait montré et
appliqué le contrôle qualité avec des personnes du
service de radiologie qui n’ont pas pu, pour x raisons,
continuer d’assurer ces contrôles.
S1 est le moment de mon arrivée qui est
précédée de quelque mois de l’arrivée du
nouveau technicien qui à en charge le service de radiologie et
le contrôle qualité.
-->
Afin
d’évaluer les différents problèmes
rencontrés qui peuvent faire cesser
l’évolution de la mise en place du
contrôle qualité, une enquête est effectuée.
Voici les différents résultats obtenus sous forme de
graphique radar ; (Ce sondage à été
distribué aux personnes concernées ; l’ingénieur
biomédical, la PCR, le technicien biomédical, la
manipulatrice et moi-même qui peut amener un regard
extérieur)
Résultat du premier
sondage
Figure
15
Après
ce sondage, on a pu déterminer les points à
améliorer afin de pouvoir réaliser les
contrôles qualités des différents appareils
concernés.
La communication entre les
services est établie à T.0 mais pas à 100%. Pour
obtenir le 100% il faudrait en plus un investissement des trois
services suivant :
Figure 16
Sachant que le point principal
était dû à
l’organisation entre les services, les différents acteurs du
contrôle qualité se sont concertés pour savoir s’
ils pourraient planifier les contrôles pour pouvoir les effectuer
avec rigueur et méthodologie.
La
réalisation d’un
calendrier s’est donc effectué et les contrôles
qualité ont pu, dans l’ensemble, être planifiés et
validés par chacun ;
Ce
premier point « amélioration » est la communication
avec le service de l’imagerie et le service biomédical afin
d’avoir de très bons contacts et pouvoir s’accorder sur
l’organisation du contrôle, d’où le schéma de
relation suivant ;
Figure 18
Pour démontrer que
le point défaillant
était bien la communication, le sondage a été
redistribué aux mêmes personnes qu’au début du
stage et on peut remarquer que le nouveau graphique montre une
évolution des choses. Ces choses sont tous simplement
l’implication de chaque personne dans cette démarche de mise en
place de contrôle qualité (annexe 3);
Figure 19
Maintenant que le relationnel entre
les services est établi,
ceux peuvent donc « remettre en place le contrôle
qualité » avec l’objectif suivant :
Figure 20
3.
Etude de coût
a. En
référence au
diagramme d’Ishikawa, on peut voir que le coût des
équipements de contrôle de mesure et d’essai sont
cités, en voici les prix d’achats et les prix des
étalonnages TTC pour ceux concernés (devis demandé
à la société GIPS) ;
Figure 21
A
compter en plus
l’étalonnage du dosimax wellhofer qui est de 478,40 euros, la
valise de transport qui est de 540 euros TTC , et les frais de port
pour les achats d’appareil neuf de 48 Euros.
Sachant
que le CHI d’Elbeuf est déjà équipé des
différents appareils de contrôles, la question de mettre
en place le contrôle qualité en externe ou en
interne est déjà ciblée.
De plus l’Hôpital est équipé d’un logiciel qui
guide les différentes étapes de la mise en œuvre du
contrôle qualité et qui entre dans les critères des
normes.
b.
Coût de la main d’œuvre
Le coût d’un technicien est d’environ 27000 Euros/an
(salaire+charge), le taux horaire est donc d’environ 17
Euros.
Le technicien chargé d’un contrôle qualité est
occupé une bonne partie de l’année pour cela. L’embauche
d’un technicien référent ne s’occupant que du
contrôle qualité pourrait être envisagé dans
le temps, ce qui ne reviendrait pas plus chèr qu’un
contrôle externe mais toujours plus chèr que
si c’était le technicien présent qui l’organisait sur son
planning.
Il existe des formations types
sur le contrôle
qualité en imagerie. Cette formation est faite par le
Laboratoire National de métrologie et d’Essais
(LNE). Le planning de cette formation est prévu sur
deux jours pour un total horaire de 14 heures pour la
somme de 895 Euros, sachant que pour 2009, la formation était
prévue le 17 et 18 Mars mais aussi pour le 15
et 16 Décembre à Paris. Au cours de ces deux jours, les
différents points abordés sont les suivants ;
- principes de l’imagerie de
radiologie
- les références
en matière de contrôle qualité et mesure de dose
- la pratique du contrôle
qualité
- comment réaliser un
rapport de contrôle qualité
- des travaux pratiques autour
de l’image
numérique
Graphique
représentant les coûts (en Euros) de formation, de main
d’œuvre interne et externe :
Figure 22
COMMENT
METTRE EN PLACE LE CONTROLE DE
QUALITE ?
-->
Dans un premier temps, on
fait
l’inventaire des dispositifs médicaux concernés ;
3 catégories
d'équipements sont à distinguer en
fonction des contrôles de qualité. Elles aboutissent
à 3 protocoles de contrôle pour les équipements de
radiographie mobile (Mobilett Plus E, Mobilett XP, Mobilett II), pour
les équipements de radioscopie mobile (Stenoscop9000, 2
Siremobil 2000, Flexiview 8800), pour les équipements de
radiologie générale (Salles
télécommandées 1600 S, 1600 X, 1600 TVX,
Challenge, Salle vasculaire Axiom Artis, panoramique dentaire
Orthophos).
Il ne faut pas oublier dans les
protocoles le contrôle de
qualité des équipements de la chaîne de
développement et de visualisation (les développeuses
FUJI, les moniteurs, les négatoscopes).
Figure 25
Figure 26
Figure 27
Figure 28
-->
Dans un second
temps, on peut faire l’inventaire des équipements de
contrôles, de mesures et d’essais (E.C.M.E) ;
Appareils de tests et
leurs intérêts pour le Contrôle Qualité pour
chaque appareil ci-dessus confondues ;
Figure 31
Protocole; indicateur de qualité
Figure
32
Tests
à réaliser pour le contrôle qualité
Figure 33
4.
Application du
contrôle qualité avec
les démarches du logiciel
Voici
la mise en pratique des différentes étapes
contenues dans le logiciel de contrôle qualité du
CHI d’Elbeuf réalisées dans la salle deux début
Juin;
- Contrôle en radiographie;
Exactitude
et
répétabilité de la tension (la
valeur mesurée doit correspondre à la valeur
affichée à 10%) [12]
Reproductibilité-répétabilité-linéarité
(les valeurs mesurées lors de la série d’expositions ne
doivent pas différer de plus de 10% de la valeur
moyenne) [13]
Correspondance
des champs X et
lumineux [14]
Contrôle
de la
filtration-mesure de la CDA (la CDA est
l’épaisseur d’aluminium pour laquelle la dose est divisée
par deux) [15]
Contrôle
de l’exposeur
automatique (le kerma à la surface
d’entrée du patient ne doit pas dépasser 10
mGy) [16]
Résolution
spatiale [17]
- Contrôle en radioscopie ;
Mesure
du débit de
dose (la valeur de kV mesurée ne doit
pas s’écarter de
plus
de 10% de la valeur affichée).Mettre le 333 à 40cm de la
sortie du tube
pour
obtenir les valeurs. [18]
Taille des
champs et distorsion [19]
Résolution
spatiale [20]
Débit de
dose maximum (le
débit de dose max ne devra pas
dépasser les valeurs suivantes : en radioscopie conventionnelle
et en vasculaire diagnostic ;100 mGy/min, en radioscopie
interventionnelle : 200 mGy/min .) [21]
Tests de routine des constantes
à ne pas oublier d’appliquer
pour un Contrôle Qualité ;
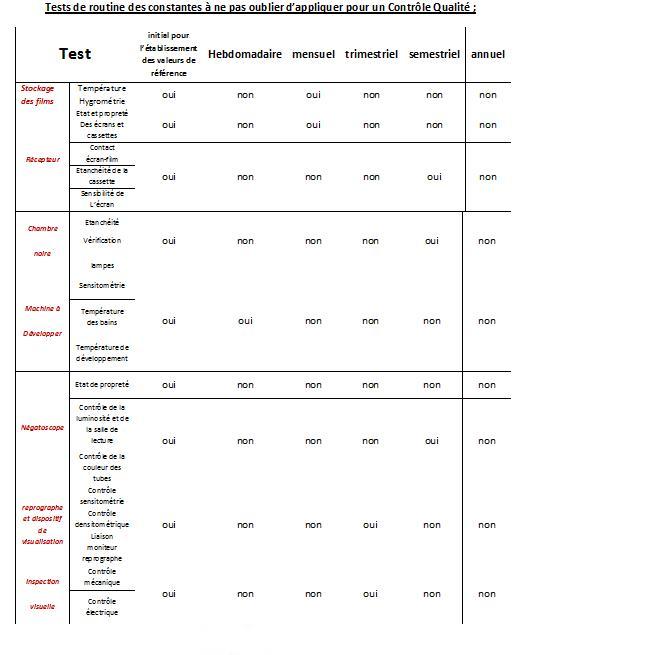 |