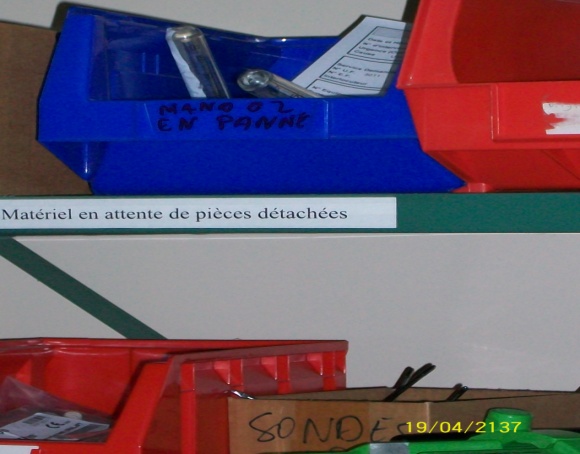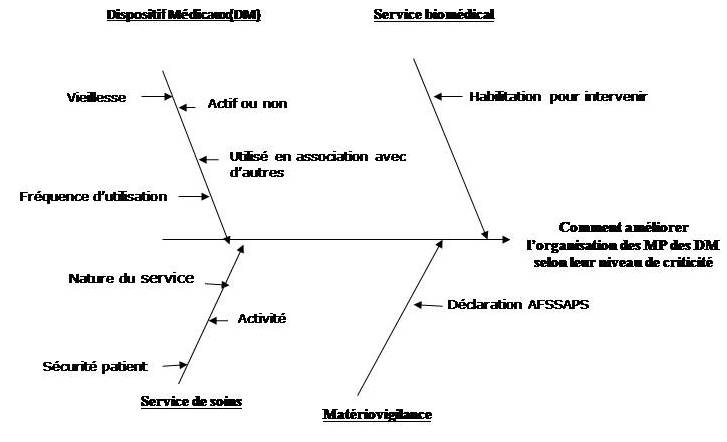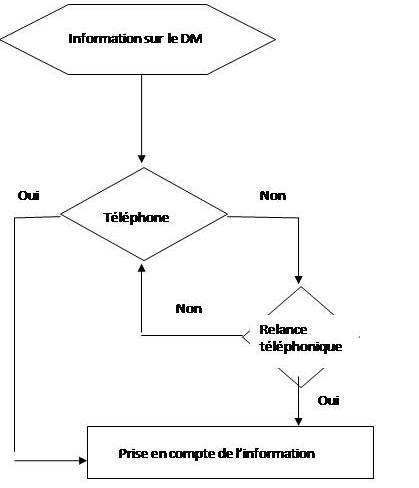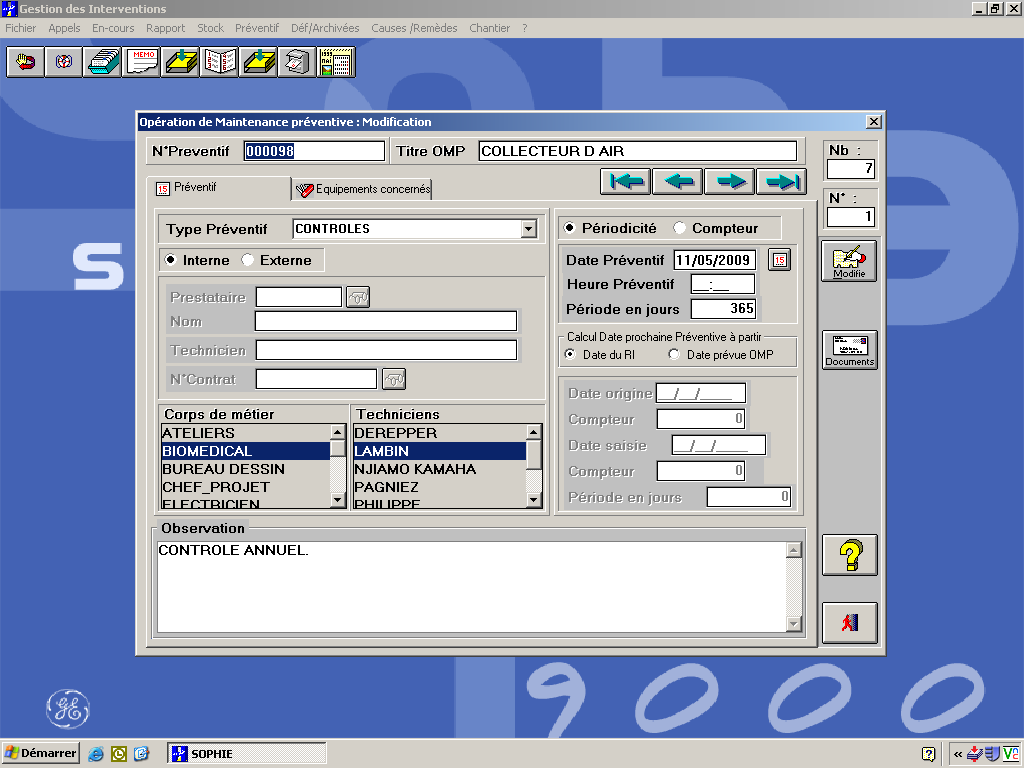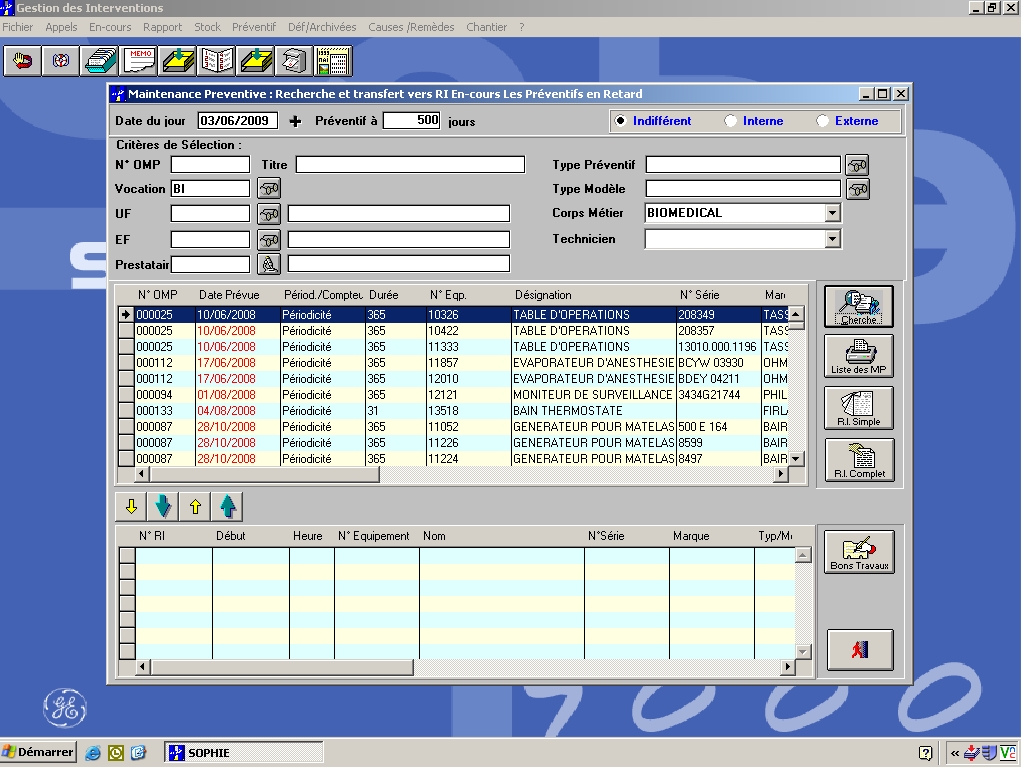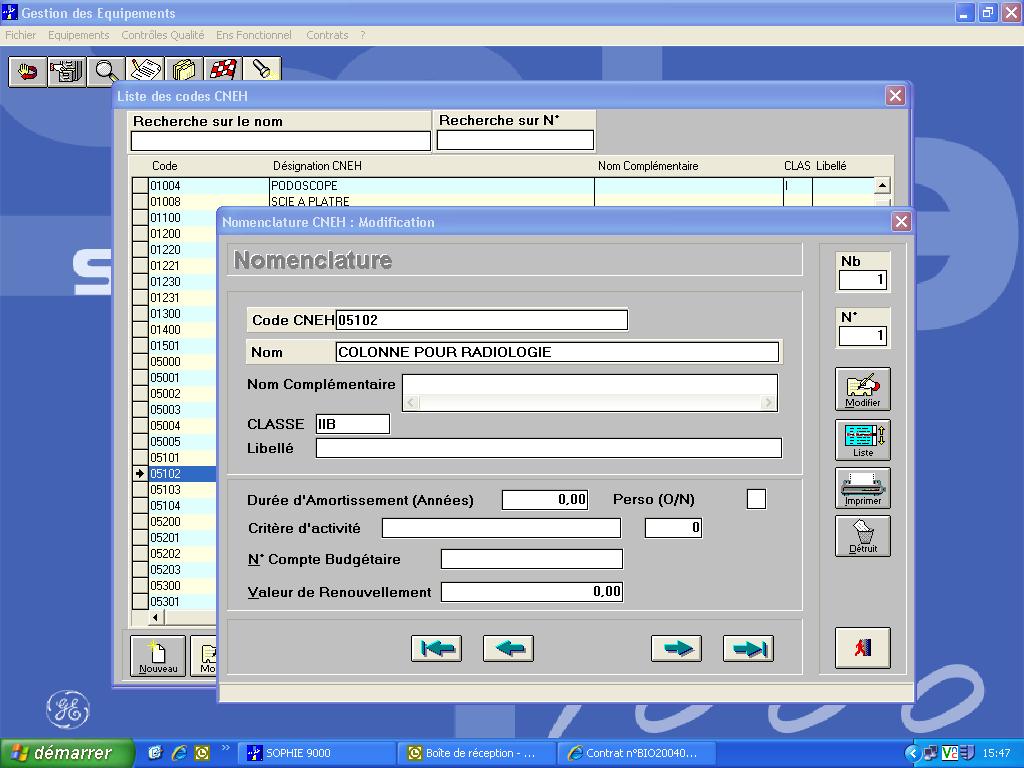• L'équipe
pédagogique de l'Université de Technologie de
Compiègne pour leur encadrement, leur enseignement et leur
compétence qui ont largement contribué à la
réussite de mes études
1.
Un peu d’histoire
Ce n’est qu’à la fin du XIXème siècle qu’est
créé, grâce à la libéralité
des Gaillard, l’hôpital privé de Creil. Celui-ci est alors
reconnu d’utilité publique.
Le 10 mai 1933, Albert LEBRUN, Président de la
République, signe un décret qui autorise la
création de l’hôpital maternité.
En 1964, la ville de Creil fait don du terrain nécessaire et le
projet d’un nouvel hôpital est agréé par le
Ministère de la Santé pour un hôpital de 582 lits.
Le 23 mars 1975, la première pierre est posée et le
Centre Hospitalier Laennec de Creil ouvre ses portes le 15 septembre
1978. L’inauguration officielle s’est déroulée le 05
décembre 1978.
2. Quelques chiffres
En 2007, la capacité en lits et places de l’hôpital
était de 444 lits et places installées, dont 395 lits en
hospitalisation complète, 28 places en hospitalisation de jour
et 21 postes d’hémodialyse.
En ce qui concerne les ressources humaines, l’hôpital comptait un
effectif total de 1580 personnes (personnel non-médical et
médical) en 2007.
Le personnel non-médical compte 1371 personnes dont :
- 188 personnels
administratifs
- 1017 personnels soignants, socio-éducatifs
et médico-techniques
- 166 ouvriers et techniques
Le personnel médical compte 209 personnes dont :
- 98 praticiens
à temps plein et temps partiel
- 42 internes
- 41 praticiens attachés
- 14 praticiens contractuels
- 8 assistants
- 6 étudiants en pharmacie
3.
Le service biomédical
Le service Biomédical est composé d’un ingénieur
responsable du service et trois techniciens biomédicaux.
Il est chargé de la gestion du parc des équipements
biomédicaux de l’établissement, ses principales
activités sont : achat et mise en service des
équipements, suivi et traçabilité des
interventions internes et externes, gestion du stock des pièces
détachées et des accessoires, conseil auprès des
utilisateurs. Il travaille également en étroite
collaboration avec les services administratifs, techniques,
informatique.
Pour les interventions, il dispose d’un atelier qui comporte un accueil
où le personnel des services utilisateurs peut apporter le
matériel pour demande de réparation ou conseil. C’est
également là où il récupère le
matériel sorti de réparation.
|
|

|
Etabli
pour
réparation
[b]
|
Etagère pour
équipements réparés
|
|
|

|
|
|
Accueil
|
Pour mieux gérer leur activité quotidienne, il utilise
l’outil informatique GMAO Sophie9000. Ce logiciel leur permet de
gérer un parc de 2917 dispositifs médicaux.
4. Etat des lieux de l’organisation
des opérations de maintenance préventive.
Actuellement au Centre Hospitalier Laennec de Creil, la maintenance
préventive n’est pas pratiquée à 100% pour les
dispositifs médicaux de classe IIb, essentiellement faute de
budget et de moyens humains. Cela peut être aussi dû
à un défaut d’organisation et un manque de formalisme.
L’état des lieux nous permettra d’avoir une vision plus
claire de la situation.
Le Service Biomédical en concertation avec les services
utilisateurs planifie les Operations de Maintenance Préventive
(MP). Ces opérations de MP sont réalisées soit par
le service (selon les préconisations des fournisseurs) soit par
les fournisseurs.
Cependant, on constate qu’il existe un retard dans la maintenance tant
interne qu’externe, ceci peut s’expliquer en partie par les
délais d’interventions imposés par certains prestataires
ou de l’indisponibilité des techniciens (selon les plannings
d’intervention).
Par ailleurs il n’existe pas encore de lien concret dans le logiciel de
GMAO, entre les Opérations de Maintenances Préventives et
les contrats de maintenance qui y sont associés.
C’est dans ce contexte qu’il m’a été demandé de
réaliser une étude sur les dispositifs médicaux de
classe IIb des services les plus critiques de l’Hôpital afin de
proposer et valider une méthode permettant de déterminer
les priorités dans la maintenance préventive.
Ce travail devrait permettre dans l’avenir au personnel du Service
Biomédical de s’appuyer sur la méthode qui leur sera mise
à disposition pour travailler sur d’autres dispositifs
médicaux non traités.
III. DEROULEMENT DE L’ETUDE
1. Gestion des opérations de
maintenance préventive
Le travail demandé concerne la Gestion des
Opérations de Maintenance Préventive des dispositifs
médicaux.
L’évolution de mon stage s’est déroulée en 6
parties essentielles :
• Etude de
l’inventaire existant dans la base de données du logiciel de
GMAO « SOPHIE9000 ».
• Recherche des informations sur la classification
des dispositifs médicaux.
• Etude de la criticité des dispositifs
médicaux de classe IIb.
• Recherche des informations sur la
périodicité de maintenance préventive
auprès des différents prestataires (fabricants,
fournisseurs).
• Aide à la décision dans le
choix du type de maintenance. (Interne/externe)
• Traiter et définir les OMP en rapport avec
les résultats de l’étude.
Suite à l’arrêté du 3 Mars 2003, les exploitants
sont tenus de s’assurer de la maintenance des dispositifs
médicaux, sauf ceux pour lesquels ils sont en mesure de
justifier qu’une maintenance est inutile en raison de leur conception
ou de leur destination, d’où l’étude de la
criticité.
L’article D.665.5.2 du CSP(*) propose trois orientations à
l’exploitant pour la mise en œuvre de la maintenance :
- réalisation par le fabricant
ou sous sa responsabilité,
- réalisation par un fournisseur de tierce maintenance,
- réalisation par l’exploitant lui-même.
Selon la classe du dispositif médical qui détermine son
niveau de risque, et des recommandations des constructeurs,
l’exploitant pourra déterminer la périodicité de
maintenance préventive à effectuer.
2. Classification des dispositifs
médicaux
2.1.
Marquages des dispositifs médicaux
Le Marquage CE est établi selon la directive 93/42/CEE et
la certification EN 46000. Cette classification répartit les
dispositifs médicaux est faite en quatre classes (I, II a,
II b et III) correspondant à des niveaux de risques croissants.
2.2.
Règle de classification
La règles de classification a été
instituée sur la base des critères suivants :
- la durée
d’utilisation du dispositif : de quelques minutes (temporaire) à
plusieurs années (implantable),
- le caractère invasif ou non du dispositif,
- le type chirurgical ou non du dispositif,
- le caractère actif ou non du dispositif,
- la partie vitale ou non du corps concernée
par le dispositif (systèmes circulatoire et nerveux centraux).
Une fois définie la classe à laquelle appartient son
dispositif, le fabricant doit établir une déclaration CE
de conformité après avoir apporté la preuve que
son dispositif satisfait aux exigences essentielles (de
sécurité et de santé des patients) de la directive
qui lui est applicable.
2.3.
Les différentes classes auxquelles appartiennent les DM
Classe I => Son niveau est faible (
ex: instruments de chirurgie courante)
;
Classe II a => Niveau de risque moyen (
ex: tubulures pour le sang);
Classe II b => Niveau de risque élevé (
ex: générateurs de dialyse);
Classe III => Niveau de risque très sérieux. . (
Ex: dispositifs en contact avec le
système cardiovasculaire ou nerveux central)
Puisque la détermination de la classe d’un dispositif
médical n’est pas si simple, en cas de litige sur l’application
des règles de classification entre le fabricant et un organisme
notifié (qui intervient dans les procédures de
certification de conformité), le code de la santé
publique prévoit que c’est l’AFSSAPS qui doit trancher pour
déterminer la classe dont relève le dispositif en
question.
Dans notre étude les dispositifs médicaux qui nous
préoccupent les plus, ce sont ceux de la classe IIb des services
jugés critiques (USIC , BLOC OPERATOIRE,NEONATOLOGIE,ANESTHESIE
REANIMATION) de l’hôpital. (Après concertation avec
l’équipe biomédicale)
Les DM de la classe II b :
• La classe II b
regroupe principalement des dispositifs invasifs utilisés sur du
long terme.
• Des dispositifs
médicaux invasifs de type chirurgical destinés à
un usage à court terme, s’ils sont destinés à
fournir de l’énergie sous la forme d’un rayonnement ionisant.
• Tous les dispositifs destinés
spécifiquement à désinfecter, à nettoyer et
à rincer.
• Les poches de sang appartiennent à la classe
II b aussi.
3.
Etude de la criticité
Pour mieux réaliser cette étude, la proposition
d’une méthodologie basée sur une analyse de risques afin
de définir une stratégie de maintenance applicable
à l’ensemble des dispositifs médicaux s’est
avérée nécessaire.
Le souhait de définir une stratégie de maintenance
commune à l’ensemble des DM de classe IIb, est apparu au regard
d’une part, de la forte pression économique s’exerçant
sur le budget de maintenance biomédicale, et d’autre part,
l’absence d’un outil interne qui pourrait aider dans la prise de
décision à la priorisation des dispositifs
médicaux les plus critiques. [1]
Cette définition d’une stratégie de maintenance s’inscrit
dans un processus de maîtrise des risques vers lequel
souhaite s’orienter le Centre Hospitalier de Creil en
général et le Service biomédical en particulier.[1]
3.1.
Approche méthodologique
Il est important de définir une stratégie de
maintenance biomédicale.
Avoir une stratégie de maintenance biomédicale claire
et pertinente reposant sur une méthodologie et des
critères démontrables c’est :
* Réduire la fréquence et la gravité des incidents
(principe de prévention),
* Prévenir les plaintes, limiter et maîtriser les
contentieux (principe de précaution).
3.1.1.
Utilisation de l’outil qualité QQOQCP pour la
détermination de la criticité:
Qui
?
Qui est concerné
|
Le service biomédical du
centre hospitalier de Creil
|
Quoi
?
Quel est le problème ?
|
Déterminer la
criticité des DM |
Où?
Où apparait le problème ?
|
Au Centre
Hospitalier Laennec de Creil. |
Quand
?
Quand apparait le problème ? |
A l’achat et au cours de
l’exploitation d’un DM. |
Comment
?
Comment apparait le problème ?
|
Réalisation
inhomogène de la MP sur le parc de DM. |
Pourquoi
?
Pourquoi il faut résoudre le problème ?
|
Améliorer
l’organisation des MP des DM selon leur niveau de criticité |
3.1.2.
Analyse des faits et des causes racines :
Après un brainstorming réalisé
concernant la priorisation des dispositifs médicaux, plusieurs
facteurs ont être listés.
- Utilisation de
l’outil de qualité Ishikawa.
Les causes racines qui ont
été listées dans le brainstorming
réalisé sont :
Dispositif
Médicaux(DM), Service de soins, Service
Biomédical, Matériovigilance
L’appréciation de la criticité des DM au sein du Centre
Hospitalier de Creil engendre différents facteurs, dont leur
choix est discutable, en contre partie il reflète une
cohérence et une logique entraînant un résultat
exploitable. La mesure de criticité permet donc de mettre en
évidence les équipements sensibles sur lesquels doit
être axée en priorité la politique de maintenance.
3.1.3.
Mise en œuvre de la méthode PIEU
La méthode PIEU a été
utilisée pour faire l’étude de criticité. Ceci
parce quelle permet de mettre en évidence les différents
facteurs cités pendant les brainstormings.
Les facteurs les plus fréquemment cités dans le
brainstorming sont :
- Incidence des pannes des dispositifs médicaux.
- Service utilisateur
- DM actif ou non
- Fréquence d’utilisation
- Importance de l’équipement
- Etat de l’équipement.
Pour adapter la méthode PIEU à notre étude, il a
été décidé :
de
retenir les facteurs suivants :
- Importance de l’équipement
- Fréquence d’utilisation (facteur de taux d’utilisation)
de négliger les
critères suivants :
- La nature du service utilisateur car une désignation
précise du dispositif médical permet de s’en dispenser.
(Exemple : respirateur d’anesthésie).
- L’impact du dysfonctionnement sur l’activité du
service car en prenant en compte l’importance de l’équipement
« I » on intègre déjà cette notion, en
effet si un DM est unique dans l’établissement, en cas de panne,
il en résulte automatiquement un arrêt de
l’activité du service.
- DM actif ou non car tous les dispositifs médicaux sont
considérés comme potentiellement dangereux qu’ils soient
actifs ou non.
La méthode PIEU présente quatre paramètres qui
associés permettent de déterminer la criticité de
chaque catégorie d’appareil. Ces quatre critères sont
pondérés pour chaque type d'équipement par des
valeurs allant de 0.01 à 3 (0.01 étant le
paramètre ayant le plus d'importance, et 3 le moins critique)
| Grille d'évaluation de
la criticité |
|
Poids |
| Critères |
0.01 |
1 |
2 |
3 |
P
|
Incidence des pannes |
Répercussions graves sur l'entité |
Répercussions sur la qualit"é et
génération de "rebuts" |
Retouches possibles |
Aucune répercussion sur la qualité des soins |
| I |
Importance de
l'équipement
|
Startégique, pas de délestage sur d'autres
équipements, sous traitance impossible |
Important pas de délestage possible, Soustrautance
possible |
Secondaire, délestage possible |
Equipement de secours |
| E |
Etat |
A rénover, à réformer |
A réviser |
A surveiller |
A
l'état spécifié |
| U |
Taux d'utilisation |
Saturé |
Elevé |
Moyen |
Faible |
Le calcul de la criticité se fait selon la formule suivante :
Criticité
« CR »= P x I x E x U
Plus CR est faible, plus la
criticité de l'équipement est élevée.
Le classement imposé pour la méthode est la suivante :
Pieu < 1 : très critique
1<Pieu< 10 : Moyennement
critique
Pieu > 10 : moins critique
La détermination de cette
criticité va permettre de mettre en évidence
les équipements sur lesquels doit être axée en
priorité la maintenance préventive.
3.1.4.
Application de la méthode PIEU
Il a été décidé d’engager la
démarche sur trois cas « pilotes » où l’on
fait les opérations de maintenance préventive pour
vérifier si notre démarche est cohérente.
a. Cas d’un équipement dont la maintenance
préventive est faite en interne
b. Cas d’équipement maintenu en externe sans
contrat
c. Cas d’équipement maintenu en externe sous
contrat.
Les résultats qui ont été obtenus sont les
suivants :
- Equipement :
mélangeur de gaz
ETUDE DE
CRITICITE
P = 0,01 :
Répercussions graves sur la santé du malade et la
qualité des soins apportés par l’utilisation de ce
dispositif. Les mélangeurs de gaz utilisés en
ventilation, au cas où ils ont un problème, l’impact vis
à vis du patient serait grave et entraînerait des
conséquences graves voire même mortelles ; d’où
l’attribution de la note précédente.
I = 1
: Important (pas de délestage mais sous-traitance possible).
N’étant pas unique mais important, sa note correspondante est
celle lui est attribuée.
E = 2 :
à surveiller. Comme il n’est pas à reformer ou à
réviser non plus tout neuf, sa note correspondante est celle lui
est attribué
U = 1 :
élevé, ayant d’autres en remplacement, et vu le service
utilisateur, son taux d’utilisation est quand même
élevé d’où l’attribution de cette note.
CR =Pieu =0,01*1*2*1 = 0,02.
CR = Pieu < 1 : Très
critique.
Le résultat de l’analyse est tout à fait
cohérent à la position qu’occupent les mélangeurs
de gaz dans les services utilisateurs, car ils font partis des DM
vitaux lors des interventions chirurgicales auxquels on doit y
prêter une attention particulière vis à vis
des patients.
3.1.5.
Evaluation des cas « pilotes »
- Tenant compte des résultats obtenus par notre
méthode sur les trois cas pilotes étudiés, ces
équipements présentent un nivaux de criticité
élevé.
- On peut être amener à dire que le niveau de la
criticité détermine le nombre de MP par an, mais on
constate que plus la criticité est grande plus la vigilance sur
la bonne exécution de ces MP doit être importante quelque
soit la périodicité du moment qu’elle répond aux
préconisations du constructeur.
3.1.6.
Extension de l’étude aux services sélectionnés:
Les résultats concluants de l’application de la
méthode PIEU sur les 3 exemples pilotes ont amené
à étendre la même étude sur les DM de classe
IIb des services les plus critiques.
Dans le cadre de notre étude nous avons réalisé
une sélection des services hospitaliers les plus critiques du CH
, dans l’objectif de toucher le plus grand nombre de DM à
risque, présentant un caractère invasif ou non, de
type chirurgical ou non et à caractère actif ou pas.
Cette sélection a aussi été faite dans l’objectif
de limiter l’étude aux services les plus critiques et ainsi
augmenter la probabilité de rencontrer le plus grand nombre des
DM assujettis aux opérations de MP.
C’est ainsi qu’une classification par ordre de priorité a
été mise en place par la méthode
«PIEU».
a. Classements des
dispositifs médicaux par ordre de priorité
| DESIGNATION |
CR |
PERIODICITE |
| Defibrillateur |
0,02 |
1fois/an |
| Monitorage |
0,02 |
1fois/an |
| Bistourie électrique |
0,02 |
1fois/an |
| Néopuff |
0,02 |
1fois/an |
| Incubateur de transport |
0,02 |
1fois/an |
| Incubateur Ouvert |
0,02 |
1fois/an |
| Inubateur Fermé |
0,02 |
1fois/an |
| Ventilateur pulmonaire |
0,02 |
1fois/an |
| Table de réanimation neonatale |
0,02 |
1fois/an |
| Electrocardiographe |
0,02 |
1fois/an |
| Evaporateur d'anesthesie |
0,02 |
1fois/an |
| Insuflateur pour endoscopie |
0,02 |
1fois/an |
| Instrumentation chirurgicale |
0,02 |
1fois/an |
| Cryode chirurgicale |
0,02 |
1fois/an |
| generateur pour matelas chauffant |
0,02 |
1fois/an |
| Phacoemulsificateur |
0,02 |
1fois/an |
| lit fluidisé |
0,02 |
1fois/an |
| Osmoseur |
0,02 |
1fois/an |
| Generateur / moniteur indivuduel d' hemodialyse |
0,02 |
1fois/an |
| Reseau d' image |
0,02 |
1fois/an |
| Module ECG |
0,02 |
1fois/an |
| pompe à nutrition |
0,02 |
1fois/an |
| Module PICCO |
0,02 |
1fois/an |
| Rechauffeur de perfusion/transfusion |
0,02 |
1fois/an |
| lithotriteur intracorporel |
0,02 |
1fois/an |
| Lumière froide |
2 |
1fois/2an |
| Pousse seringue |
2 |
1fois/2an |
| Pompe à perfusion |
2 |
1fois/an |
| Humidificateur |
2 |
1fois/2an |
| Module de gaz |
2 |
1fois/2an |
| Fibroscope |
2 |
1fois/2an |
| Ureto renoscope |
2 |
1fois/2an |
| Manodetendeur pour bouteil à gaz |
4
|
1fois/3an |
| Aspirateur médicaux chirurgicale |
16 |
1 fois/ 4 an |
Compte tenu de la classification prioritaire ci-dessus, qui provient de
l’analyse méthodologique portée sur ces DM, trois
catégories selon le nivaux de risque correspondant sont à
observés :
1) La catégorie des dispositifs
très critiques c'est-à-dire dont l’étude a
attribué une note de CR< 1.
2) Celle dont l’étude a montré
qu’ils sont moyennement critiques et que leurs notes correspondante
était de 1 < CR < 10
3) Enfin la catégorie dont l’étude a
montré qu’ils sont moins critiques par leurs notes
correspondantes de CR>10.
La pression budgétaire économique ne
permettant pas de faire une maintenance préventive annuelle sur
tous les dispositifs médicaux de l’établissement, un
travail de hiérarchisation s’impose. C’est ainsi que nous
justifierons nos choix en se basant sur la méthode PIEU et son
analyse.
Trois zones ont été définies et réparties
sur une échelle de priorité telle que :
| CR ou
PIEU<1 |
Zone
1
|
| 1<CR ou
PIEU<10 |
Zone
2
|
CR ou
PIEU> 10
|
Zone
3
|
ZONES DE MAINTENANCE |
Zone 1 pour un indice de
criticité CR < 1
Les actions de maintenance préventive comprise dans cette zone
devraient être réalisées avec une
périodicité maximale de douze mois ou, soit au moins une
fois par an.
Zone 2 pour un indice de criticité CR 1< CR<10
Ici, les actions de maintenance préventive sont moins
prioritaires, et peuvent être réalisées tous les
deux ans.
Zone 3 pour un indice de
criticité CR >10.
En règle générale, les défaillances
analysées sur ce type de dispositif médical ne
présentent pas de risque vital pour le patient. Les dispositifs
médicaux concernés par cette zone peuvent faire l’objet
d’une maintenance préventive tous les cinq ans à
condition qu’une vérification visuelle soit faite chaque
année.
Après compilation des résultats
obtenus pour chacun des services, pour chaque dispositif
médical, il faudra appliquer en fonction de la valeur de la
criticité, la périodicité de maintenance
préventive correspondante. Ainsi, le tableau ci-dessous montre
la classification des DM et leur périodicité
correspondante.
b. Classification des DM par
ordre de CR et périodicité
| ZONE DE RISQUE |
DESIGNATION |
CR |
PERIODICITE |
| |
Defibrillateur |
0,02 |
1fois/an |
| |
Monitorage |
0,02 |
1fois/an |
| |
Bistourie
électrique |
0,02 |
1fois/an |
| |
Néopuff |
0,02 |
1fois/an |
| |
Incubateur de
transport |
0,02 |
1fois/an |
| |
Incubateur
Ouvert |
0,02 |
1fois/an |
| |
Inubateur
Fermé |
0,02 |
1fois/an |
| |
Ventilateur
pulmonaire |
0,02 |
1fois/an |
| |
Table de
réanimation neonatale |
0,02 |
1fois/an |
| |
Electrocardiographe |
0,02 |
1fois/an |
| |
Evaporateur
d'anesthesie |
0,02 |
1fois/an |
| |
Insuflateur
pour endoscopie |
0,02 |
1fois/an |
| |
Instrumentation
chirurgicale |
0,02 |
1fois/an |
| |
Cryode
chirurgicale |
0,02 |
1fois/an |
| |
generateur pour
matelas chauffant |
0,02 |
1fois/an |
| |
Phacoemulsificateur |
0,02 |
1fois/an |
| |
lit
fluidisé |
0,02 |
1fois/an |
| |
Osmoseur |
0,02 |
1fois/an |
| |
Generateur /
moniteur indivuduel d' hemodialyse |
0,02 |
1fois/an |
| |
Reseau d' image |
0,02 |
1fois/an |
| |
Module ECG |
0,02 |
1fois/an |
| |
pompe à
nutrition |
0,02 |
1fois/an |
| |
Module PICCO |
0,02 |
1fois/an |
| |
Rechauffeur de
perfusion/transfusion |
0,02 |
1fois/an |
| |
lithotriteur
intracorporel |
0,02 |
1fois/an |
| |
Lumière
froide |
2 |
1fois/2an |
| |
Pousse seringue |
2 |
1fois/2an |
| |
Pompe à
perfusion |
2 |
1fois/an |
| |
Humidificateur |
2 |
1fois/2an |
| |
Module de gaz |
2 |
1fois/2an |
| |
Fibroscope |
2 |
1fois/2an |
| |
Ureto renoscope |
2 |
1fois/2an |
| |
Manodetendeur
pour bouteil à gaz |
4
|
1fois/3an |
| |
Aspirateur
médicaux chirurgicale |
16 |
1 fois/ 4 an |
L’étape suivante a consisté en la recherche des
coordonnées téléphoniques des différents
fournisseurs et fabricants afin d’obtenir ce qu’ils préconisent
sur leurs équipements .Il a été parfois difficile
d’obtenir directement des renseignements chez certains fournisseurs car
celui qui devait fournir ces informations n’était pas
disponible, ou il proposait l’envoi des informations par fax. (Voir
annexe3,4 )
- Démarche de demande d’information auprès des
fournisseurs
Après avoir collecté les informations, le tableau
regroupant les renseignements fut élaboré :
| ZONE DE RISQUE |
DESIGNATION |
CR |
INFO, FOURNISSEURS |
| |
Defibrillateur |
0,02 |
1fois/an |
| |
Monitorage |
0,02 |
1fois/an |
| |
Bistourie
électrique |
0,02 |
1fois/an |
| |
Néopuff |
0,02 |
1fois/an |
| |
Incubateur de
transport |
0,02 |
1fois/an |
| |
Incubateur
Ouvert |
0,02 |
1 fois/an |
| |
Inubateur
Fermé |
0,02 |
1 fois/an |
| |
Ventilateur
pulmonaire |
0,02 |
2fois/an |
| |
Table de
réanimation neonatale |
0,02 |
1fois/an |
| |
Electrocardiographe |
0,02 |
1fois/an |
| |
Evaporateur
d'anesthesie |
0,02 |
1fois/an |
| |
Insuflateur
pour endoscopie |
0,02 |
1fois/an |
| |
Instrumentation
chirurgicale |
0,02 |
1fois/an |
| |
Cryode
chirurgicale |
0,02 |
1fois/an |
| |
generateur pour
matelas chauffant |
0,02 |
1fois/an |
| |
Phacoemulsificateur |
0,02 |
1fois/an |
| |
lit
fluidisé |
0,02 |
1fois/an |
| |
Osmoseur |
0,02 |
4fois/an |
| |
Generateur /
moniteur indivuduel d' hemodialyse |
0,02 |
1fois/an |
| |
Reseau d' image |
0,02 |
1fois/an |
| |
Module ECG |
0,02 |
1fois/an |
| |
pompe à
nutrition |
0,02 |
1fois/an |
| |
Module PICCO |
0,02 |
1fois/an |
| |
Rechauffeur de
perfusion/transfusion |
0,02 |
1fois/an |
| |
lithotriteur
intracorporel |
0,02 |
2fois/an |
| |
Lumière
froide |
2 |
1fois/an(450
à 500heures) |
| |
Pousse seringue |
2 |
1fois/an |
| |
Pompe à
perfusion |
2 |
1fois/3ans |
| |
Humidificateur |
2 |
1fois/an |
| |
Module de gaz |
2 |
1fois/an |
| |
Fibroscope |
2 |
350
examens/an/MP |
| |
Ureto renoscope |
2 |
1fois/an |
| |
Manodetendeur
pour bouteil à gaz |
4
|
1fois /5ans |
| |
Aspirateur
médicaux chirurgicale |
16 |
1fois/4ans
|
d. Comparaison
CR et fournisseurs
| ZONE DE RISQUE |
DESIGNATION |
CR |
PERIODICITE |
INFO, FOURNISSEURS |
| |
Defibrillateur |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
Monitorage |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
Bistourie
électrique |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
Néopuff |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
Incubateur de
transport |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
Incubateur
Ouvert |
0,02 |
1fois/an |
1 fois/an |
| |
Inubateur
Fermé |
0,02 |
1fois/an |
1 fois/an |
| |
Ventilateur
pulmonaire |
0,02 |
1fois/an |
2fois/an |
| |
Table de
réanimation neonatale |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
Electrocardiographe |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
Evaporateur
d'anesthesie |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
Insuflateur
pour endoscopie |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
Instrumentation
chirurgicale |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
Cryode
chirurgicale |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
generateur pour
matelas chauffant |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
Phacoemulsificateur |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
lit
fluidisé |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
Osmoseur |
0,02 |
1fois/an |
4fois/an |
| |
Generateur /
moniteur indivuduel d' hemodialyse |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
Reseau d' image |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
Module ECG |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
pompe à
nutrition |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
Module PICCO |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
Rechauffeur de
perfusion/transfusion |
0,02 |
1fois/an |
1fois/an |
| |
lithotriteur
intracorporel |
0,02 |
1fois/an |
2fois/an |
| |
Lumière
froide |
2 |
1fois/2an |
1fois/an(450
à 500heures) |
| |
Pousse seringue |
2 |
1fois/2an |
1fois/an |
| |
Pompe à
perfusion |
2 |
1fois/2an |
1fois/3ans |
| |
Humidificateur |
2 |
1fois/2an |
1fois/an |
| |
Module de gaz |
2 |
1fois/2an |
1fois/an |
| |
Fibroscope |
2 |
1fois/2an |
350
examens/an/MP |
| |
Ureto renoscope |
2 |
1fois/2an |
1fois/an |
| |
Manodetendeur
pour bouteil à gaz |
4
|
1fois/2an |
1fois /5ans |
| |
Aspirateur
médicaux chirurgicale |
16 |
1fois/4an |
1fois/4an |
CONCLUSION :
On constate qu’en confrontant les résultats obtenus par
l’étude de CR et les préconisations des constructeurs il
y a des concordances, mais toutefois le service biomédical
doit toujours garder un esprit critique lors de l’application de la
méthode PIEU, afin de savoir prendre certaines décisions
(suivre les préconisations constructeurs ou s’appuyer sur
la méthode PIEU).
4. Réalisation
de la maintenance préventive
L’objectif principal de notre étude consistant en l’organisation
de la MP des DM, il parait aussi nécessaire de discuter
sur le choix d’externaliser ou d’internaliser les opérations de
MP.
D’après la norme NF X
60 – 010 :
On entend par “maintenance” d’un DM, l’ensemble des activités
destinées à maintenir (maintenance préventive) ou
à rétablir (maintenance corrective) un DM dans un
état ou dans des conditions données de
sûreté de fonctionnement pour accomplir une fonction
requise.
Maintenance
préventive d’après la norme NF X 60 – 010 :
La maintenance préventive est « la maintenance
effectuée selon des critères déterminés,
dans l’intention de réduire la probabilité de
défaillance d’un bien ou la dégradation d’un service
rendu ». La maintenance préventive a pour objectif la
prévention des défaillances par des actions
programmées.
4.1.
Différentes types de
Maintenance Préventive.
- Maintenance
préventive systématique d’après la norme NF X 60 –
010 :
D’après la norme NF X 60 – 010, la maintenance préventive
systématique est « effectuée selon un
échéancier préétabli selon le temps ou le
nombre d’unités d’usage des équipements ». Ce
concept de maintenance consiste à remplacer un certain nombre de
pièces dont la dégradation peut induire des
disfonctionnements sur l’équipement, avec une
périodicité connue à l’avance. L’action de
maintenance préventive est déclenchée par une
périodicité définie, et non pas par l’état
de la pièce à remplacer. Il est donc possible de
planifier ces interventions de maintenance. Dans le cas d’un dispositif
médical, le constructeur fournit les indications pour les
pièces à changer avec la périodicité.
- Maintenance préventive conditionnelle d’après la
norme NF X 60 – 010 :
La maintenance préventive conditionnelle est «
déclenchée suivant des critères
prédéterminés significatifs de l’état de
dégradation d’un équipement ». Cette maintenance
consiste à analyser et à surveiller l’état de
dégradation des pièces qui ne seront remplacées
qu’à partir d’un seuil de dégradation fixé. Il est
plus difficile de planifier ces interventions, car elles
dépendent de l’état d’usure des pièces. Par
exemple la surveillance du rendement lumineux des négatoscopes.
- Maintenance préventive prévisionnelle
d’après la norme NF X 60 – 010 :
La maintenance préventive prévisionnelle est «
subordonnée à l’analyse de l’évolution
surveillée de paramètres significatifs de la
dégradation de l’équipement ». Cette maintenance
consiste à prévoir la dégradation à venir
des pièces à partir de leur analyse. Dans ce cas il sera
possible de planifier cette intervention.
4.2.
Choix de maintenance
préventive
Pour faire le choix d’une maintenance à faire, qu’il soit
interne ou externe, on doit d’abord se poser des questions qui puissent
nous révéler des informations relatives aux
préconisations du constructeur ou fournisseur vis-à-vis
de son équipement, ensuite s’en poser d’autres permettant de
savoir si le Service Biomédical peut prendre en charge du
début à la fin la dite maintenance
préventive.
4.2.1.
Recueil des Informations
auprès des fournisseurs.
N°
|
QUESTIONS
|
| 1 |
Que préconisez-vous comme
maintenance préventive sur votre équipement? |
| 2 |
Quelles sont les pièces
qu'il faut remplacer? |
| 3 |
Combien de temps faut-il
pour faire cette maintenance préventive?
(temps d’indisponibilité du materiell pour le service
utilisateur et
temps technicien pour intervention) |
| 4 |
Quel est le coût
pour faire cette maintenance? |
| 5 |
Quel est le coût de la
formation au cas où vous formiez les techniciens? |
| 6 |
Pour ne pas paralyser le
service utilisateur, Y- a-t' il la possibilité de prêt de
DM pendant la période d’indisponibilité ? |
4.2.2.
Maintenance interne ou externe ? Questions à se poser !
1. Quelle est la fréquence des MP ?
2. Combien de temps faut-il pour réaliser cette maintenance?
(temps technicien)
3. Le technicien est-il habilité pour la faire?
4. Y a-t-il les équipements indispensables pour faire
cette maintenance? (Outillages et ECME)
5. Quel est le coût des pièces détachées ?
Les données sont :
fréquence (f), temps (t), habilitation (h), outils et ECME (o),
coût des pièces détachées (c)
F et t , connaissant le nb de techniciens, nous permettent
déjà de savoir si cette MP peut être
intégrée dans le planning interne. Si dans ce cas, la
réponse est négative on peut conclure
immédiatement qu’il est préférable de
réaliser la MP en externe.
Hypothèse 1 : le personnel est
disponible.
Question suivante : le technicien
est-il habilité ? si oui, on peut passer à la question
suivante. Si non comment le technicien peut-il être
habilité ? cela nécessite-t-il une formation
spécifique chez le fournisseur ou constructeur ? combien
coûterait cette formation ? combien de temps durerait cette
formation (initiale et rappels périodiques
éventuels) ? si le budget ne permet pas de payer cette
formation, de suite la décision peut être prise de
réaliser la MP en externe. On suppose que le budget est
suffisant pour la formation (hyp 2) ; si la formation exige une
disponibilité trop important du technicien, il peut être
aussi décidé à ce stade de réaliser la MP
en externe.
Hypothèse 3 : la formation
éventuelle peut être intégrée dans le
planning des techniciens.
Pièces détachées :
combien coûtent-elles ? il sera assez facile d’obtenir cette
réponse auprès du fournisseur. Il est aussi possible de
s’interroger sur la possibilité de se fournir chez un autre
fournisseur moins cher.
A ce stade, avec toutes les réponses obtenues nous pouvons
déjà mettre en parallèle :
- externe :
coût de l’intervention (sous contrat ou pas) incluant main
d’œuvre, pièces détachées, déplacement
(coût apparaissant sur un devis)
- interne : main d’œuvre (obtenue à partir du
temps technicien et du coût horaire), coût des
pièces détachées, il n’y a bien sûr pas de
déplacement
Outillage et ECME : sont-ils disponibles à l’atelier ? si oui
l’analyse peut s’arrêter là, la décision finale
peut être prise en fonction des réponses obtenues
précédemment. Si non , quels sont les outils et ECME
nécessaires pour cette MP ? quel est leur coût (achat,
entretien, étalonnage,…) ? à partir des données
précédentes il est alors possible de savoir si la
différence de coût interne/externe permet de financer les
outils et ECME manquants ?
D’autres questions doivent également se poser :
- temps d’indisponibilité du
matériel pour le service utilisateur ? y a-t-il du
matériel de suppléance ou de secours dans le service ? ou
est-il possible de bénéficier d’un prêt pendant
cette période ?
NB : Cette prévision se fait à partir de l’inventaire des
DM, et l’organisation en interne nécessite en plus la mise en
place des procédures de
maintenance.
L’organisation de la maintenance qu’elle soit interne ou externe
nécessite de prévoire à partir de l’inventaire des
DM :
La traçabilité des opérations de maintenance,
Le suivi des maintenances
Le recueil de dysfonctionnements et les actions d’amélioration
5.1.1.
MAINTENANCE A REALISER
DISPOSITIF
MEDICAL
|
Freq.MP et
TEMPS MP(hr)/ |
Nbr de DM
|
Effectif TSBM
|
LOCAL |
FORMATION
|
MATERIELS
|
PRÊT |
COUT ECME |
COUT/H
MP EXTERNE HORS PIECES DETACEE
(Euros TTC) / DM |
COUT/H
DE MP INTERNE |
COUT TOTAL
EXTERNE |
COUT TOTAL
INTERNE
|
| Bistouri (ERBE) |
1fois/an,
4heures
|
10 |
3 |
interne |
Oui
|
ECME |
Possible |
9000
|
402 |
20-30
|
1608
|
80-120 |
Ventilateur
(DRAGER)
|
2fois/an
1.5 à 2heures |
20 |
3 |
interne |
Oui |
ECME |
Possible
|
9000 |
1239.95 |
20-30 |
2479 ,90
|
40-60 |
Soudeuse(HAWO)
|
1fois/an
4heures |
2 |
3 |
interne |
Oui
|
ECME |
Possible |
11000 |
368.5 |
20-30 |
1463.95 |
80-120 |
(Couts extraits du Guide
Pratique de maintenance de la DRASS Midi-Pyrénées)
REPONSES
AUX QUESTIONS
a. Fréquence et durée
des Maintenances Préventives
Généralement la fréquence de maintenance
préventive est annuelle, mais pour les ventilateurs la
fréquence est semestrielle. Le temps nécessaire pour
faire une MP dépend de l’équipement à maintenir,
et de l’activité qu’on doit mener sur le DM lors de la
maintenance (révision, calibrage..). Pour un bistouris ou
une soudeuse ça prend une demie journée ; 2heures pour un
respirateur, le technicien ne serait pas monopolisé tout ce
temps sur un dispositif alors qu’il doit aussi suivre le bon
fonctionnement des différents services de soins (Maintenance
corrective).
b. Le technicien est
habilité pour faire cette maintenance?
Le niveau de formation ou de qualification requis du
personnel(TSBM) pour maintenir les DM est suffisant. A part
certains équipements qui nécessitent une formation
spécifique.
c. Y a-t-il des équipements
indispensables pour faire cette maintenance? (outillages et ECME)
L’atelier dispose d’outillage classique qui lui
permet de faire le maximum. Quant aux ECME, il dispose juste de
quelques uns qui sont repris dans le tableau ci-dessous.
d. Combien va couter cette
maintenance?
Le cout horaire de maintenance pour un technicien
supérieur biomédical varie entre 20 et 30 Euros. S’il
faut faire la maintenance des bistouris ça va couter entre 80 et
120 Euros, un ventilateur va couter entre 40 et 60 Euros, une soudeuse
entre 80 et 120 Euros. Quant au prestataire externe le cout horaire
varie entre 200 à 1500 Euros. S’il faut maintenir un bistouris
ça va couter 1608 Euros, un ventilateur va couter 2479.90 Euros
; une soudeuse coutera 1463.95Euros.
Toute maintenance préventive qu’elle soit faite en interne
ou en externe de l’hôpital, le contrôle qualité est
recommandé avant que le DM ne soit remis en service. C’est pour
cela le service biomédical devrait s’équipe d’avantage en
ECME pour pouvoir mener à fins ses activités.
Cout des ECME que le service biomédical ne
possède pas.
Désignation
|
Cout en Euro
|
| Testeur de pousse seringues et
pompes volumétrique |
7500 |
| Testeur de tensiomètres |
2500 |
| Analyseur d'oxygène |
1500 |
| Contrôleur de
générateur d’hémodialyse |
2500 |
| Testeur de bistouris |
9000 |
| Testeur de respirateurs |
9000 |
| TOTAL |
32000 |
Prévoir également entre 400 et 500 € TTC pour
l'étalonnage périodique de certains testeurs
(tensiomètres, défibrillateurs).
Où
trouver ces ECME ?
La liste suivante est celle des fournisseurs potentiels, mais elle est
non exhaustive :
(
METRON, GAMIDA,
INTEGRAL PROCESS, SERES, MALLINCKRODT PURITAN-BENNET, DRAGER, MSA).
La présence des ECME n’est pas un gage d’augmentation des MP
internes :
• Il faut aussi
inclure la formation à l’utilisation de ces ECME pour les
techniciens,
• Frais liés à l’étalonnage,
Le service
biomédical occupant le même bâtiment que les
services utilisateurs des DM, la prise en charge des maintenances
préventives en interne ne ferait que réduire les temps
d’immobilisation de DM en cas de panne et permettra aussi de favoriser
la connaissance des DM par les techniciens, d’où une
rapidité et une efficacité accrues dans les
dépannages.
5.
Opérations de maintenance préventive
La
maintenance préventive est une action qu'on mène dans le
but de prévenir les défaillances d'équipements.
Son organisation au Centre Hospitalier Laennec de Creil comme
dans d’autres milieux hospitaliers demeure un sujet d'actualité.
La qualité des soins, la sécurité, la
réglementation et les contraintes budgétaires sont autant
d'éléments qui justifient aujourd'hui
l'intérêt que les services biomédicaux hospitaliers
doivent accorder au préventif.
L'expérience acquise, bien
que modeste, montre que l'on peut minimiser les coûts globaux de
maintenance par la maintenance préventive. Le milieu hospitalier
est un milieu sensible et complexe. Toute initiative, comme organiser
le préventif, peut donc s'avérer difficile car il faudra
tenir compte de plusieurs facteurs qui ne sont pas forcément
d'ordre technique. La méthodologie de mise en place est tout de
même classique et les points essentiels sont: l'analyse du
système de maintenance existant, la définition de la
charge de maintenance et les moyens, l'élaboration de
procédures de maintenance et de gestion des interventions, le
suivi et l'évaluation par le biais d'un tableau de bord avec des
indicateurs simples et pertinents.
Pour pallier à ces contraintes, et optimiser ses
activités quotidiennes, le service biomédical s’aide du
logiciel de GMAO pour gérer toute les Opérations de
Maintenance réalisées sur le parc de DM de
l’hôpital.
5.1.
Interventions et Rapports
En cas de panne du DM, le service de soins appelle le service
biomédical pour intervention ou amène le dispositif
à l’atelier :
• Le technicien
crée une fiche d’intervention associée automatiquement
à un numéro d’intervention dans la GMAO
• Edition d’un bon de travail qu’il donne au service
concerné. Ce bon comprend les informations essentielles telles
que le n° d’intervention, le n° d’équipement, le type,
la marque, le motif de l’appel ou du dépôt de l’appareil,
le service utilisateur détient alors les informations
suffisantes pour éventuellement interroger le service
biomédical sur l’évolution de l’intervention.
• Après réparation ou la MP ou le
contrôle édition du rapport d’intervention où
il décrit tout ce qu’il a fait ainsi que les pièces de
rechange utilisées .Rentre tout dans la GMAO, fait signer
la copie au responsable de soins utilisateur de ce DM. le rapport
d’intervention est classé en définitive.
Réalisation
d’une Opération de Maintenance Préventive dans le GMAO
Pour remplir une Operations de Maintenance Préventive,
dans Sophie :
- Commencer par donner le numéro de cette OMP,
- Préciser le type de maintenance (interne ou externe),
- Préciser la périodicité (Semestrielle,
Annuelle ou tous les 5 ans),
- Préciser le prestataire et la date de la prochaine
maintenance préventive,
- Enfin à partir des recommandations du fabricant on
doit préciser ce qu’on a fait, s’il s’agit d’une
révision, calibration, … il faut le mentionner dans la
rubrique « Observation »
Maintenance Préventive en
retard
La GMAO
permet de faire apparaître les MP en retard. Ce retard peut
être en partie dû à un mauvais remplissage de
SOPHIE. L'outil est en plus utilisé depuis peu pour cette
fonctionnalité, auparavant les maintenances préventives
étaient gérées comme toutes les autres
interventions. L'idée serait d'exploiter l'outil qui est
à disposition et apporte de nombreux avantages pour le suivi des
MP. Pour aboutir à cette utilisation au quotidien il faut
d'abord mettre en place une formation en interne et nommer un
technicien référent pour veiller à la bonne
utilisation et refaire des formations périodiques. Un
remplissage correct et exhaustif de la GMAO garantira un meilleur suivi
des MP et une meilleure maîtrise des coûts.
IV. DISCUSSION
• la criticité calculée par la
méthode PIEU pourrait être inscrite dans la fiche du CNEH
dans SOPHIE ce qui permettrait d'extraire rapidement et de
manière exhaustive les équipements de criticité
élevée
• La criticité « CR »
servira pour outil d’aide à la mise en place et planification
des OMP.
• La criticité de l’équipement devrait
être calculée lors de son acquisition, ce qui
permettra d’associer ou pas l’équipement à une OMP.
V. CONCLUSION
• Ce stage pratique effectué du 14 avril au 26
juin 09 dans les locaux du Centre Hospitalier Laennec de Creil m’a
fait découvrir, participer et réaliser des taches
assignées à un responsable d’atelier technique, comme la
préparation et la participation à des réunions qui
m’ont permis de découvrir l’ambiance de travail et les objectifs
à atteindre dans ces conditions.
• Les objectifs et attentes visées lors de ce
stage ont presque tous été atteints.
• D’autres part la qualité des soins, la
sécurité, la réglementation et les contraintes
budgétaires sont autant d'éléments qui justifient
aujourd'hui l'intérêt que les services biomédicaux
hospitaliers doivent accorder au préventif.
• Le milieu hospitalier étant un milieu
sensible et complexe, toute initiative comme l'organisation
préventive, peut donc s'avérer difficile car il faudra
tenir compte de plusieurs facteurs qui ne sont pas forcément
d'ordre technique.
SIGLE
DM : Dispositif Médical
MP : Maintenance
Préventive
GMAO : Gestion de Maintenance
Assisté par Ordonnateur
SBM : service Biomédical
CH : Centre Hospitalier
OMP : Opération de
Maintenance Préventive
CSP : Code de la Santé
Publique
CEE : Communauté
Economique Européen
EEE : Espace Economique
Européenne
CE : Conformité
Européenne
AFSSAPS : Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Produits de
Santé.
ECG : Electro Cardio Graphe
ECME : Equipement de
Contrôle de Mesure et d’Essaie
TTC : Toute Taxe Comprise
TSBH : Technicien
Supérieur Bio- Médical
CQ : Contrôle
Qualité
BIBLIOGRAPHIE
SITES :
1. Site drager :
http://www.drager-medical.com
2. Site fresenius Vial :
http://www.fresniusvial.fr
3. Site datex ohmed :
http://www.datex-ohmeda.fr
4. Site Karl storz:
http://www.karlstorz.de
5. Site erbe :
http://www.erbe-md.de
6. Site afnor :
http://www.afnor.fr
7. Site Drass Midi-Pyrénées :
http://www.midipy.sante.gouv.fr
8. Site association AFIB:
http://www.afib.asso.fr
OUVRAGE :
Guide des Bonnes Pratiques en Etablissement de Santé
Genèse et Contenu
Gilbert Farges
Support de cours
TSIBH
Université de Technologue de Compiègne
Résolution de problèmes
Gilbert Farges
Support de cours
TSIBH
Université de Technologue de Compiègne
LES PRINCIPAUX Outils en Qualité
Gilbert Farges
Support de cours
TSIBH
Université de Technologue de Compiègne
Maintenance et assurance qualité dans un milieu hospitalier
Maintenance et Gestion de la Qualité.
François Thibault
Support de cours
TSIBH
Université de Technologue de Compiègne
RAPPORT DE
STAGE :
Définition d’une stratégie de maintenance
biomédicale basée sur une analyse de risques.
Stéphanie ROUSSELIN
Rapport de stage 2005-2006
MASTER Management des technologies en santé.
Université de Technologue de Compiègne
Marquage CEE et codes CNEH outils de synthèse au service de
maintenance
Goddilière Patric
Rapport de stage2003-2004
SPIBH
Université de Technologue de Compiègne
Controle qualité des Pompes à Perfusion et Nutrition
Sylvain NJIAMO KAHAMA
Rapport de stage de Master Ingénierie Pour la Santé
2007
Université Claude Bernard de Lyon 1
IMAGES
[a], [b], [c]: Photos prises au
CH Laennec Creil
ANNEXES
FEUILLE
DE CALCULE DE LA CRITICITE DES EQUIPEMENTS DE CLASSE IIb
PAR LA METHODE PIEU
|
DESIGNATION |
PAR LA METHODE
P I E U |
|
|
P |
I |
E |
U |
CR |
| Monitorage |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| Bistourie
électrique |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| Lumière
froide |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
| Manodetendeur
pour bouteil à gaz |
1
|
1 |
2 |
1 |
4
|
| Pompe à
perfusion |
1 |
2
|
2 |
1 |
2 |
| Pousse seringue |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
| Néopuff |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| Humidificateur |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
| Incubateur de
transport |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| Incubateur
Ouvert |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| Inubateur
Fermé |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| Ventilateur
pulmonaire |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| Table de
réanimation neonatale |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| Electrocardiographe |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| Evaporateur
d'anesthesie |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| Module de gaz |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
| Defibrillateur |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,01 |
| Fibroscope |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
| Aspirateur
médicaux chirurgicale |
2 |
2 |
2 |
2 |
16 |
| Insuflateur
pour endoscopie |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| Ureto renoscope |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
| lithotriteur
intracorporel |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
| Instrumentation
chirurgicale |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| Cryode
chirurgicale |
1 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| Phacoemulsificateur |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| lit
fluidisé |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| Osmoseur |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| Generateur /
moniteur indivuduel d' hemodialyse |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| Reseau d' image |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| Module ECG |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| pompe à
nutrition |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
| Module PICCO |
0,01 |
1 |
2 |
1 |
0,02 |
|
ZONE DE RISQUE
|
CNEH
|
CR
|
DESIGNATION
|
|
|
32501
|
0,02
|
Défibrillateur
|
|
|
15901
|
0,02
|
Monitorage
|
|
|
36301
|
0,02
|
Bistouri électrique
|
|
|
32600
|
0,02
|
Néo puff
|
|
|
32603
|
0,02
|
Incubateur de transport
|
|
|
32604
|
0,02
|
Incubateur Ouvert
|
|
|
32601
|
0,02
|
Incubateur Fermé
|
|
|
32201
|
0,02
|
Ventilateur pulmonaire
|
|
|
32602
|
0,02
|
Table de réanimation
néonatale
|
|
|
15101
|
0,02
|
Electrocardiographe
|
|
|
32002
|
0,02
|
Evaporateur
d'anesthésie
|
|
|
37014
|
0,02
|
Insufflateur pour endoscopie
|
|
|
36700
|
0,02
|
Instrumentation chirurgicale
|
|
|
36502
|
0,02
|
Cryode chirurgicale
|
|
|
32413
|
0,02
|
générateur
pour matelas chauffant
|
|
|
36908
|
0,02
|
Phacoémulsificateur
|
|
|
54105
|
0,02
|
lit fluidisé
|
|
|
48805
|
0,02
|
Osmoseur
|
|
|
40001
|
0,02
|
Générateur /
moniteur individuel d'hémodialyse
|
|
|
60500
|
0,02
|
Réseau d'image
|
|
|
32007
|
0,02
|
Module ECG
|
|
|
32405
|
0,02
|
pompe à nutrition
|
|
|
32012
|
0,02
|
Module PICCO
|
|
|
32410
|
0,02
|
Réchauffeur de
perfusion/transfusion
|
|
|
44602
|
0,02
|
lithotriteur intracorporel
|
|
|
37002
|
2
|
Lumière froide
|
|
|
32401
|
2
|
Pousse seringue
|
|
|
32402
|
2
|
Pompe à perfusion
|
|
|
32204
|
2
|
Humidificateur
|
|
|
32005
|
2
|
Module de gaz
|
|
|
37001
|
2
|
Fibroscope
|
|
|
37011
|
2
|
Urétéro
rénoscope
|
|
|
1501
|
4
|
Manodétendeur pour
bouteille à gaz
|
|
|
32301
|
16
|
Aspirateur médicaux
chirurgicale
|