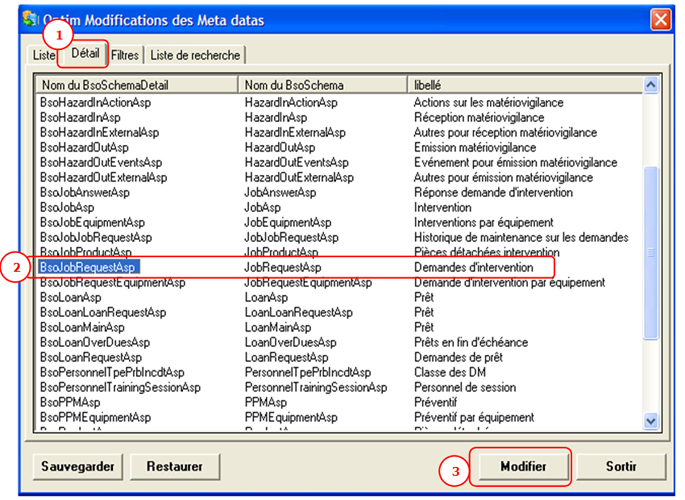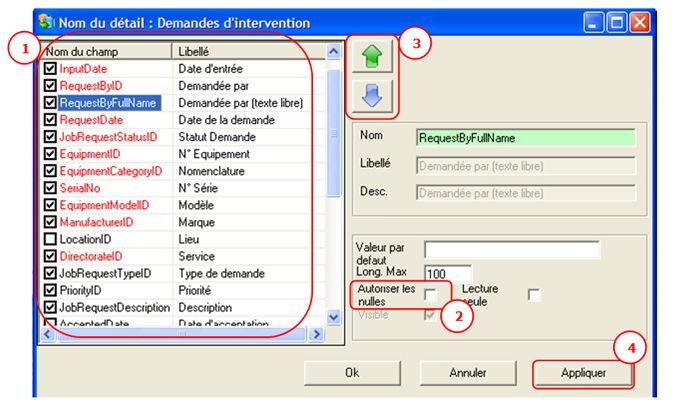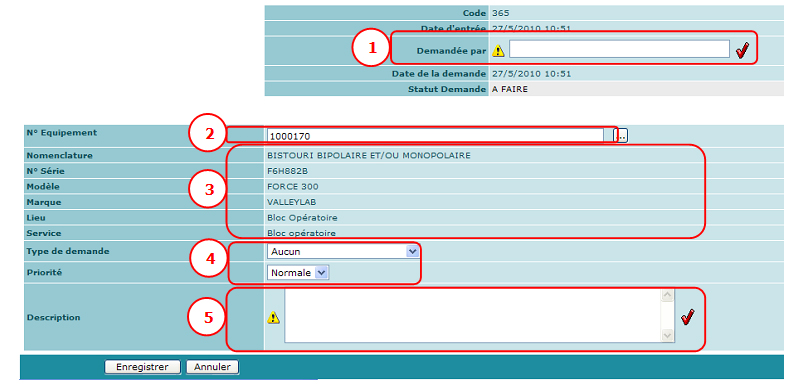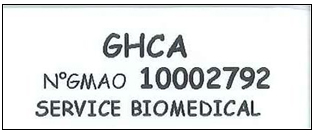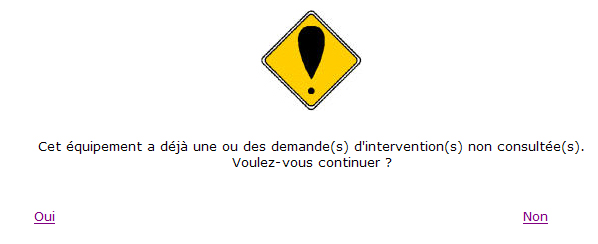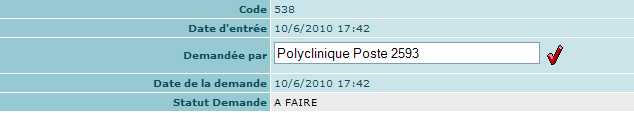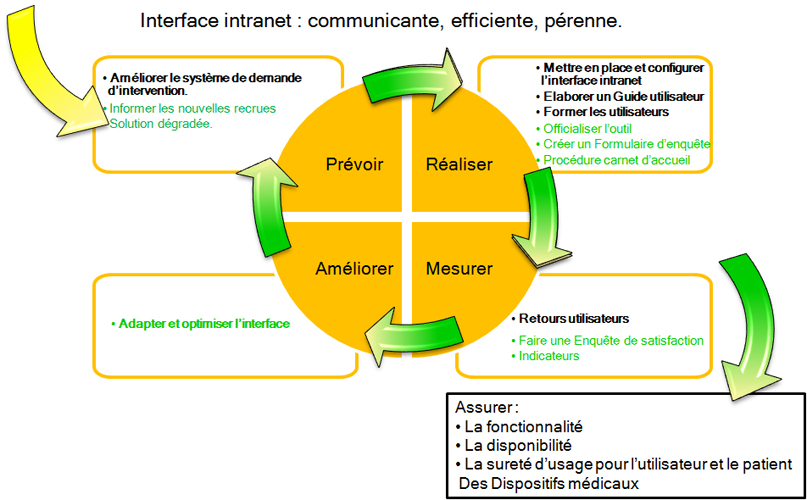|
Avertissement
|
Si vous arrivez
directement sur cette page, sachez que ce travail est un rapport
d'étudiants et doit être pris comme tel. Il peut donc
comporter des imperfections ou des imprécisions que le lecteur
doit admettre et donc supporter. Il a été
réalisé pendant la période de formation et
constitue avant-tout un travail de compilation bibliographique,
d'initiation et d'analyse sur des thématiques associées
aux technologies biomédicales. Nous
ne
faisons
aucun
usage
commercial
et
la
duplication
est
libre.
Si
vous
avez
des
raisons
de
contester
ce
droit
d'usage, merci
de nous en faire part . L'objectif de la
présentation sur le Web est de
permettre l'accès à l'information et d'augmenter ainsi
les échanges professionnels. En cas d'usage du document,
n'oubliez pas de le citer comme source bibliographique. Bonne
lecture...
|
|
GMAO: Mise en place de
l'interface intranet
|

UTC
|

Joël Deck
|

GHCA
|
|
|
|
Résumé
Dans sa démarche qualité, le service
biomédical du GHCA a décidé d’améliorer la
Gestion des interfaces avec les services de soins et
médicotechniques, tel que le préconise le "Guide des
Bonnes Pratique Biomédicales" [18] (Chapitre
Bonnes Pratiques Opérationnelles « Processus de gestion
des interfaces avec les services »).
L’interface intranet de la GMAO est un outil répondant
à ce besoin car elle en permet d’améliorer la
communication entre le service biomédical et les parties
prenantes.
Elle permet aux services de soins et médicotechniques de
faire des demandes d’intervention, au service biomédical, pour
l’ensemble de son parc de dispositifs médicaux et de connaitre
à tout moment l’état de celui-ci.
Néanmoins, sa mise en place au sein du GHCA à
nécessité plusieurs étapes importantes.
Ce rapport vous décrira les étapes nécessaires
pour optimiser cet outil afin de rendre son utilisation efficiente
et pérenne.
Mots clés :
communication, démarche qualité, demandes d’intervention,
dispositifs médicaux, gestion des interfaces, GMAO, guide des
bonnes pratiques biomédicales, interface intranet, service
biomédical.
|
Abstract
Based on the quality
improvement process, the biomedical department of GHCA has decided to
improve the relationship between the maintenance department, the
medical department and technical services as recommended by the
“Guide des Bonnes pratiques biomédicales ” [18]
(operational practice chapter “
processus de gestion des interfaces avec les services” )
The intranet option of the computerized maintenance
management system (CMMS)is the right tool to fulfil the aim of this
project. This allows to improve the communication between the
biomedical department and all other concerned services.
This application allows to the medical and technical
departments to ask for intervention automatically using their computer
including 100% of the equipments available in the hospital. In
addition, this system allows a real time view of the status of the
equipment under repair.
Nevertheless, the deployment of this application must
fulfil several important milestone.
This report describe the necessary activity to optimize this
tool in order to use it
with the best efficiency.
Key words:
Communication, quality improvement process, request application,
medical systems.
|
Remerciements
- Monsieur
Olivier
Muller, Directeur Général
du Groupement
Hospitalier de Centre Alsace, qui m’a reçu dans son
établissement.
- Madame
Aimée
Massotte,
responsable
des services techniques et du service biomédical, qui m’a
accueillie au sein du service
biomédical.
- Monsieur
Olivier
Béasse
mon
tuteur ainsi que son
collègue,
Monsieur Bertrand Simonin, techniciens du service biomédical.
Leur
sympathie, leur disponibilité et leurs conseils, ont rendus mon
stage
agréable, instructif et m’ont permis de mener à bien mon
projet.
- L’équipe
pédagogique
de
l’Université
de Technologie de Compiègne
: Gilbert Farges, Pol-Manoël Felan, Alain Donadey, Chantal Perot,
Francis Canon ainsi qu’à tous les intervenants, qui
m’ont transmis
une partie de leur savoir et les informations importantes pour la
poursuite de mes activités au sein du service biomédical
dans lequel je
suis affecté.
- Madame
Nattier
qui,
grâce
à sa disponibilité et ses
compétences, m’a guidée et aidée dans les
tâches administratives.
Enfin
je
remercie
tout
particulièrement
mon
épouse
et
mes
parents
qui,
par
leur
aide
et
leur
compréhension,
m’ont
soutenu
tout
au
long
de
cette
formation.
Sommaire
Glossaire
AFSSAPS
:
Agence
Française de Sécurité Sanitaire des
Produits de Santé.
APS : Avant projet sommaire.
ASH : Agent de Service
Hospitalier.
ASP : Active Server Pages.
CD : Compact Disc.
CQ : Contrôle
Qualité.
CNEH : Centre National de
l’Expertise Hospitalière.
DDASS : Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
DI : Demande d’intervention.
DM : Dispositif Médical.
DRASS : Direction
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales.
ECME : Équipements de
Contrôle, de Mesure et d'Essai.
ENI : Exploration fonctionnelle
Non Invasive.
GBPB : Guide des Bonnes
Pratiques Hospitalières.
GHCA : Groupement Hospitalier
du Centre Alsace.
GHPCA : Groupe Hospitalier
Privé du Centre Alsace.
GMAO : Gestion de la
Maintenance Assistée par Ordinateur.
HAS : Haute Autorité de
Santé.
HTML : Hyper Text Markup
Langage.
IP : Internet Protocol
IRM : Imagerie par
Résonance Magnétique.
JO : Journal Officiel.
MC : Maintenance Curative.
MCO :
Médico-chirurgicales et Obstétricales.
MP : Maintenance
Préventive.
ORL : Oto-Rhino-Laryngologie.
PDF : Portable Document Format.
PNI : Pression
artérielle Non Invasive.
PSE : Pousse Seringue
Electrique.
PSPH : Participant au Service
Public Hospitalier.
RSQM : Registre
Sécurité Qualité Maintenance.
SSPI : Salle de Surveillance
Post-Interventionnelle.
USIC : Unité de Soins
Intensifs Cardiologiques.
Introduction
Dans
le cadre de la certification professionnelle d’Assistant
Biomédical en Ingénierie Hospitalière, j’ai
effectué la session pratique au sein du service
biomédical du GHCA
de Colmar.
La mission qui m’a été
confiée durant le stage était de mettre en place
l’interface intranet de la GMAO "OPTIM" [16].
Ceci
permettra
d’informatiser
les
demandes
d’intervention,
émises
par
les
services
de
soins
et
médicotechniques,
dans
le
but
d’améliorer
le
système
de
demande
d’intervention.
Ce rapport de stage vous
décrira :
• Le contexte
actuel ainsi que la problématique et ses enjeux.
• L’analyse et la
méthodologie pour la mise en œuvre de l’ interface.
• Les
problèmes rencontrés et solutions proposés afin de
pérenniser l’utilisation de cet outil.
• Les conclusions
du projet ainsi que les perspectives d’avenir.
1.
Contexte,
Objectif
et
enjeux
a)
L’historique
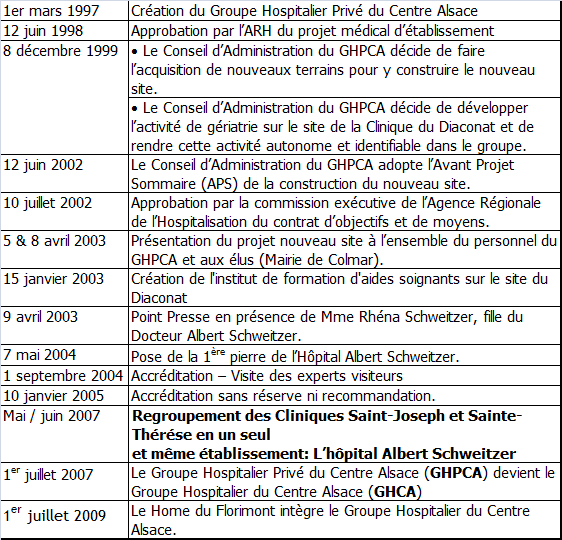
Tableau 1 : Historique du GHCA
[1]
|
b)
La
situation
géographique
Ville : Colmar
Département : Haut-Rhin
Région : Alsace
Les établissements dans la ville
Colmar :
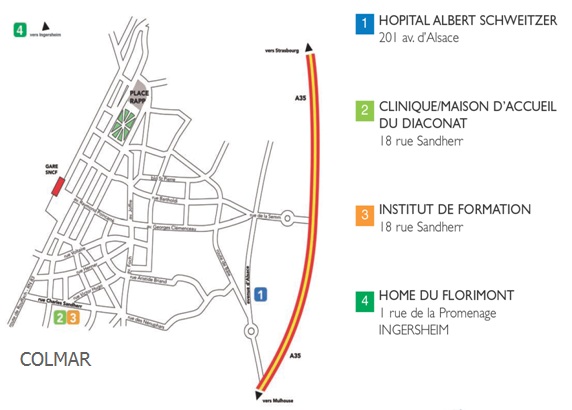
Figure 1 : Les sites du GHCA [1]
|
retour
sommaire
c)
Le
statut
juridique
et
la
constitution
du
GHCA
Le Groupe Hospitalier du Centre
Alsace est un établissement
privé de santé participant au service publique
hospitalier (PSPH).
Il est constitué de quatre
établissements :
- Le « Home
de Florimont » :
Maison
de
retraite
privée
avec
une
capacité
de
69
résidents.
- L’Institut de
Formation :
Il
dispense
les
formations
suivantes
:
- Auxiliaire de
Puériculture
- Aide-Médico-Psychologique
30 personnes pour chaque
session.
- La clinique du
Diaconat :
Elle
regroupe
toutes
les
activités
orientées
vers
la
personne
âgée
:
- Le centre de
gérontologie de court,
- une unité
spécifique destinée à accueillir les patients
atteints de la maladie d’Alzheimer
110 lits.
- L’Hôpital
Albert Schweitzer :
La
centralisation
de
l’ensemble
des
activités
MCO
(Médico-Chirurgicales et
Obstétricales) du Groupe Hospitalier du Centre Alsace, à
l’exception de la gériatrie, a été
réalisée sur le site de l'Hôpital Albert Schweitzer.
Quelques chiffres :
• 9 salles
d’opération.
• 2 salles de
cardiologie interventionnelle.
• 3 salles
d’accouchement.
• 235 lits.
• 840
employés dont 66
médecins.
• 2114 dispositifs
médicaux.
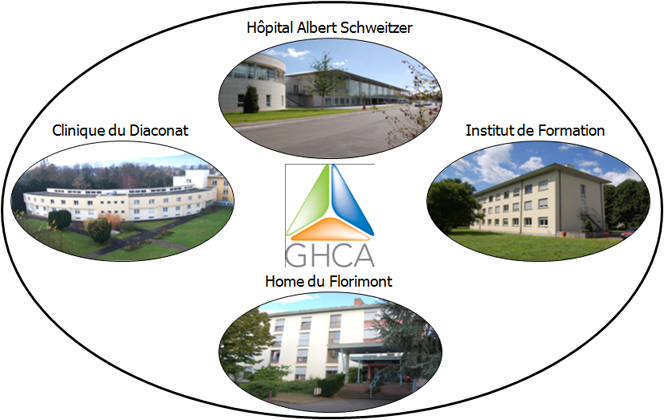
Figure 2 : Les
établissements du GHCA [1]
|
d)
Les
pôles
d’activités
Les
activités
du
GHCA
sont
diverses
et
couvrent
tant
des
spécialités
médicales
et
chirurgicales
très
spécialisées
que
des
interventions
et
actes
plus
courants,
tel
que
:
•
Anesthésie
• Cardiologie
• Chirurgie
(générale, digestive, vasculaire, plastique…)
•
Gériatrie
•
Gynécologie
• Imagerie
médicale (radiologie conventionnelle ; radiologie
interventionnelle : coronographie, angioplastie ; Mammographie ;
Scanner ; IRM ;
échographie)
•
Obstétrique
•
Ophtalmologie
•
Orthopédie
• ORL
•
Pédiatrie
•
Réanimation
•
Stomatologie
e) La
certification du GHCA
Le
GHCA
a
obtenu
sa
certification
V2007 [2] en juin 2009.
La certification des
établissements de santé est une procédure
d’évaluation externe, indépendante de
l’établissement de santé et de ses organismes de tutelle,
effectuée par des professionnels de santé, concernant
l’ensemble de son fonctionnement et de ses pratiques.
La certification des
établissements de santé est suivie et dirigée par
la Haute autorité de Santé (HAS) [3].
1.2. Les textes
règlementaires relatifs aux dispositifs médicaux
- L’arrêté
du
3 octobre 1995[4], fut le premier à
préciser une organisation de la maintenance
pour
les
matériels
d’anesthésie
et
les
dispositifs
de
surveillance
et d’entretien per et postopératoires.
- Le
décret
no 96-32 du 15 janvier 1996 [5], relatif à la
matériovigilance exercée sur les dispositifs
médicaux, qui stipule l’obligation de signalement des incidents
et des risques d'incident mettant en cause un dispositif médical.
- Les
circulaires
DH/EM1 N°96-4459 du 12 août 1996 [6], et
N° 98-1133 du 27
janvier 1998[7], stipulent la maintenance
préventive
régulière des tables
d’opération à plateaux
transférables.
- Circulaire
DH/EM1 n°987262 du 15 juillet 1998[8] concernant
les laveurs
d’endoscopes, stipule l’obligation d’effectuer la maintenance
décrite par le fabricant.
- Selon
R-5126-14
du CSP et le décret N° 2002-587 du 23 avril 2002 [9] relatif
au système permettant d’assurer la stérilisation des DM:
laveurs-désinfecteurs d’instruments, autoclaves, soudeuses…,
stipule que tout équipement doit être entretenu selon un
plan de maintenance planifié et documenté.
- Les textes
du
décret n° 2001-1154 du 5 décembre 2001 [10]
complété par l’arrêté du 3 mars 2003 [11] stipulent, que l’exploitant des dispositifs
médicaux, a
pour obligation : D’avoir un inventaire précis sur
l’ensemble de ses DM.
- De maintenance
et de Contrôle Qualité sur ses Dispositifs
Médicaux, notamment sur les dispositifs de classe IIb et III [12] (la directive 93/42/CEE qui décrit
les
règles de
classification applicables).
- De tenir
à jour un registre (RSQM) défini par la
norme AFNOR
XPS 99-170 [13] pour chaque équipement.
Pour
répondre à la
règlementation et aux recommandations du critère 16c de
la certification V2007 [2], le GHCA a mis en place et
formalisé
sa politique de maintenance préventive et curative sur
l’ensemble des dispositifs médicaux qu’il exploite [14].
1.3. Le service
biomédical
1.3.1.
Ses
missions
Les
missions
du service
biomédical sont multiples :
- Il
participe au plan d’équipement médical de
l’établissement.
- Il s’occupe
de
la gestion du parc des équipements médicaux, de
l’acquisition à la réforme.
- Il organise
et
effectue la maintenance et les contrôles qualité des DM.
- Il Planifie
les CQ
et maintenances préventives
des DM.
- Il assure
les
maintenances curatives, en fonction de sa qualification et de son
niveau d’habilitation.
- Il assure
le
suivi des interventions effectuées par des fournisseurs ou
prestataires de maintenance sur site ou en externe.
- Il assure
la
traçabilité des maintenances, des interventions et des CQ
dans
le
RSQM
(Registre
sécurité
qualité
maintenance).
- Il assure
la
gestion de stock de pièces détachées et
accessoires pour les DM.
- Il organise
la
formation des utilisateurs à l’usage des DM.
- Il se
former sur
les dispositifs médicaux sur lesquels il devra intervient.
- Il assure
la
veille règlementaire et technologique : S’informe
sur les
règlementations en vigueurs. S’informe sur les nouvelles
technologies dans le domaine biomédical.
- Il assure
la
matériovigilance : Monsieur Olivier Béasse,
technicien biomédical du GHCA est correspondant local de
matériovigilance. Il
assure
le suivi des alertes de
matériovigilance et réalise les déclarations, en
cas d’incident, auprès de l’AFSSAPS [15].
En
fonction
des
recommandations
de
L’AFSSAPS,
il
met
en
place
des
actions
correctives
ou
de
réforme
sur
les
dispositifs
médicaux
incriminés.
Nous
constatons
que
les
compétences
des
techniciens
biomédicaux
ne
se
limitent
pas
au
domaine
technique,
mais
elles
sont
pluridisciplinaires (gestionnaire, formateur, conseiller,
…).
1.3.2.
Les
moyens
pour
assurer
ses
missions
Le
service
biomédical
se
compose
de deux techniciens
biomédicaux, qui gèrent et
interviennent sur un parc de 2114 DM
(Dispositifs Médicaux).
Il est supervisé par
Madame
Aimée Massotte, responsable du service biomédical et des
services techniques.
Les bureaux et ateliers du
service
biomédical sont implantés à L’Hôpital
Albert Schweitzer.
Les moyens techniques mis à
la disposition du service biomédical sont:
• Les ECME et
équipements de calibration :
Ces
équipements
permettent
au
service
biomédical
d’assurer
le
Contrôle
Qualité
sur
les
dispositifs
médicaux.
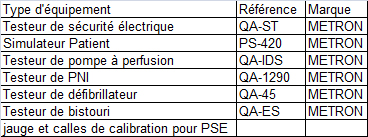
Tableau 2 : ECME et
équipements de calibration du service biomédical [17].
|
• La GMAO :
Le
service
biomédical
est
doté
d’une
GMAO
« OPTIM EMS V.4.6.3» [16]. Cet
outil incontournable permet d’assurer:
•
L’inventaire
du
parc
des
équipements
médicaux.
• La
Traçabilité des interventions effectuées sur les
DM (RSQM).
• La liste de
référence de pièce des pièces
détachées.
• La liste
des
fournisseurs et fabricants.
• La
planification
des maintenances préventives.
• Les
Statistiques.
Cette
GMAO
a
bien
d’autres
fonctionnalités
qui
ne
sont
actuellement
pas
toutes
exploitées
par
le
service
biomédical
tel
que
:
• La gestion
de
stock
de pièces
• La gestion
des
alertes de matériovigilance :
• La gestion
des
prêts de matériel (équipements).
• La gestion
des
documents (archivage des documents )
• La gestion
de
la
formation du personnel.
• La gestion
des
contrats de maintenance.
• La gestion
des
coûts.
• La gestion
des
demandes d’intervention.
• Le module
intranet.
1.3.3.
Son
organisation
et
ses
activités
Le
Politique
de
maintenance
GHCA
a
été
formalisé
suite
aux
recommandations
de
la
certification
V2007
[2] [14]. Ce
document définit les domaines
d’interventions du service biomédical ainsi que les maintenances
réalisées par les sociétés externes.
a)
Maintenance
préventive
et
curative
effectuée
par
le
fabricant
ou
société
tierce
La
Maintenance,
des
équipements
médicaux
:
• D’imagerie
médicale.
• De
ventilation.
• De
Chirurgie.
• De
stérilisation.
Est sous contrat et est
effectuée, soit par le fabricant ou par une
société tierce. Le service biomédical dans ce cas,
assure le suivi des contrats (mise à jour), le suivi des
maintenances qui ont été définis dans les
différents contrats, et assure la mise à jour du RSQM
pour ce type d’équipement grâce à la GMAO.
D’autres
dispositifs
médicaux
de
classe
IIa
et
de
classe
I
sont
sous
contrat
et
sont
assujettis
à
une
maintenance
préventive
périodique
afin
d’assurer
leur
disponibilité,
la
continuité
et
la
sécurité
des
soins
au
patient.
b) Maintenance
effectuée par le service biomédical
La
maintenance
des
équipements
médicaux
:
• Moniteur de
surveillance.
• Pousse
seringue
électrique (PSE).
• Pompe
à
perfusion.
• Incubateur.
•
Défibrillateur.
•
Télémétrie.
•
Générateur d’air chaud pour couverture chauffante.
c)
La
maintenance
en
chiffres
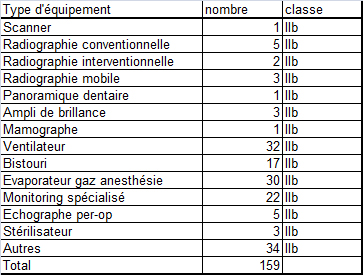
Tableau 3 : Équipements
de
Classe IIb sous contrats [17].
|
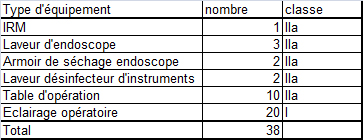
Tableau 4 : Équipements
de
Classe IIa et de classe I sous contrats [17].
|
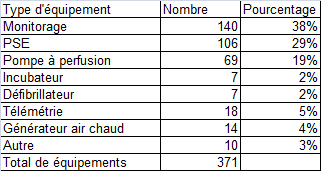
Tableau 5 : Équipements
de
Classe IIb dont la MP et le CQ est réalisée par le
service biomédical [17].
|
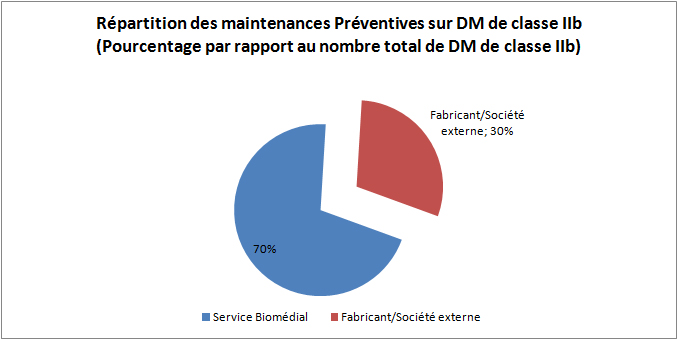
Figure 3 : Répartition
des maintenances préventives
externe/interne sur les DM de classe IIb [17].
|
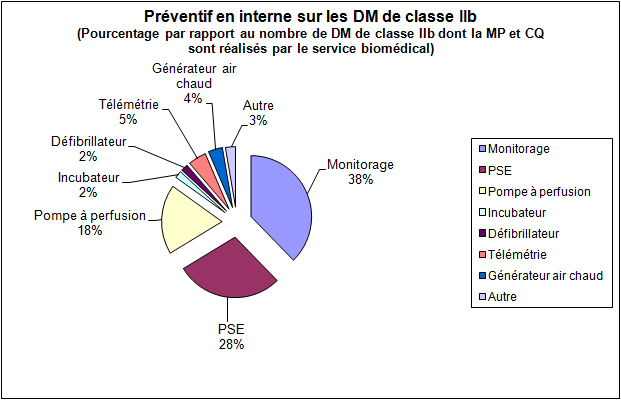
Figure 4 : Répartition
des activités, du service biomédical, de la MP et du CQ
sur équipements de classes IIb [17].
|
d)
La
planification des maintenances et activités du service
biomédical
L' organisation du temps de travail du
service biomédical est la suivante :
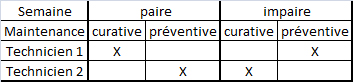
Tableau 6 : Organisation des
maintenances préventives et curatives du service
biomédical [17].
|
Cette
organisation
permet
au
technicien
de
se
focaliser
essentiellement
sur
les
tâches
qui
lui
sont
attribuées
durant
«
sa
semaine
».
Durant la semaine de «
Maintenance curative », le technicien répond aux demandes
d’intervention émises soit par fax ou par
téléphone pour les interventions urgentes.
Durant la semaine «
maintenance préventive », le technicien assure la
maintenance préventive et le contrôle qualité
essentiellement sur les dispositifs de classe IIb, d’après un
planning annuel.
Répartition
des
activités
du
Service
Biomédical
en
2009
:
(Pourcentage par
rapport au
nombre d’heures effectués par le service biomédical pour
l’année 2009)
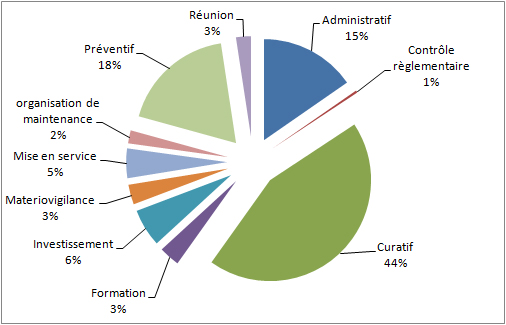
Figure 5 : Répartition des
activités du Service Biomédical en 2009 [17].
|
Nous
constatons que les activités prédominantes du
Service Biomédical sont :
- La maintenance préventive
- Les activités Administratives, qui englobent
:
- Les saisies des interventions.
- Les commandes de pièces
détachées et des consommables.
- L’archivage et saisies diverses.
Le service biomédical
intervient sur trois sites du GHCA :
- Le home du Florimont (maison de retraite). : 9DM.
- La Clinique et maison d’accueil du Diaconat
(Gériatrie) : 388 DM.
- L’Hôpital Albert Schweitzer (soins MCO): 722
DM.
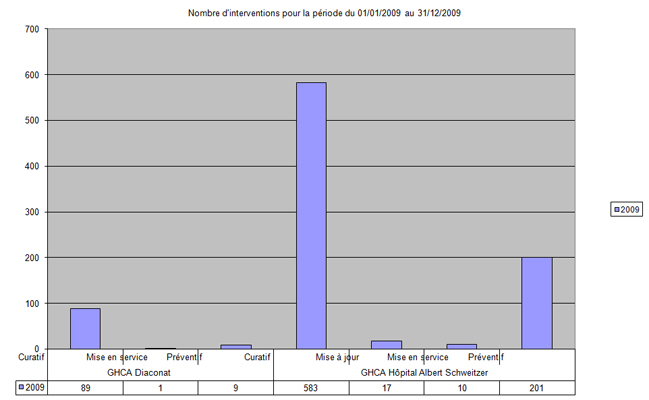
Figure 6 : Nombre
d’interventions Curatif /Préventif sur les sites du Diaconat et
de l’hôpital Albert Schweitzer [17].
|
Les
activités principales, de
maintenances et d’interventions du service biomédical, se font
à l’hôpital Albert Schweitzer.
1.4. Les demandes
d’intervention
Actuellement,
les
demandes
d’intervention
au
GHCA se font par
formulaire de demande
d’intervention (annexe 1) envoyé
par fax au service
biomédical ou par téléphone en cas d’urgence.
Les
informations suivantes sont
à renseigner dans ce formulaire :
- Service
demandeur.
- Date de demande.
- Type/modèle, N° de GMAO,
Localisation.
- Descriptif du problème.
- Observations
complémentaires dans lequel le demandeur
peut préciser la nature de sa demande ou du dysfonctionnement.
- Matériel
désinfecté ?
- Nom de la
personne qui a émis la demande.
- N° de
téléphone du demandeur/service.
- Signature du
demandeur.
Ce formulaire est accessible,
à l’ensemble du personnel, sur intranet (documents «
qualité »).
a)
Processus de demande
d’intervention par Fax :
1)
Le
service
de
soins
remplit
un
formulaire
de
demande
d’intervention
et
l’envoie
par
fax
au
service
biomédical.
En cas d'urgence il appelle
le service biomédical.
2) Le service biomédical
prend en compte la demande et crée une intervention au niveau de
la GMAO.
3) Le service biomédical
effectue les actions correctives et de contrôles sur
l’équipement et le remet en service.
4) Le service biomédical
enregistre l’intervention (finalise l’intervention crée) en
renseignant les actions effectuées sur l’équipement dans
la GMAO (RSQM).
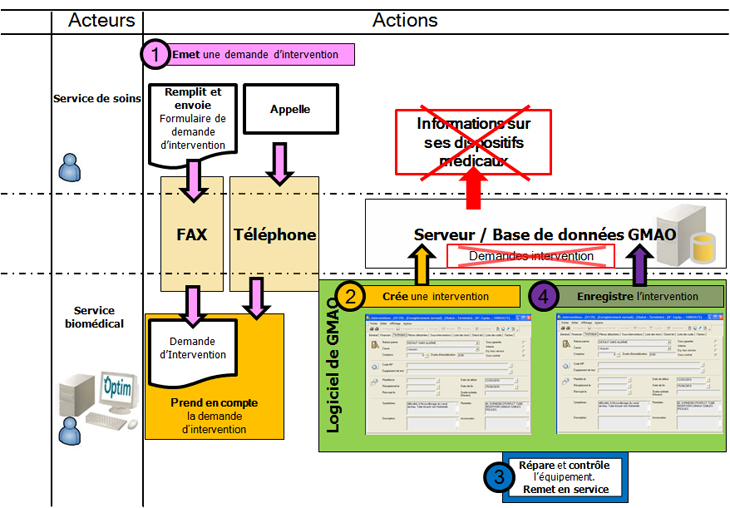
Figure 7 : Processus de
Demande d’intervention par Fax
[17].
|
b) Les avantages et inconvénients
du système de demande
d’intervention actuel
Avantages :
- Le
service
biomédical
dispose
de
toutes
les
informations
nécessaires
pour
localiser
et identifier
l’équipement
incriminé. Il connait aussi la personne
émettrice de la demande et peut la contacter par
téléphone pour avoir des informations plus précis
sur la nature de la demande. Dans le cas où toutes les
informations sur le formulaire papier sont renseignées.
- La
demande
est
transmise
directement
au
service
biomédical.
- La demande
peut être faite par la clinique du
Diaconat (site distant).
- Il y a une
trace papier, ce qui permet
d’éviter les oublis de la part des techniciens
biomédicaux.
Inconvénients
:
- Le
personnel risque de se tromper de numéro
de le fax, dans ce cas le service biomédical ne recevra pas la
demande d’intervention.
- Risque que
les champs du formulaire ne soient pas
tous renseignés.
- Risque
d’erreur lors de la saisie du N°
d’équipement.
- Pas de
trace informatique de la demande d’
intervention.
- Double
saisie. Le demandeur doit remplir le
formulaire papier, puis le technicien biomédical doit saisir la
demande dans la GMAO.
- Le
personnel qui était absent par exemple,
ne connait pas l’état de leur parc de dispositifs
médicaux.
- Le service
demandeur n’est pas informé sur
l’avancement et du délai de l’intervention.
- Le service
demandeur n’a pas accès à
l’historique des interventions effectuées sur ses dispositifs
médicaux.
La
problématique:
comment
améliorer
le
système de
demande
d’intervention actuel.
1.5. Objectif et
enjeux
L’objectif est d’informatiser le formulaire
de déclaration de
panne grâce la mise en place de l’interface intranet de la GMAO.
Ceci permettra de pallier les inconvénients de la
procédure actuelle en :
- Evitant les oublis d’informations importantes :
Des champs seront à renseigner obligatoirement, sinon la demande
ne sera pas prise en compte. L’utilisateur en sera informé et
devra remplir les champs manquants afin que la demande soit
enregistrée.
- Evitant les erreurs de saisie : Lorsque le
demandeur renseigne le numéro d’équipement, un
récapitulatif de l’équipement (modèle, n° de
série, marque..) sera affiché et pourra vérifier
s’il n’a pas commis d’erreur de saisie. Ceci permet de fiabiliser les
saisies.
- Assurant la traçabilité des demandes
d’intervention : Lorsqu’une demande est faite par intranet
celle-ci est directement enregistrée dans la base de
données de la GMAO.
- Évitant les doubles saisies: Les services
demandeurs renseignent dans leur demande d’intervention, le N°
d’équipement et la description des problèmes
rencontrés. Les techniciens biomédicaux n’ont plus
à refaire cette saisie au niveau de la GMAO.
- Donnant l’accès à la base de
données : Les services demandeurs peuvent prendre connaissance
de l’avancement des interventions et de l’historique des interventions
effectuées sur leurs équipements. Ceci leurs permet de
connaître en temps réel le statut de leurs
équipements (actif, en panne, en préventif, ..).
Les bénéfices pour
le service biomédical :
- Gain de temps : moins de saisies.
- Meilleure traçabilité des demandes
d’interventions.
- Gain en réactivité et
efficacité : demandes instantanées et mieux
renseignées.
Les bénéfices pour
les services de soins et
médicotechniques :
- Information sur l’état de l’ensemble de son
parc et l’historique des interventions sur ses équipements.
- Ils bénéficient d’une transparence
sur les activités du service biomédical.
2. Mise en place de
l’interface intranet de la GMAO
2.1. Processus de
demande d’intervention par intranet
1.
Le
service
de
soins
crée une
demande
d’intervention via l’interface intranet. Le service
biomédical
est informé par une alarme générée
par
le
logiciel
de
GMAO.
2. Le service
biomédical, via la GMAO, prend
en compte la demande et informe le service de soins sur les
actions déjà entreprises.
3. Le service de
soins visualise la réponse
à leur demande, pour connaitre l’état d’avancement
de
l’intervention.
4. Le service
biomédical effectue les actions
correctives et de contrôles sur l’équipement, puis
le
remet
en service.
5. Le service
biomédical enregistre
l’intervention dans la GMAO, en renseignant les actions
effectuées sur l’équipement (RSQM).
6. Le service de
soins visualise l’historique des
interventions sur ses équipements.
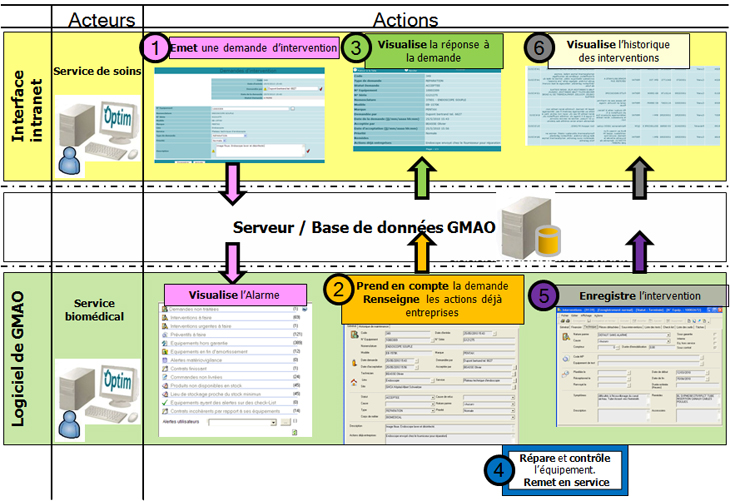
Figure 8 : Processus de
demande d’intervention par l’interface intranet [17].
|
2.2. L’analyse des moyens
nécessaires pour sa
mise en œuvre
Le
diagramme
de
cause
à
effets
permet
d’identifier
les
moyens,
les
ressources
nécessaires
ainsi
que
les
actions
à
entreprendre
pour
réussir
la
mise
en
place
des
demandes
d’intervention
par
internet.
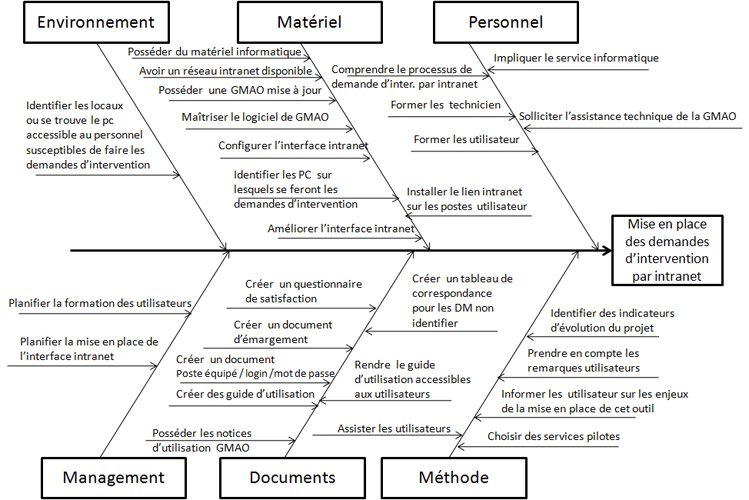
Figure 9 : Processus pour
réussir la mise en place de l’interface intranet [17].
|
2.3.
Les étapes nécessaires pour sa
mise en place
La
mise
en
place
de
l’interface
intranet
c’est a nécessité
en
plusieurs
étapes:
- La prise en main du logiciel de GMAO et de son module
intranet
- La mise à jour du logiciel de GMAO et installation de
son module sur le serveur.
- La définition des groupes utilisateurs et de leurs
droits d’accès.
- La configuration des pages intranet.
- L’élaboration d’un guide utilisateur.
- Rencontrer les responsable des services afin d’identifier
les postes informatiques à équiper et de planifier la
formation du personnel.
- Formater et accompagner les utilisateurs.
- Identifier les problèmes rencontrés et y
apporter des solutions.
2.3.1.
La
prise
en
main
du
logiciel
de
la
GMAO
et
de
son
module
intranet
Cette
étape
m’a
permis
:
•
D’étudier les fonctionnalités du
logiciel de GMAO et de l’utilitaire de configuration des pages intranet
(module intranet).
• De
m’imprégner de la logique de cette GMAO.
• D’explorer
les possibilités et d’identifier
les limites du logiciel.
• De
comprendre le processus de demande
d’intervention par intranet.
•
D’identifier les problèmes rencontrés
lors de son utilisation.
Pour
ce
faire
il
fallait
:
•
Étudier les
documents d’utilisation de la GMAO et
de l’utilitaire de personnalisation de l’interface intranet.
• Utiliser la
GMAO afin d’identifier toutes les
fonctionnalités de celle-ci.
• Me
familiariser avec l’utilitaire de configuration
du module intranet afin de pouvoir personnaliser les pages intranet.
• Simuler le
processus de demande d’intervention.
• Prendre
contact avec le support technique de la
GMAO afin d’avoir des informations plus précises sur certaines
fonctionnalités du logiciel.
2.3.2.
La
mise
à
jour
du
logiciel
de
GMAO
Bien
que
l’établissement
ait
un
contrat
de
maintenance,
d’assistance
technique
et
de
mise
à
jour
du
logiciel,
on
s’est
rendu
compte,
suite
aux
entretiens
avec
le
support
technique,
que
nous
n’avions
pas
la
dernière
version
logicielle.
On a demandé à ce
que l’on nous envoie la dernière
mise à jour du logiciel de GMAO.
Dés réception du
CD de
mise à jour,
j’ai
procédé à la mise à jour du logiciel en
désinstallant en premier lieu l’ancienne version « OPTIM
EMS 4.6.3 », puis installé la dernière version
« OPTIM CEM 5.2 » [16] sur les trois
postes du service
biomédical.
La mise à jour au niveau
du serveur a été
réalisée par le service informatique du GHCA.
2.3.3.
Le
choix
des
services
pilotes
Il
était
important
dans
un
premier
temps,
d’identifier
les
services
pilotes
avec
lesquels
nous
allions
tester
se
nouveau
système.
Nous avons choisi le
service de stérilisation et le
plateau technique d’endoscopie, car ces services avaient
déjà pour habitude et obligation de tracer leurs
activités.
Mais le choix c’est fait sur
ces services, car leurs responsables avaient un
réel besoin de connaître l’avancement et l’historique des
interventions effectuées sur leurs équipements.
Après cela il fallait
définir les groupes d’utilisateurs
ainsi que leurs droits d’accès à la base de
données.
2.3.4.
Définition
des
groupes
d’utilisateurs
et
définition
des
droits
L’intérêt
de
la
définition
des
groupes
utilisateurs
et
de
leurs
droits,
est
de
créer
des
profils
utilisateur
pour
les
différents
services
du
GHCA.
Chaque service aura son propre
identifiant et mot de passe qui
permettra de se connecter à l’interface intranet avec ses droits
associés.
La définition des
utilisateurs et des droits ce font au niveau
du logiciel d’OPTIM [16] dans l’onglet
administration -> Utilisateurs.
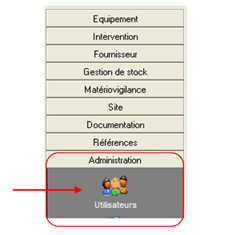
Figure 10 : Copie
d’écran du menu de la GMAO [16].
|
a) Méthodologie pour la
création des groupes
d’utilisateurs et définition des droits
1)
Ajout
d’un
groupe
d’utilisateurs
:
(exemple
«
Stérilisation-endoscopie
»
).
2) Ajout d’un
utilisateur pour ce groupe
d’utilisateurs (exemple « ste »).
3)
Définition de l’identifiant et mot de passe
pour cet utilisateur.
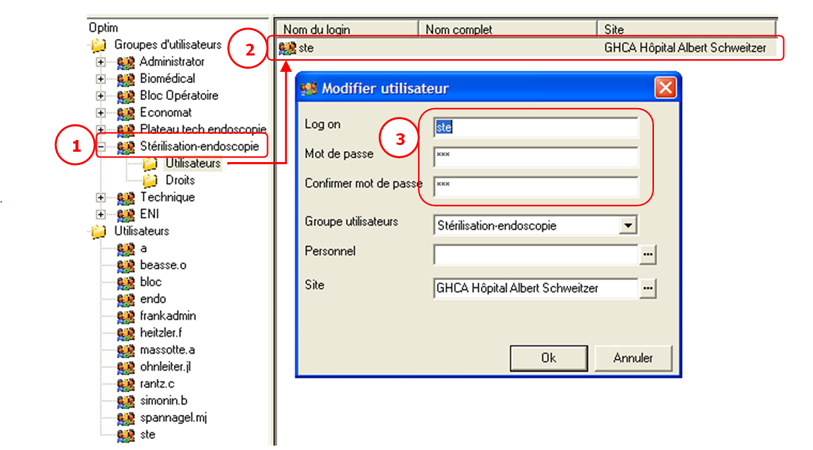
Figure 11 : Copie
d’écran de la GMAO : définition des groupes
d’utilisateurs et utilisateurs [16].
|
b) Méthodologie de définition
des droits
Le
paramétrage des droits est indispensable pour
sécuriser la base de données. Il n’est pas souhaitable
que les utilisateurs puissent effacer ou modifier des données
dans la base de données.
D’autre part, il n’est pas utile
qu’il aient accès à
l’ensemble des informations de la base de données de la GMAO.
Les droits d’accès pour les
services seront les suivant :
- Avoir
accès et créer des demandes d’intervention.
- Avoir
accès à la liste des
équipements qui sont attribués à leur service.
- Avoir
accès à l’historique des
interventions qui ont déjà été faites sur
leurs équipements.
- Avoir un
aperçu sur le statut de la demande.
c) Méthodologie du
paramétrage des droits d’accès
à la base de données
1)
Sélection
de
l’onglet
«
Droits
»
du
groupe
d’utilisateur
Visualisation et affectation des
droits d’accès aux
entrées proposées.
2) Les droits
peuvent être configurés en
:
- « aucun
accès »
- « lecture
»
- « lecture
» et « ajout »
- « lecture
», « ajout »,
« modifier »
- « lecture
», « ajout »,
« modifier », « supprimer »
3) Filtre
restrictif : il permet de ne rendre
visible, à un groupe d’utilisateurs (stérilisation par
exemple), que les équipements des services sur lesquels il est
susceptible de faire une demande d’intervention.
Dans notre
exemple :
- Bloc
opératoire
- Plateau technique
d’endoscopie
- Stérilisation
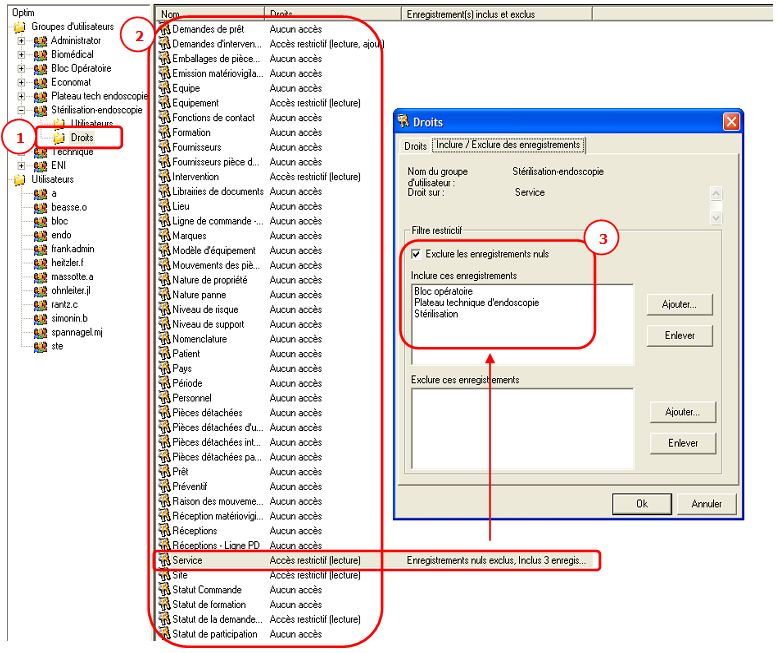
Figure 12 : Copie
d’écran de la GMAO: configuration des droits [16].
|
2.3.5.
Configuration
des
pages
de
l’interface
intranet
de
la
GMAO
Durant
cette
étape
j’ai
configuré
et
adapté
les
pages
intranet
qui
permettront
aux
services
de
faire
leurs
demandes
d’intervention
et
de
visualiser
l’avancement
et
l’historique
des
interventions.
Le but de la configuration des pages
intranet, est de n’afficher aux
utilisateurs que les informations pertinentes et utiles lors de la
visualisation de la liste d’équipements par exemple et de rendre
obligatoire la saisie d’informations importantes pour le service
biomédical.
a) Principe des pages
intranet
Les
pages intranet du module intranet de la GMAO, sont des pages au
format HTML dans lesquelles sont insérées des balises ASP
qui permettent via un navigateur internet
d’accéder aux données de la base de données de la
GMAO. Elles permettent d’afficher une partie du contenu de la base de
données, d’ajouter des entrées, de les modifier ou de les
effacer en fonction des requêtes de l’utilisateur.
Les pages affichées sont des
pages « dynamiques »,
car elles sont générées au niveau du serveur.
Elles changent en fonction de la demande (requête) de
l’utilisateur et du contenu de la base de données.
Ces pages intranet sont
stockées sur le serveur.
b) Présentation
d’un page intranet
La
page intranet se décompose en trois parties :
1)
Le bandeau : Affichant
l’entête de la page
dans laquelle on se trouve.
2)
Le menu : Il permet
d’accéder aux
différentes pages de cette interface.
3)
Le corps : cadre où
s’affichent les pages
sélectionnées dans le menu.
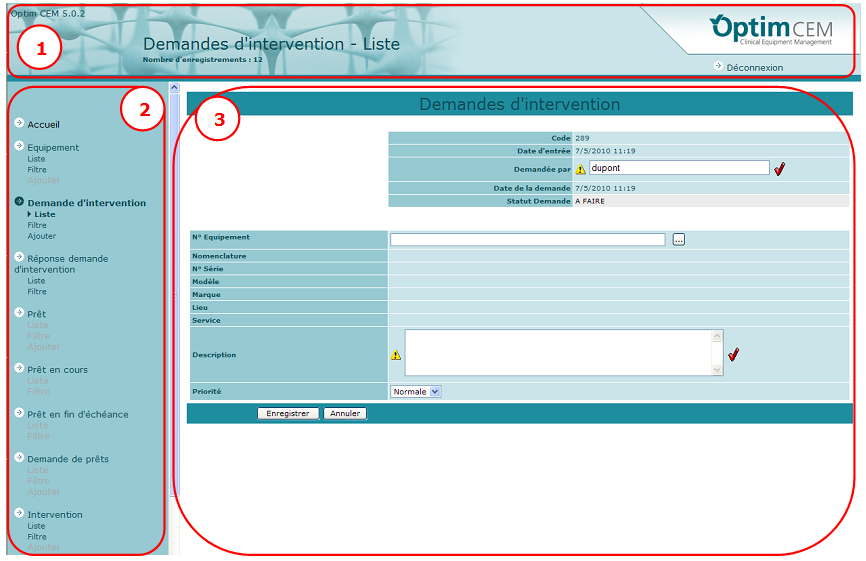
Figure 13 : Copie
d’écran d’une page intranet de la GMAO [16].
|
Les
pages
accessibles
via
le menu de l’interface intranet sont :
- « Équipement
»:
- Liste : Affiche la
liste des équipements
affectés au service.
- Filtre : Il permet de
faire une recherche
ciblée, par exemple en fonction de la marque, du n° de
série, du modèle, dans la liste des équipements.
- « Demande
d’intervention » :
- Liste : Affiche la
liste des demandes
d’intervention déjà faites par le service.
- Filtre : Il permet de
faire une recherche
ciblée dans la liste des demandes d’intervention.
- Ajout : affiche la page
qui permet d’effectuer les
demandes d’intervention.
- « Réponse
demande
d’intervention
» :
- Liste : Affiche la
liste des réponses aux
demandes d’intervention émises par le service biomédical.
- Filtre : Permet de
faire une recherche
ciblée dans la liste des réponses aux demandes
d’intervention.
- « Intervention
»:
- Liste : Affiche
l’historique des interventions
déjà entreprises sur l’ensemble des équipements
qui sont affectés au service.
- Filtre : Permet de
faire une recherche
ciblée (modèle, marque, n° de série..), sur un
équipement et d’afficher l’historique des toutes les
interventions qui ont déjà été
réalisées sur celui-ci.
c) Personnalisation de
la page de demande
d’intervention
La
personnalisation
des
pages
intranet se fait à l’aide de
l’utilitaire « Modif Méta Données pour intranet
» du pack OPTIM CEM.
Pour accéder à
cet outil il faut aller dans :
programmes/Optim Cem 5/Modif Meta données pour Intranet.
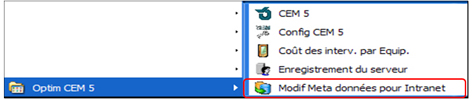
Figure 14 : Copie
d’écran de l’onglet « Modif Meta données pour
intranet » [16].
|
 La
fenêtre
ci-dessous s’ouvre :
La
fenêtre
ci-dessous s’ouvre :
On choisi la page à
personnaliser :
1) Sélection
de l’onglet «
Détail ».
2)
Sélectionner BsoJobRequestAsp (Demande
d’intervention par équipement).
3) Cliquer sur
« Modifier ».
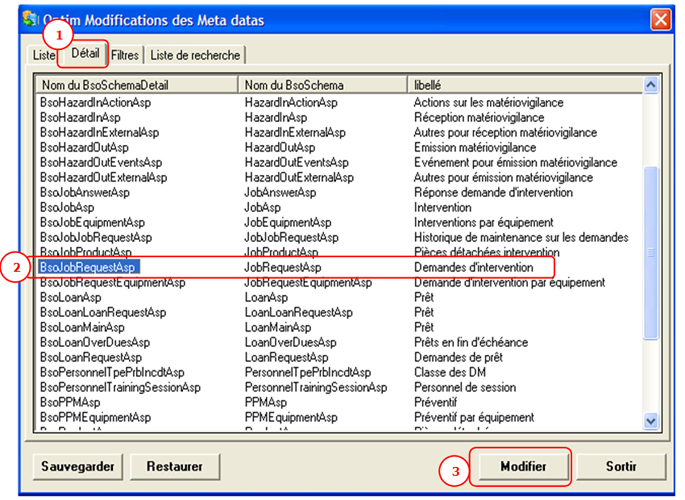
Figure 15 : Copie
d’écran de la fenêtre de « modification des
méta data » [16].
|
 La
fenêtre de configuration de la
page de demande d’intervention
ci-dessous s’ouvre :
La
fenêtre de configuration de la
page de demande d’intervention
ci-dessous s’ouvre :
1) Champs
à cochés : Les champs
sélectionnés seront visibles dans les pages de demande
d’intervention.
2) «
Autoriser les nulles » : si la case
est décochée, le champ devra obligatoirement être
renseigné.
3) Les
flèches permettent de modifier l’ordre
d’affichage des différents champs dans la page intranet.
4) Une fois
la page configurée on valide la
configuration en cliquant sur « Appliquer ».
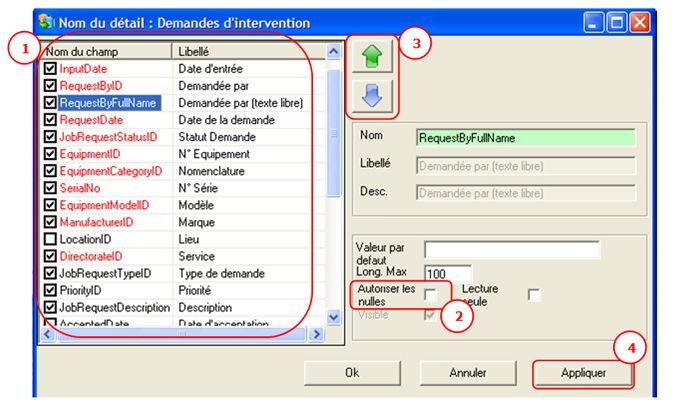
Figure 16 : Copie
d’écran de la fenêtre de configuration de la page «
demande d’intervention [16].
|
 Page de demande d’intervention
après personnalisation
Page de demande d’intervention
après personnalisation
1) Champ
« Demandée par » : A renseigner pas le nom du
demandeur.
2) Champ
« N° Equipement » : A renseigner par le numéro
« GMAO » du DM.
3) Champs de
récapitulatif : Ils s’affichent lorsque le n°
d’équipement est renseigné. Ceci permet de
vérifier si le numéro de GMAO qu’on a saisie correspond
bien au bon
équipement, ceci permet d’éviter les
erreurs de saisie.
4) Champs de
sélection « Type de demande » et de «
Priorité » : Permet à l’utilisateur de
préciser le type de demande (réparation, renseignement,
accessoires..) et l’urgence de
l’intervention.
5) Champ
« Description » : A renseigner par la description du
problème rencontré.
Remarques : Les champs
précédés du panneau « attention » sont
à renseigner obligatoirement. Le N° d’équipement n’a
pas été rendu obligatoire dans le cas où les
demandes se font sur des équipements non
répertoriés dans la GMAO, comme par exemple un
stéthoscope.
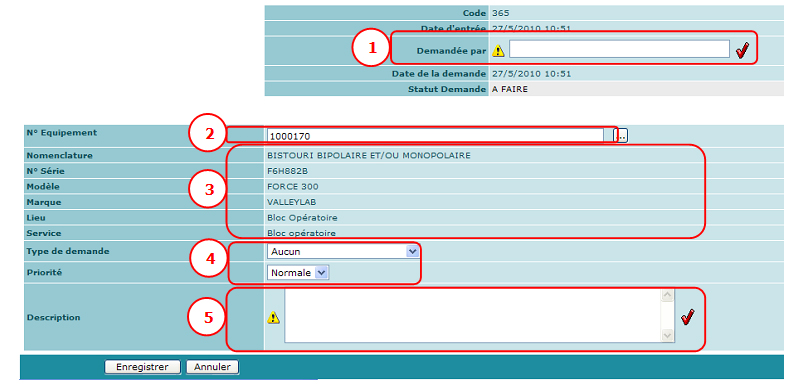
Figure 17 : Copie
d’écran de la page intranet de demande d’intervention [16].
|
 Les
pages
«
liste
»
et
«
filtres
»
se
configurent
de
la
même
manière.
Les
pages
«
liste
»
et
«
filtres
»
se
configurent
de
la
même
manière.
2.3.6. Mise en
place, formation du personnel et phase de test
a) Actions entreprises
pour cette sa mise en œuvre :
- Élaboration
d’un
guide
d’utilisation:
Un
guide
d’utilisation
simplifié
(annexe 2) a été
élaboré. Celui-ci décrit pas à pas, la
procédure pour réaliser une demande d’intervention. Il
explique aussi comment procéder pour visualiser l’historique des
interventions.
- Identification des
ordinateurs et
mise en place d’un raccourci :
Les
demandes
d’interventions
seront
réalisées
sur
les ordinateurs de salle de soins et
sur les postes des cadres des services.
Un
raccourci
pointant
sur
le
lien
de l’interface intranet à été installé
sur ces postes.
- Formation
et accompagnement du personnel :
Il
fallait
:
- Organiser les
formations en fonction de l’emploie du temps du personnel et de
leur
présence.
- Présenter l’outil en
simulant
des
demandes
d’intervention.
- Montrer les
bénéfices et avantages par rapport au
système mis
en place actuellement.
- Faire remplir une demande
fictive et
de le guider dans la procédure.
- Remettre
un guide
d’utilisation pour une consultation ultérieure.
- Assurer la
traçabilité du
personnel formé.Une feuille d’émargement
(annexe 3) a été
élaborée avec l’intitulé et l’objectif de la
formation. Ce
document
a
été
transmis
à
la « cellule formation » du GHCA pour la
traçabilité.
- Former les
techniciens biomédicaux à l’utilisation du module
intranet et à la manière de renseigner la GMAO :
Les
techniciens
doivent
changer
leurs
habitudes
d’utilisation de la GMAO.
- Ils doivent
laisser la page d’alertes de la GMAO visible et de s’habituer à
vérifier les alertes générées, suite
à des demandes émises.
- Les
sensibiliser sur l’importance de renseigner tous les champs de la GMAO.
Ils devaient s’habituer à renseigner le champ « statut de
la demande » par « accepté », renseigner le
nom du technicien ayant pris en charge l’équipement, renseigner
la date d’acceptation et indiquer les actions déjà
entreprises. Ceci
afin que les
services demandeurs connaissent l’état d’avancement de
l’intervention.
Remarque
:
Après deux semaines de
test de l’interface, le service de stérilisation et le
plateau technique d’endoscopie, n’ont pas rencontrés de
problèmes d’utilisation de cet outil.
Nous avons décidé
de déployer ce système sur d’autres services afin d’avoir
plus de retours utilisateurs.
b)
Déploiement du système de demande d’intervention
par intranet sur d’autres services
Nous
avons
décidé
de
mettre
en
place
cette
interface
dans
les
services
suivant
:
- Bloc
opératoire qui inclut les services d’anesthésie et de
SSPI.
- Le service
d’exploration fonctionnelle non invasive (ENI).
- Les
services de chirurgie (chirurgie 1, chirurgie 2, chirurgie 3, chirurgie
4, chirurgie ambulatoire, soins continus de chirurgie).
- Les services de
médecine.
- La
polyclinique.
- La
maternité.
- Le bloc
obstétrical.
- L’USIC
(unité de soins intensifs cardiologiques).
c) Création des
groupes d’utilisateurs et leurs droits d’accès
Il
fallait
pour
ces
services,
créer
et
définir
de
nouveaux
groupes
d’utilisateurs
avec
leurs
droits
d’accès
à
la
base
de
données. C'est-à-dire restreindre, entre autre,
l’accès aux équipements qui sont attribués
à leur service.
d) Identification et
rencontre des responsables de service afin :
•
D’identifier
les
postes
sur
lesquels
se
ferrons
les
demandes
(poste
de
cadre
de
la
salle
de
soins
accessible
à
l’ensemble
des
soignants)et
d’y
installer
le
raccourcie
pointant
vers
l’interface
intranet.
• D’avoir la
liste du personnel susceptible de faire des demandes d’intervention
(Cadre, référent,
infirmière, agent de service hospitalier (ASH).
• De
planifier à l’aide des responsables, la formation du personnel
concerné, en fonction de leur disponibilité et leur
présence.
e) Formation du
personnel
Dans
les
services
de
chirurgie
il
était
quasiment
impossible
de
former
les
personnes
individuellement.
Le
seul
moment
où
toutes
les
infirmières de ces services étaient présentes
(celles qui travaillent du matin ou de l’après midi),
était durant les transmissions. Pour ces services j’ai du
expliquer l’intérêt de cet outil et faire une
démonstration. Pour les autres services j’ai pu former les
personnes individuellement (chacun à pu faire une demande
d’intervention fictive).
Un guide d’utilisation a
été remis à chaque service et aux cadres de soins
pour consultation ultérieure en cas d’oublie de la
procédure.
La phase de test a
été très importante pour la mise en œuvre de
l’interface. Elle nous a permis, grâce aux remarques et
questionnements du personnel durant la formation, d’identifier des
problèmes auxquels nous n’avions pas pensé lors de sa
configuration initiale.
Cela nous a permis d’apporter
des solutions d’amélioration, afin de faciliter et de
pérenniser son utilisation.
2.4.
Problèmes rencontrés et solutions apportées.
a)
Problèmes rencontrés par les services de
stérilisations et le plateau technique d’endoscopie :
Problème
: DM répertorié sans numéro
d’équipement.
Les
dispositifs
médicaux
comme
par
exemple,
les
endoscopes
rigides
,les
endoscopes
souples
ou
les
moteur
chirurgicaux,
étaient
enregistrés
dans
la
base
de
données
de
la
GMAO,
sans
attribution
de
numéro
d’équipement.
Il
est
impératif
,
lors
d’une
demande
d’intervention
de
renseigner
le
numéro
d’équipement
afin
que
le
service
biomédical
sache
de
quel
équipement
il
s’agit.
Lorsque
l’on
voulait
modifier
la
fiche
de
cet
équipement
pour
lui
attribuer
un
numéro
d’équipement,
le
champ
restait
grisé
et
n’était
pas
modifiable.
 Solution:
Solution:
Nous
avons
pris
contact
avec
le
support
technique
de
la
GMAO
afin
de
résoudre
se
problème.
Il
suffisait
d’appuyer
sur
le
clavier
de
l’ordinateur
«
Ctrl
»+
«
F12
»
afin
qu’on
puisse
leurs
affecter
un
numéro
d’équipement
(cette
fonction
n’était
pas
décrite
de
le
manuel
d’utilisation).
Problème : dispositifs
sans numéro d’identification.
Normalement,
tous
les
dispositifs
médicaux
répertoriés
dans
la
GMAO,
sont
dotés
d’un
étiquette
avec
son
numéro
de
GMAO
(n°
d’équipement).
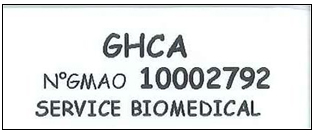
Figure 18 : Exemple
d’étiquette d’identification des dispositifs médicaux [17].
|
Certains
équipements
ne
pouvaient
pas
être
dotés
de
cette
étiquette.
Les
endoscopes
rigides,
les
endoscopes
souples
et
les
moteurs
chirurgicaux
sont
soit
stérilisés
ou
désinfectés.
Les
étiquettes
ne
résistaient
pas
aux
hautes
températures
ou
aux
lavages/désinfections.
 Solution
:
Solution
:
Nous
avons
formé
le
responsable
de
stérilisation
à
l’utilisation
des
filtres
de
recherche
.
Il
permet
de
faire
une
recherche
en
fonction
du
numéro
de
connaitre
le
numéro
d’équipement
afin
de
pouvoir
faire
une
demande
d’intervention.
Cette
procédure
a
été
rajoutée
dans
le
guide
d’utilisation
des
demandes
d’intervention
par
intranet
(annexe 2).
Pour
simplifier
la
tâche
du
personnel
d’endoscopie,
nous
avons
réalisé
un
tableau
de
correspondance
N°
interne
des
endoscopes
/
N°
d’équipement/N°
de
série
(annexe 4),
afin
qu’il
puisse
retrouver
rapidement
le
numéro
d’équipement
des
endoscopes.
b)
Problème
rencontré
par
le
service
d’
ENI
:
Problème :
Le
personnel
c’est
rendu
compte
lors
de
la
visualisation
de
la
liste
de
leurs
équipements
médicaux,
que
la
désignation
de
certains
équipements
était
erronée.
Les
holters
tensionnels
était
enregistrés
en
tant
qu’holter
cardiaque.
 Solution
:
Solution
:
La
désignation
de
ces
équipements
a
été
modifiée.
On
remarque
qu’il
est
important
que
le
service
biomédical
soit
plus
méticuleux
lors
du
renseignement
de
la
base
de
données
de
la
GMAO.
c)
Problème
rencontré
par
le
service
au
Bloc
opératoire:
Problème :
Des
équipements
étaient
attribués
au
bloc
opératoire
alors
qu’il
appartenaient
au
service
d’anesthésie.
 Solution
:
Solution
:
Réaffectation
des
équipements
à
son
service.
d)
Problèmes rencontrés par les services de chirurgie :
Un
problème
majeur
a
été
soulevé
lors
d’une
discussion
avec
un
cadre
de
santé.
Problème :
Les
services
de
chirurgie
se
prête
entre
eux
les
pousses
seringue
et
pompes
à
perfusion.
Il
arrive
parfois
que
ces
équipements
ne
reviennent
pas
dans
les
services
auxquels
ils
sont
affectés.
Les
droits
d’accès
que
nous
avions
définis ne permettaient aux
services de n’accéder qu’aux équipements qui
étaient attribués à leur service. Le service de
« Chirurgie 1 » qui avait un pousse seringue du service de
« Chirurgie 2 », ne pouvait pas faire de demande
d’intervention sur cet équipement.
 Solution
:
Solution
:
Nous
avons
reconfiguré
les
droits
d’accès
dans
la
GMAO,
des
services
de
chirurgie
et
de
médecine,
afin
que
chaque
service
ait
accès
à
l’ensemble
des
équipements
de
ces
services.
e)
Problèmes rencontrés par le services de maternité :
Problème :
Lorsque
l’on
fait
un
demande
d’intervention,
un
champ
«
N°
d’équipement
»
doit
être
renseigné,
par
contre
l’étiquette
d’identification
collée
sur
le
dispositif
indique
«
N°
GMAO
»,
il
y
a
risque
de
confusion.
 Solution
:
Solution
:
Le
logiciel
permet
de
créer
des
messages
en
page
d’accueil
de
l’interface
intranet.
Un message qui averti
l’utilisateur que le champ « N° d’équipement »
qui est à renseigner correspond au N° GMAO (étiquette
d’identification collée sur l’équipement).
Le guide d’utilisation des
demandes d’intervention par intranet (annexe 2),
informe
également
l’utilisateur
le
numéro
est
renseigner
dans
ce
champ.
Problème :
Comment
savoir
si
une
demande
à
déjà
été
faite
pour
un
dispositif
médical
en
panne
si
celui-ci
se
trouve
encore
dans
le
service.
 Solution
:
Solution
:
Un
message
d’alerte
signale
à
l’utilisateur,
lors
d’une
création
de
demande,
qu’une
demande
a
déjà
été
faite.
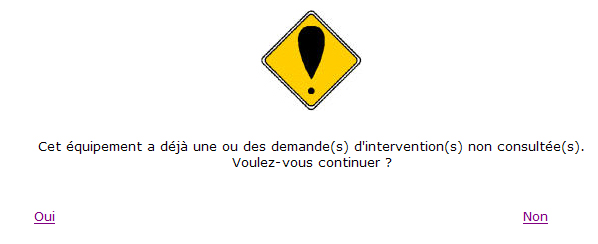
Figure 19 : Copie
d’écran du message d’alerte de l’interface intranet qui signale
qu’une DI a déjà été faite [16].
|
Problème
:
L’identifiant
et
le
mot
de
passe
que
l’on
avait
défini
lors
de
la
configuration
différait
de
l’identifiant
et
du
mot
de
passe
d’accès
à
l’ordinateur
sur
lequel
est
installé
le
raccourci
de
l’accès
à
l’interface
intranet.
 Solution
:
Solution
:
Uniformisation
des
identifiants
et
mots
de
passe.
f)
Problème rencontré par le service biomédical :
Problème :
Chaque
équipement
est
affecté
à
un
service
bien
défini.
Lorsqu’un
service
de
«
chirurgie
1
»
fait
par
exemple
une
demande
d’intervention
pour
un
pousse
seringue
qu’il
a
emprunter
à
la
«
chirurgie
2
»
par
exemple,
le
service
biomédical
pensera
que
le
pousse
seringue
se
trouve en « chirurgie 2 ».
 Solution
:
Solution
:
Pour
palier
à
ce
problème,
nous
avons
configuré
la
GMAO
et
le
module
de
l’interface
intranet
de
manière
à
ce
que
le
champ
«
Demandée
par
»
soit
automatiquement
renseigné
avec
le
nom
du
service
demandeur
et
de son numéro de
téléphone.
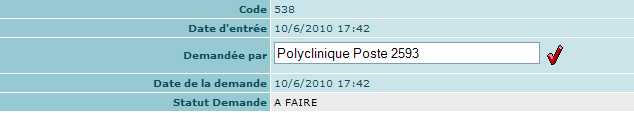
Figure 20 : Copie
d’écran de l’interface intranet, renseignement automatique du
champ « Demandée par » [16].
|
Problèmes
:
Comment :
- Connaitre
les poste sur lesquels sont installés les raccourcie pour faire
les demandes d’intervention par intranet.
- Connaitre
le personnel formé.
- Apporter
des modifications sur l’interface intranet.
 Solutions
:
Solutions
:
- Un tableau
récapitulatif a été mis à disposition
du service biomédical. Celui-ci indique les postes «
équipés », leurs lieu physique (service,
désignation du local et numéro du local), le nom de
l’ordinateur avec sont adresse IP, l’identifiant et le mot de passe (annexe 5).
- Une feuille
d’émargement (annexe 3) a
été remplie par le personnel formé.
- Un guide
expliquant la configuration des pages intranet a été
remis au service biomédical.
g) Autres
problèmes :
- Que faire
si l’utilisateur ne se rappel plus de la procédure à
suivre pour faire une demande d’intervention et ne retrouve plus le
guide d’utilisation au format papier qui a été remis au
service.
- Comment
faire pour que les nouveaux arrivants connaissent la procédure
à suivre pour faire une demande d’intervention.
 Solutions :
Solutions :
Le
GHCA
a
mis
en
ligne
un
dossier
«
communication
»,
accessible
à
l’ensemble
du
personnel.
On
y
trouve
un
dossier
«
consignes
biomédicales
».
Nous
y
avons
ajouté
le
guide
de
demande
d’intervention
par
intranet
au
format PDF. Dans la page
d’accueil de l’interface intranet un message indique aux utilisateurs
où trouver ce guide.
Dans
le
livret
d’accueil
des
nouveaux
arrivants,
un
chapitre
concernant
la
procédure
des
demandes
d’intervention
devra
être
inséré.
Les
nouvelles
recrue
pourrons
prendre
connaissance
de
la
procédure
sauront
où
trouver
son
guide
d’utilisation.
3. Conclusion et perspectives
d'avenir
Au terme de ces 10 semaines de stage, l'interface intranet de la GMAO
"OPTIM" est opérationnelle.
Au départ, nous pensions l'installer dans deux services pilotes.
Les résultats étant concluants, cet outil a
été
étendu progressivement à la
totalité des services de l’hôpital Albert Schweitzer. Il a
été très bien accueilli par les
utilisateurs, il est perçu comme un très bon outil de
communication.
Ce travail de mise en place m’a permis de décrire le processus
à la manière d’un cycle PDCA (Plan, Do, Check, Act)
d’amélioration continue :
- Prévoir ce
qu’il faut faire : Améliorer le système de demande
d’intervention.
- Réaliser ce
qui est prévu : Configuration et mise ne place de l’interface.
- Mesurer les
résultats : Former le personnel et retours des utilisateurs.
- Amélioration
et évaluation : Apporter les modifications à l’interface
suite aux remarques et problèmes rencontrés par les
utilisateurs.
Les résultats sont
encourageants car après six semaines de mise en place j’ai
constaté que :
- 80 % des services sont
« équipés » avec ce système (28
services sur 35). Les sept services restants se trouvent sur le site du
"Home du Florimont" et de la clinique du Diaconat.
- 30 % du personnel est
formé (82 personnes sur 271).
- 81 % des Dispositifs
Médicaux sur l’ensemble du parc sont concernés par
la demande d’intervention par intranet(1692 DM sur 2114).
- 32 % de demandes sont
faites à l’aide de ce nouvel outil. (21 demandes ont
été faites par intranet sur 65 demandes au total).
Ce système de demande
d’intervention sera mis en place, sur l’ensemble des services du GHCA,
d’ici la fin de l’année 2010.
Pour finaliser cette mise en place le service biomédical devra :
- Officialiser la procédure en l’enregistrant dans le
système qualité.
- Prévoir une solution dégradée en cas de
problème informatique.
- Noter l’existence du système intranet dans le livret
d’accueil des nouvelles recrues.
- Évaluer le niveau de satisfaction du personnel par
une
enquête de satisfaction et tenir compte des remarques des
utilisateurs.
- Mettre en place des indicateurs afin d’évaluer
l’évolution de l’utilisation de cet outil.
Cela permettra d’optimiser cet outil afin
qu'il reste communicant, efficient et pérenne.
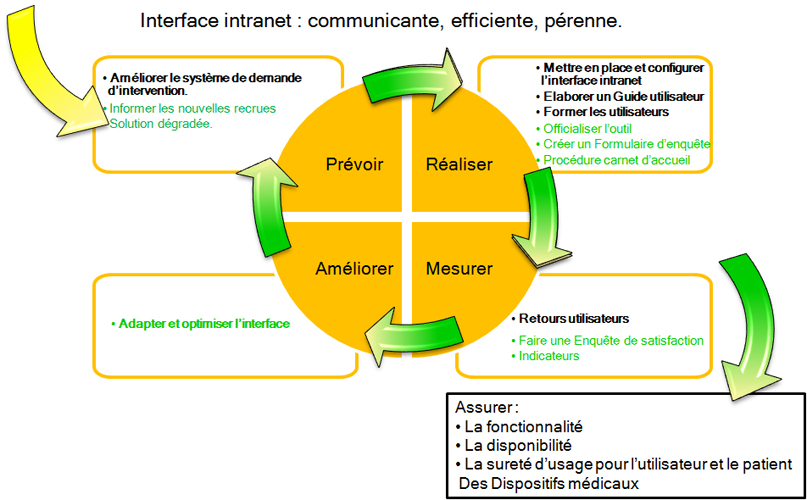
Figure 21 : Cycle d'amélioration continue [17]. |
La mise en place de cet outil
s’inscrit dans le plan
d’amélioration des pratiques et prestations du service
biomédical dont la priorité est d’assurer la
fonctionnalité, la disponibilité et la sureté
d’usage des dispositifs médicaux vis-à-vis de
l’utilisateur et du patient.
Bilan de stage
Ce
stage m’a permis :
- De faire du
« benchmarking » auprès du service biomédical
du GHCA, en observant et en analysant leur
façon de s’organiser
et de travailler.
- De
découvrir et d’utiliser les ECME (Équipements de Contrôle,
de
Mesure et d'Essai) et outils nécessaires,
afin de réaliser le contrôle qualité sur les
dispositifs médicaux tel que les PSE
et les pompes à
perfusion.
- De
découvrir de nouvelles technologies biomédicales (veille
technologique), grâce aux démonstrations des commerciaux.
- D’élargir mes contacts (prestataires, fournisseurs ,
techniciens
biomédicaux).
- De me
familiariser avec la GMAO et son utilitaire de
configuration des pages
intranet.
- D’identifier les étapes nécessaire à la
mise en
place de l’interface intranet. Ceci me sera d'une grande
aide , car mon établissement a pour dessein de mettre en place
cet outil.
Fort de cette expérience
et grâce aux enseignements qui m’ont été
dispensés à l’UTC de Compiègne, je vais contribuer
à l’évolution du service biomédical de mon
établissement dans lequel j’ai été affecté
il y a un an.
Récapitulatif des illustrations
et tableaux
Figure
1
:
Les
sites
du
GHCA
[1].
Figure 2 : Les
établissements du GHCA [1].
Figure 3 : Répartition
des maintenances préventives externe/interne sur les DM de
classe IIb [17].
Figure 4 : Répartition
des activités, du service biomédical, de la MP et du CQ
sur équipements de classes IIb [17].
Figure 5 : Répartition
des activités du Service Biomédical en 2009 [17].
Figure 6 : Nombre
d’interventions Curatif /Préventif sur les sites du Diaconat et
de l’hôpital Albert Schweitzer [17].
Figure 7 : Processus de Demande
d’intervention par Fax [17].
Figure 8 : Processus de demande
d’intervention par l’interface intranet [17].
Figure 9 : Processus pour
réussir la mise en place de l’interface intranet [17].
Figure 10 : Copie
d’écran du menu de la GMAO [16].
Figure 11 : Copie
d’écran de la GMAO : définition des groupes
d’utilisateurs et utilisateurs [16].
Figure 12 : Copie
d’écran de la GMAO: configuration des droits [16].
Figure 13 : Copie
d’écran d’une page intranet de la GMAO [16].
Figure 14 : Copie
d’écran de l’onglet « Modif Meta données pour
intranet » [16].
Figure 15 : Copie
d’écran de la fenêtre de « modification des
méta data » [16].
Figure 16 : Copie
d’écran de la fenêtre de configuration de la page «
demande d’intervention [16].
Figure 17 : Copie
d’écran de la page intranet de demande d’intervention [16].
Figure 18 : Exemple
d’étiquette d’identification des dispositifs médicaux [17].
Figure 19 : Copie
d’écran du message d’alerte de l’interface intranet qui signale
qu’une DI a déjà été faite [16].
Figure 20 : Copie
d’écran de l’interface intranet, renseignement automatique du
champ « Demandée par » [16].
Figure 21 : Cycle
d'amélioration continue [17].
Tableau 1 : Historique du GHCA [1].
Tableau 2 : ECME et
équipements de calibration du service biomédical
[17].
Tableau 3 : Equipements de
Classe IIb sous contrats [17].
Tableau 4 : Equipements de
Classe IIa et de classe I sous contrats [17].
Tableau 5 : Equipements de
Classe IIb dont la MP et le CQ est réalisée par le
service biomédical [17].
Tableau 6 : Organisation des
maintenances préventives et curatives du service
biomédical [17].
Références bibliographiques
[1] Livret
d’accueil 2010 du GHCA.
[3] http://www.has-sante.fr/
, site de
la Haute Autorité de santé, consulté le 4 juin
2010.
[4]
Arrêté du 3 octobre 1995 relatif aux modalités
d’utilisation et de
contrôle
des
matériels
et
dispositifs
médicaux
assurant
les
fonctions
et
actes cités aux articles
D.712-43 et D.712-47 du code
[5] Décret no
96-32 du 15 janvier 1996 relatif à la matériovigilance
exercée
sur
les dispositifs médicaux
et modifiant le code de la santépublique (2e partie : Décrets
en Conseil d’État), JORF no 14 du17 janvier 1996. p. 803, NOR :
TASH9523427D.
[6] Circulaire
DH/EM1
N°96-4459 du 12 août 1996, relative à la
sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux,
incidents ou risques d'incidents liés à l'utilisation de
tables d'opération.
Bulletin
officiel
du
ministère
chargé
de
la
santé
n°
96/37
p.
159-160.
[7]
Circulaire
DH/EM1 N° 98-1133 du 27 janvier 1998,relative à la
sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux.
Incidents ou risques d'incidents liés à l'utilisation de
tables d'opérations
[8] Circulaire DH/EM1
n°987262 du 15 juillet 1998, concernant la
traçabilité des procédés de
désinfection des endoscopes, site http://www.sante.gouv.fr ,
consulté le 9 juin 2010.
[9] Décret no
2002-587 du 23 avril 2002 relatif au système permettant
d’assurer
la
qualité
de
la
stérilisation
des
dispositifs
médicaux
dans
les établissements de
santé et les syndicats inter hospitaliers,JORF no 98 du 26 avril 2002. p. 7505,
NOR : MESH0221170D.
[10]
Décret
no 2001-1154 du 5 décembre 2001 relatif à l’obligation de
maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs
médicaux prévus à l’article L. 5212-1
[11]
Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs
médicaux soumis à l'obligation de maintenance et au
contrôle de qualité mentionnés
[12] Directive
93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs
médicaux, modifiée par : Directive 98/79/CE du Parlement
européen et du Conseil,
[13] Norme XPS
99-170 : http://www.afnor.org/
,
site de L’Afnor, consulté le 7 juin 2010.
[14] Politique
de
maintenance préventive et contrôle qualité des
équipements, site de communication du GHCA, répondant au
manuel de certification des établissements
de
santé(V2007), chapitre 2 : ressources transversales,
référence
16c : La maintenance préventive et curative est assurée .
[15] http://www.afssaps.fr/,
site
de
L’Agence
Française
de
sécurité
sanitaire
des
produits
de
santé,
consulté
le
8
juin
2010.
[16] http://www.optim.fr/ ,
site de la GMAO
OPTIM, consulté le 8 juin 2010.
[17] GMAO :
Mise en place de son interface intranet, Joël DECK, UTC, ABIH 2010.
[18] Guide
des
Bonnes
Pratiques
Biomédicales
en Etablissement de
Santé
,
Farges G. (UTC), Wahart G. (Pdte AFIB), Denax J.M. (Pdt AAMB),
Métayer H. (Pdt ATD) et 45 co-auteurs,
ITBM/RBM
News,
Ed
Elsevier,
novembre
2002,
vol.
23,
Suppl.
2,
23s-52s).
Bibliographie
A.
Livret
d’accueil
2010
du
GHCA
B. http://www.legifrance.gouv.fr
, site qui regroupe les textes et décrets relatifs à la
santé public, consulté le 4 juin 2010.
C. http://www.afssaps.fr/
, site de
L’Agence Française de sécurité sanitaire des
produits de santé , consulté le 8 juin 2010.
D. http://www.has-sante.fr/
, site de
la Haute Autorité de santé, consulté le 4 juin
2010.
E. http://www.sante.gouv.fr
, site du
ministère de la santé et des sports, consulté le 9
juin 2010.
F. http://www.afnor.fr ,
site de
l’Association Française de Normalisation, consulté le 31
mai 2010.
G. http://www.utc.fr , site
de
l’Université de Technologie de Compiègne (UTC),
page consultée le 28 mai 2010.
H. http://www.midipy.sante.gouv.fr/
,
site
la
DRASS
Midi-Pyrénées,
consulté
le
2
juin
2010.
I. http://www.legifrance.gouv.fr/
, site Légifrance, service public de la diffusion du droit
par l’internet, consulté le 3 juin 2010.
J. Guide
pratique Maintenance des dispositifs médicaux
Conception-Réalisation : mars 2005 http://www.midipy.sante.gouv.fr/
, consulté le 22 avril 2010.
K. http://www.midipy.sante.gouv.fr/
, site de la DRASS et des DDASS, consulté le 22 avril 2010.
L.
«
Fondements
méthodologiques
de
l’amélioration
continue
et
de
la
résolution
de
problèmes
»,
auteur
Gilbert
Farges,
Responsable
et
animateur
de
spécialités
du
master,
d'une
certification
professionnelle
et
de
formations
en
technologie
biomédicale
et
en
qualité
pour
des
chercheurs,
managers,
ingénieurs
ou
techniciens
supérieurs,
http://www.utc.fr/~farges
.
M.
«
Outils
du
Contrôle
et
Management
de
la
Qualité
»,
auteur
Gilbert
Farges.
N. «
Asset Management Solutions UTC 2010 – GMAO », auteur Christian
Rapin, Sales and marketing manadger, Christian.rapin@med.ge.com , GE
healthcare.
O. Site
de GE Healthcare « Solutions d’Asset Management », http://www.gehealthcare.com/eufr/services/asset-management-solutions/asset_plus/index.html
, consulté le 7 mai 2010.
P. Site de
Corim GMAO, http://www.corim-solutions.com
, consulté le 13 juin 2010.
Q. Site de
Développeur de GMAO G2IT « 100% web », http://www.asp-gmao.fr/
,
consulté le 13 juin 2010.
R.
Site
du
CEFH
centre
d’études
et
de
formation
hospitalières
:Traçabilité
des
procédés
de
Stérilisation
et
Désinfection,
Dany
Gouadain
Directeur
scientifique
Annexes



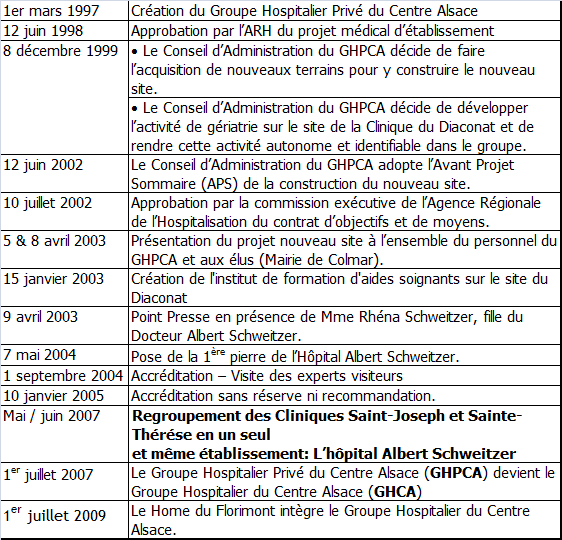
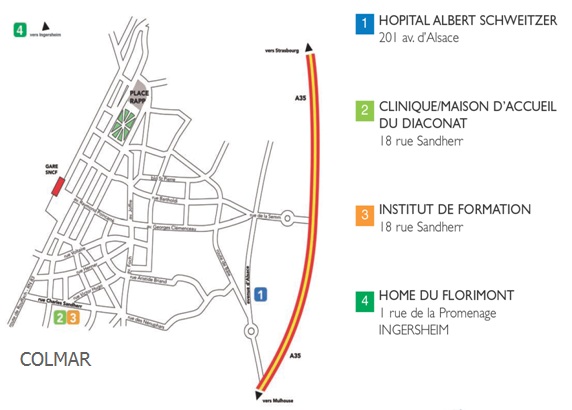
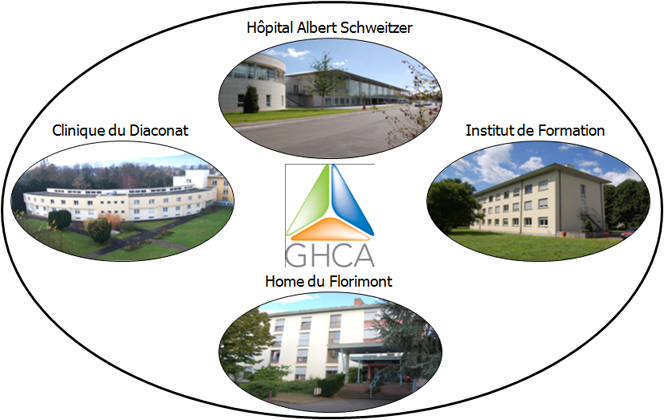
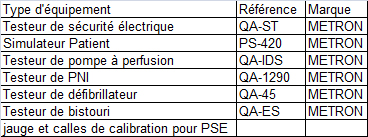
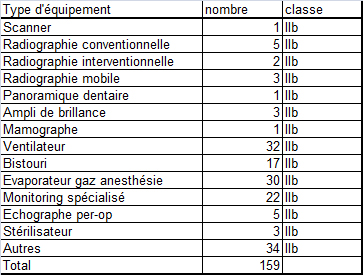
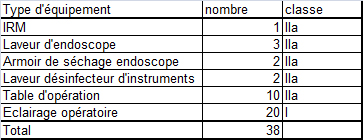
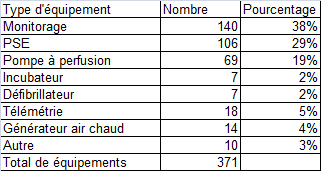
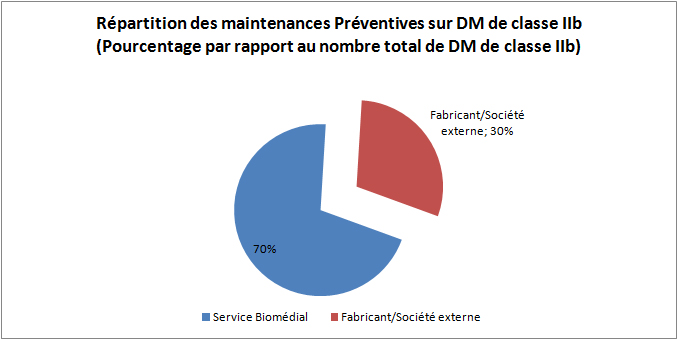
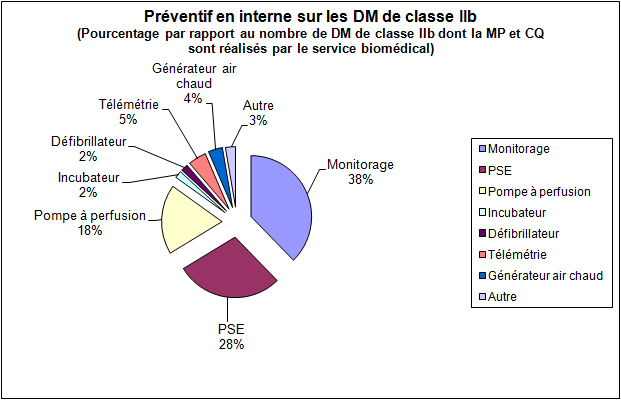
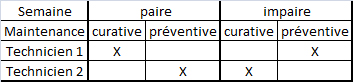
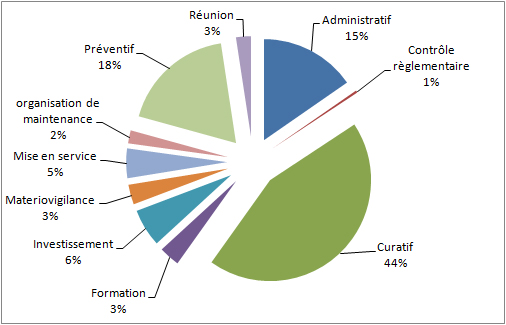
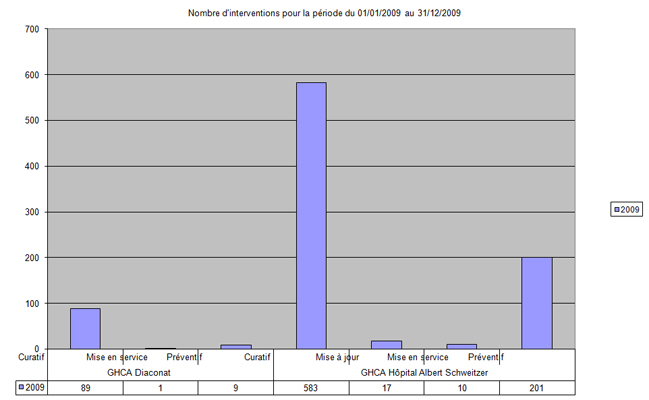
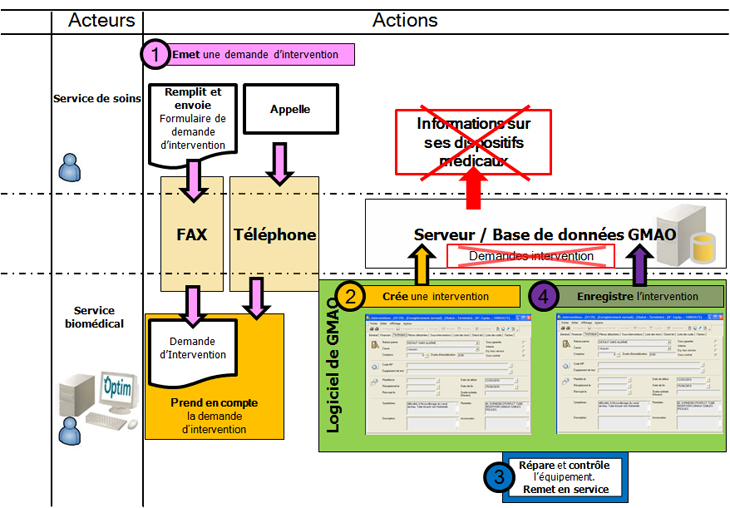
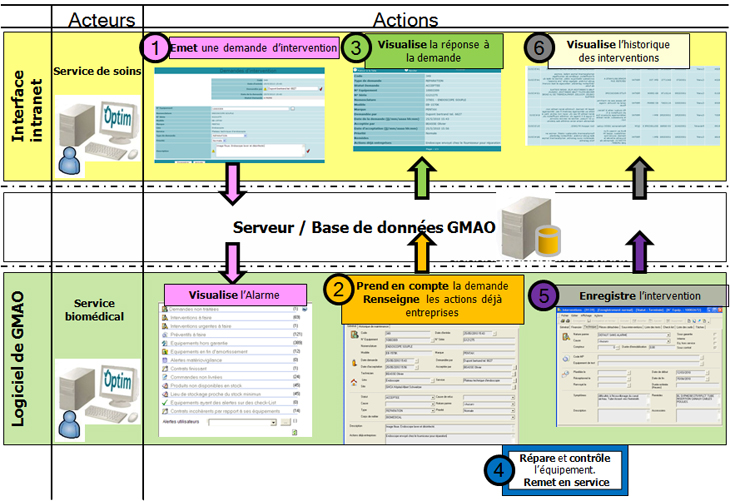
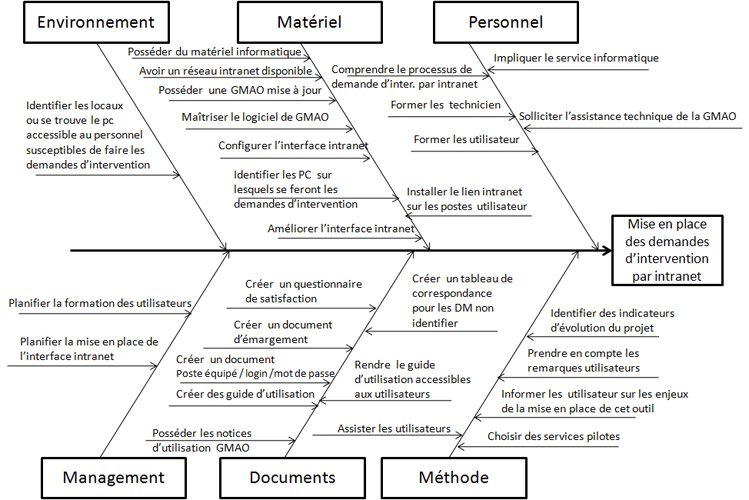
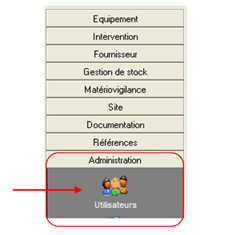
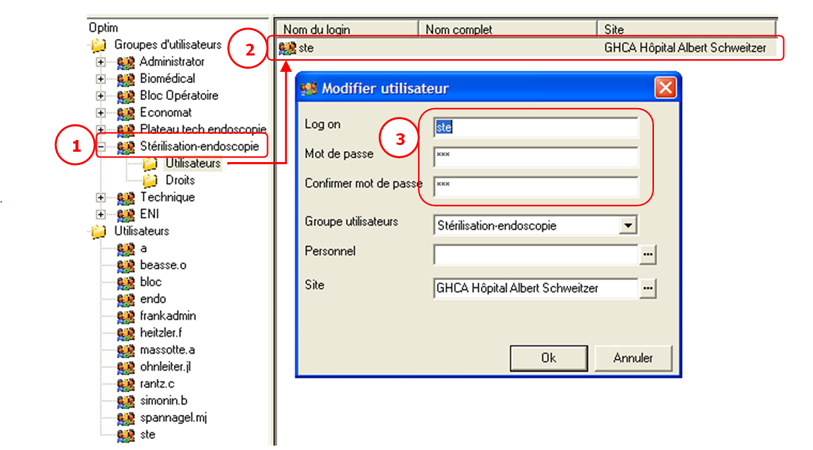
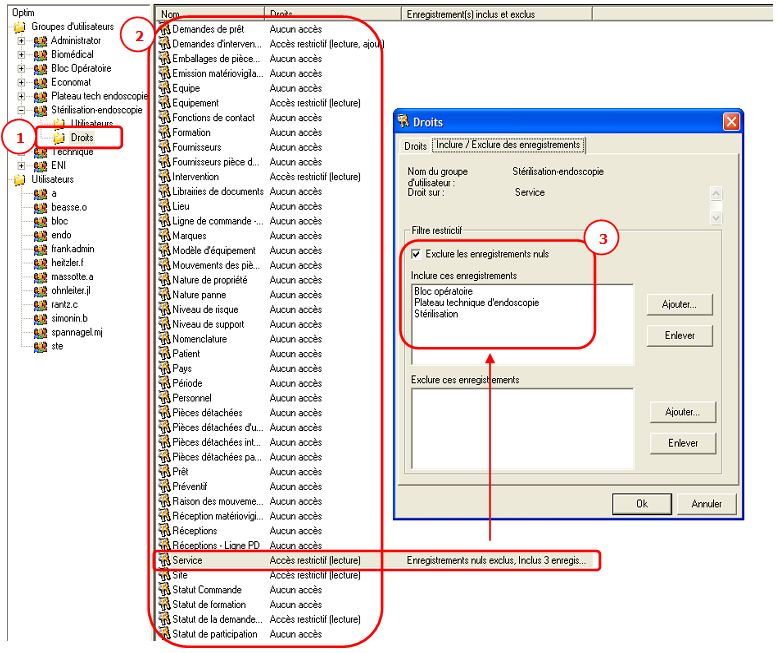
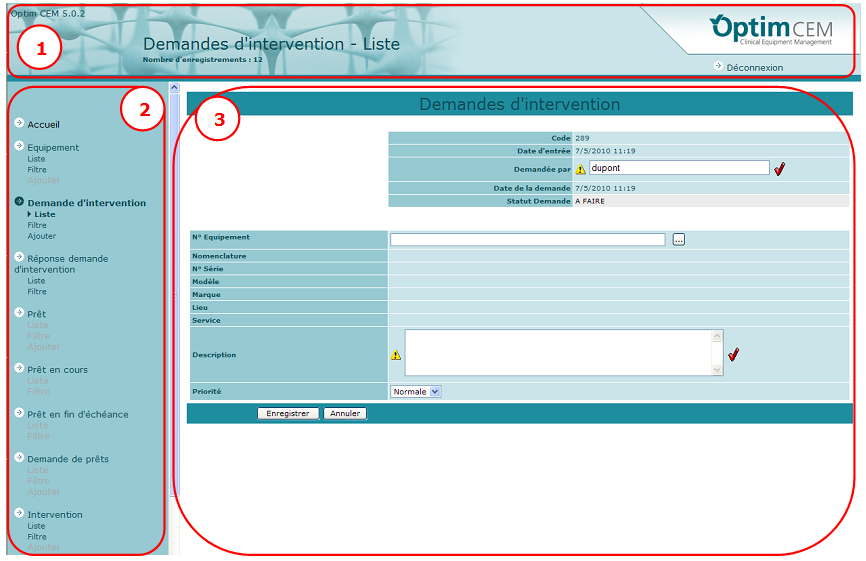
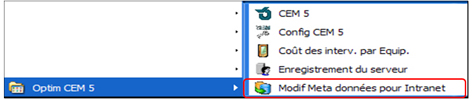
 La
fenêtre
ci-dessous s’ouvre :
La
fenêtre
ci-dessous s’ouvre :