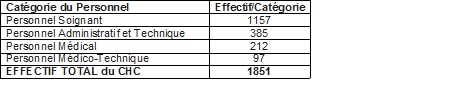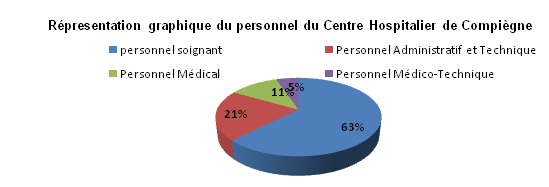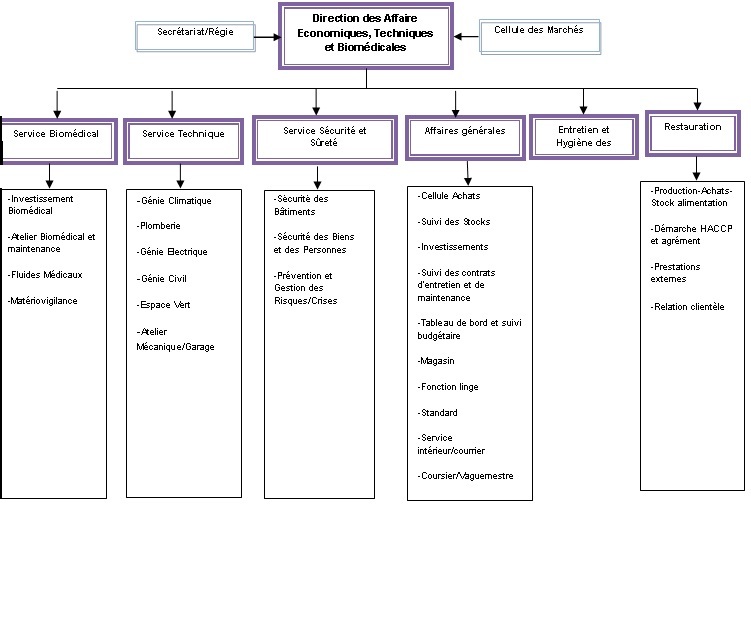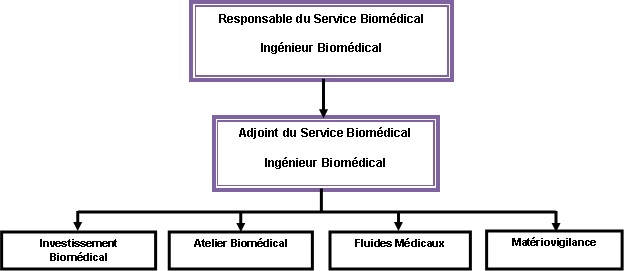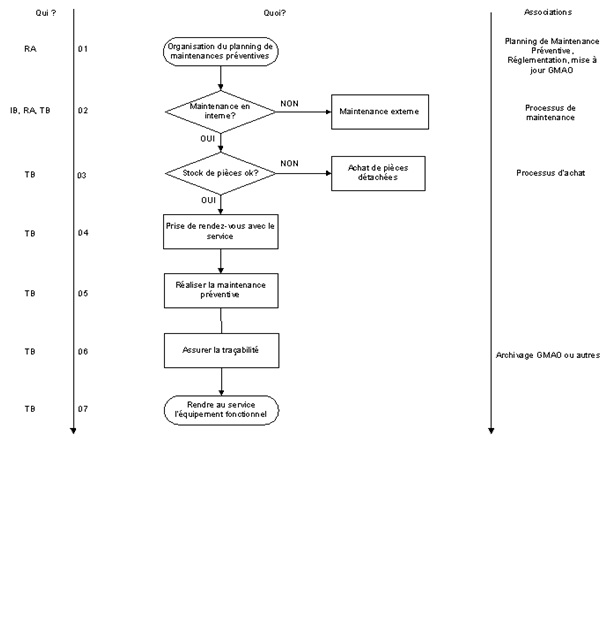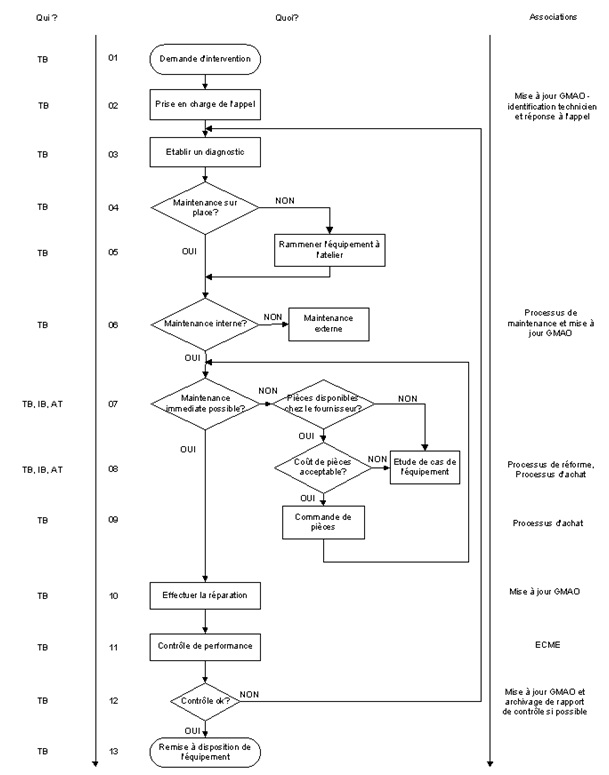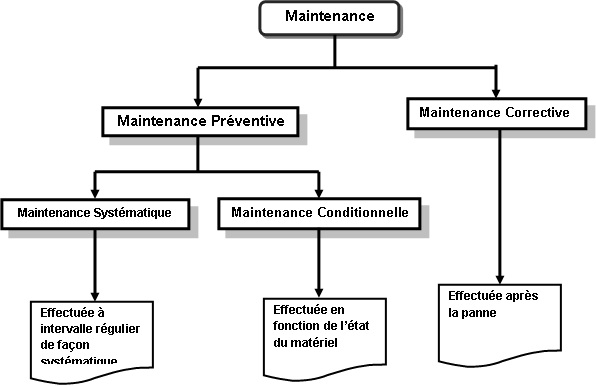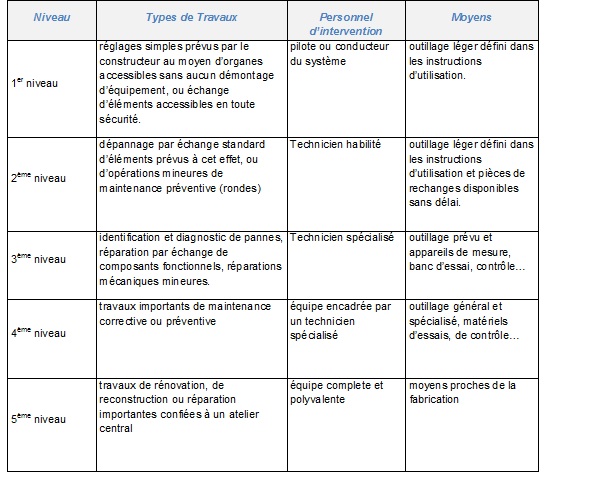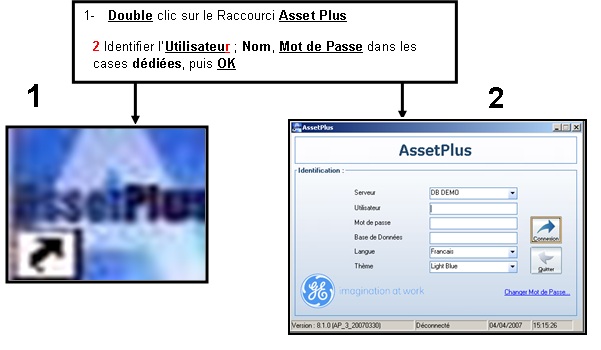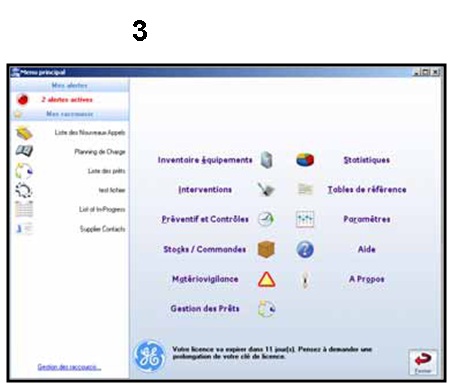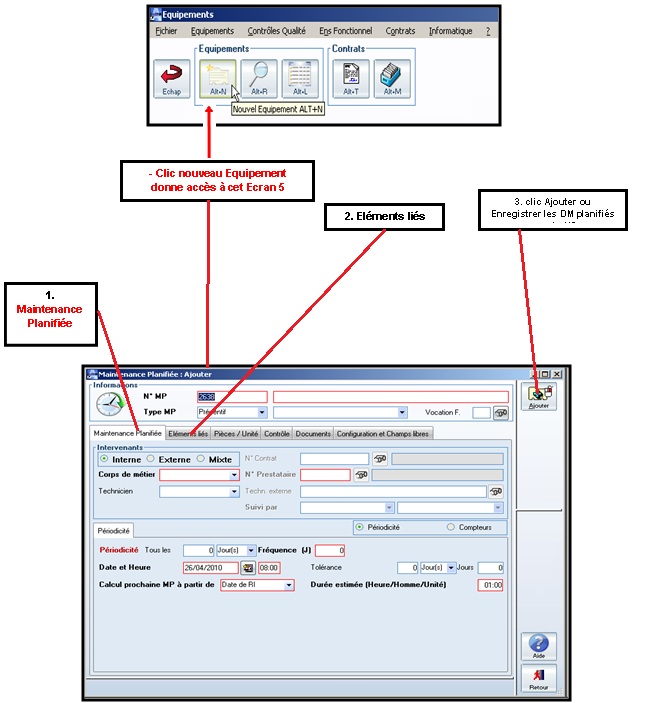I.3. Missions du Service Biomédical
Le Service Biomédical a pour missions la Gestion des Dispositifs
Médicaux en exploitation du Centre Hospitalier de
Compiègne.
Ses missions consistent à satisfaire les besoins des services
médico-techniques relative aux dispositifs médicaux,
notamment au travers de deux axes majeurs qui sont l’acquisition de
matériels neufs (la fonction achat) et la fonction maintenance
»
Les Missions du Service Biomédical sont basées sur
l’Achat et la Maintenance du patrimoine technologique du CHC et se
déclinent par la réalisation des activités qui
suivent à savoir :
- Planifier l’investissement des DM de
l’établissement ;
- Assurer la maintenance
(préventive/curative) ;
- Suivre la distribution des fluides
médicaux ;
- Veiller à la Matériovigilance ;
- commander et gérer les Pièces de
rechanges (PR) ;
- Former les services de soins à
l’utilisation des DM.
II. ORGANISATION
DE
LA
MAINTENANCE
PAR
LE
SERVICE
BIOMEDICAL
Le Service Biomédical est basé sur le site central (CHC)
où sont regroupés aux jours et heures ouvrables les
techniciens formant l’équipe d’intervention et prend en charge
les équipements biomédicaux des autres centres de
santé qui sont :
* la Maison de Retraite et
l’Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées
Dépendantes ;
* le centre hospitalier de
Noyon.
Un programme d’astreinte (garde) est observé selon un emploi du
temps établi, où chaque technicien doit respecter pour
assurer la continuité du service.
Une bonne organisation des activités d’un service
biomédical doit pouvoir permettre d’adapter les moyens aux
besoins et une connaissance des concepts et des principes directeurs de
ses prérogatives (missions).
Pour garantir la qualité, la continuité et la
sécurité des soins, le Service biomédical se fixe
pour missions et pour valeurs de mettre en œuvre les moyens
matériels, humains et financiers dont il dispose afin d’assurer
aux services utilisateurs la disponibilité, la
sûreté de fonctionnement ou le maintien des performances
des DM acquis par la DAETB, la sécurité des utilisateurs
et du patient.
Ainsi, le Service biomédical vise à atteindre la
satisfaction du Patient et celle des Praticiens de la médecine
de santé pour une utilisation optimale des DM et
participer à l’amélioration continue de la prise en
charge des soins de santé.
Le Service biomédical peut également conseille et forme
les professionnels de santé pour une utilisation optimale des
dispositifs médicaux mis à leur disposition.
Au niveau du service biomédical, deux grandes fonctions sont
assurées par les techniciens biomédicaux (TB) :
- La Maintenance Préventive (MP)
planifiée;
- La Maintenance corrective.
II.1.La
Réalisation de la Maintenance par le service biomédical
Lors d’une demande d’intervention par les services de soins, le service
biomédical répond à l’appel et ensuite prend en
charge la réparation (intervention interne) de
l’équipement, dans le cas contraire (Prestation externe, si le
DM est sous contrat), la société en charge du contrat est
contactée.
II.1.1.Maintenance
préventive
L’Adjoint Biomédical, le responsable de l’atelier
Biomédical a la charge d’organiser le planning de la maintenance
préventive.
Il identifie et définit, la criticité des dispositifs
médicaux soumis à la Maintenance Préventive, tout
en tenant compte aux exigences des textes réglementaires et
normatifs liés au domaine
Le Responsable Atelier définit la périodicité des
interventions préventives (fréquence de la MP), identifie
le technicien biomédical en charge, ou la société
externe, selon le cas. Ces informations sont saisies sur la GMAO.
Quand la MP est réalisée par un prestataire
extérieur, il faut suivre le processus de la nature des
opérations réalisées par celui-ci qui doivent
faire l’objet d’un rapport d’intervention externe (RI externe) transmis
au responsable atelier qui doit être renseigné sur la GMAO.
Quand la MP est effectuée en interne, le technicien
biomédical prend en compte le planning établi par le
responsable atelier, s’assure d’avoir au magasin les pièces
nécessaires et prend rendez-vous avec le service médico
technique concerné.
Il réalise la maintenance préventive, tout en s’assurant
de la traçabilité (respect des exigences
réglementaires ; normatives) et doit procéder à la
saisie du rapport d’intervention sur la GMAO. L’équipement
fonctionnel est rendu dans le service utilisateur.
II.1.2.Maintenance
corrective
A la demande d’un service de soins pour une défaillance d’un DM,
le TB pose un premier diagnostic de la panne.
Il analyse la possibilité de déplacer le DM à
l’atelier biomédical ou faire l’intervention sur le site de
l’unité fonctionnelle (service de soins) concernée.
Il analyse aussi la nécessité du type d’intervention
(interne, ou externe).
Quand la maintenance est réalisée en interne, le
technicien biomédical s’assurer de la disponibilité de
pièces. Au regard du coût de la réparation et de
l’état vétuste du dispositif médical, les cadres
du service décident pour la réparation ou l’étudie
pour la réforme ou le déclassement.
Auquel cas, l’équipement réparé est soumis
à un contrôle de performances, avant sa remise en service
avec la traçabilité du contrôle effectuée
avant sa remise à disposition définitive au service
utilisateur.
II.1.3.Maintenance
externe
La maintenance externe peut se pratiquer en deux phases.
Pour les DM sous contrat, le Service Biomédical fait appel par
la transmission d’une demande d’intervention à la
société en charge du DM concerné.
Quand le DM n’est pas sous contrat, le Service Biomédical, fait
un Bon de Commande d’intervention (BCI) qu’il adresse au prestataire
externe qui établit un devis de réparation adressé
aux cadres biomédicaux pour analyse de validation.
.Au cas où le devis requiert l’accord des cadres
biomédicaux, le TB, organise l’intervention du prestataire
externe et évalue la possibilité d’un prêt de DM en
prenant soin de vérifier auprès du service de soins
l’urgence de l’intervention.
Le Prêt peut s’avérer négatif, par
conséquent, le technicien biomédical est tenu d’informer
le service de soins des éventuelles raisons, dans le cas
contraire celui suit le processus de pour assurer la continuité
du service de soins.
L’intervention externe, quand elle est réalisée, le
TB reçoit un bon d’intervention (BI) émis par la
société externe, qui met en exergue la nature des
opérations réalisées qui doivent être
stockées ou archivées sur la GMAO.
L’adjoint biomédical (AB), le responsable de l’atelier
biomédical se charge du suivi administratif de l’intervention et
de la facturation.
Les cadres du Service Biomédical ayant la responsabilité
des DM en exploitation au CHC, ceux veillent au respect des
règles de l’Art et aux respects des exigences
réglementaires qui se traduisent par des réunions de
service en début de semaine (tous les lundis) et en fin de
semaine (tous les vendredis).
Ces réunions font le point des tâches
réalisées et en instance d’exécution
Les deux grandes fonctions de maintenance (préventive et
corrective : interne/externe) sont réalisées et font
office d’un rapport d’intervention.
Les RI externes (MP ou MC) sont dans la majorité sur supports
papiers archivés rangés dans les classeurs et
gérés par l’adjoint biomédical en attente
d’être saisis et stockés sur la GMAO.
« La maîtrise de la technologie biomédicale
représente aujourd’hui un véritable enjeu rappelé
régulièrement par la réglementation toujours plus
lourde.
Elle implique rigueur et professionnalisme dans la gestion du
patrimoine biomédical depuis l’achat des équipements
jusqu’à leur réforme »
[6].
« Le contexte réglementaire et sociétal
évoluent vers une recherche croissante de la
sécurité et requiert des moyens supplémentaires
»
[7].
Par conséquent, le Responsable Biomédical porte un regard
particulier à la qualité de la traçabilité
des interventions, aux respects des périodes d’exécution
de la MP et les délais de réparation des DM, en vue
d’offrir des prestations de qualité à tous les niveaux.
L’Organisation de la Gestion des DM par le Service Biomédical
doit être comprise l’ensemble du personnel biomédical et
s’avère primordial pour son applicabilité de :
- Définir et connaître les enjeux
liés aux exigences du domaine ;
- Poser le ou les problèmes et tracer les
axes de résolution ;
- Fixer les objectifs à atteindre.
Processus de réalisation
de la
Maintenance Préventive par le Service Biomédical au
Centre Hospitalier de Compiègne
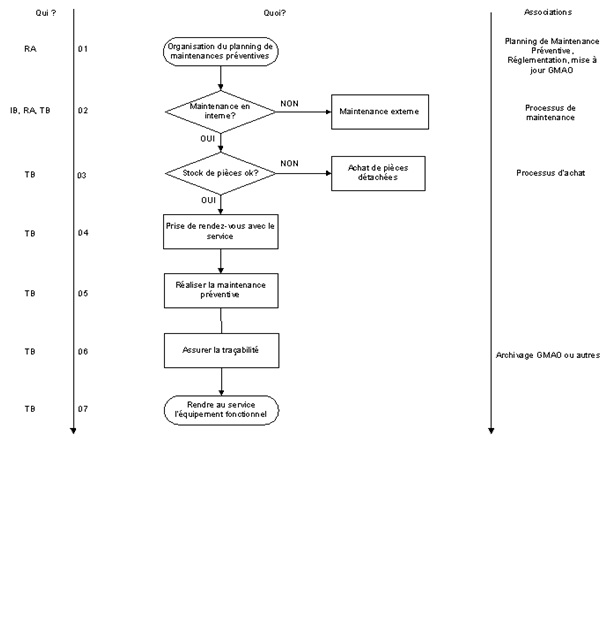 Figure 6 : Processus de la
réalisation de la Maintenance
Préventive par le Service Biomédical du CHC
Figure 6 : Processus de la
réalisation de la Maintenance
Préventive par le Service Biomédical du CHC
Source : Manuel Qualité Service
Biomédical CHC
Processus
de
réalisation
de
la
Maintenance
Corrective
par le Service
Biomédical au Centre Hospitalier de Compiègne
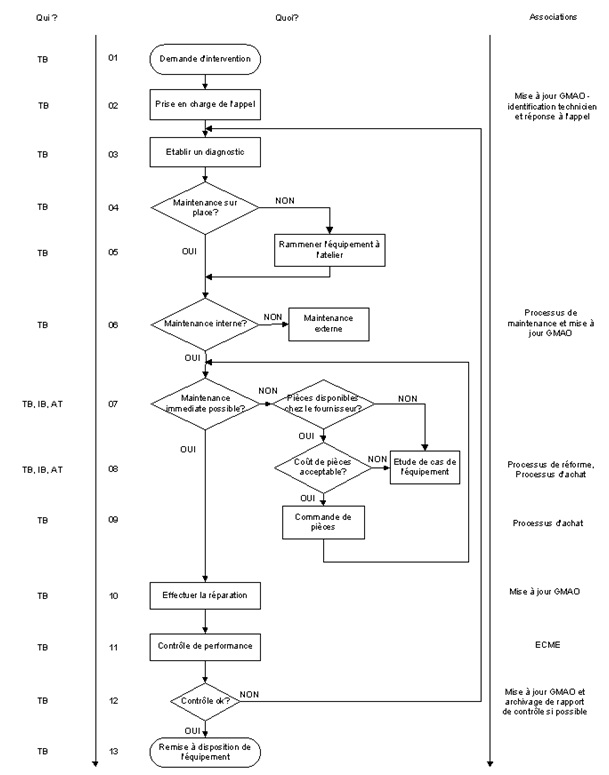 Figure 7 : Processus de la
réalisation de la Maintenance
Corrective par le Service Biomédical du CHC
Source : Manuel Qualité Service
Biomédical CHC.
Figure 7 : Processus de la
réalisation de la Maintenance
Corrective par le Service Biomédical du CHC
Source : Manuel Qualité Service
Biomédical CHC.
Voir
figure
8:
Pour
telécharger
le
Diagramme
du
Réseau
Technique
Humain
(RTH)
réalisé
par
l’Auteur du Rapport cliquez ici
II.1.4. Enjeux
L’organisation de la maintenance des dispositifs médicaux du CHC
sont nombreux et se définissent par l’amélioration de la
qualité des soins au profit du patient et doivent pouvoir :
- Respecter et Mettre en adéquation les
exigences liées au corps métier en milieu
hospitalier (textes réglementaires, normes liés aux DM) ;
- Programmer et Investir les besoins (DM) des
Services de soins (SS).
II.1.5. Problématique
Le sujet de ce rapport de stage vise à la planification de la
maintenance préventive des dispositifs médicaux du Centre
Hospitalier de Compiègne par la technologie informatique,
à savoir la Gestion de la Maintenance Assistée par
Ordinateur (GMAO).
Cet outil informatique de gestion de la maintenance(GMAO)
(préventive ou curative), va Permettre à l’Unité
Biomédicale (UB) du Centre Hospitalier de Compiègne de :
- Planifier sur la GMAO les DM soumis à
la MP du CHC ;
- Réaliser et Suivre la MP des DM
conformément aux prescriptions du fabricant ;
- Garantir la disponibilité des DM dans
les Cliniques au profit du Patient.
II.1.6. Objectifs
La planification par définition est un processus d’aide à
la décision qui vise, par concertation des acteurs
concernés, à prévoir des ressources et des
services requis pour atteindre des objectifs déterminés,
selon un ordre de priorité établi, permettant ainsi le
choix d’une solution préférable parmi plusieurs
alternatives
[8].
La Planification de la maintenance préventive du patrimoine du
CHC sur la GMAO a pour objectifs de :
- Anticiper les pannes sur les DM du CHC ;
- Gérer la traçabilité des
DM en exploitation du CHC ;
- Rassurer l’utilisateur sur la
sûreté et de la fiabilité des DM de soins ;
- Contribuer à la délivrance des
soins de qualité au Patient ;
III. LA GESTION
DE LA MAINTENANCE PAR LE SERVICE BIOMEDICAL
III.1.L’outil de
la Gestion de la Maintenance interne/externe
Pour la Gestion de la maintenance et le suivi des équipements
biomédicaux en exploitation, le service biomédical
utilise l’outil informatique à partir du logiciel Assetplus : la
GMAO qui est la Gestion de la maintenance Assistée par
Ordinateur, installé depuis 1998.
La définition et l’intérêt de la gestion de la
Maintenance, selon l’Association Française de Normalisation
(AFNOR), est « l’ensemble des actions permettant de maintenir ou
de rétablir un bien dans un état spécifié
ou en mesure d’assurer un service déterminé »
[9].
Depuis 2001, la maintenance, selon la norme (NF EN 13306 X 60-319),
définit celle-ci, comme étant « l’ensemble de
toutes les actions techniques, administratives et de management durant
le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou
à le rétablir dans un état dans lequel il peut
accomplir la fonction requise»
[10].
D’une manière générale, la Maintenance doit
pouvoir assurer la rentabilité des équipements en tenant
compte de la politique définie par l’entreprise ou
l’établissement.
Ainsi, elle procède à des études préalables
afin de permettre la réduction des coûts d’investissement
et des interventions, préparer les tâches, analyser les
conditions de fonctionnement, de défaillances possibles et les
conditions d’intervention.
La Gestion de la Maintenance des dispositifs médicaux par le
service biomédical du Centre Hospitalier de Compiègne est
essentiellement basée sur deux principaux concepts, comme il a
été décrit dans le chapitre « Organisation
de la maintenance » à savoir :
- La Maintenance Préventive;
- La Maintenance Corrective.
III.1.1. La Maintenance Préventive
La Maintenance Préventive correspond à la volonté
d’anticiper toute défaillance pouvant entraîner la
dégradation de l’équipement et vise à optimiser
(pérenniser) ses performances conformément aux
préconisations revendiquées par le constructeur,
évitant ainsi tout dysfonctionnement.
Il existe deux types de solutions :
• Le remplacement ou la réparation
systématique d’organes : c’est la maintenance
systématique qui consiste à bien connaître les
processus de dégradation ;
• Le changement ou la réparation des organes
en fonction de leur état de dégradation : c’est la
maintenance conditionnelle qui impose une surveillance de la
progression d’usure du matériel.
III.1.2. La Maintenance Corrective
Selon l’Association Française de Normalisation, la Maintenance
Corrective est effectuée suite à une défaillance
rendant le dispositif (le BIEN ou Matériel) non productif,
d’où l’arrêt de la production ou du service attendu.
Elle correspond à une attitude passive d’attente de la panne :
la réaction (l’intervention) consiste alors à
éradiquer le défaut ou la défaillance (panne)
suite à une réparation.
La démarche ou le fonctionnement de ce type de maintenance
demande à faire :
- Le diagnostic de la panne (le
dysfonctionnement, en se servant des schémas et des appareils de
tests (contrôleur universel, oscilloscope..) pour détecter
la défaillance ;
- La réparation (le dépannage) de
façon définitive, permettant ainsi au fonctionnement
correct du matériel, apte pour le service ou la production.
Les différentes options de la
maintenance (selon AFNOR)
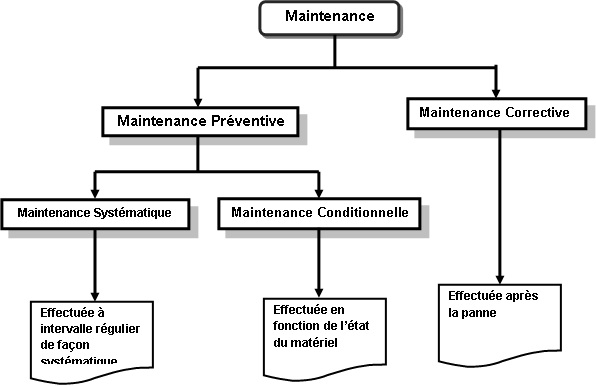 Figure 9: Dfférentes options de
la Maintenance selon AFNOR
Figure 9: Dfférentes options de
la Maintenance selon AFNOR
Pour mettre en œuvre une organisation
efficace de la maintenance et prendre des décisions comme
gestionnaire dans des domaines tel que la sous-traitance le recrutement
de personnel approprié, les niveaux de maintenance sont
définis en fonction de la complexité des travaux
[11].
Il existe, selon l’'AFNOR cinq (5) niveaux de maintenance qui sont
consignés dans le tableau ci-dessous
[12].
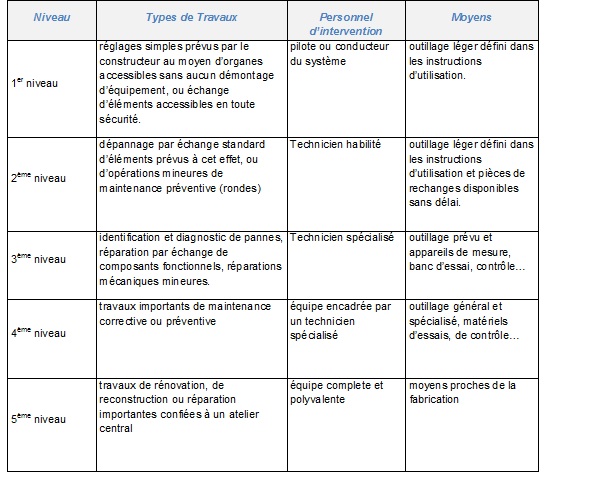
Figure
10:
les
Niveau
de
la
Maintenance selon AFNOR
III.2. Planification
de la Maintenance
Préventive sur la GMAO
La Planification de la maintenance préventive de tout DM en
général nécessite, comme son nom l’indique
à prévoir ou anticiper tout incident susceptible pouvant
subvenir lors de son exploitation dans la prise en charge des soins de
santé du patient par les services médico-techniques.
Selon l’AFNOR celle-ci se définit par la volonté de
réduire ou de minimiser toute probabilité de
défaillance d’un bien ou la dégradation d’un service
rendu.
« Mieux vaut prévenir que Guérir », cette
citation traduit bien le thème traité par ce
rapport, qui est la « Planification de la maintenance
préventive des dispositifs médicaux sur la
GMAO».
La planification de la MP pour un fonctionnement correct et atteindre
des résultats Probants implique la nécessité de
besoins.
Ainsi les outils d’une planification de la Maintenance
Préventive, comme c’est le cas de l’Unité
Biomédicale du CHC doit reposer sur les besoins essentiels
suivants :
- Les besoins organisationnels entre autre la
technologie informatique à savoir la Gestion de la Maintenance
Assistée par Ordinateur (GMAO) qui demeure le cerveau d’une
bonne organisation de planification de Maintenance ;
- Les besoins matériels qui doivent
respecter les dispositions fixées par le constructeur pour
réaliser la MP : la périodicité, les pièces
détachées, les outils, les procédures, de
contrôles qualités ;
- Les besoins humains indispensable : pour la
réalisation de la maintenance préventive nécessite
la compétence et du temps agent.
La Planification de la MP par la GMAO du CHC va permettre au Service
Biomédical, non seulement d’avoir une base de données
exhaustive des DM, mais surtout de :
- Maintenir les DM en bon état de
fonctionnement ;
- Améliorer leurs disponibilités
dans les services de soins ;
- Garantir leurs fiabilités et
sécurisés les services de soins au profit du patient ;
- Mettre en conformité avec les textes
réglementaires en vigueur.
Elle vise donc en définitive à réduire le taux de
pannes imprévues sur les équipements biomédicaux
concernés.
Ces pannes imprévues engendrent souvent des
désagréments qui peuvent être critiques pour le
patient et sont de plusieurs ordres à savoir :
- Un faux diagnostic pour mauvaise
qualité d’image (ex : en radiologie, ou en échographie) ;
- Un traitement thérapeutique ne
correspondant pas à la prescription médicale (ex : d’un
pousse seringue) ;
- Une mauvaise rééducation
(suppléance respiratoire) pour cause d’un respirateur de
réanimation non soumis à une MP ;
- Financier (manque à gagner de la
régie financière) pour reports des examens, poussant la
direction de l’ES à prévoir des DM doublons ou prêt
d’équipements pour pallier à ces défaillances ;
- Relationnels entre le SMB et les SS (les
utilisateurs) d’une part, d’autre part entre la population (Patients)
et la structure sanitaire (perte de confiance dans les DM, à
l’ES, pas de sécurité, pas de fiabilité).
III.2.1.Présentation
de
la
GMAO
:
Accès
aux
menus
de
la
GMAO
du
logiciel
Assetplus
Pour avoir accès aux menus de la GMAO, les étapes
ci-dessous sont nécessaires et obligatoires.
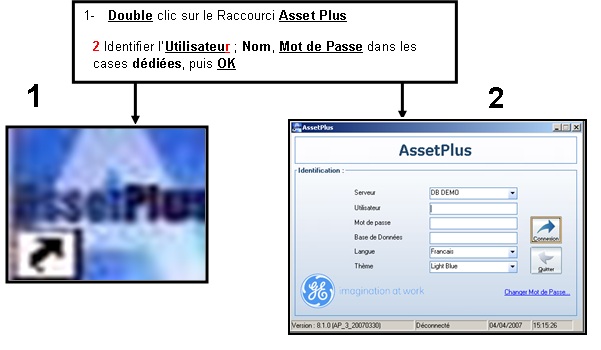 Figure 11 : Ecran d’accès
AssetPlu
Figure 11 : Ecran d’accès
AssetPlus
Ces deux
étapes effectuées (1, 2) donnent droit à l’Ecran
d’Accueil (3) ci-dessous, présentant les principaux menus du
logiciel AssetPlus de la GMAO.
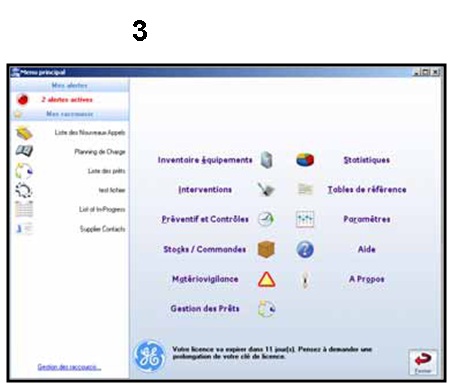
Figure 12 : Menus essentiels de la GMAO AssetPlus
Cet
écran ci-dessus va permettre à l’utilisateur
d’accéder à un menu en cliquant sur celui qui est
visé par la procédure concernée afin de renseigner
les fiches-écrans
dédiés aux
informations de ladite procédure (Inventaire, interventions,
planification, stocks/commandes…)
Le Menu servant à la mise en
œuvre de la Planification de la MP est noté «
Préventif et Contrôles », un Clic sur celui-ci donne
accès à un Ecran présentant les boutons à
la manipulation de AssetPlus pour la planification de la Maintenance
Préventive (4).
La Sélection ou un clic sur
« nouveau équipement » donne accès à
l’écran destiné à saisir les informations
incrémentées (dans les onglets) relatives à la
planification de la MP
III.2.2.Procédure
de
Planification
de
Maintenance
Préventive
d’un
DM
sur
la
GMAO
Figure
13
:
Masque
–écran
de
saisie
pour
la planification de la Maintenance Préventive
Sur cet écran (n° 5), tous
les « Champs » marqués en rouge doivent être
renseignés en suivant les informations indispensables à
la planification de la MP avant tout enregistrement ou validation.
III.2.3. Outil
Qualité
de
la
Planification
Pour cadrer le thème de l’étude, l’outil de
Qualité utilisé est le QQOQCP qui a permis de situer la
nécessité de la Planification de la Maintenance
Préventive et identifier le bien fondé de
l’intégration de la GMAO à l’organisation de la
Maintenance en général et en particulier la planification
de la MP des DM du Centre Hospitalier de Compiègne.
L’outil de Qualité QQOQCP, va me permettre de cadrer le sujet de
ce stage
 Figure 14: Outil de
Qualité QQOQCP.
Figure 14: Outil de
Qualité QQOQCP.
Cet outil de qualité de cadrage
va permettre de proposer des Procédures d’informations
nécessaires au bon fonctionnement de la GMAO portant sur :
- L’inventaire exhaustif et précis des DM
à jour ;
- Les rapports d’interventions des intervenants
(Techniciens internes/externes) renseignés
systématiquement et à jour ;
- La planification de la MP et contrôle
des DM à jour et effectuée selon les prescriptions
du constructeur ;
- La gestion des stocks et commandes des PR.
Le cadrage de ce sujet peut amener un autre outil de Qualité, le
« Brainstorming », susceptible d’apporter des idées
de recherche de solutions probantes pour la réalisation de la
planification de la maintenance préventive des Dispositifs
médicaux du CHC.
III.2.4. Outil
de
Qualité
:
Le
BRAINSTORMING
Au regard de la recherche des idées (brainstorming), la
planification de la MP va dépendre en premier chef de la
mise à jour de l’inventaire des DM en exploitation du CHC,
à l’effet de pouvoir établir toute la programmation
possible de la MP destinée à chaque type de DM ou
à un ensemble d’équipements biomédicaux.
A cela, il serait opportun de décrire le processus de la
réalisation de la MP et veiller au suivi par la saisie de la
nature des opérations effectuées pour chaque DM ou et ou
ensemble d’équipements biomédicaux planifiés pour
la Maintenance Préventive.
III.2.5.Procédure
de
la
Planification
de
la
Maintenance
préventive
(MP)
sur
la
GMAO
retour sommaire
voir
figure
16:
Pour
telécharger
la
procédure
cliqquez
ici
Ainsi la planification de la MP sur la GMAO et de la gestion de la
Maintenance sont assujetties à ces processus liés aux
actions ou opérations ci-contre :
- Mettre à jour l’inventaire ;
- Planifier les DM soumis à la MP ;
- Suivre l’exécution de la MP.
L’intérêt de la Planification de la MP des DM sur la GMAO
et de sa réalisation par les Services Biomédicaux vise
à répondre aux obligations réglementaires
liées à l’organisation de la Maintenance en milieu
hospitalier.
Le Service biomédical du CH de Compiègne n’échappe
pas à ces obligations.
Pour ce faire l’organisation et la planification de la maintenance sur
la GMAO et de sa réalisation suivant les dispositions
s’avèrent nécessaires et indispensables aux fins de
disposer d’une traçabilité (respect des textes
réglementaires) pour une protection juridique et la valorisation
du travail, justifiant ainsi la raison d’être le milieu
hospitalier.
Ces obligations réglementaires tendent à améliorer
les activités au sein de l’établissement de santé
et ont pour vision la sécurité et la qualité des
soins délivrés patients.
Depuis quelques années des textes de lois apparaissent et
resserrent de plus en plus le cadre des obligations de maintenances, en
introduisant des notions de contrôles qualités et de
traçabilités.
IV- RAPPEL
EXIGENCES REGLEMENTAIRES A L’OBLIGATION DE MAINTENANCE
Pour mémoire, il est bon de rappeler certaines de ses exigences,
entre autres :
- Le décret n° 2001-1154 du 5
décembre 2001 relatif à l'obligation de maintenance et au
contrôle de qualité des dispositifs médicaux
prévus à l'article L. 5212-1 du code de la santé
publique (troisième partie : Décrets) et
complété par l’arrêté du 03 mars 2003 fixant
le champ d’action [13].
Ce décret décrit en six (06) points les
prérogatives de l’exploitant dans la gestion DM.
Il est tenu de :
1-
disposer d'un
inventaire des dispositifs qu'il exploite, tenu
régulièrement à jour, mentionnant pour chacun
d'eux les dénominations commune et commerciale du dispositif, le
nom de son fabricant et celui du fournisseur, le numéro de
série du dispositif, sa localisation et la date de sa
première mise en service ;
2- définir et
mettre en œuvre une organisation destinée à s'assurer de
l'exécution de la maintenance et du contrôle de
qualité interne ou externe des dispositifs dont il
précise les modalités, qui sont transcrites dans un
document ; dans les établissements de santé, cette
organisation est adoptée après avis des instances
médicales consultatives ; elle est portée à la
connaissance des utilisateurs ; les changements de cette organisation
donnent lieu, sans délai, à la mise à jour du
document ;
3- disposer d'informations permettant d'apprécier les
dispositions adoptées pour l'organisation de la
maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe,
ainsi que les modalités de leur exécution ;
4- mettre en œuvre les contrôles prévus par l'article D.
665-5-4 ;
5- tenir à jour, pour chaque dispositif médical, un
registre dans lequel sont consignées toutes les
opérations de maintenance et de contrôle de qualité
interne ou externe, avec pour chacune d'elles l'identité de la
personne qui les a réalisées et, le cas
échéant, de son employeur, la date de réalisation
des opérations effectuées et, le cas
échéant, la date d'arrêt et de reprise
d'exploitation en cas de non-conformité, la nature de ces
opérations, le niveau de performances obtenu, et le
résultat concernant la conformité du dispositif
médical ; ce registre doit être conservé cinq ans
après la fin d'exploitation du dispositif, sauf dispositions
particulières fixées par décision du directeur
général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour
certaines catégories de dispositifs ;
6- permettre l'accès aux dispositifs médicaux et aux
informations prévues par le présent article à
toute personne en charge des opérations de maintenance et de
contrôle de qualité.
La réforme hospitalière
L’Ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l'hospitalisation publique et privée
[14].
Cette ordonnance prévoit de créer un système
d'accréditation des établissements de santé en les
invitant à s'engager dans une procédure
d'accréditation de leurs activités.
Cette procédure a pour objectifs l'optimisation de la
prise en charge des patients à savoir, l’implication et la
responsabilité des professionnels de la santé à
l’amélioration de l’organisation et du fonctionnellement de
l’établissement de santé.
Les Services biomédicaux sont interpellés et
impliqués directement dans cette démarche
d’accréditation en mettant en place une organisation de la
Maintenance Préventive et des contrôles qualités
systématiques sur certains types de dispositifs médicaux.
La Haute Autorité Sanitaire (HAS), dans son manuel version 2010,
au chapitre, « Management de l’établissement de
santé », voir référence 8, critère 8K
sur la gestion des équipements biomédicaux en milieu
hospitalier, a de façon spécifique défini les
responsabilités des services biomédicaux à la
gestion des équipements biomédicaux en exploitation dans
les structures de santé
[15].
Ainsi, l’établissement de santé à travers le
service biomédical doit :
- Définir un système de gestion
des DM et mettre en place une procédure de secours d’urgence en
cas de défaillance ;
- Faire la Maintenance des DM jugés
critiques et assurer la traçabilité ;
- Evaluer les DM pour garantir sa
fiabilité et ses performances revendiquées par le
fabricant.
« Qui veut aller loin, ménage sa monture ».
Ce Proverbe français a tout son sens sur le sujet de ce rapport.
Ainsi, la Gestion des dispositifs médicaux, font l’objet d’une
organisation de la Maintenance en général et en en
particulier la planification de Maintenance Préventive sur la
GMAO : « Mieux vaut prévenir que de guérir ».
Cet Outil de Gestion de la MP, représente le cerveau de
l’organisation de la Maintenance Préventive des DM pour
être en phase avec les dispositions assujetties aux
activités des services biomédicaux.
L’utilisation et l’application de la GMAO durant mon stage, m’a
permis
d’avoir une vision assez nette sur le Guide des Bonnes Pratiques de
l’Ingénierie Biomédicale (GBPIB v2011 en cours
d’édition) en Etablissement de Santé
[16].
La GMAO est un outil qui consiste à mettre à jour le
Registre de Sécurité de
Qualité et de Maintenance
(RSQM), un moyen indispensable pour mettre en oeuvre les
obligations des acteurs
biomédicaux
En se rapportant à cette citation de Pierre Dac et je cite :
« Quand nous saurons une bonne fois d’où nous venons et
où nous allons, nous pourrons alors savoir où nous en
sommes
»
[17].
La GMAO dans son fonctionnement dans les services biomédicaux
est la base des Bonnes Pratiques de Réalisation (BPR du GBPIB
v2011 en cours d’édition) qui sont le cœur de la profession
biomédicale à savoir
- Les Activités support du Service
biomédical (BPR1) ;
- Les Activités de Gestion des
Dispositifs
Médicaux.
La Planification de la Maintenance Préventive sur la GMAO,
semble être l’une des solutions qui doit pouvoir orienter le SMB
à satisfaire les services médico-techniques du Centre
Hospitalier de Compiègne aux fins qu’ils puissent assurer des
Offres de qualité au profit du PATIENT.
Toutes les données relatives à la nature des
opérations
de maintenance (préventive ou corrective) à la charge du
service biomédical doivent être renseignées et
enregistrées sur la GMAO, d’où une
traçabilité des activités.
Mon passage au service Biomédical m’a permis d’avoir une vision
claire et nette d’une bonne Gestion des DM en exploitation dans un
établissement de santé.
J’ose espérer faire bénéficier cette connaissance
organisationnelle à nos structures de maintenance.
La Maintenance, si elle s’effectue depuis l’achat du DM, doit faire
l’objet
d’une planification de la MP dite Maintenance d’anticipation pour
pallier aux pannes imprévues.
BIBLIOGRAPHIE
[1] Site
internet CH compiègne: http://www.ch-compiegne.fr/pdf/ifsi.pdf
[2] Site internet CH
Compiègne:
http://www.ch-compiegne.fr/site_central.php
[3] Site internet CH
Compiègne http://www.ch-compiegne.fr/fournier.php
[4] Site internet CH Compiègne http://www.ch-compiegne.fr/site_central.php
[5] Site Internet CH Compiègne
http://www.ch-compiegne.fr/pdf/chc1.pdf
[12]Réglementations
française: http://www.legifrance.com/
[13]Réglementation
Française:
http://www.legifrance.gouv.fr/
[14] Site Internet de la Haute
Autorité de Santé http://www.has-sante.fr/
[15] GBPIB v2011 en cours
d’édition
[17] BPR voir
GBPIBv2011 en cours d’édition