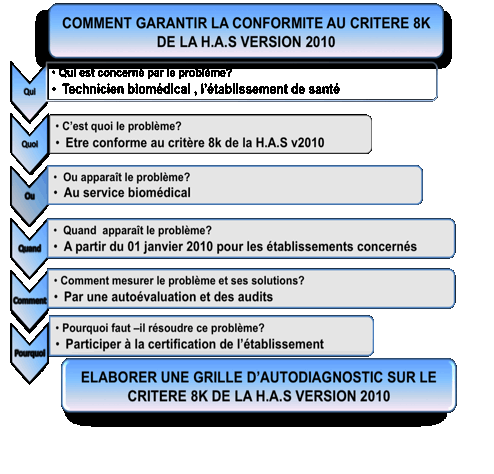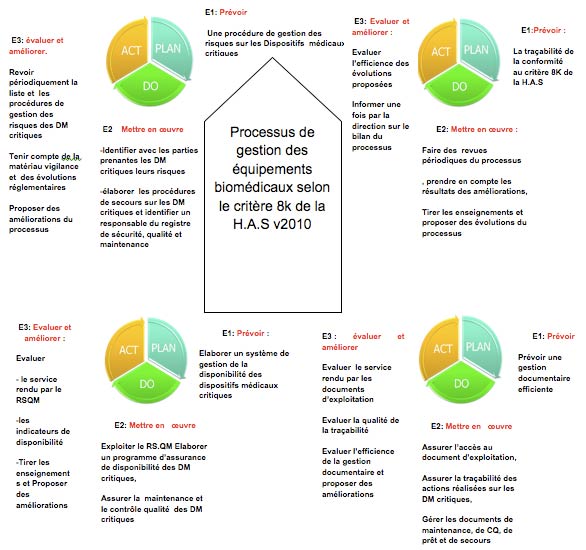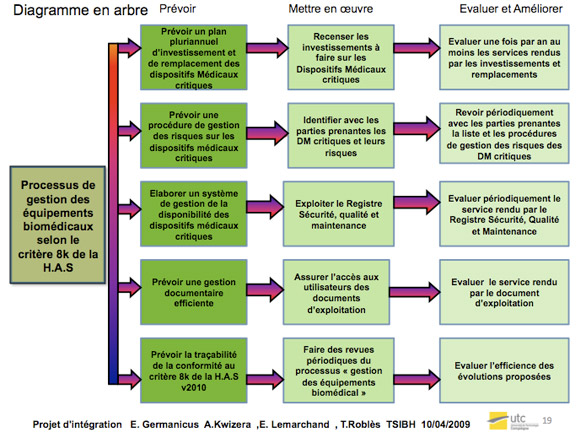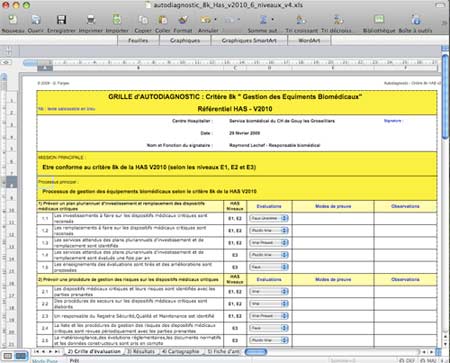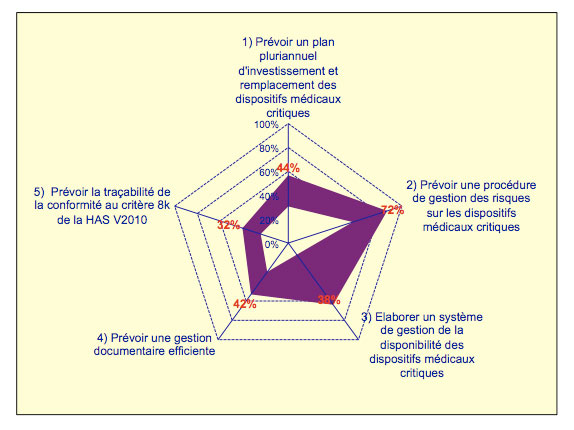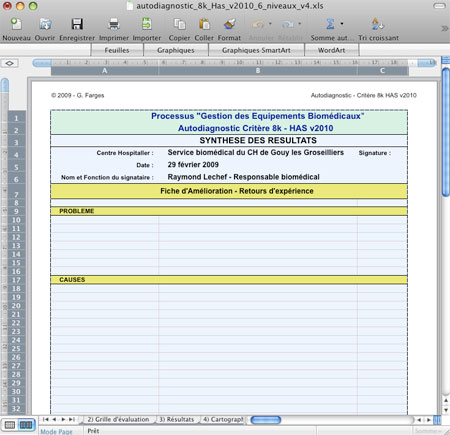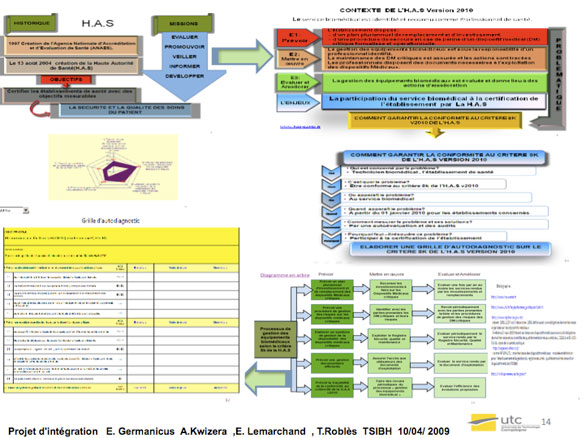Avertissement |
Si vous arrivez
directement sur cette page, sachez que ce travail est un rapport d'étudiants
et doit être pris comme tel. Il peut donc comporter des imperfections
ou des imprécisions que le lecteur doit admettre et donc supporter.
Il a été réalisé pendant la période
de formation et constitue avant-tout un travail de compilation bibliographique,
d'initiation et d'analyse sur des thématiques associées
aux technologies biomédicales. Nous
ne faisons aucun usage commercial et la duplication est libre. Si vous
avez des raisons de contester ce droit d'usage, merci
de nous en faire part . L'objectif de la présentation
sur le Web est de permettre l'accès à l'information et
d'augmenter ainsi les échanges professionnels. En cas d'usage
du document, n'oubliez pas de le citer comme source bibliographique. Bonne
lecture... |
|
Grille d'autodiagnostic sur le Critère 8k v2010
de l'H.A.S
|

Eric Lemarchand
|

Anicet Kwizera |
|

Thomas Robles
|
|
RESUME
Dans le cadre de la certification
par la H.A.S v2010 des établissements de santé, l'activité biomédicale
est reconnue, à travers le critère 8k, comme contribuant à la
qualité des soins et à la sécurité des
patients, ce qui leur donne aussi des obligations. A partir de chaque
processus E1, E2, E3, une grille d'autodiagnostic a été élaborée
afin d'évaluer l'activité biomédicale vis à vis
des exigences de du référentiel de certification H.A.S
v2010.
Téléchargement de
la grille d'autodiagnostic "Critère 8k HAS v2010" (mise à jour
le 24 mars 2011) :
Autodiagnostic_8k_Has_v2010_6_niveaux_v13.xls
Mots clés : H.A.S v2010
- Critère 8k - Qualité - Activité biomédicale
- Grille d'autodiagnostic
|
ABSTRACT
Within the framework of certification
by the H.A.S v2010 of the health care institutions, the biomedical
enginerring is recognized, through the criterion 8k, like contributing
to the quality of the care and the safety of the patients, which gives
them also obligations. From each step E1, E2, E3 of the process, a
self-assessment tool was designed in order to asset the biomedical
activity in accordance to the requirements of the certification standard
H.A.S v2010.
Download the self-assessment
tool "Criterion
8K HAS v2010" (in French, updated
March, 24, 2011) :
Autodiagnostic_8k_Has_v2010_6_niveaux_v13.xls
Key words : H.A.S v2010, 8k criterion,
quality, biomedical engineering, self-assessment tool |
SOMMAIRE
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier : Monsieur
Gilbert Farges enseignant-chercheur et responsable de la formation continue à l’Université de
Technologie de Compiègne, Tuteur de notre projet d’intégration
pour sa patience et son soutien pour l’élaboration de ce document.
Monsieur Pol Manoel Felan, assistant, responsable pédagogique de
la formation continue TSBIH à l’UTC monsieur Alain Donaday
enseignant chercheur à l’UTC . Tous les enseignants et intervenants
qui ont contribué à notre savoir ainsi que madame Isabelle
Nattier pour sa sympathie et son professionnalisme. Les collègues
de la Formation continue TSIBH Session 2009.
I.INTRODUCTION
Dans la nouvelle
version v2010 du manuel de certification des établissements de santé,
la haute autorité de santé identifie pour la première
fois par le critère 8K : La gestion des équipements biomédicaux,
l’activité biomédicale comme participant à la
qualité et à la sécurité des soins. L’objet
de ce travail est d’élaborer une grille d’autodiagnostic
permettant aux acteurs biomédicaux de se situer par rapport aux exigences
de ce critère.
II.HISTORIQUE
II 1 - Agence Nationale d’accréditation
et d’Evaluation en Santé
L’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation
en Santé (ANAES) était un établissement public créé le
14 octobre 1997 dans le cadre des ordonnances du 24 Avril 1996. Elle était
chargée d’accompagner les établissements de santé dans
leurs démarches d’accréditation, procédures d’évaluation
de leur fonctionnement et de leurs pratiques. Celle-ci visait à assurer
la sécurité et la qualité des soins donnés aux
malades et à promouvoir une politique de développement continu
de la qualité au sein de l’établissement. Elle était
aussi chargée d’émettre un avis sur l’admission
au remboursement des actes, prestations et fournitures par l’assurance
maladie. Elle contribuait à évaluer les actions et les programmes
de santé publique. Elle avait pour mission d’accréditer
les établissements de santé pour une durée de 5 ans.
Les comptes-rendus d’accréditation étaient rendus publics.
La procédure d’accréditation n’avait ni jugement,
ni classement des établissements.
II 2 -La Haute Autorité de Santé
L’ANAES devient la Haute Autorité de Santé (HAS)
par la loi du 13 août 2004 parue au journal officiel 190 du 17 août
2004 relative à l’assurance maladie.
La HAS est chargée :
• D’évaluer objectivement l’utilité médicale
des médicaments, des dispositifs médicaux et des actes
professionnels et de suggérer ou non leur remboursement par l’assurance
maladie.
• De promouvoir les bonnes actions et la bonne pratique des soins
auprès des professionnels de santé et des usagers de soins.
• D’améliorer la qualité de soins dans les établissements
de santé et en médecine de ville.
• De veiller à la qualité de l’information médicale
diffusée.
• D’informer les professionnels de santé et le grand
public.
• De perfectionner la qualité de l’information médicale.
• De développer l’entente et le partenariat des acteurs
du système de santé en France et à l’étranger.
• Elle a pour mission de certifier les établissements de
santé pour une durée de 4 ans. |
Champ de la certification : La procédure de certification
a pour objectifs :
•De favoriser l'amélioration de la prise en charge des
patients, de la qualité et de la sécurité des
soins délivrés par les établissements de santé.
•Porter une appréciation indépendante sur la
qualité d'un établissement. |
retour sommaire
Elle concerne tous les établissements de santé publics
et privés. Elle consiste en une auto-évaluation suivie d'une
expertise accomplie par des professionnels de santé extérieurs à l'établissement.
Elle incorpore un dispositif de suivi qui vise à ammener les professionnels
de l'établissement dans une démarche qualité durable.
La certification doit :
• Permettre un éclairage des usagers en renforçant
la lisibilité de son rapport pour tous les publics.
• Chercher à renforcer sa pertinence en tant qu’outil
de management interne aux établissements.
• Assurer son rôle dans la régulation des établissements
de santé par la qualité. |
Il y a 4 niveaux de certifications :
• Certification sans recommandation, ni réserve, ni
réserve majeure.
• Certification avec recommandations.
• Certification avec réserve(s).
• Certification avec réserve(s) majeure(s). |
La H.A.S peut également sursoir à la certification
de l'établissement de santé (en cas de réserves majeures)
ou même prononcer une décison de non certification.
En France, 2772 établissements de santé publics
et privés sont concernés.(2) Actuellement, il existe deux versions
de manuels de certification de la H.A.S (V1 - V2)
retour sommaire
II 3 - La Haute Autorité de Santé V2010
Le manuel HAS v2010 (V3) contient 28 références
et 82 critères ce qui représente un allégement du nombre
d’exigences par rapport aux précédentes versions.
Cette nouvelle version est organisée en deux chapitres
:
• Management de l’établissement
• Prise en charge du patient.
|
Parmi les nouveautés, l'introduction :
• De l'utilisation d'indicateurs de performance pour l'amélioration
de la qualité hospitalière (IPAQH), afin de :
- développer la culture de la mesure de la qualité
- disposer de mesures factuelles de la qualité
et ainsi renforcer l'effet levier sur l'amélioration de la
qualité.
• Des pratiques exigibles prioritaires (PEP) jugées par
la HAS fondamentables pour l'amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins et sur lesquelles la certification
peut être remise en cause.
|
Les éléments d'appréciation de chaque
critère seront revalorisés en nombre de points suivant leur
niveau de conformité. Le total permettra de côter le critère
en un des quatre niveaux : A, B, C ou D.
retour sommaire
III.
CONTEXTE
Si dans sa première version en 2005, la H.A.S avait
pris en compte implicitement l’activité biomédicale en
mettant un texte sur la maintenance préventive et curative des dispositifs
médicaux, dans la version 2010 elle identifie très clairement
l’activité biomédicale comme élément contribuant à la
qualité des soins et la sécurité du patient et faisant
partie intégrante de la certification de l’établissement.
III 1 - Situation du critère 8 k dans l'organisation
du manuel HAS v2010
Cette activité est définie dans :
• le chapitre 1 : « Management de l’établissement ».
• la partie 3 :« Management de la qualité et de la
sécurité des soins ».
• La référence 8 : « le programme global et
coordonné de management de la qualité et des risques »
et à travers le critère 8K « Gestion des équipements
biomédicaux » . |
III 2 - Contenu du critère 8 k
Elle organise les éléments d’appréciation
selon les étapes d’une démarche d’amélioration
: prévoir, mettre en œuvre, évaluer et améliorer.
E1 : PREVOIR : L’établissement
a défini un système de gestion des équipements biomédicaux,
comprenant un plan pluriannuel de remplacement et d’investissement.
Une procédure (équipement de secours, solution dégradée
ou dépannage d’urgence) permettant de répondre à une
panne d’un équipement biomédical critique est formalisée
et opérationnelle.
E2 : METTRE EN ŒUVRE : Le système
de gestion des équipements biomédicaux est mis en œuvre
sous la responsabilité d’un professionnel identifié.
La maintenance des équipements biomédicaux critiques est assurée
et les actions sont tracées. Les professionnels disposent des documents
nécessaires à l’exploitation des équipements biomédicaux.
E3 : EVALUER ET AMELIORER : La gestion
des équipements biomédicaux est évaluée et donne
lieu à des actions d’amélioration. (http://www.has-sante.fr)
Une des nouveautés du manuel de certification de la H.A.S V 2010 est
l’apparition de la notion de criticité concernant les dispositifs
médicaux.
retour sommaire
III 3 - Définition d'un dispositif médical
On entend par dispositif médical, tout instrument,
appareil, équipement, matière, produit, à l'exception
des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en
association , y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son
fonctionnement, destiné par le fabricants a être utilisé chez
l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue
n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques, ni par
métabolisme, mais dont la fonction peut être assistées
par de tels moyens.(3)
III 4 - Définition et analyse de la criticité d'un
dispositif médical
Le décret 2001 – 1154 du 05 décembre
2001(4) et l’arrêté du 03 mars 2003 (5) fixent l’obligation
de maintenance et de contrôle qualité et la liste des dispositifs
médicaux soumis à cette obligation.
Outre les équipements de radiodiagnostic, radiothérapie, médecine
nucléaire, les dispositifs médicaux de classe II b et III sont
concernés par ces obligations.
Les services biomédicaux en collaboration avec les parties prenantes
(les services de soins, les services médicaux, les services médico-techniques)
listent les dispositifs médicaux jugés critiques et analysent
leur criticité afin de prévoir et d’organiser des solutions
de secours en cas de panne.
Tout cela dans le souci de garantir la continuité d'utilisation
pour maintenir la qualité et la sécurité des soins.
Chaque établissement de santé peut définir
sa propre liste de dispositifs médicaux critiques en fonction de ses
activités médicales, de son mode de fonctionnement et du nombre
de ses équipements biomédicaux.
L'analyse des risques et les différents niveaux de
criticité peuvent donc être spécifiques à chaque établissement.
Plusieurs méthodes existent pour analyser et évaluer cette
criticité en particulier la méthode PIEU ou la méthode
AMDEC.
retour sommaire
III 4.1 - Méthode PIEU :
La méthode PIEU permet de calculer la criticité d'un
dispositif médical en tenant compte des incidences des pannes sur
la santé du malade, de son importance stratégique, de son état
et de son taux d'utilisation.
Cette criticité PIEU (exprimée sous forme
d'indice) permet de mettre en évidence et de hiérarchiser les équipements
sensibles sur lesquels doit être axée en priorité la
politique de maintenance.
Plus l'indice est petit, plus le dispositif médical
est critique.
Aucune des pondérations n'est égale à 0
afin de mieux hiérarchiser les différents dispositifs médicaux
critiques.
Exemple de grille
d'évaluation de la criticité appliquée à un
dispositif médical |
| |
|
|
Poids |
|
|
| |
Critères |
0,1 |
1 |
2 |
3 |
P |
Incidence des pannes |
Répercussions graves sur la santé du malade |
Répercussions sur la qualité des soins |
Corrections des soins possible |
Aucune répercussion sur la qualité des soins |
I |
Importance de l'équipement |
Stratégique, pas de délestage possible, sous-traitance
impossible |
Important, pas de délestage possible, sous traitance possible |
Secondaire, délestage possible |
Equipement de secours |
E |
Etat |
A rénover, à réformer |
A réviser |
A surveiller |
A l'état spécifié |
U |
Taux d'utilisation |
Saturé |
Elevé |
Moyen |
Faible |
Criticité CR=
P× I ×E ×U
III 4.2 - Méthode de AMDEC
Analyse des Méthodes de Défaillance,
de leurs Effets et de leur Criticité (résultats exprimés
en pourcentage).
| Note F |
Fréquence ou probabilité d'apparition |
Note G |
Gravité |
Note D |
Probabilité de non détection |
10 |
Permanent |
10 |
Mort d'homme |
10 |
Aucune probabilité de détection |
5 |
Fréquent |
5 |
Conséquences financière et/ou matérielles |
5 |
Un système de protection est en place mais n'est pas infaillible |
1 |
Rare |
1 |
Pas grave |
1 |
Le système de détection est infaillible |
Criticité CR= F× G × D
Plus CR est grand, plus le dispositif médical est critique.
L’AMDEC est une méthode d’analyse prévisionnelle
de la faisabilité permettant de recenser systématiquement les
défaillances potentielles d’un dispositif médical puis
d’estimer les risques liés à l’apparition de ces
défaillances, afin d’engager les actions correctives à apporter
au dispositif.
Elle a pour objectif de minimiser les risques, le coût de non qualité et
les pertes d’exploitation.
retour sommaire
IV ENJEUX et PROBLEMATIQUE
Dans le cadre de leur certification par la H.A.S et afin de
garantir la qualité et la continuité des soins ainsi que la sécurité du
patient, les établissements de santé doivent :
- s’assurer qu’ils disposent de dispositifs médicaux
critiques fiables et conformes à la réglementation.
- s’assurer qu’ils respectent la réglementation
(RSQM).
- prouver les actions de maintenance pour une exploitation
des dispositifs médicaux efficiente.
- optimiser la coordination de la gestion des dispositifs
médicaux critiques.
- réduire l’indisponibilité des dispositifs
médicaux critiques.
- programmer les dépenses.
- s’inscrire dans une démarche qualité.
L’activité biomédicale participe à cette
certification. Elle doit donc répondre aux exigences contenues dans
le critère 8 k de la H.A.S V2010 et se situer par rapport à ce
dernier.
retour sommaire
V
CLARIFICATION DE LA PROBLEMATIQUE
L’outil de qualité Qui, Quoi, Ou, Quand, Comment, Pourquoi a
permis de clarifier la problématique et d’arriver au résultat
qu’il faut élaborer une grille d’autodiagnostic pour répondre
aux exigences du critère 8k.
V 1 - L'outil de qualité QQOQCP
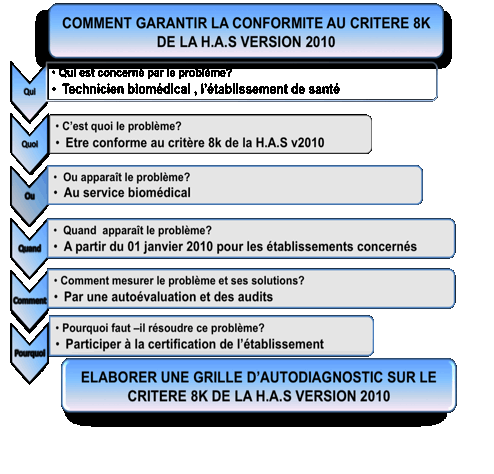
Afin
de mieux coordonner les activités et maîtriser les interfaces,
et dans le but de répondre aux exigences du critère 8k, une cartographie
du processus a été élaborée.
retour sommaire
V 2 - Cartographie du processus de conformité au critère
8 k de la Haute Autorité de Santé v2010
Les services biomédicaux de part la règlementation
: obligation de tenue du registre RSQM (norme 99-171), le décret 2001
(obligation de maintenance des dispositifs médicaux), l'arrêté du
3 mars 2003 qui identifie les équipements biomédicaux soumis à l'obligation
de maintenance et de contrôle qualité, répondent partiellement
aux obligations du critère 8 k surtout dans ses aspects "prévoir
et mettre en oeuvre".
La participation à l'élaboration du plan d'investissement
et de remplacement des DM critiques ainsi que la tenue à jour de la
GMAO, du RSQM et des évaluations périodiques (audit, enquête
de satisfaction...) permettront de mieux satisfaire les exigences de la H.A.S
v2010 en ce qui concerne l'étape "évaluation et amélioration".
L’outil qualité (brainstorming) a permis de générer
des idées d’action à partir des exigences du critère
8k (E1, E2, E3). Celles-ci ont été enregistrées, contrôlées
et classées par affinité afin d’élaborer le diagramme
en arbre.
Plutôt qu’une approche « H.A.S » :
E3 : Evaluer et améliorer
La gestion des équipements biomédicaux est évaluée
et donne lieu à des actions d'amélioration. |
|
E1 : Prévoir
L'établissement a défini un système de gestion
des équipements biomédicaux comprenant un plan plurannuel
de remplacement et d'investissement.
Une procédure (équipements de secours, solution dégradée
ou dépannage d'urgence) permettant de répondre à une
panne d'un équipement biomédical critique est formalisée
et opérationnelles
|
| |
E2 : Mise en oeuvre
Le système de gestion des équipements biomédicaux
est mis en oeuvre sous la responsabilité d'un professionnel identifié.
La maintenance des équipements biomédicaux critiques est
assurée. Les professionnels disposent des documents nécessaires à l'exploitations
des équipements biomédicaux.
|
|
il a été préféré une
approche métier pour élaborer le diagramme.
Le processus « gestion des équipements biomédicaux selon
le critère 8k » a été décomposé en
5 sous processus :
• Plan d’investissement
et de remplacement des dispositifs médicaux critiques.
• Procédure de gestion des risques sur les dispositifs médicaux
critiques.
• Système de gestion de la disponibilité des dispositifs
médicaux critiques.
• Gestion documentaire efficiente.
• Traçabilité de la conformité au critère
8k de la HAS. |
Chaque sous processus est décomposé suivant
les 3 étapes d’une démarche qualité (prévoir,
mettre en œuvre, évaluer et améliorer) ; Le diagramme en
arbre montre que les actions prioritaires concernent la gestion des risques
(analyse de la criticité des dispositifs médicaux), la traçabilité, évaluations
et améliorations continues.
E3 : Evaluer et améliorer
Evaluer une fois par an les services rendus par les investissements
et le remplacements.
Tirer les enseignements des évaluations et proposer des améliorations.
|
|
E1 : Prévoir
Un plan pluriannuel d'investissement et de remplacement des DM critiques
|
| |
E2 : Mise en oeuvre
Recenser les investissements et les remplacements à faire sur
les DM critiques, identifier les services attendus des plans plurannuels
d'investissement et de remplacement.
|
|
retour sommaire
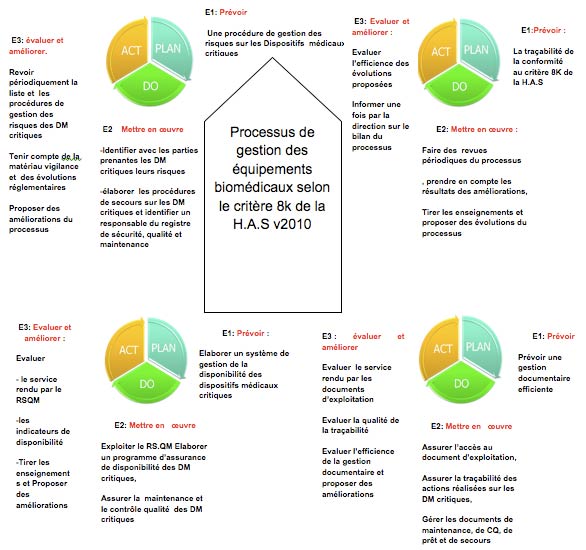
retour sommaire
V 3 - Diagramme en arbre
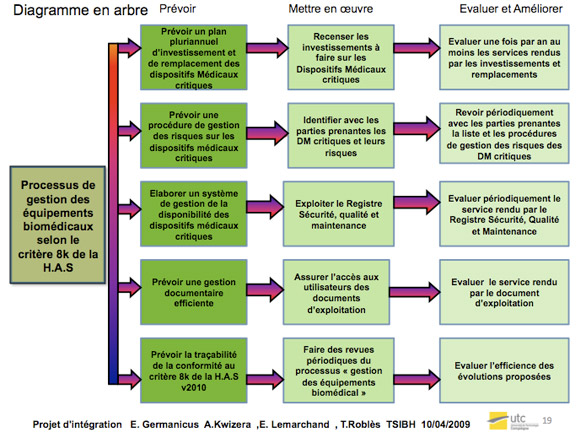
VI
GRILLE D'AUTODIAGNOSTIC SUR LE CRITERE 8K DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE
V2010
VI 1 - Note explicative de la grille et évaluation
Cette grille d’autodiagnostic est une aide à l’interprétation
du critère 8k. Elle permet de s’évaluer rapidement, de
fournir des renseignements importants. Elle permet en quelques « clics » d’avoir
une auto-évaluation. Le service biomédical pourra voir rapidement
comment il se positionne par rapport au critère 8k de la HAS. Il pourra
analyser ses points faibles et identifier les actions prioritaires qu’il
devra mettre en œuvre, dans un souci de maitrise de la gestion des dispositifs
médicaux et d’amélioration. La mise en place de la grille
sur internet avec les cartographies des différentes évaluations,
pourrait permettre aux services biomédicaux de se comparer aux autres.
Afin de les aider à mieux remplir la grille (surtout pour le niveau
d’évaluation « vrai prouvé ») des modes de
preuves sont proposés.
VI 2 - Grille d'autodiagnostic
Exemple de l'interface utilisateur
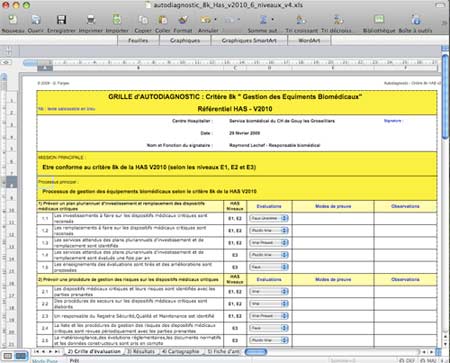
retour sommaire
VI
3 - Synthèse des résultat : cartographie
Un des membres du groupe a rempli la grille afin de l’évaluer
et d’avoir un exemple d’autodiagnostic.
Une analyse des résultats permet d’identifier les actions prioritaires à mettre
en œuvre :
- Le service biomédical devra élaborer un système de gestion
de la disponibilité des dispositifs médicaux critiques et prévoir
la traçabilité de la conformité au critère 8k de
la HAS V2010 (score 0%)
- Il devra améliorer sa procédure de gestion des risques et sa
gestion documentaire.
Dans l’exemple, la gestion des investissements et des
remplacements des DM critiques est le processus le plus maitrisé.
Une analyse à deux niveaux (E1 et E2 ensemble ) et
E3 ,approche HAS , montre que ce service est globalement bon en ce qui concerne
les prévisions et les mises en œuvre , mais que les actions d’évaluation
et d’amélioration sont à développer.
Une appréciation ponctuelle de la grille d’autodiagnostic
n’est peut-être pas très judicieuse car la personne qui
a rempli la grille peut avoir tendance à surestimer ou sous-estimer
l’évaluation des différentes actions.
Seule une évaluation périodique permettra de
voir les évolutions et savoir s’il y a des améliorations.
Cartographie radar
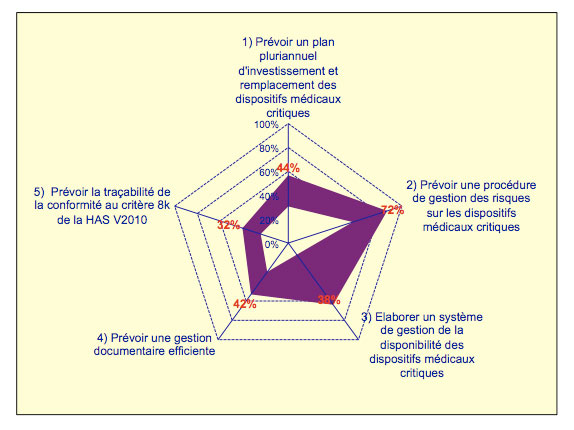
retour sommaire
VI
4 - Fiche d'amélioration - Retour d'expérience
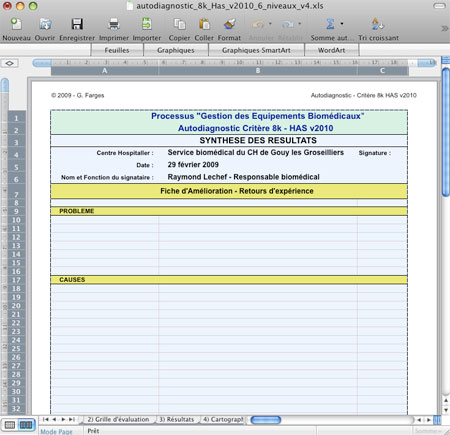
retour sommaire
VII
- CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
L'activité biomédicale (comme les activités
de soins) est de plus en plus encadrée par des textes règlementaires,
ce qui est tout à fait logique vu l'impact d'une mauvaise gestion des
dispositifs médicaux sur la qualité et la sécurité des
soins et les risques encourus par les patients.
Cette grille d'autodiagnostic a été élaborée
avec une approche métier, dans le but d'apporter une aide aux professionnels
biomédicaux dans l'interprétation du critère 8 k de la
H.A.S. Elle peut être enrichie et exploitée.
Elle devra dans tous les cas être validée par
la communauté biomédicale.
Le positionnement de l'activité biomédicale
au regard de ce critère associé au respect de la norme NF 17050
(déclaration de conformité de l'activité de fournisseur)
et une bonne application du manuel des bonnes pratiques biomédicales
peuvent-ils être suffisants pour permettre au service biomédical
de s'auto certifier ?
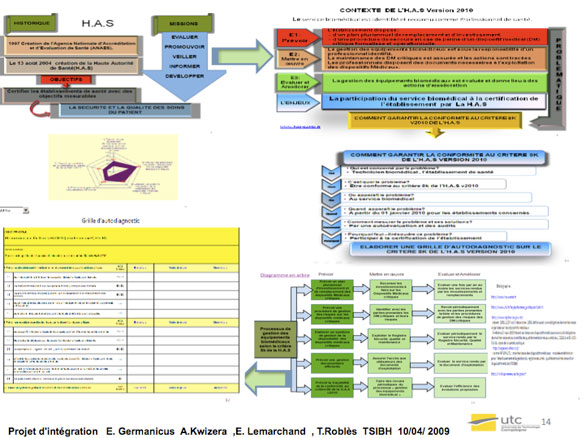
retour sommaire
VIII BIBLIOGRAPHIE
- http://www.has-santé.fr consulté le
05 mars 2009
- http://www.insee.fr consulté le
25 février 2009
- Décret 2001-1154 du 5 décembre
2001 relatif à l'obligation de maintenance et au contrôle qualité des
dispositifs médicaux prévus à l'article L.5212-1 du
code de la santé publique, Troisième partie : Décret
JORF n°284 du 7 décembre
2001 page 19481, NOR : MESP0123968
- Arrêté du 3 mars 2003 fixant
les listes des dispositifs médicaux soumis à l'obligation de
maintenance et au contrôle qualité mentionnée aux articles
L.5212-1 et D.665-5-3 du code de la santé publique (texte n°26),
JORF n°66 du 19 mars 2003 page 4848, NOR : SANP0320928A
- http://www.legifrance.gouv.fr
- http://www.techniques-ingenieur.fr consulté le
23 février 2009
- NF EN ISO/CEI 17050-1 Déclaration de conformité du
fournisseur, Edition AFNOR Avril 2005 http://www.sagaweb.afnor.org
retour sommaire
IX GLOSSAIRE
| DM |
Dispositif Médical |
| GMAO |
Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur |
| HAS |
Haute Autorité de Santé |
| Méthode AMDEC |
Analyse des Méthodes de Défaillance, leur effets et leur
criticité |
| Méthode PIEU |
Incidence des pannes, importance de l'équipement, état
de l'équipement, taux d'utilisation de l'équipement.
Résultats exprimés sous forme d'indice
Résultats exprimés en %
|
| RSQM |
Registre Sécurité Qualité et Maintenance |