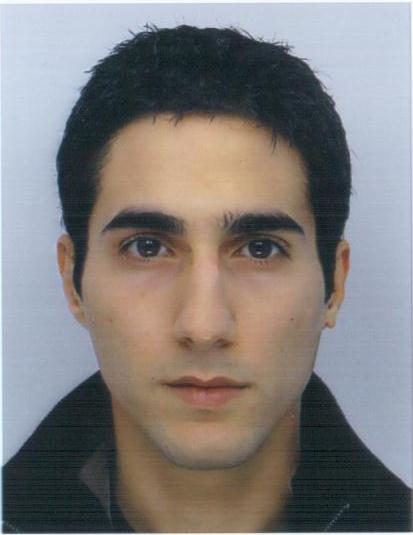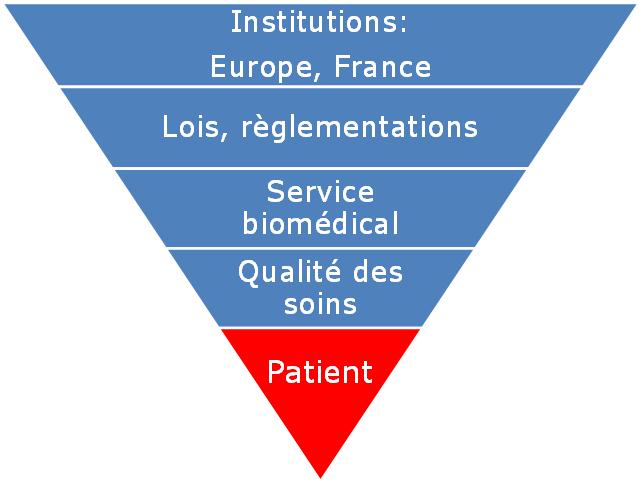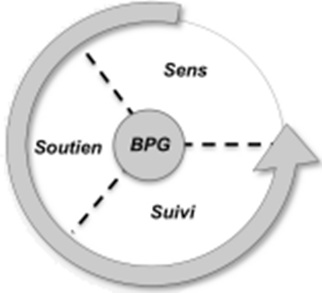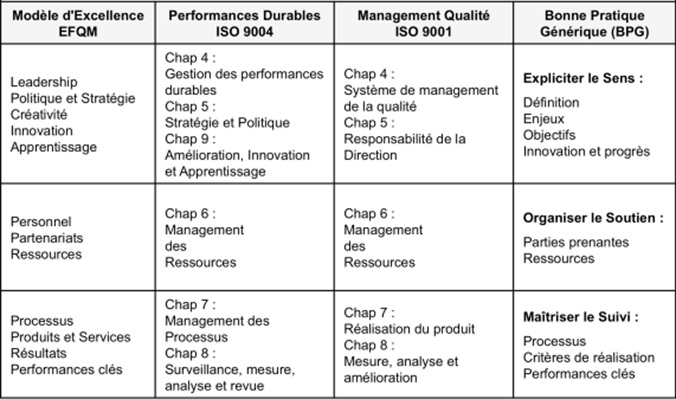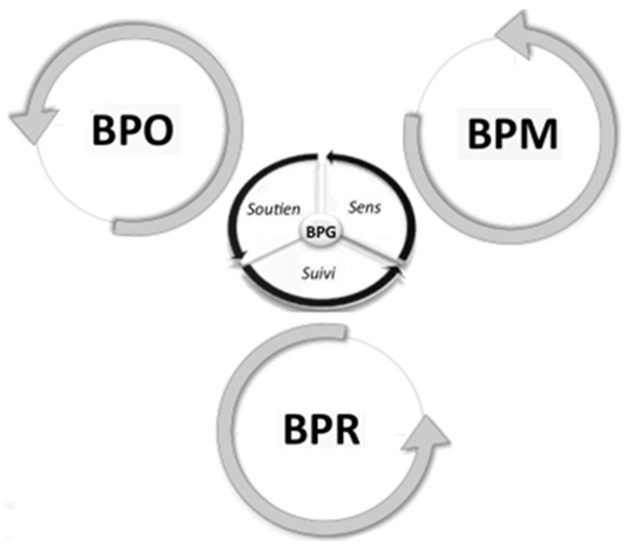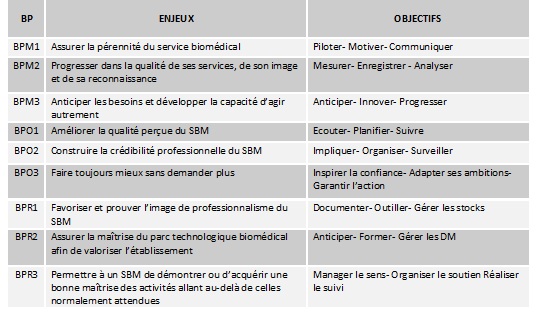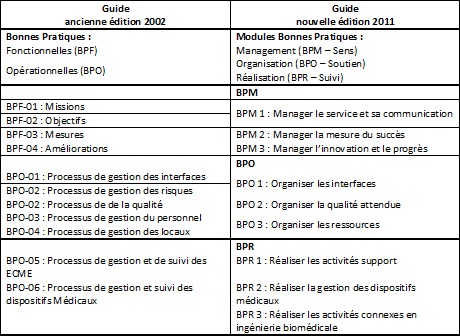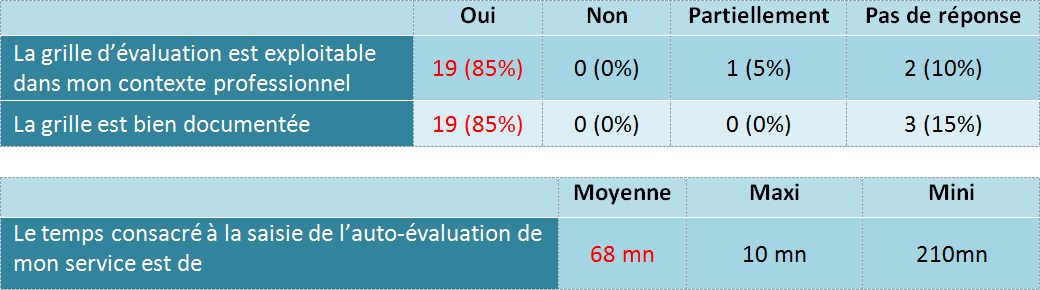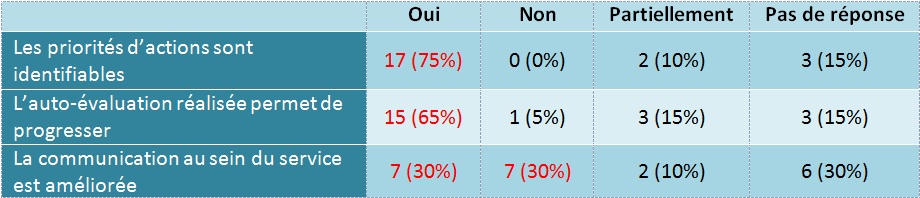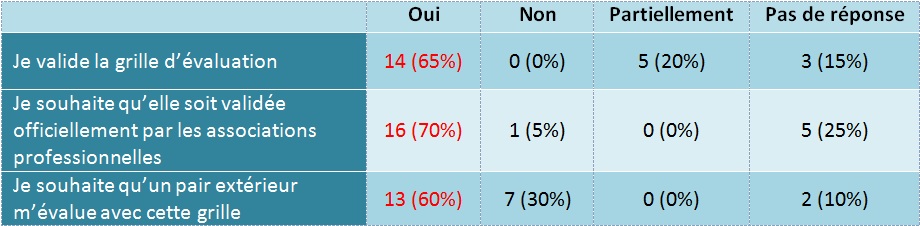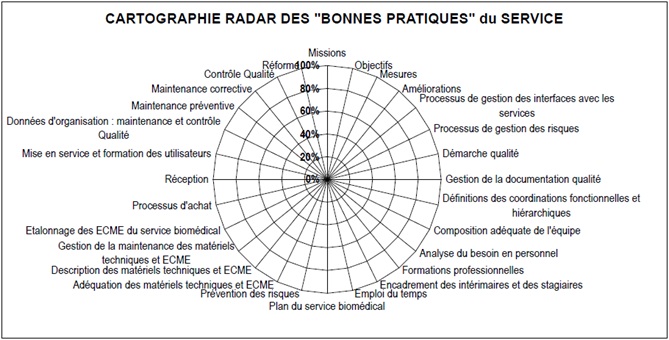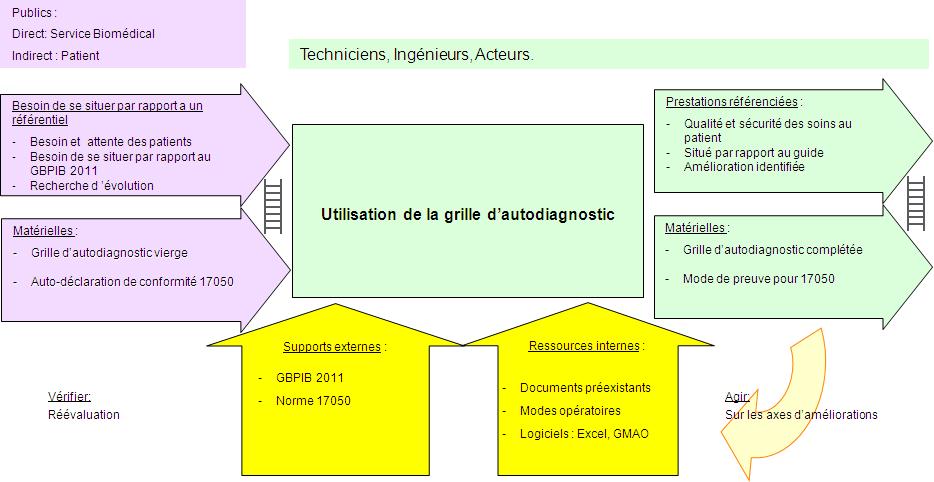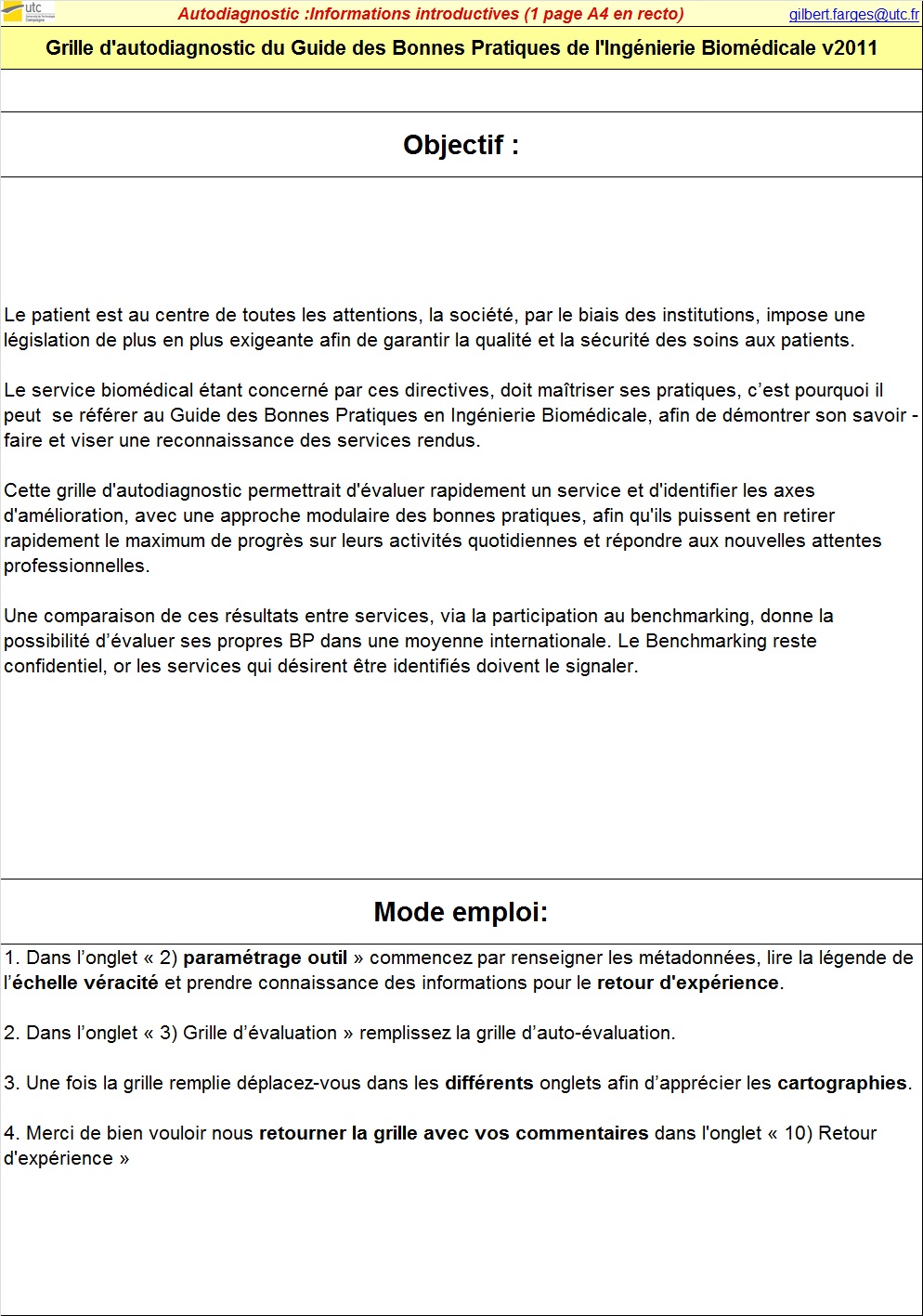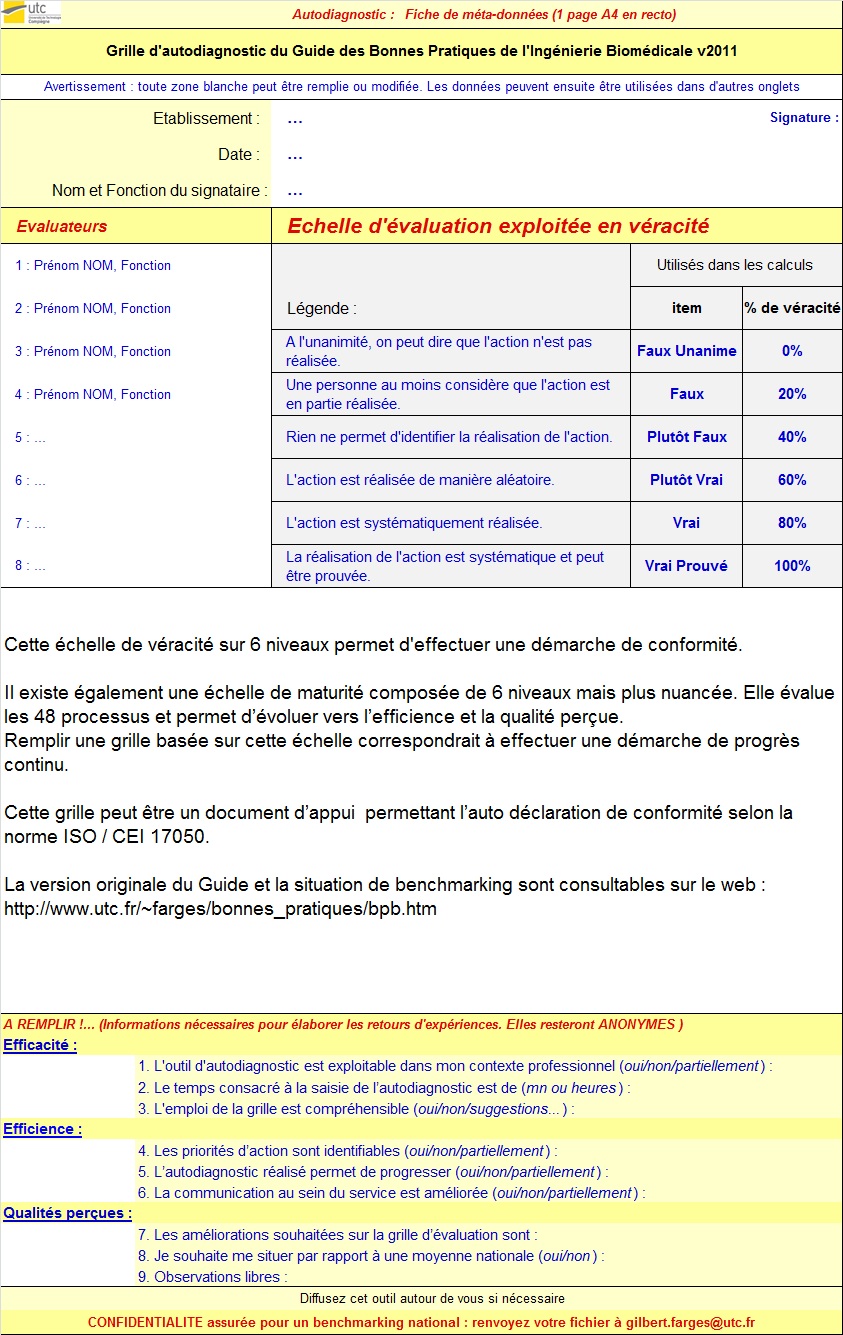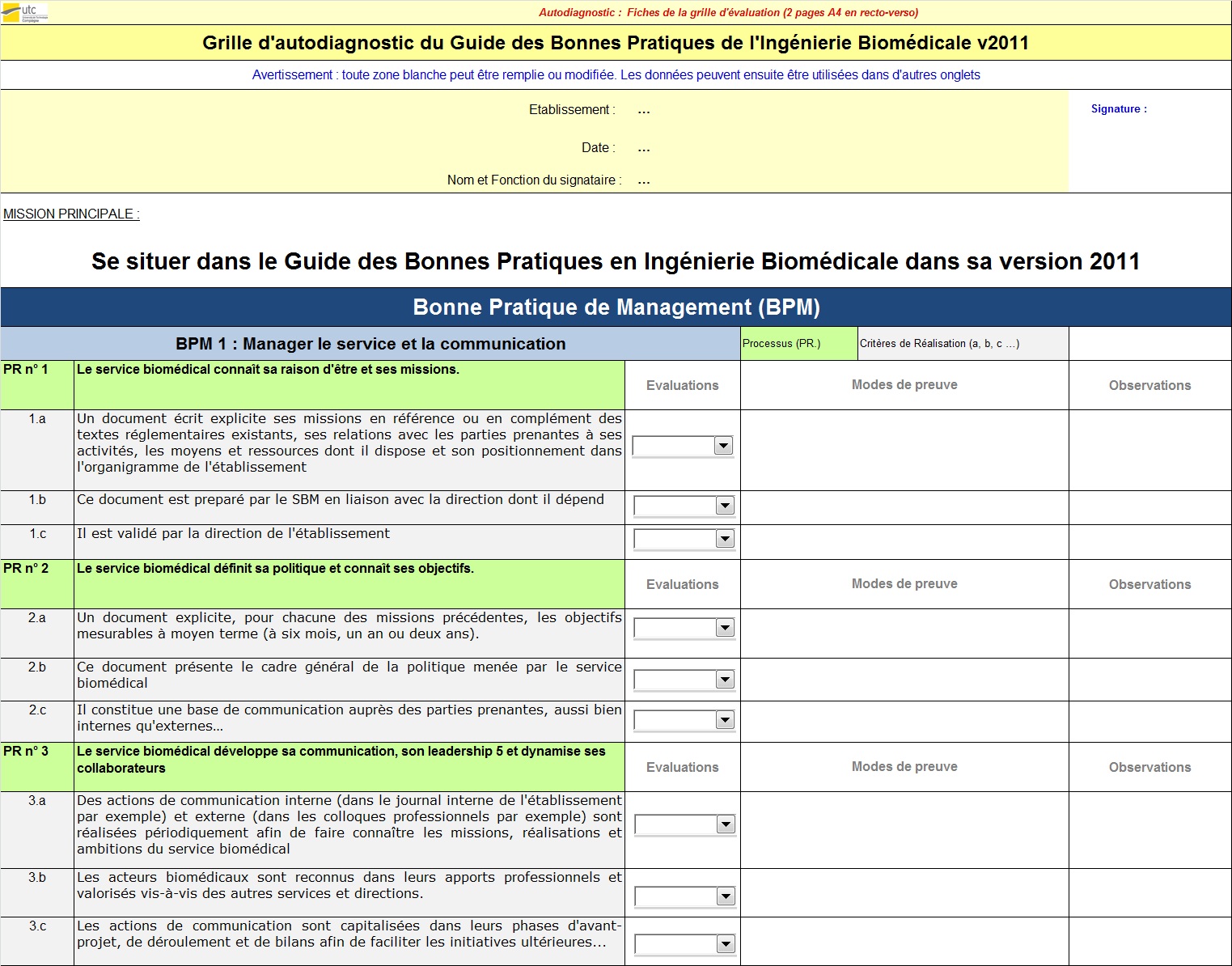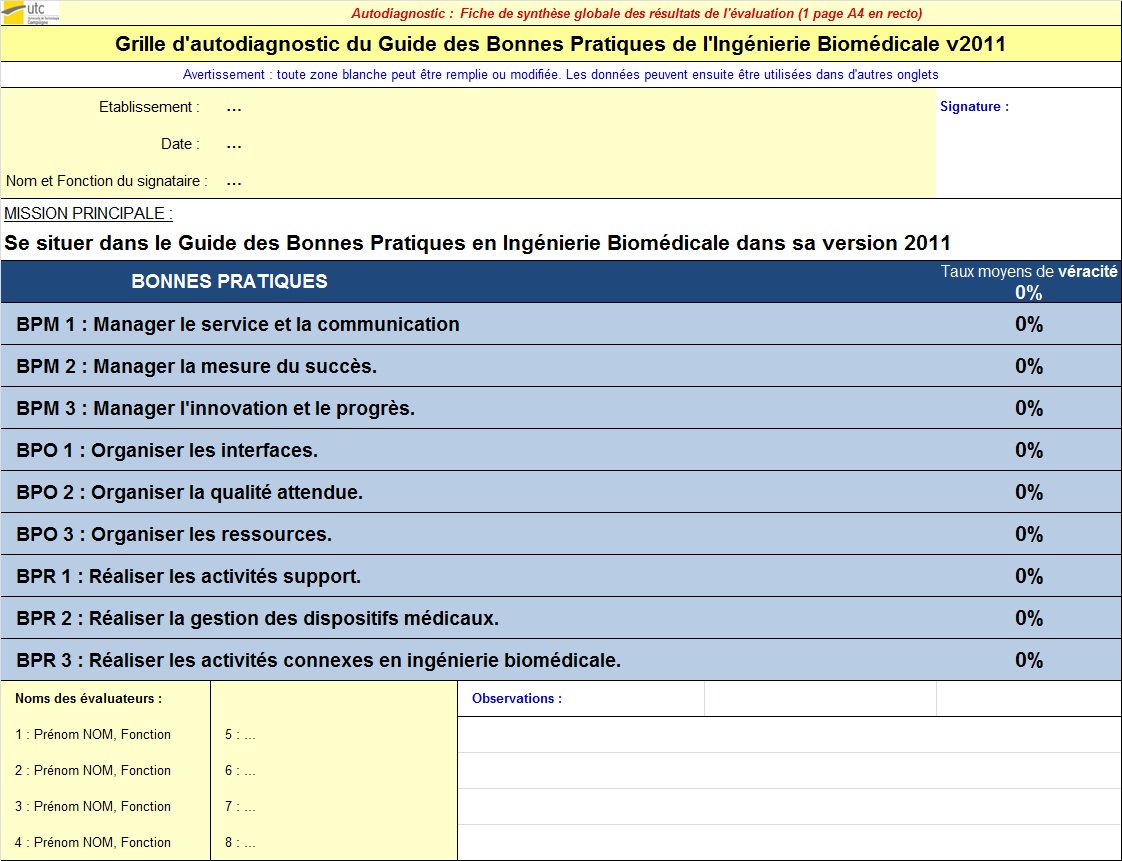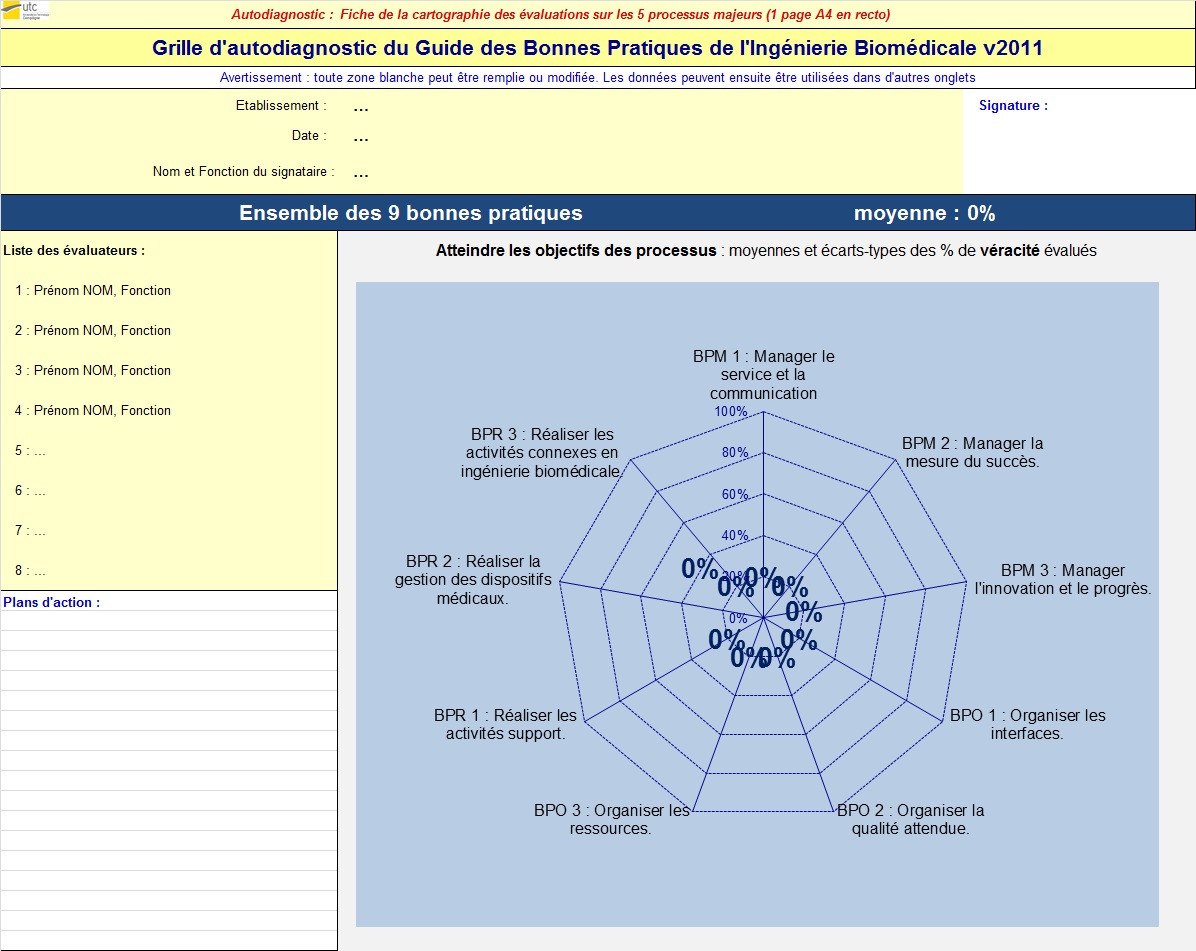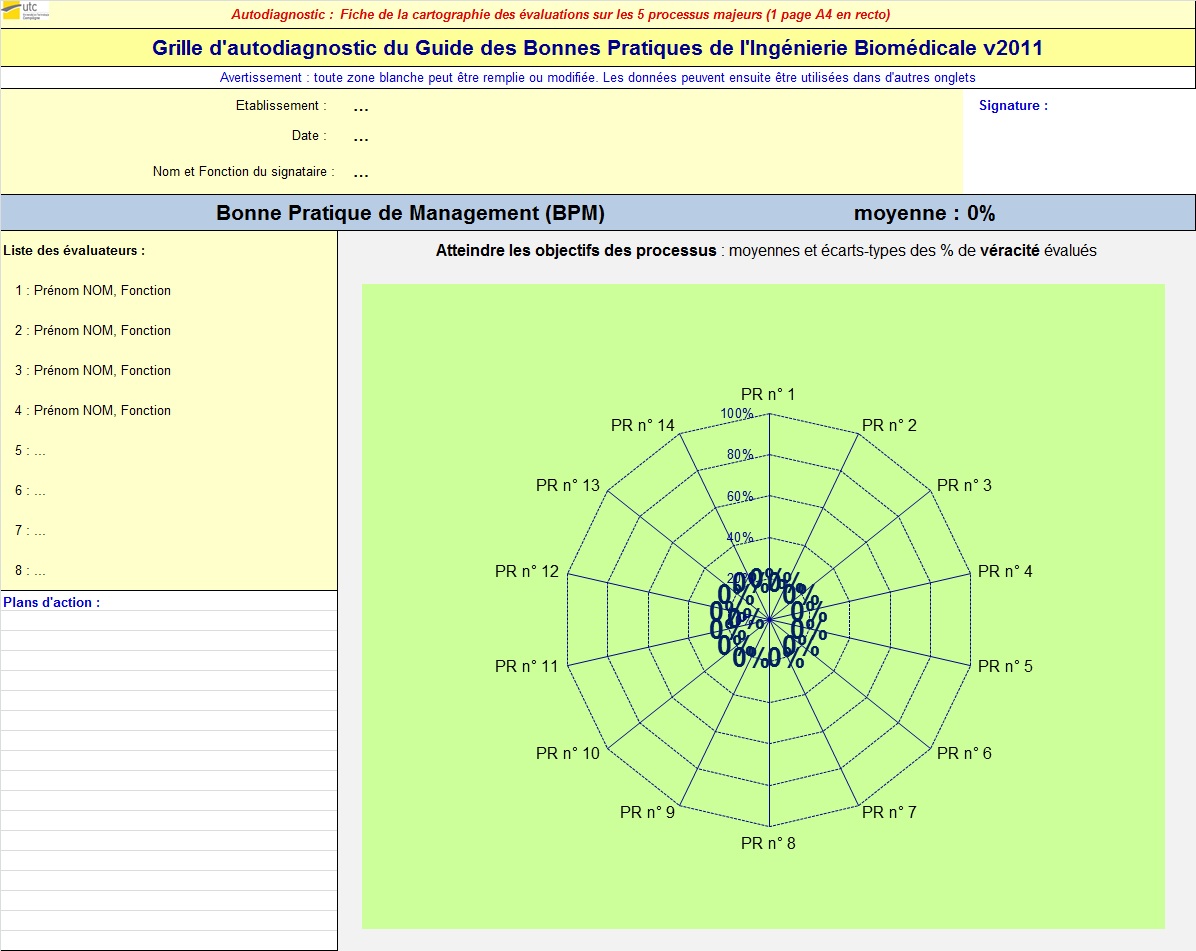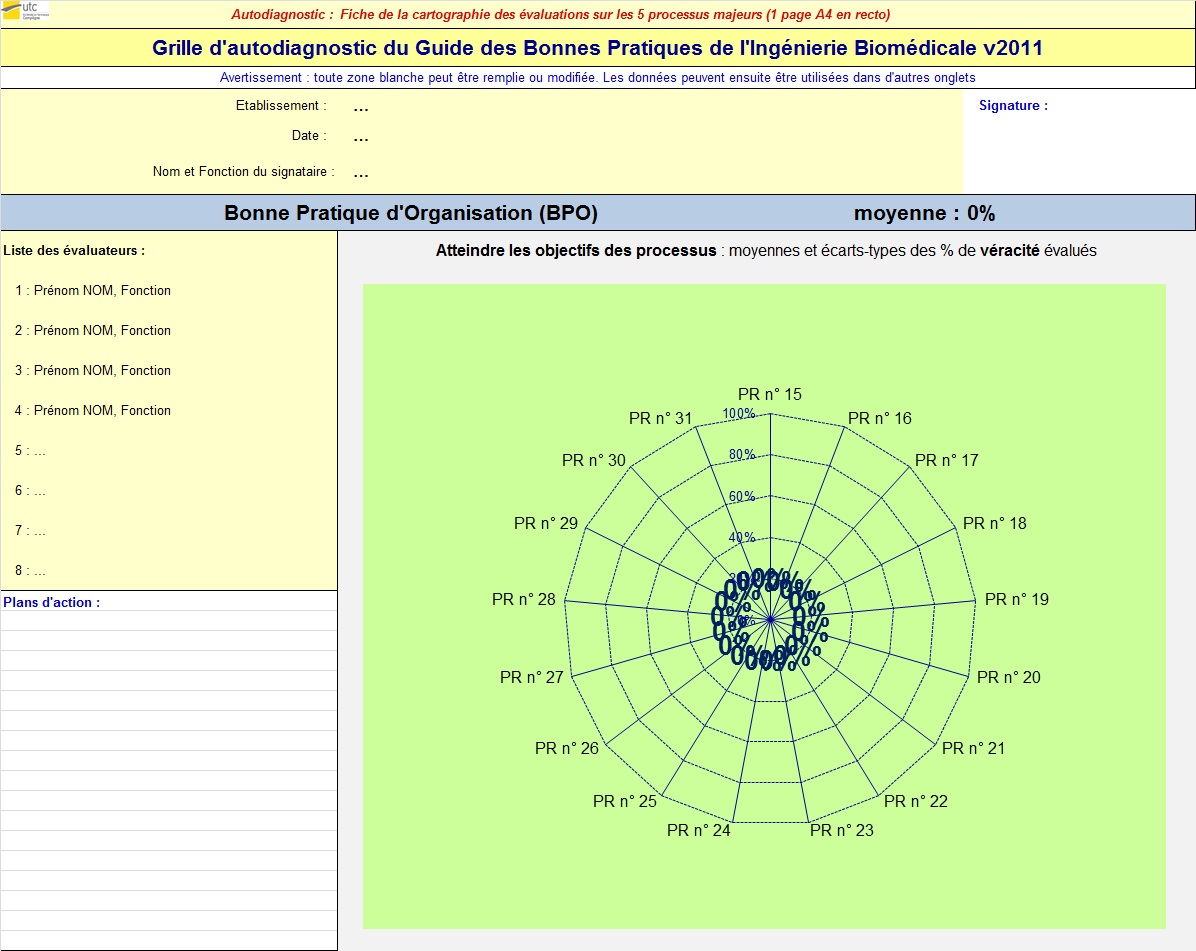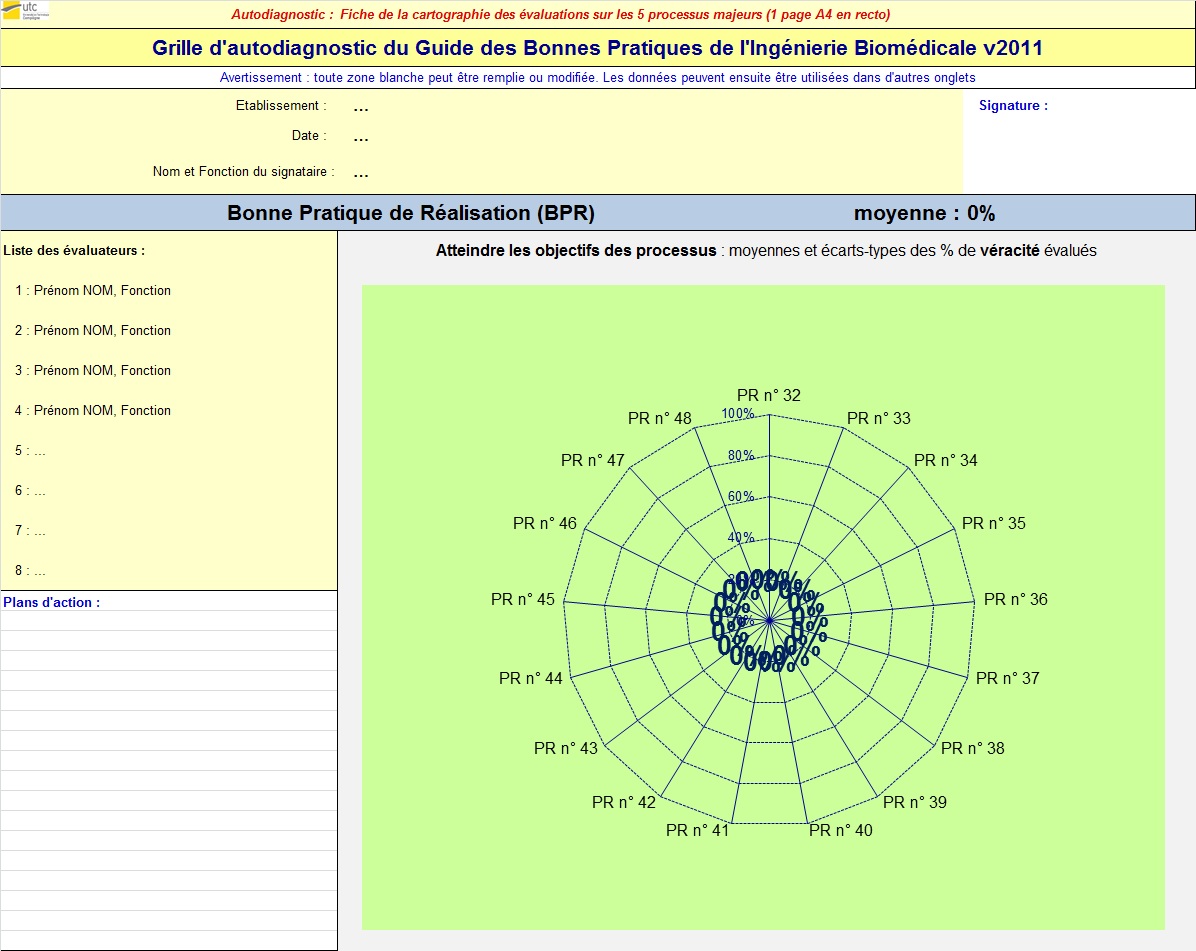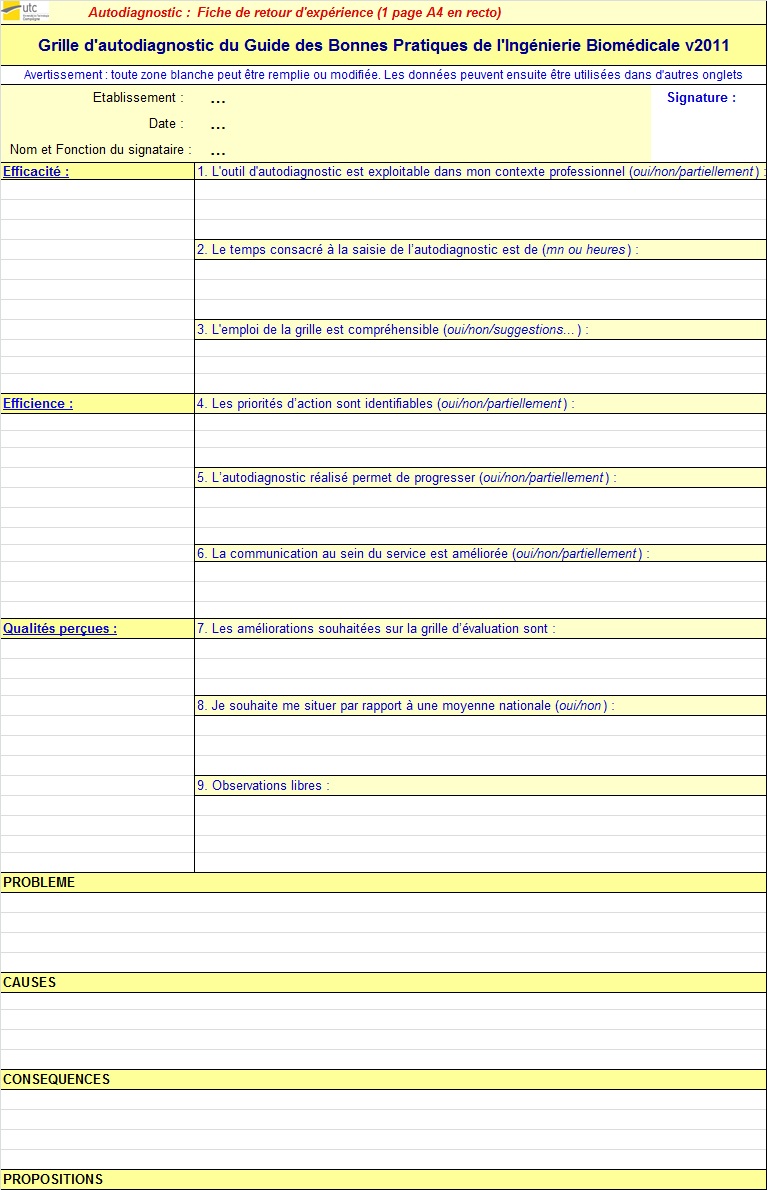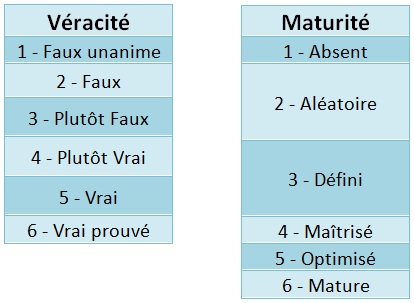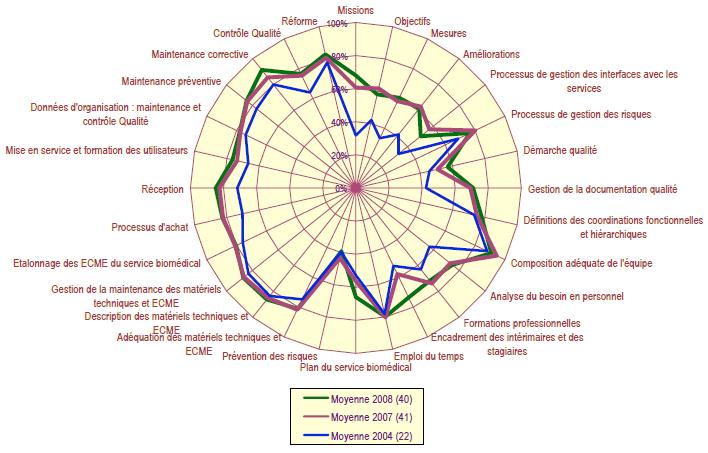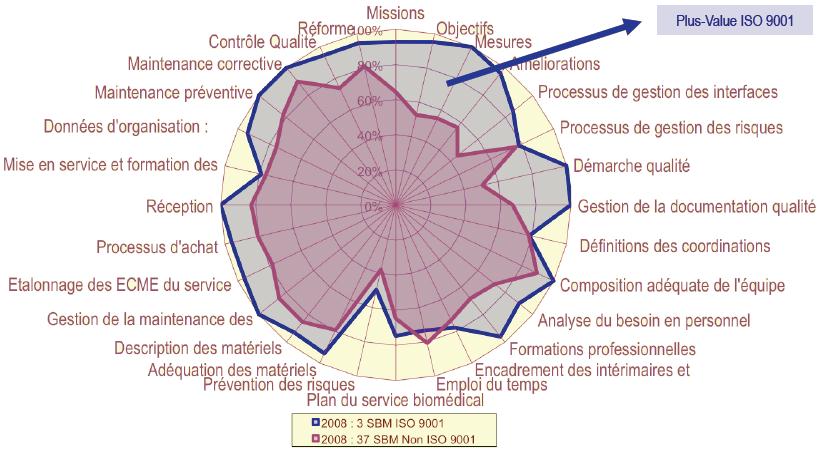|
Avertissement
|
Si vous arrivez
directement sur cette page, sachez que ce travail est un rapport
d'étudiants et doit être pris comme tel. Il peut donc
comporter des imperfections ou des imprécisions que le lecteur
doit admettre et donc supporter. Il a été
réalisé pendant la période de formation et
constitue avant-tout un travail de compilation bibliographique,
d'initiation et d'analyse sur des thématiques associées
aux technologies biomédicales. Nous
ne
faisons
aucun
usage
commercial
et
la
duplication
est
libre.
Si
vous
avez
des
raisons de contester ce droit d'usage, merci de nous en faire part .
L'objectif de la présentation sur le Web est de
permettre l'accès à l'information et d'augmenter ainsi
les échanges professionnels. En cas d'usage du document,
n'oubliez pas de le citer comme source bibliographique. Bonne
lecture...
|
|
Elaboration
d’une
grille
d’autodiagnostic pour le Guide
des Bonnes Pratique d’Ingénierie
Biomédical (GBPIB) 2011
|

Christophe
CERAM
|

David DA COSTA |
|
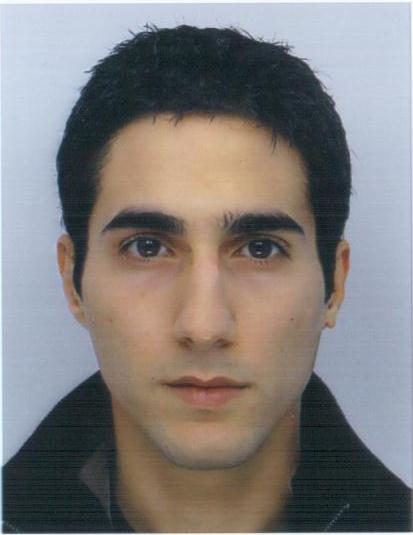
Antony
ROUHBAN
|
Référence
à rappeler : Elaboration
d’une
grille
d’autodiagnostic pour le Guide
des Bonnes Pratique d’ Ingénierie
Biomédical (GBPIB) 2011, C. CERAM, D. DA
COSTA, C.LAMURE, A. ROUHBAN, Projet, Certification Professionnelle
ABIH,
UTC, 2011, Outil
véracité
ici, Outil
maturité
ici
URL : http://www.utc.fr/abih
; Université de
Technologie de Compiègne
|
|
RESUME
Le patient est au centre de toutes les attentions, la
société, par le biais des institutions, impose une
législation de plus en plus exigeante afin de garantir la
qualité et la sécurité des soins aux patients.
Le service biomédical étant concerné par ces
directives, doit maîtriser ses pratiques. Pour cela, il
peut se référer au Guide des Bonnes Pratiques en
Ingénierie Biomédicale, afin de démontrer son
savoir -faire et viser une reconnaissance des services rendus.
Ce rapport propose un outil d’autodiagnostic qui va permettre, en
s’auto évaluant, de se situer par rapport au guide et de
s’inscrire dans une démarche de progrès.
Mots clés : Patient, qualité des soins,
sécurité des soins, Guide, Bonnes Pratiques,
Ingénierie Biomédicale, GBPIB, outil, autodiagnostic,
autoévaluation
|
|
ABSTRACT
The patient is at the center of
attention. The society, trough institutions, imposes an increasingly
demanding legislation in order to guarantee the quality and security of
healthcare.
Being affected by these guidelines, the Biomedical Department must
control its practices. To do so, the department can refer to the “Guide
des Bonnes Pratiques en Ingéniereie Biomédicale” (Guide
of Good Practices in Biomedical Engineering) to demonstrate its
expertise and seek recognition of its provided services.
This report introduces self-diagnosis tool allowing Biomedical
Departments to evaluate themselves in relation to the guide and to
enroll in an improvement process.
Key words : Patient, quality, security, healthcare,
guide, good practices, biomedical engineering, GBPIB, tool,
self-diagnosis.
|
Remerciements
Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour nous
avoir permis de mener à bien notre projet:
Notre tuteur, M. Gilbert FARGES, Docteur-Ingénieur, enseignant
chercheur et responsable de la formation ABIH (Assistant
Biomédical en Ingénierie Hospitalière) à
l’UTC pour ses conseils avisés et son suivi.
M. Pol-Manoël FELAN, responsable pédagogique de la
formation ABIH de l’UTC pour sa présence quotidienne et son aide.
Mme Isabelle NATTIER, secrétaire de la formation ABIH de l’UTC
pour son accueil, sa sympathie et sa bonne humeur.
L’ensemble de la promotion ABIH 2011 pour une ambiance remarquable.
Sommaire
I. Contexte. 4
. 4
II. Guide des Bonnes Pratiques de l’Ingénierie
Biomédicale en Etablissement de Santé 2011
. 7
III. Evaluation. 17
IV. Grille d’autodiagnostic 2011 : 21
V. Conclusions et perspectives. 26
VI. Glossaire. 27
VII. Bibliographie. 28
VIII. Annexes. 31
Projet
d’Intégration
–
ABIH
2011
Elaboration
d’une
grille
d’autodiagnostic
pour
le
Guide
des Bonnes Pratique d’Ingénierie
Biomédical (GBPIB) 2011
A. Situation. 4
1. Patient
L’augmentation de
l’espérance
de vie entraîne une augmentation des actes de soins.
L’accès aux informations sur
les évolutions de la médecine et des technologies procure
aux patients, de plus
en plus nombreux, une exigence et des attentes légitimes :
être bien
soigné, avec les meilleures technologies et le maximum de
sécurité, le plus
rapidement possible et au moindre coût.
Les
sociétés véhiculent
facilement à travers les médias les problèmes
rencontrés dans le secteur
sanitaire : les citoyens, qui sont tous des patients potentiels,
ont besoin
d'être rassurés.
Pour
répondre
à
ces
nouvelles
obligations,
les
institutions
mettent
en
place
des
mesures
afin
de garantir la
sécurité et la
qualité
[G5]
des soins et donc, du plateau technique, lieu
d’interaction entre patients
et personnel soignant. Mais la performance des systèmes
biomédicaux est souvent
connexe à leur complexité et seule une expertise
biomédicale peut garantir la
sécurité dans l'exploitation et anticiper sur les
nouveaux usages et les
nouvelles technologies.
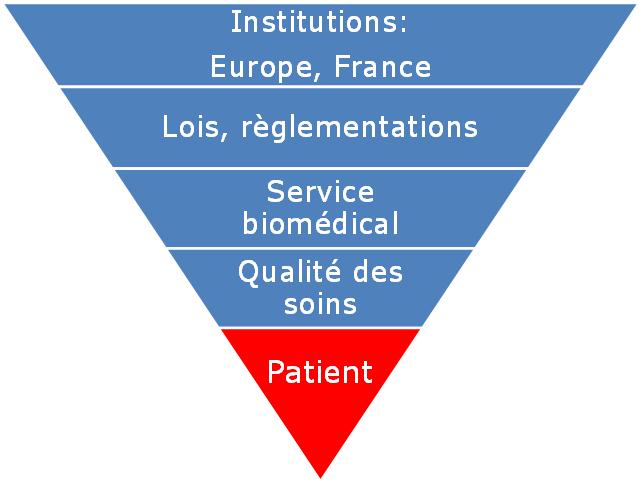
Figure 1 : Pyramide. Source : [R31].
2. Situation Européenne
Les états de l’union européenne sont passés
récemment de 15 à 27 membres. L’Europe doit donc faire
face à la mondialisation de l'économie,
l'évolution démographique, l’évolution politique,
économique et sociétale.
Dans ce contexte, les gouvernements sont confrontés à des
enjeux auxquels ils ne peuvent répondre seuls. Pour relever ces
défis, l’Europe doit se moderniser et se doit de disposer
d’outils efficaces et cohérents.
Pour cela, les états membres de l’union européenne ont
signé, le 13 décembre 2007, le traité de Lisbonne
[R1] modifiant le
traité sur l'Union européenne et le
traité instituant la Communauté européenne. Ces
modifications ont été faite afin de permettre à
l’union d'adapter les institutions européennes et leurs
méthodes de travail. Le traité est entré en
vigueur en décembre 2009.
Titre XIV du traité de Lisbonne concernant la santé
publique, Article 168 [R2]:
- Il encourage la coopération entre les états
membres, visant à améliorer la
complémentarité de leurs services de santé dans
les régions frontalières.
- Il préconise une coordination entre les états
membres en liaison avec la commission européenne, sur leurs
politiques et programmes portant sur l’amélioration de la
santé publique
- Il permet notamment toutes initiatives en vue d’organiser
l’échange des meilleurs pratiques et de préparer les
éléments nécessaires à la surveillance et
à l’évaluation périodique.
- L'Union et les États membres favorisent la
coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière de santé
publique.
- Afin de faire face aux enjeux communs de sécurité,
le Parlement européen et le Conseil, après consultation
du Comité économique et social et du Comité des
régions, peuvent adopter des mesures fixant des normes
élevées de qualité et de sécurité
des médicaments et des dispositifs à usage médical
3. Situation Française. 5
La
France
est
un
état
membre
de
la
communauté
européenne,
à
ce titre elle a signé et
accepté les conditions du traité de Lisbonne.
Géographiquement et culturellement, elle a de nombreux pays
frontaliers et francophones, ce qui implique des échanges
à tous les niveaux, notamment dans le domaine de la santé
et en particulier celui de l’ingénierie biomédicale.
Il y a 465 services biomédicaux et environ 4000
établissements de santé en France [R3], ce nombre
important d’établissements oblige une législation et une
réglementation dans le domaine de la santé publique. Ces
établissements doivent être encadrés par des
organismes accréditeurs tel que la Haute Autorité de
Santé (HAS) [R4].
Comme le précise la récente loi « Hôpital,
patients, santé et territoires » (HPST) [R5] du 21 juillet
2009, en France, la qualité du service rendu aux usagers est,
pour l’ANAP [R6]
(Agence Nationale d’Appui à la Performance des
établissements de santé et médicaux sociaux), le
premier critère de la performance telle que l’a définit
l’OMS : qualité des soins et des prises en charge,
qualité des organisations et des conditions de travail.
B. Bonnes Pratiques
En 1847, aux Etats-Unis, par le biais de l’AMA (American Medical
Association) [R7] la
communauté médicale commença
à organiser et uniformiser ses bonnes pratiques en vue
d’améliorer la santé publique. A partir de 1883, l’AMA
publiera continuellement JAMA (The Journal of the American Medical
Association) [R8],
une revue médicale évaluée par
des pairs. Il est maintenant devenu le journal médical le plus
diffusé.
Depuis, divers corps de métiers ont élaboré des
référentiels de leurs métiers. Citons par exemple
:
- Les « Bonnes Pratiques de Laboratoire » [R9]
- Les « Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière
» [R10]
- La « Bonne Exécution des Analyses de Biologie
Médicale » [R11]
- Les « Guides des Bonnes Pratiques d’Hygiène »
[R12]
La communauté biomédicale, elle, n’a commencé
qu’à la fin des années 1990. Un retard qui montre les
manques et attentes de la profession.
Maintenant, de plus en plus de pays, notamment francophones, sont
demandeurs et attendent un référentiel qualité sur
la profession biomédicale.
1. Guide des Bonnes Pratiques Biomédicales en
Etablissements de Santé 2002 (GBPB)
D’après
[R13]
et
[R15]
C’est à l’initiative de M. Farges que l’on doit la
réalisation d’un guide des bonnes pratiques biomédicales
en établissement de santé.
A un contexte d’intérêt croissant de la profession voulant
démontrer ses capacités professionnelles et l’apparition
de nouvelles réglementations françaises et
européennes s’ajoute une expérience acquise sur le
management [G8] des
démarches de progrès (lors
d’un séjour aux Etats-Unis et au Canada).
Son statut d’enseignant chercheur à l’université de
technologique de Compiègne (UTC) lui a permis, entre 2000 et
2001, de conduire un projet réalisé par des
étudiants du DESS (TBH) [R16].
Un état des lieux des attentes professionnelles des services
biomédicaux a permis d’établir les premières
réflexions sur les bonnes pratiques biomédicales. Cette
enquête a été effectuée auprès de 75
acteurs biomédicaux avec un taux de 21% de réponses.
L’année suivante, en collaboration avec 120 acteurs
biomédicaux, M. Farges élabora le guide des bonnes
pratiques. Il fut approuvé et soutenu par écrit par les
associations AAMB [G19],
AFIB [G20] et ATD [G25] et validé par
46 acteurs
Ce guide vise l’amélioration du quotidien des pratiques
biomédicales en établissement de santé. C’est une
aide à la réflexion, au conseil, à
l’amélioration des actes et missions des services
biomédicaux. C’est un outil interactif, flexible et
évolutif.
Ce guide est librement téléchargeable sur internet [R13].
Il aura également permis la certification [G11] de
certains services, en effet on en dénombre une dizaine en 2002.
Citation de M. Farges : « Ce guide n’est pas un sommet à
gravir, mais simplement un horizon à atteindre ».
2. Evolution de la situation
D’après
[R14].
Depuis l’édition du GBPB en 2002
la profession biomédicale hospitalière s’est enrichie sur
plusieurs points :
- Elaboration d’une grille d’autodiagnostic en 2004 :
l’évolution des pratiques est constatée grâce
à la comparaison de grilles exploitées
périodiquement par de nombreux services hospitaliers
(français et étrangers). Néanmoins, les
comparaisons faites entre 2007 et 2008 montrent une stagnation : cela
laisse supposer la nécessité d’une évolution du
guide.
- Implication internationale : différentes associations de
différents pays font preuve d’intérêt pour le GBPIB
2011. Le Québec a même publié en 2005 un guide
Québécois adapté de la version française.
En septembre 2007 après une sollicitation de M. Farges pour un
benchmarking [G12]
sur l’auto évaluation des bonnes
pratiques, la Côte d’Ivoire, la Belgique et le Québec ont
répondus à hauteur de 25%.
- Preuves de reconnaissance : en effet, des progrès
mesurables globalement pour la profession (constatés et
publiés périodiquement) ont maintenu un niveau
d’attention assez élevé envers les pairs et les tutelles.
En France, par exemple, la Haute
Autorité de Santé (HAS) a intégré dans la
version 2010 de son Manuel de Certification des Etablissement de
Santé [
R19],
la « Gestion des équipements
biomédicaux » comme critère d’évaluation
(critère 8k) [
G13] explicité dans la
partie «
Management de la qualité et de la sécurité des
soins ».
- Prises de responsabilités : cette reconnaissance a non
seulement salué l’effort mis en œuvre et sa continuité
mais a aussi induit des exigences d’anticipation et de maintien du haut
niveau professionnel.
- Evolution des règlementations : depuis 2002,
évolution et création de nombreuses normes
internationales, européennes et françaises.
- En 2003 : NF S99-172
- En 2005 : ISO/CEI 17050 [G14]
- En 2007 : EN 60601-1
- En 2008 : ISO 9001 [G15]
- Etc.
- Principaux axes d’évolutions du guide :
Entre 2002 et 2010, compte tenu des
nouvelles attentes identifiées, des propositions
d’évolutions publiées ciblaient particulièrement
les points suivant :
- Progressivité : un guide applicable quelle que soit
l’ampleur, la situation et la maturité [G12] du service
biomédical.
- International : un guide sans frontières
intégrant règlements, exigences et particularités.
- Compatibilité ISO 9001 : un guide apte à mener
vers une certification ISO 9001 vis-à-vis du système de
management de la qualité.
- Autodiagnostic : un outil d’auto-évaluation
associé à toute évolution du guide.
II. Guide des Bonnes Pratiques de l’Ingénierie
Biomédicale en Etablissement de Santé 2011
. 7
Tout ce qui figure dans ce chapitre se réfère au Guide
des Bonnes pratiques de l’Ingénierie Biomédicale en
établissement de Santé (GBPIB) [R14].
Afin d’éviter tout ambiguïté sur le terme «
Biomédical » le guide des bonnes pratiques change de nom
en « Guide des Bonnes Pratiques de l’Ingénierie
Biomédicale en établissement de santé ». En
effet, pour beaucoup d’acteurs et décideurs en France et encore
plus au niveau international, le terme « biomédical
» recouvre plus largement les techniques thérapeutiques,
médicamenteuses, biotechnologiques, biologiques et
moléculaires, voire les champs des biomatériaux, des
suppléances au handicap etc.
A. Le « comment » de l’élaboration
du guide
A partir de
septembre 2008, le
processus d’élaboration s’est déroulé en deux
étapes :
- 2008-2009 :
Recherche
des
structures
possibles
et
des
nouveaux
contenus
à
intégrer.
Un
groupe
d’étudiants
du
Master
Sciences,
Technologies,
Santé
de
l’UTC
a
permis :
- La
mise
en
compatibilité
de
l’ancienne
structure
du
guide
avec
le
modèle
processus
recommandé
par l’ISO
9001.
- La démonstration de la faisabilité d’une
nouvelle structure du guide permettant la progressivité et la
compatibilité ISO
9001
- 2009-2010 :
Mise
en
œuvre
d’une
structure
générique
et
intégration
des
contenus.
Des
étudiants
en
certification
professionnelle
« Assistant
Biomédical
en
Ingénierie
Hospitalière
(ABIH) »
de
l’UTC
ont
permis :
- L’adaptation
et
l’enrichissement
des
contenus
du
guide.
- L’intégration des exigences ISO 9001 sur la
« gestion
des ressources ».
Des
étudiants
du
Master
Sciences,
Technologies,
Santé
de
l’UTC
ont
permis :
- La
finalisation
de
la
structure
grâce
à
un
modèle
générique
simplifié
de
management,
adaptable
à
n’importe quelle bonne pratique
- L’intégration des recommandations de l’ISO 9004[G16]
version 2009 afin de cibler des performances durables dans
l’activité
biomédicale.
- L’établissement
d’un
bilan
intéressant :
le
nouveau
guide
devrait
être
plus
simple
à
exploiter
et
plus
rapide à mettre en
œuvre.
B. L’esprit du guide. 8
Les citoyens, qui
sont tous
des patients potentiels, vivent dans une société de plus
en plus complexe et ont
besoin d’être rassurés par une expertise
biomédicale qui doit être capable :
- D’assurer
la
sécurité
légitime
attendue
dans
l’exploitation
des
dispositifs
médicaux.
- D’anticiper
sur
les
nouveaux
usages
et
les
nouvelles
technologies.
- Le
guide
vise
à
faire
progresser
les
pratiques
professionnelles
afin
que
le
service
biomédical
puisse
mieux
remplir ses missions.
- Le
guide propose un état de l’art complet validé par les
pairs afin que chaque acteur
biomédical puisse évaluer ses propres pratiques et
identifier des voies d’amélioration.
- Le
guide a pour vision de devenir un instrument libérant les
potentiels et les
initiatives des acteurs biomédicaux sur le terrain.
- Le
guide est là pour mener les pratiques de l’ingénierie
biomédicale à leur plus
haut niveau de professionnalisme et de confiance pour la
société, les citoyens
et les patients.
Avec ce guide, la communauté biomédicale
hospitalière peut proposer aux tutelles des alternatives
crédibles aux mises en
conformité réglementaire.
- Le
guide
offre
l’accès
à
la
liberté
de
construire
son
avenir
professionnel
et
ouvre
tous
les
horizons possibles d’adaptation, d’innovation et de
création.
Tous
ces
critères
sont
des
composantes
intrinsèques
aux
performances
durables
et
donc
à
la
pérennité
des organisations.
C. La structure du guide. 8
La structure de
l’édition 2011
du guide est construite à partir d’une « Bonne
Pratique Générique (BPG) ».
En effet, chaque bonne pratique est décrite selon une approche
générique qui
suit les processus métier habituels de l’ingénierie
biomédicale « 3S » :
Sens, Soutien et Suivi.
Figure 2 : Cycle 3S. Source : [R14]
De plus, la BPG
intègre les
notions des principaux référentiels qualité
internationaux suivant :
- Principe
de
l’amélioration
continue
(ISO
9001)
- Principe de la performance durable (ISO 9004)
- Principe
de
l’Excellence
(EFQM [G17]).
Figure
3
:
Correspondance
entre
les
principaux
référentiels
qualité
et
la « Bonne pratique générique
». Source : [R14].
a)Définir les mots permet de
bien expliciter « de quoi on parle ».
b)Préciser les enjeux
associés aux bonnes pratiques afin d’en démontrer leur
utilité et leur pertinence.
c)Définir les objectifs
recherchés à travers les bonnes pratiques afin d’en
dresser les processus structurant à mettre en œuvre et à
décliner en tâches de réalisation.
d)Favoriser l’amélioration
continue des bonnes pratiques.
a)Identifier les parties prenantes
[G13] aux bonnes pratiques en précisant leurs
caractéristiques (interne ou externe, direct ou indirect,
partenaire ou support, client ou fournisseur)
b)Identifier les ressources (interne ou externe) nécessaire
à la réalisation des bonnes pratiques.
a)Définir les processus
correspond à expliciter l’enchaînement des actions afin de
produire le résultat attendu des bonnes pratiques.
b)Identifier les tâches avec des
critères de réalisation permettant de considérer
que les bonnes pratiques sont réalisées avec
succès.
c)Evaluer la performance des bonnes pratiques en s’appuyant sur les
dimensions génériques d’efficacité [
G3] ,
d’efficience [
G4]
et de qualité perçue [
G6] .
La cohérence entre l’approche des « 3S », la BPG,
ISO 9001 et ISO 9004 s’organise autour de trois modules.
D. Trois Modules : BPM, BPO, BPR. 10
Les
modules
peuvent
être
représentés
dans
un
système
suivant
la
boucle
«
Sens,
Soutien,
Suivi
»
formalisant le fil directeur entre le management (BPM),
l’organisation (BPO) et
la réalisation (BPR) des services.
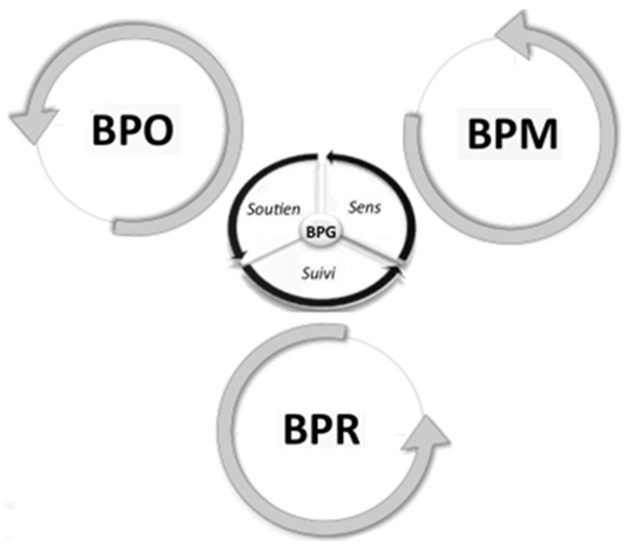
Figure 4 : les trois modules s’organisent autour des bonnes pratiques
génériques. D’après [R14].
- « Bonnes
Pratiques
de
Management
(BPM) » :
associées au « Sens ».
Module
intégrant
les
éléments
de :
- Décision :
stratégie.
- Direction.
- Pilotage :
définir une politique (mission et vision), des objectifs et une
stratégie.
- Innovation :
permet de favoriser les démarches créatives
managériales et opérationnelles.
- Communication :
comprendre
et
se
faire
comprendre des autres.
Il
comporte
les
principaux
éléments
associés
à
la
qualité
perçue
du
service
biomédical :
- Identification
et
mesure
de
l’impact
des
missions
et
engagements
de
service
- Mise
en
œuvre
d’une
dynamique
de
progrès
retour
sommaire
-
« Bonnes Pratiques
d’Organisation (BPO) » :
associées au « Soutien ».
Module
explicitant :
- La
bonne gestion des ressources
- La
mesure des résultats obtenus et leur analyse.
Il comporte les éléments
clés
de l’efficience d’un service biomédical :
- Allocation
optimale des ressources
- Analyse
des
services
rendus
par
rapport
à
ceux
attendus
- Identification
des améliorations
retour
sommaire
- « Bonnes
Pratiques
de
Réalisations
(BPR) » :
associées au « Suivi ».
Crucial,
ce
module
est
le
cœur
du
métier
de
l’ingénierie
biomédicale. En
effet :
- Il
précise
les
bonnes
pratiques
nécessaires
à
la
livraison
des
services
définit
par
les
missions
- Il
est à la source de la mesure de l’efficacité
perçue du service biomédical.
Pour
un
service
n’ayant
jamais
fait de démarche qualité, commencer par les bonnes
pratiques de réalisation est
plus judicieux. En effet, les critères de réalisation
sont les fondements du
métier et correspondent plus aux pratiques effectuées au
quotidien,
contrairement au management et à l’organisation qui ne sont pas
des concepts forcément
familiers à tous.
-
Chaque
module est décliné en trois bonnes pratiques majeures.
E. Neuf Bonnes Pratiques. 11
Les
neufs
bonnes
pratiques
qui
découlent
des
trois
modules
sont
représentatives
du
métier
et
donc
facile à
mémoriser. Elles sont également :
- Identifiables
facilement
en
processus
métier :
au
nombre
de
48.
- Cohérentes
avec les modèles de management par la qualité.
1. Bonnes Pratiques de Management
- BPM 1
– Manager le service et la communication :
Cette bonne pratique
consiste à
- Développer
les conditions internes de
déploiement des talents de tous les acteurs
- Veiller
aux
résultats
livrés
aux
parties
prenantes
- Communiquer
efficacement pour identifier la qualité
perçue et les évolutions pertinentes sur les produits et
services à rendre.
Enjeux :
assurer
la
pérennité
du
service
biomédical.
Objectifs :
- Piloter.
- Motiver en assurant un
« leadership ».
- Communiquer.
Structure : 4 processus et 12 critères de
réalisation.
- BPM 2
– Manager la mesure du succès :
Cette
bonne
pratique
consiste
à
développer
une
culture
d’action
basée
sur
les
données
factuelles
recueillies
et
mises à jour périodiquement. Il faut garantir aux acteurs
de ce processus que
cette bonne pratique est appliquée en vue de remplir à
terme les missions et d’atteindre
les objectifs du service biomédical. C’est une source
d’enseignement, aucun
effet pervers ne doit être induit par la suite : ce n’est
pas le résultat
qui compte mais ce que l’on va pouvoir en faire pour progresser.
Enjeux : permettre au service biomédical de
progresser dans la
qualité de ses services, de son image et de sa reconnaissance
Objectifs :
- Mesurer avec des indicateurs de
performance et des tableaux de bord.
- Enregistrer grâce à des mesures
périodiques (autoévaluations).
- Analyser via le
« benchmarking ».
Structure : 5 processus et 19 critères de
réalisation.
-
BPM 3
– Manager l’innovation et le progrès :
Cette bonne pratique
consiste à manager :
- L’innovation
qui
est
quelque
chose
de
nouveau
visant
à
améliorer
les
performances
durables
d’une
entité
en accompagnant une démarche
de progrès.
- Le progrès qui est le constat concret et
mesurable d’un changement profitable
dont la source est une innovation.
Remarque :
- L’innovation
et
le
progrès
peuvent
porter
sur
les
produits,
services
ou
organisations
de
toute
entité. Ils
peuvent donc être
matériels ou immatériels, concrets ou organisationnels,
opérationnels ou managériaux.
- Le profit peut concerner les bénéficiaires, les
parties prenantes ou les acteurs internes de l’entité
Enjeux : anticiper les besoins et développer
la capacité
« d’agir autrement ».
Objectifs :
- Anticiper en veillant aux évolutions
tout en proposant des axes stratégiques d’amélioration.
- Innover.
- Progresser en mettant en œuvre les
innovations et en mesurant leurs effets.
Structure : 5
processus et 15 critères de réalisation.
2. Bonnes Pratiques Opérationnelles
- BPO 1
– Organiser les interfaces :
Cette
bonne
pratique
porte
sur
la
gestion
des
interfaces
avec
les
services.
Cela
correspond
à
la gestion des
relations qui sont mises en place entre le service biomédical et
les services
qui sont parties prenantes vis-à-vis de ses activités.
Remarque :
- Le
service
biomédical
peut
être
amené
à
travailler
au
sein
de
groupes
de
travail
transversaux
interdisciplinaires
(métiers différenciés).
Les relations avec ces derniers sont alors à considérer
avec la même approche
que celle employée pour les services parties prenantes.
Enjeux : améliorer la qualité
perçue du service biomédical.
Objectifs :
- Ecouter afin de déterminer les attentes
critiques des parties prenantes.
- Planifier en validant les processus et
en anticipant les risques.
- Suivre en veillant à la mise en œuvre
et en communiquant avec le personnel concerné.
Structure : 4 processus et 12 critères de
réalisation
- BPO 2
– Organiser la qualité attendue :
La
qualité attendue
d’un service ou d’un
produit correspond
au respect des caractéristiques identifiées
et validées avec
les bénéficiaires ou parties prenantes du service
biomédical.
Remarque :
- Elle
est
différente
de
la
qualité
souhaitée puisqu’elle
est
le
résultat
d’une
éventuelle
négociation
contractualisée
avec
les
parties.
- Elle est
différente de la qualité livrée qui
connaît parfois des écarts avec les engagements à
respecter.
- Elle est
différente de la qualité perçue. En
effet, les parties prenantes peuvent avoir évolué dans
leurs attentes initiales
ou avoir eu des besoins implicites ou latents non pris en compte.
Enjeux : construire la crédibilité
professionnelle du service
biomédical.
Objectifs :
- Impliquer le personnel du service
biomédical en développant l’autonomie et les
capacités.
- Organiser le système de management de
la qualité.
- Surveiller de façon continue
l’efficacité permettant de produire la qualité attendue.
Structure : 4 processus et 14 critères de
réalisation
- BPO 3
– Organiser les ressources :
Cette
bonne
pratique
consiste
à
estimer
les
ressources
prévues
dans
toutes
leurs
dimensions :
- Humaines
- Juridiques
- Financières
- Logistiques
- Techniques
Enjeux : faire toujours mieux sans pour autant
demander plus
afin de tendre vers l’autonomie.
Objectifs :
- Inspirer la confiance en valorisant les
ressources humaines.
- Adapter ses ambitions en adaptant les
ressources financières et logistiques.
- Garantir l’action.
Structure : 9 processus et 31 critères de
réalisation
3. Bonnes Pratiques de Réalisation
- BPR 1
– Réaliser les activités support :
Le support au
service biomédical correspond aux éléments
essentiels
pour réaliser les activités associées à la
maîtrise en exploitation d’un
dispositif médical. La notion de support recouvre :
- Les méthodes
- Les documents
- Les
moyens
- Les
équipements de contrôle de mesure et d’essai
(ECME)
- Les
outils
- Les fournitures et
pièces détachées
Enjeux : favoriser et prouver l’image de
professionnalisme du
service biomédical.
Objectifs :
- Documenter : obtenir et/ou mettre
à jour les documentations techniques, normatives ou
réglementaires.
- Outiller : exploiter des
compétences métrologiques et des moyens techniques
(maintenance et contrôle
qualité) adaptés aux besoins.
- Gérer les stocks afin d’en assurer la
disponibilité en concordance avec les besoins.
Structure : 5 processus et 17 critères de
réalisation
- BPR 2
– Réaliser la gestion des dispositifs médicaux :
Bonne
pratique
qui
correspond
à
l’ensemble
des
activités
à
mener
tout
au
long
du
cycle
de vie d’un dispositif
médicale : de l’anticipation du besoin jusqu’à la
réforme (obsolescence,
déclassement ou mise hors service).
Enjeux : assurer la maîtrise du parc
technologique biomédical
afin de valoriser l’établissement de santé.
Objectifs :
- Anticiper les besoins en dispositifs
médicaux (court et moyen terme)
- Former à l’usage des dispositifs
médicaux en toutes circonstances et évaluer la
nécessité de réactualisation
- Gérer les dispositifs médicaux et
maîtriser
leur service rendu et qualité fonctionnelle tout au long du
cycle de vie.
Structure : 9 processus et 71 critères de
réalisation
-
BPR 3
– Réaliser les activités connexes en ingénierie
biomédicale :
Les activités connexes ne sont
pas forcément applicables à tous les services.
Dépendantes du contexte, elles
recouvrent des besoins particuliers à satisfaire.
Néanmoins, dans le cadre
d’échanges des bonnes pratiques, elles représentent une
source considérable
d’innovation et de progrès.
Enjeux : permettre à un service
biomédical de démontrer ou
d’acquérir une bonne maîtrise des activités allant
au-delà de celles
normalement attendues.
Objectifs :
- Manager le sens en précisant un besoin,
ces enjeux et objectifs mesurables.
- Organiser le soutien en identifiant les
risques, les critères de qualité et les ressources
nécessaires.
- Réaliser le suivi en définissant
les
processus, les critères de réalisation et les mesures de
succès.
Structure : 3 processus et 21 critères de
réalisation
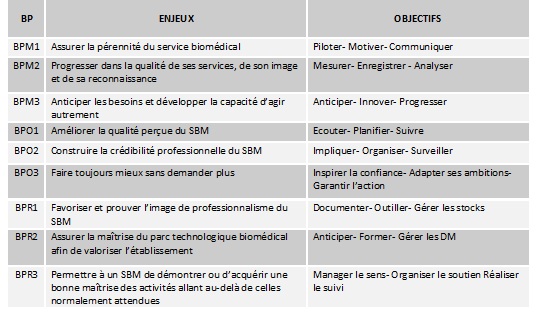
Tableau 1 : récapitulatif des enjeux et objectifs de chaque
bonne pratique. Source : [R31].
F. Comparaison des deux guides. 15
- Guide
des
Bonnes
Pratiques
Biomédicales
en
établissement
de
santé
(GBPB)
2002 :
- Le GPBP a été élaboré avec le
soutien de 3
associations biomédicales et plus de 120 acteurs
biomédicaux.
- Il
comporte
28
bonnes
pratiques
et
118
affirmations.
- Guide des Bonnes Pratiques de l’Ingénierie
Biomédicale en établissement de santé (GBPIB)
2011 :
- Le GBPIB a
été validée par 8 associations et comprend
2 fois plus de contributeurs
- L’ensemble est
décliné selon 3 modules, 9 bonnes
pratiques et 48 processus associés chacun a des propositions de
tâches à
réaliser, ces critères sont au nombre de 2
- En
intégrant les critères de réalisation dans son
contenu même, il est rendu plus
explicite et plus précis.
retour
sommaire
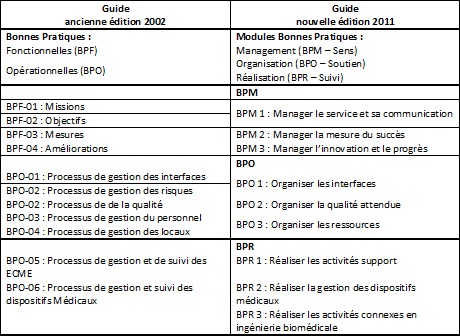
Tableau 2 : comparatif de l’organisation des
bonnes pratiques entre les deux guides. D’après [R14].
G. L’avenir du guide 2011. 16
Cette nouvelle
version du
guide à la même ambition que sa première
édition : être un outil pour la
communauté biomédicale hospitalière dont la
dynamique professionnelle imposera
des évolutions périodiques.
Les enseignements de la
première édition indiquent de mener les actions
suivantes :
- Identifier
des
référents-guide
au
sein
de
chaque
association
et
pays
- Publier périodiquement des bilans et des
propositions afin de :
- Maintenir
une communication professionnelle de haut niveau sur le guide
- Garantir
la maîtrise des innovations dans les pratiques.
Proposer
un
outil
d’autodiagnostic
accessible
librement,
si
possible
multilingue,
exploitable
via
un
simple
navigateur
internet
et
permettant les échanges de bonnes pratiques entre
professionnels.
III. Evaluation. 17
A. Pourquoi s’évaluer. 17
L’évaluation
est
primordiale
parce
qu’elle
permet
de
mesurer
les
performances
(efficacité,
efficience,
etc.)
des
pratiques
professionnelles.
Elle est donc essentielle pour :
- Identifier
les
axes
d’améliorations
permettant
de
progresser.
- Démontrer la qualité rendue et perçue des
prestations.
De plus,
l’évaluation
périodique est préconisée dans l’article 168 de la
santé publique du traité de
Lisbonne.
B. Comment s’évaluer. 17
L’évaluation
consisterait
à
comparer
ce
qui
est
réalisé
par
rapport
à
ce
qui
est
attendu.
Ceci suppose donc
que l’on
dispose de référentiels de pratiques (recommandations de
bonnes pratiques,
références…) qui soient validés au plan
scientifique et adaptés à la pratique.
Il existe
différentes
modalités d’évaluation suivant les objectifs que l’on
souhaite atteindre.
- L’auto
évaluation est un examen systématique effectué
par le service biomédical
lui-même. Il évalue l’efficacité et l’efficience du
système par rapport à un
guide pour connaître ses points forts et les points à
améliorer.
- L’évaluation
par les pairs est un examen effectué par un comité
d’audit composé de
différents membres de la profession afin de vérifier la
conformité du service
par rapport au référentiel. (Exemple :
associations biomédicales)
- L’évaluation
par une tierce partie est réalisée par un organisme
accrédité indépendant
et extérieur au monde biomédical. (Exemple : HAS)
Si l’on souhaite
améliorer nos
pratiques en interne, une auto-évaluation est suffisante.
C. L’auto-évaluation. 17
L’auto-évaluation
est
le
meilleur
outil
d'amélioration
continue
promu
par
tous les
référentiels internationaux relatifs à la
qualité.
Définition de l’auto-évaluation par l’ISO 9000:2005 [G18]
: revue complète et méthodique des activités et
des résultats de l’organisme. Elle peut fournir une vision
globale des performances et du niveau de maturité des processus
et contribuer à identifier les domaines nécessitant des
améliorations et leurs priorités.
C’est d’ailleurs à travers une grille d’auto-évaluation
[R29] (ou
autodiagnostic) basée sur le GBPB 2002 que la
communauté biomédicale va pouvoir se situer et mettre en
évidence des axes d’amélioration.
D. Grille d’autodiagnostic 2004. 18
D’après [R29].
Cette grille a
été réalisée par
deux étudiants de l’UTC en DESS [R17] et
diffusée en février 2004.
Basée sur
le GBPB 2002, elle
permet de mesurer les écarts entre les pratiques réelles
du service et les
références minimales du guide.
Elle peut également être
utilisée pour des évaluations.
La grille se
compose donc d’un
rappel des références minimales du guide (BPF, BPO) et
d’un nombre variable
d’affirmation pour chacune d’entre elles. Chaque affirmation est
affectée d’un
coefficient de pondération permettant d’en distinguer
l’importance relative au
de sein de la référence évaluée.
L’évaluation
de
ces
affirmations
est
à
réaliser
suivant
4
niveaux :
- Vrai
- Plutôt
Vrai
- Plutôt
Faux
- Faux
Il y a
également la
possibilité de choisir « N/A » lorsque
c’est non applicable dans le
service concerné.
Cette
échelle
est
volontairement
asymétrique.
1. Enquête d’usage de la grille. 18
Un onglet
« retour
d’expérience » intégré à la
grille contient les métadonnées à remplir
(nom, fonction, établissement, etc.) et des questions pour
pouvoir réaliser une
enquête d’usage.
Enquête
d’usage :
- Retours
sur
la
saisie de la grille :
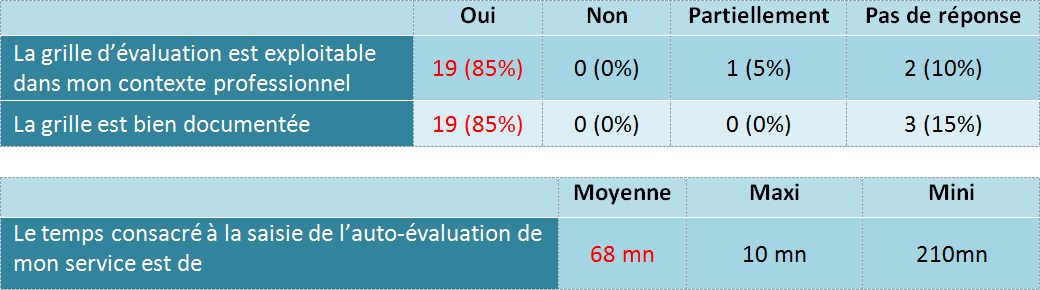
Tableau 3 : Retours sur la saisie de la
grille.
D’après [R30].
- Retours
sur l’exploitation
de la grille :
Tableau 4 : Retours sur la l’exploitation
de la
grille. D’après [R30].
- Retours
sur
la
validation de la
grille :
Tableau 5 : Retours sur la validation de
la
grille. D’après [R30].
retour
sommaire
- Retours
sur
les
améliorations souhaitées :

Tableau
6 :
Retours
sur
les
améliorations
souhaitées
de
la
grille.
D’après
[R30].
Ce
dernier
point
a
été
pris
en
compte
et
a
induit
plusieurs
comparaisons
entre
différents
services.
2. Comparaisons. 19
La grille
d’autodiagnostic
2004 contient un onglet « Cartographie ».
Figure 5 : Cartographie radar vierge de
la grille
d’autodiagnostic 2004. Source [R29].
La cartographie
radar des
bonnes pratiques permet :
- Une
lecture
claire
et
synthétique
des
résultats
obtenus.
- Une
identification
des
axes
d’amélioration
et
donc
une
mise
en
évidence
des
actions
prioritaires
à
engager.
Liste des comparaisons
effectuées :
En
2004 : moyennes et écart types de plusieurs
cartographies de
différents Service Biomédicaux
- 05/05/2004 :
moyenne de 8 établissements [R20]
- 01/06/2004 :
moyenne de 20 établissements [R21]
- 01/09/2004 :
moyenne [R22]
et écart type [R23] de 22
établissements
(dont 3 certifiés ISO 9001)
retour
sommaire
En
2006 : deux études faites en juin.
- Moyenne des
cartographies de 23 services de l’Assistance Publique des
Hôpitaux de Paris
(APHP)
- La moyenne des
23 services de l’APHP [R24]
- La moyenne
en France en 2004 : 19 établissements non certifiés
[R25].
- La moyenne
en France en 2004 : 3 établissements certifiés ISO
9001[R25].
En
2007 :
- Comparaison
des services biomédicaux certifiés ISO 9001 (au nombre de
6) avec les non
certifiés (au nombre de 35) [R26]
- Comparaisons
entre 7 mêmes services (dont 2 certifiés)
évalués en 2004 puis en 2007 [R27]
- Moyenne de
41 services biomédicaux (dont 9 Québécois) [R28]
En 2008 :
- Comparaison [A1]
des moyennes des cartographies de :
- 22
établissements en 2004
- 41
établissements en 2007
-
40
établissements en2008
- Comparaison [A2]
des moyennes des
cartographies de :
- 3
établissements
certifiés
ISO
9001
- 37
établissements
non
certifiés
3. Remarques et enseignements tirés. 20
-
Les services biomédicaux sont
réactifs et
répondent assez bien aux demandes explicites de mutualisation,
mais ils
n’adressent pas naturellement ou spontanément leurs fichiers
d’autodiagnostic.
La
communauté professionnelle biomédicale
hospitalière a besoin d’une stimulation
permanente pour réaliser ses autodiagnostics. Mettre en place un
comité de
« pilotage » interprofessionnel ou
inter-associatif.
- Un tiers seulement des services biomédicaux ont rempli
le volet « retour d’expérience ».
Cela prouve un manque de connaissance sur la
perception de l’usage de la grille.
- Entre
2004
et
2007, on remarque :
-
Les principaux progrès sont en
« management » et il y a une relative
stabilité en
« organisation » et en
« exécution ».
- L’ISO 9001
induit une plus-value sur la plupart
des bonnes pratiques excepté « Prévention des
risques ».
La
bonne pratique « prévention des risques »
est probablement mal
rédigée ou pas assez nuancée dans le GBPB 2002. Il
faut la modifier.
- L’ISO
9001
induit
une
plus-value
sur
la
plupart
des
bonnes
pratiques
excepté
« Processus
de
gestion des
interfaces avec les
services ».
Les
services biomédicaux ont tendance à se suffire de la
satisfaction des clients
sans pour autant expliciter le processus.
- Le
fait
que
les
cas
« N/A »
(non
applicable)
soient
considérés
comme
un
« Non »
perturbe
certains
utilisateurs
qui estiment que cela fausse les cartographies.
Ils
sont à éliminer dans les prochaines versions de la grille.
- Il y a peu
d’écarts entre 2007 et 2008.
Plusieurs interprétations
possibles :
- Le système
de mesure de la grille est saturé, il n’est plus adéquat
à ce que l’on
souhaiterait mesurer.
- Le
GBPB
2002
est
acquis,
il
faut
donc
rédiger
une
nouvelle
version.
- L’ISO
9001
induit
une
plus-value
sur
toutes
les
bonnes
pratiques.
La nouvelle version du guide
à tout intérêt à être
compatible avec la norme internationale ISO 9001.
retour
sommaire
IV. Grille d’autodiagnostic 2011 :
21
A partir de 2004,
grâce à la
grille d’autodiagnostic, de nombreuses constatations ont pu être
faite sur le
GBPB 2002. De ce fait, l’élaboration d’une grille a
été identifiée comme un des
axes principaux d’évolution du nouveau guide GBPIB 2011.
C’est un outil automatisé sous format Excel basé sur
la grille d’autoévaluation du processus de surveillance de
l’Assurance de la
Qualité Instrumentale (AQI) dans un laboratoire de recherche [R18].
A. Utilisation de la grille. 22
Figure 6 : Cartographie du processus
"Utilisation de la grille autodiagnostic". D’après [R31]
retour
sommaire
Comme l’explicite
la
cartographie ci-dessus, la grille permet à un service
biomédical de se situer
par rapport au GBPIB 2011 et d’identifier des axes
d’amélioration. Elle va
donc, indirectement, permettre au service de garantir la qualité
et la sécurité
des soins au patient.
Etant conçu
pour être
compatible ISO 17050 [G14] cet outil peut servir comme mode
de
preuve d’auto déclaration de conformité.
Les données
issues de l’utilisation
de la grille d’autodiagnostic 2011 peuvent entrer dans un processus
d’amélioration continu qui permet d’agir sur les axes
d’améliorations à
entreprendre et de les réévaluer par le même
processus. Cette méthode s’inscrit
dans une démarche de progrès.
B. Structure de la grille. 22
Tout
comme
le
GBPIB
2011,
l'ensemble
est
décliné
selon
3
modules, 9 bonnes pratiques et 48 processus associés chacun
à des critères de réalisation (212 au total).
Contrairement à la grille 2002, chaque critère de
réalisation [G2]
(qui
correspond
aux
«
affirmations
»)
composant
un processus est affecté au même
coefficient de pondération.
L’évaluation de ces critères de réalisation se
fait suivant 6 niveaux de véracité:
- Vrai
prouvé : La réalisation de l'action est
systématique et peut être
prouvée
- Vrai :
L'action est systématiquement réalisée
- Plutôt
vrai : L'action est réalisée de
manière aléatoire
- Plutôt
faux : Rien ne permet d'identifier la réalisation de
l'action
- Faux :
Une
personne
au
moins
considère
que
l'action
est
en
partie
réalisée
- Faux
unanime : A l'unanimité, on peut dire que l'action
n'est pas réalisée
Cette
échelle est
volontairement asymétrique : lorsqu’il y a un point milieu,
les indécis
auront tendance à s’y placer naturellement.
La
grille
[R32] est
composée de 9 onglets différents.
1. Onglet « Contexte ». 23
- Les objectifs de l’évaluation
- Le
mode
d’emploi.
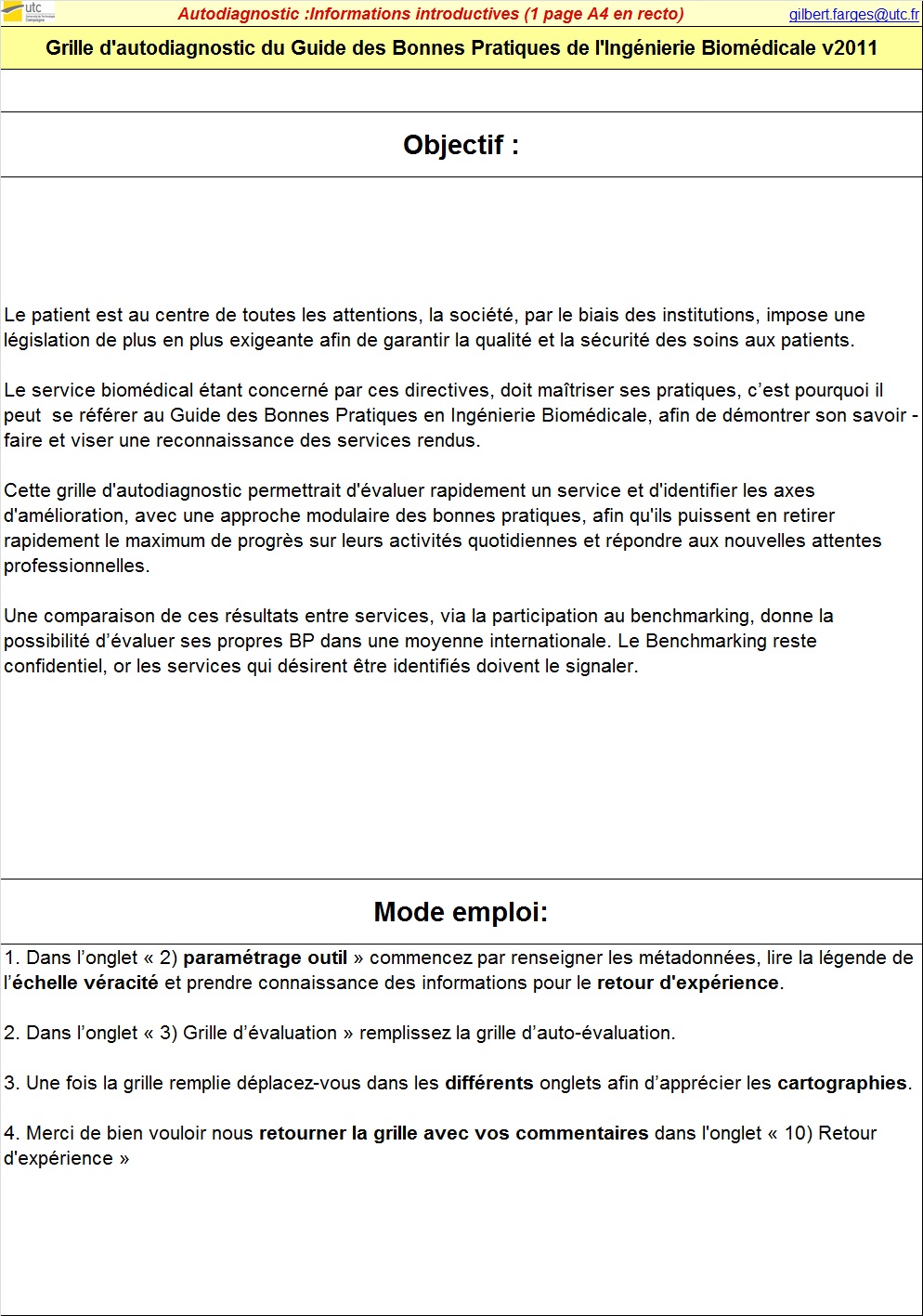
Figure 7 : onglet
« Contexte » de la
grille d’autodiagnostic 2011. Source [R32]
- Métadonnées
des
utilisateurs
- Informations
pour
les
retours
d’expérience à
lire avant de commencer la grille.
- Explication de
l’échelle d’évaluation
Figure 8 : onglet
« Outil » de la grille
d’autodiagnostic 2011. Source [R32]
3. Grille d'évaluation. 23
- La grille
d’évaluation avec 212 critères de
réalisation a évalué.
- Colonne de modes de preuve
- Colonne
d’observation pour proposer des
axes d’amélioration
Figure 9 : onglet « Grille
d’évalution »
de la grille d’autodiagnostic 2011. Source [R32]
4. Résultats. 24
- Moyenne des 9 bonnes
pratiques
- Résultats
pour
chacune
des
9 bonnes pratiques
Figure 10 : onglet
« Résultats » de la
grille d’autodiagnostic 2011. Source [R32]
5. Cartographie des 9 Bonnes Pratiques. 24
- Cartographie des
résultats avec écarts type pour
les 9 bonnes pratiques
- Plan
d’action
envisagé
Figure 11 : onglet
« Cartographie des 9
BP » de la grille d’autodiagnostic
2011. Source [R32]
6. Cartographie BPM... 24
- Cartographie des
résultats avec écarts type pour
les processus des BP Management
- Plan d’action
envisagé
Figure 12 : onglet
« Cartographie BPM »
de la grille d’autodiagnostic
2011. Source [R32]
7. Cartographie BPO.. 24
- Cartographie des résultats avec écarts
type pour les processus des BP d’Organisation
- Plan
d’action
envisagé
Figure 13 : onglet
« Cartographie BPO »
de la grille d’autodiagnostic
2011. Source [R32]
8. Cartographie BPR. 25
- Cartographie des résultats avec écarts type pour
les processus des BP Réalisation
- Plan
d’action
envisagé
Figure 14 : onglet
« Cartographie BPR »
de la grille d’autodiagnostic
2011. Source [R32]
9. Retour d'expérience
- Retour
d'expérience
pour
de
futures études.
- Retour en cas de
problème sur l’utilisation de
la grille pour futures mise à jour
Figure 15 : onglet « Retour
d’expérience » de la grille d’autodiagnostic
2011.
Source
[R32]
. 25
C. Echelle de
maturité
Les bonnes pratiques proposées dans le GBPIB 2011 peuvent
être évaluées selon l’échelle de maturité
proposée dans le référentiel de qualité
international ISO 9004.
L’échelle de maturité présente l’avantage
d’être plus nuancée que l’échelle de
véracité. Etant plus affinée, elle va donc mieux
expliciter les états constatés des processus.
Les niveaux d’appréciation de la maturité d’un processus
peuvent être les suivants :
1)Absent
: aucune activité n’est réalisée pour ce processus.
2)Aléatoire : les
activités sont réalisées implicitement sans
être toujours mises en œuvre complètement et dans les
délais.
3)Défini : les
activités sont définies explicitement et mises en œuvre
dans les délais, sans être forcément tracées.
4)Maîtrisé : les
activités réalisées sont efficaces, tracées
dans leur cheminement et leurs résultats.
5)Optimisé : les
activités réalisées sont efficientes et induisent
des améliorations qui sont effectivement mises en œuvre.
6)Mature : les activités
réalisées ont une excellente qualité
perçue, elles anticipent les attentes et innovent dans les
services rendus.
Le GBPIB 2011 explique que pour attester sa conformité
vis-à-vis de la 17050, un service biomédical doit au
moins avoir la totalité de ses bonnes pratiques à un
niveau « Maîtrisé » (60%).
Comparaison des 2 échelles :
- L’échelle de véracité est sur 6 niveaux.
Remplir une grille basée sur cette échelle correspondrait
à effectuer une démarche de conformité pour l’auto
déclaration.
- L’échelle de maturité est également
composée de 6 niveaux mais plus nuancée. Remplir une
grille basée sur cette échelle correspondrait à
effectuer une démarche de progrès continu.
En effet, le niveau 6 de l’échelle de
véracité (Vrai Prouvé = 100%) ne peut que
correspondre au niveau 4 de l’échelle de maturité
(Maîtrisé = 60%)
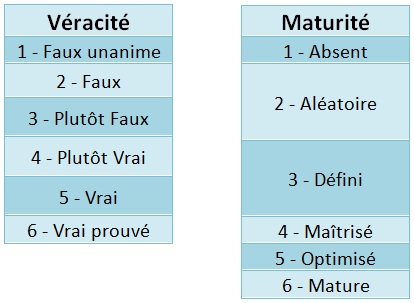
Tableau 7 : comparatif entre les deux
échelles. Source : [R31].
Exemple sur un critère de processus de management :
« Un document écrit explicite ses missions en
référence ou en complément des textes
réglementaires existants, ses relations avec les parties
prenantes à ses activités, les moyens et ressources dont
il dispose et son positionnement dans l’organigramme de
l’établissement. »
Le niveau 6 « Vrai prouvé » de l’échelle de
véracité correspond à dire « il existe un
document écrit, validé et on peut le prouver » ce
qui pourrait aussi correspondre au niveau 4 de l’échelle de
maturité « Maitrisé », cette activité
est réalisée avec efficacité. L’échelle de
maturité permet donc de faire évoluer cette pratique en
l’amenant vers l’efficience en induisant des améliorations et
vers la qualité perçue en anticipant les attentes et
innovant dans les services rendus, niveaux 5 et 6.
Pour accompagner la communauté biomédicale dans la
maîtrise de l’échelle de maturité, une
deuxième grille [R33]
a
été
conçue.
Contrairement
à
la
première,
l’évaluation porte
sur les processus et non plus sur les critères de
réalisation. En procédant de telle sorte, il n’a pas
été nécessaire de reformuler les critères,
assurant ainsi une compatibilité avec le GBPIB 2011).
Néanmoins, malgré le fait qu’il y ait moins
d’évaluation à porter (48 au lieu de 212), la
subtilité de cette nouvelle échelle fait que
l’auto-évaluation ne sera forcément plus rapide.
retour
sommaire
V. Conclusions et perspectives
Dans l’optique de l’amélioration continue, la grille
d’autodiagnostic 2011 est l’outil idéal pour démontrer
son savoir-faire. Imprimable, elle facilite l’auto déclaration
de conformité et est facilement présentable à la
direction de l’établissement afin d’obtenir de la
reconnaissance, la clef de la pérennité d’un service
biomédical.
Automatisée sous format Excel, elle est facilement modifiable :
les activités connexes du GBPIB, qui seront
rédigées au fur et à mesure pourront donc
être intégrées. De par les retours
d’expérience, la grille offre également la
possibilité à chaque acteur de la communauté de la
faire évoluer.
En devenant une plateforme multilingue « Full Web », la
grille permettrait à tous les inscrits de
bénéficier de l’échange des bonnes pratiques. Une
telle plateforme assurerait donc au GBPIB sa longévité en
devenant un outil de suivi et de pilotage. Elle intègrerait la
grille d’autodiagnostic combiné à un système de
mutualisation automatique offrant la possibilité de faire des
comparaisons par pays et/ou régulièrement. Avec un
système « push » de rappels automatiques
périodiques, la stimulation de la communauté
biomédicale serait garantie.
L’exploitation de la grille d’autodiagnostic et de ses
évolutions est un procédé incontournable si l’on
souhaite garantir la qualité et la sécurité des
soins délivrés aux patients.
A. Définitions
Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui
transforme des éléments d’entrées en
éléments de sortie. Définir les processus consiste
à expliciter l'enchaînement des actions afin de produire
le résultat attendu d’une bonne pratique.
- [G2] Critère de réalisation :
Les critères de réalisation permettent d’identifier les
tâches en détaillant les activités à remplir
ou les résultats majeurs à obtenir pour considérer
qu’une bonne pratique soit réalisée avec succès.
Les critères de réalisation peuvent donc servir d'items
à évaluer dans le cadre d'audits internes ou
d'autoévaluations des pratiques.
Niveau de réalisation des activités planifiées et
d’obtention des résultats escomptés. Les indicateurs
d’efficacité permettent de savoir si la bonne pratique donne les
"résultats attendus" et atteint les objectifs définis.
Ils sont donc en général directement associables
aux processus eux-mêmes déclinés en critères
de réalisation à mettre en œuvre.
Rapport entre le résultat obtenu et les ressources
utilisées. Etre efficace à moindre coût. Les
indicateurs d’efficience permettent d'évaluer "le rendement
interne" du service biomédical en identifiant
généralement le temps passé par les acteurs et les
ressources consommées pour obtenir les résultats
d'efficacité de la bonne pratique.
Aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques
à satisfaire des exigences (source ISO 9000[iso18]).
Appréciation d’un produit, d’un service ou d’une situation telle
que la voit et la décode une population ou un individu à
travers ses propres grilles, modalités ou critères de
perception, formels ou informels, explicites ou implicites.
Quelles que soient l'efficacité et
l'efficience d'un service rendu, la
reconnaissance intrinsèque d’une entité passe par les
regards et évaluations des bénéficiaires.
- [G7] Indicateurs de qualité perçue :
Ils sont cruciaux car associés à "l'image de
professionnalisme" que le service biomédical donne au niveau des
services de soins, de l'établissement et des tutelles. Pour
favoriser l'implication et l'esprit d'innovation, la qualité
perçue par les acteurs biomédicaux est également
évaluée en interne au sein du service biomédical,
pour chacune des bonnes pratiques
Activités coordonnées pour orienter et contrôler
une organisation
C'est une procédure destinée à faire valider, par
un organisme agréé indépendant, la
conformité du système qualité d'une organisation
aux normes ISO 9000 ou à un référentiel de
qualité officiellement reconnu.
Terme anglophone très usité. En français
référenciation ou étalonnage est une technique de
marketing ou de gestion de la qualité qui consiste à
étudier et analyser les techniques de gestion, les modes
d’organisation des autres entreprises ou entité afin de s’en
inspirer et de retirer le meilleur. C’est un processus continu de
recherche, d’analyse comparative, d’adaptation et d’implantation des
meilleures pratiques pour améliorer la performance des processus
dans une organisation (source Guide v2011).
- [G11] Parties prenantes :
Les services parties prenantes sont
ceux dont l'activité influe sur
la qualité des résultats finaux. Ils
peuvent être de soins, médico-techniques ou utilisateurs
des technologies, administratifs,
de support (informatique,
mécanique, électrique,
électronique, climatisation,
plomberie, gaz médicaux,
transport...), ou encore provenir des
partenaires ou fournisseurs
Une bonne pratique peut être considérée comme
mature si elle est réalisée de manière efficace et
efficiente et parvient aux performances durables en comprenant et
satisfaisant aux besoins et aux attentes des parties
intéressées
(Source : ISO 9004[2009-12-01], Gestion des performances durables d’un
organisme-approche de management par la qualité)
B. Règlementations et
Normes
[G13] Critère 8k [R19] : Gestion des
équipements
biomédicaux.
Ce
critère
se
situe
dans
le
manuel
du
référentiel
de
certification des établissements de santé
délivré par la Haute Autorité de Santé
(HAS) dans sa version 2010.
Ce
manuel,
est
établi
grâce
aux
travaux
de
groupes
thématiques
composés de professionnels de santé,
d’experts et de représentants d’usagers. Il est structuré
en 2 chapitres :
- Chapitre
I
:
Management
de
l’établissement
- Chapitre II : Prise en charge du patient
Il
vise
la
certification
des
établissements
de
santé,
il
porte
sur le fonctionnement global de l’établissement.
Il
poursuit
2
objectifs
:
- La
mise
place
d’un
système
de
pilotage
- L’atteinte d’un niveau de qualité sur des
critères thématiques jugés essentiels.
Il
contribue
à
la
régulation
des
établissements
de
santé
par
la qualité.
- Situation
du
critère
8K
dans
l’organisation
du
manuel
HAS
:
Cette
activité
est
définie
dans
:
- Chapitre
I
:
«
Management
de
l’établissement
»
- Partie 3 : « Management de la qualité et de la
sécurité des soins ».
- Référence 8 : « Le programme global et
coordonné de management de la qualité et des risques
» et à travers le critère 8K « Gestion des
équipements biomédicaux ».
Ce
critère
décrit
les
étapes
obligatoires
pour
la
gestion
et
la maintenance d’un dispositif biomédical et
défini pour la première fois l’organisation d’un service
biomédical. Cette reconnaissance par les pairs fait suite
à une volonté de la profession de maîtriser et
d’améliorer ses pratiques.
Il
organise
les
éléments
d’appréciation
selon
les
étapes
d’une
démarche
d’amélioration :
prévoir, mettre en œuvre, évaluer et améliorer.
Dans
le
cadre
de
la
certification
par
la
H.A.S
v2010 des
établissements de santé, l’activité
biomédicale est reconnue, à travers le critère 8k,
comme contribuant à la qualité des soins et à la
sécurité des patients, ce qui leur donne aussi des
obligations. A partir de chaque processus E1, E2, E3, une grille
d’autodiagnostic a été élaborée afin
d’évaluer l’activité biomédicale France des
exigences du référentiel de certification H.A.S v2010.
[G14]
NF
EN 17050 : Evaluation de la conformité – Déclaration
de conformité du fournisseur
Cette
norme
européenne
NF
EN
ISO/CEI
17050
:
2004
homologuée
par l’AFNOR en 2005 a le statut d’une norme
française, elle reproduit intégralement la norme
internationale ISO/CEI 17050 : 2004 et remplace l’EN 45014 : 1998
La
norme
NF
EN
ISO/CEI
17050
:
2005
présentée
sous le
titre général « Evaluation de la conformité
– Déclaration de conformité du fournisseur »,
permet l’évaluation de la conformité et permet
également au fournisseur de s’auto déclarer conforme aux
exigences de documents normatifs. Cette norme comprend 2 parties :
- ISO/CEI
17050-1
:
Exigences
générales
Cette
première
partie
spécifie
les
exigences
générales
applicables
à
la
déclaration de
conformité du fournisseur dans les cas où il est
souhaitable, ou nécessaire, d’attester la conformité d’un
objet à des exigences spécifiées, quel que soit le
secteur concerné. Pour les besoins de cette partie de l’ISO/CEI
17050, l’objet d’une déclaration de conformité peut
être un produit, un processus, un système de
management, une personne ou un organisme.
- ISO/CEI
17050-2
:
Documentation
d’appui
Cette
deuxième
partie
spécifie
les
exigences
générales
relatives
à
la
documentation d’appui
permettant de justifier la déclaration de conformité du
fournisseur décrite dans la première partie.
Ce
terme
de
fournisseur
est
un
terme
générique
qui
intègre
toute entité qui souhaite se conformer à
un référentiel.
Le
document
d’appui
contenant
les
preuves
sur
lesquelles
le
service
biomédical peut se baser pour émettre son
auto-déclaration peut être la grille d’autodiagnostic.
Champ
d’amélioration
et
évolution
de
la
norme
:
Par
rapport
au
document
remplacé
(EN
45014
:
1998),
le champ de la
déclaration de conformité du fournisseur est
étendu puisque, outre les produits, processus et services, la
déclaration de conformité peut aussi porter sur les
systèmes de management, les personnes et les organismes. De
plus, le contenu de la documentation d’appui est précisé
ainsi que les exigences s’y rapportant (disponibilité,
durée de conservation, etc.).
[G15] ISO 9001 [R14] : Systèmes
de
management de la qualité -
Exigences
C’est
le
référentiel
qualité
international
le
plus
connu
et
le
plus exploité par les entreprises du secteur
marchand et de plus en plus
par les organisations du secteur
non-marchand. Il vise à démontrer
le respect des exigences de
management qualité pour garantir
la meilleure satisfaction des clients,
publics ou bénéficiaires
vis-à-vis d’activités ou d’engagements
spécifiés.
[G16]
ISO
9004 [R34] : Gestion
des performances durables d'un organisme -
Approche de management par la qualité
L'ISO
9004:2009
fournit
des
lignes
directrices
permettant
aux
organismes
de
réaliser des performances durables par une approche de
management par la qualité. Elle s'applique à tout
organisme, quels que soient sa taille, son type et son activité.
L'ISO
9004:2009
n'est
pas
destinée
à
être
utilisée
dans
un
cadre réglementaire, contractuel ou de certification.
[G17] EFQM [R35]: European Foundation for Quality
Management
L’European
Foundation
for
Quality
Management
propose
un
référentiel
qualité
ouvert
intégrant
toutes les composantes
humaines (clients, salariés,
actionnaires, communauté) et les impacts sociétaux d’une
activité, autant pour les entreprises que pour les
organisations non-marchandes. L’EFQM remet
périodiquement un prix d’excellence aux
organisations candidates dans plusieurs
secteurs professionnels, selon leurs
statuts et les niveaux de l’évaluation faite
par deux auditeurs sur neuf processus clés.
[G18] ISO 9000:2005 [R36]: Systèmes de management de
la
qualité - Principes essentiels et vocabulaire
L'ISO
9000:2005
décrit
les
principes
essentiels
des
systèmes
de
management
de la qualité, objet de la famille des normes ISO
9000, et en définit les termes associés.
Elle
est
applicable
:
a.
aux
organismes
cherchant
à
progresser
par
la
mise
en œuvre d'un
système de management de la qualité;
b.
aux
organismes
qui
cherchent
à
s'assurer
que
leurs
fournisseurs
satisferont leurs exigences relatives aux produits;
c.
aux
utilisateurs
des
produits;
d.
aux
personnes
concernées
par
une
compréhension
mutuelle
de
la
terminologie utilisée dans le domaine du management de la
qualité (par exemple fournisseurs, clients, autorités
réglementaires);
e.
aux
personnes
internes
ou
externes
à
l'organisme,
qui
évaluent
ou auditent le système de management de la
qualité en termes de conformité aux exigences de l'ISO
9001 (par exemple auditeurs, autorités réglementaires,
organismes de certification/enregistrement);
f.
aux
personnes
internes
ou
externes
à
l'organisme
qui
donnent des
conseils ou fournissent une formation sur le système de
management de la qualité qui lui convient;
g.
aux
personnes
qui
élaborent
des
normes
apparentées.
C. Sigles
[G19] AAMB : Association des Agents de Maintenance
Biomédicale
[G20] AFIB : Association Française des
Ingénieurs
Biomédicaux
[G21] AFITEB : Association Francophone
Inter-hospitalière des
Techniciens Biomédicaux
[G22] AFPTS : Association Francophone des
Professionnels des
Technologies de Santé
[G23] APIBQ : Association des Physiciens et
Ingénieurs
Biomédicaux
[G24] ATGBM : Association des Technologues en
Génie
Biomédical
[G25] ATD : Association des Techniciens de Dialyse
[G26] H360 : association nationale des cadres et
experts techniques
hospitaliers
VII. Bibliographie
Tous les liens
ci-dessous ont été consultés de 12 avril 2004.
Liens vers sites internet d’intérêt :
[R1] : Site internet officiel de l’Union
Européenne,
traité de Lisbonne :
[R2] : Site internet d’accès au droit de
l’Union
Européenne. Journal officiel de l’union européenne ;
troisième partie « Les politiques et actions internes de
l’union » ; Titre XIV : « Santé publique » ;
Article 168 ; page 122 (Remplace l’article 152 TCE) édité
le 30/03/2010.
[R3] : Site internet de la Haute Autorité de
Santé :
[R4] : Site internet de la Haute Autorité de
Santé,
présentation de la HAS :
[R5] : Portail du Ministère du travail, de
l’emploi et de la
santé, la loi « Hôpital, patients, santé et
territoires » :
[R6] : Site internet de l’Agence Nationale d’Appui
à la
Performance des établissements de santé et
médicaux-sociaux, les missions de l’ANAP :
[R7] : Histoire de l’ « American Medical
Association »,
site internet en anglais :
[R8] : Histoire du « Journal of the American
Medical Associations
», site internet en anglais :
Référentiels métiers ne concernant pas
l’ingénierie biomédicale :
[R9] : Arrêté du 14 mars 2000 relatif
aux bonnes pratiques
de laboratoire, JORF bulletin 2000-12 du 23 mars 2000, NOR :
MESP0020869A.
Site internet du Ministère du travail, de l’emploi et de la
santé, l’arrêté en question :
[R10] : Guide des Bonnes Pratiques de Pharmacie
Hospitalière,
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité (Direction des
hôpitaux, enquête publique). Arrêté du 22 juin
2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière,
JORF Bulletin 2001-27 du 3 juillet 2001, NOR : SANH0122497A.
Site internet de Legifrance, l’arrêté en question :
[R11] : Arrêté du 26 avril 2002
modifiant
l’arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne
exécution des analyses de biologie médicale (GBEA), JORF
n ° 104 du 4 mai 2002 p.8375, NOR : SANP0221588A
Site internet de Legifrance, l’arrêté en question :
[R12] : Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène
(GBPH) et
d’application des principes HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point) relatif aux obligations réglementaire (notamment les
règlements CE n°852/2001 et 183/2005).
Site internet du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du
territoire – définition, « pourquoi » et «
comment » des guides :
Guides publics de bonnes pratiques biomédicales :
[R13] : Guide des Bonnes Pratiques
Biomédicales en Etablissement
de Santé, Farges G. (UTC), Wahart G. (Pdte AFIB), Denax J.M.
(Pdt AAMB), Métayer H. (Pdt ATD) et 45 co-auteurs, ITBM-RBM
News, Ed Elsevier, novembre 2002, vol. 23, Suppl. 2, 23s-52s.
Site internet de l’UTC, page de M. Gilbert Farges, Guide des Bonnes
Pratiques Biomédicales :
[R14] : Guide des Bonnes Pratiques
Biomédicales
d’Ingénierie Hospitalière, Farges G. (UTC), Bendele C
(Pdt AAMB), Decouvelaere M. (Pdte AFIB), Romain G. (Pdt AFITEB), Kouam
P. (Pdt AFPTS), Zoabli G. (Pdt. APIBQ), Metayer H. (Pdt ATD) Lafont M.
(Pdte ATGBM), Martin. E (Pdt H360) et 85 co-auteurs, sous presse.
Publication d'article sur les bonnes pratiques biomédicales
[R15] : Naissance du "Guide des Bonnes Pratiques
Biomédicales en
Etablissement de Santé", G. Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News,
2003, Vol. 24, n° 1, pp 5-9.
Rapports public
[R16] : Etat de l'art des missions des services
biomédicaux,
réflexions sur des bonnes pratiques de l'ingénierie
biomédicale, G. MANIBAL - C. RONCALLI , Projet DESS "TBH", UTC,
00-01, pp 68.
[R17] : Contribution à une démarche de
validation en
bonnes pratiques biomédicales en établissement de
santé: la grille d'évaluation, A. Guyard, L. Tamames,
Projet DESS "TBH", UTC, 2003-2004.
[R18] : La maîtrise de la métrologie
dans un projet de
recherche, Morgane CITEAU, Sana BOUSBIAT
Projet d'Intégration "Démarche Qualité en
Recherche" (CP13), Ecole Doctorale, UTC, 2010.
Manuel de certification impliquant l'ingénierie
biomédicale
[R19] : Manuel v2010 de certification des
établissements de
santé - version juin 2009, Haute Autorité en Santé
Version complète :
Résultats du benchmarking entre différents Services
Biomédicaux
Tous les liens de cette section se trouvent dans la page de Gilbert
Farges du site internet de l’UTC :
[R20] : Moyenne des cartographies de 8
établissements faite le
05/05/2004 :
[R21] : Moyenne des cartographies de 20
établissements faite le
01/06/2004 :
[R22] : Moyenne des cartographies de 22
établissements faite le
01/09/2004 :
[R23] : Moyenne ± écarts types des
cartographies de 22
établissements faits le 01/09/2004
[R24] : Diagnostic et Amélioration des
Pratiques
Biomédicales à l’Assistance Publique – Hôpitaux de
Paris - Mohammad Ammar, Stage professionnel, MASTER
spécialité Management de la Qualité (MQ), UTC,
2005-2006.
[R25] : En juin 2006, comparaison entre la moyenne
des cartographies de
23 établissements de l’APHP avec la moyenne de 19
établissements non certifiés et celle de 3 services
biomédicaux certifiés :
[R26] : Comparaison entre la moyenne des
cartographies de 6 services
biomédicaux certifiés avec la moyenne des cartographies
de 35 services non certifiés. Faite en 2007 :
[R27] : Comparaisons entre la moyenne des
cartographies de 7 services
faite en 2004 avec la moyenne faite en 2007 :
[R28] : Moyenne des cartographies de 41
établissements faite en
2007 :
[R29] : Grille autodiagnostic version 2004 :
[R30] : Bilan 2004, benchmarking et perspective.
Présentation de
M. Gilbert Farges lors de la 9ème journée de l’AFIB
(Angers - 27 au 29 septembre 2004).
[R31] : Elaboration d’une grille d’autodiagnostic
pour le Guide des
Bonnes Pratiques de l’Ingénierie Biomédicale version
2011, Ceram Christophe, Da Costa David, Lamuré Christophe,
Rouhban Antony, Projet d'intégration, Certification
Professionnelle ABIH, UTC, 2011, Site internet:
[R32] : Grille d’autodiagnostic du Guide des Bonnes
Pratiques de
l’Ingénierie Biomédicale, évaluation avec
échelle de véracité sur les critères de
réalisation, Ceram Christophe, Da Costa David, Lamuré
Christophe, Rouhban Antony , Projet d'intégration, Certification
Professionnelle ABIH, UTC, 2011, Site internet :
[R33] : Grille d’autodiagnostic du Guide des Bonnes
Pratiques de
l’Ingénierie Biomédicale, évaluation avec
échelle de maturité sur les critères de
réalisation, Ceram Christophe, Da Costa David, Lamuré
Christophe, Rouhban Antony , Projet d'intégration, Certification
Professionnelle ABIH, UTC, 2011, Site internet :
Références utilisés pour la définition des
normes
[R34] : Site internet officiel de l’Organisation
Internationale de
Normalisation, ISO 9004:2009 :
[R35] : Site internet officiel de la Fondation
Européenne pour
la gestion de la qualité :
[R36] : Site internet officiel de l’Organisation
Internationale de
Normalisation, ISO 9000:2005 :
retour
sommaire
. 28
VIII. Annexes
[A1] :
Comparaison
des
autodiagnostics
fait
par
différents
établissements en
2004,
2007 et 2008
- Juillet
2008 :
607
acteurs
biomédicaux
contactés
- Septembre 2008 : 40 réponses soit 6.5%
- CHU :
3
- CH :
33
- Clinique,
Institut :
2
- Luxembourg :
1
- Allemagne :
1
retour
sommaire
[
A2] : Comparaison de
la moyenne des
autodiagnostics de 37 services non certifiés ISO 9001 et celle
de 3 service certifiés.
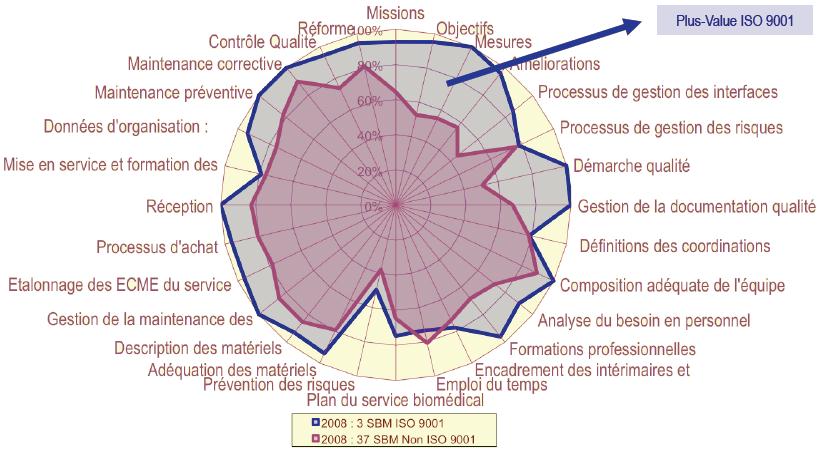
retour
sommaire